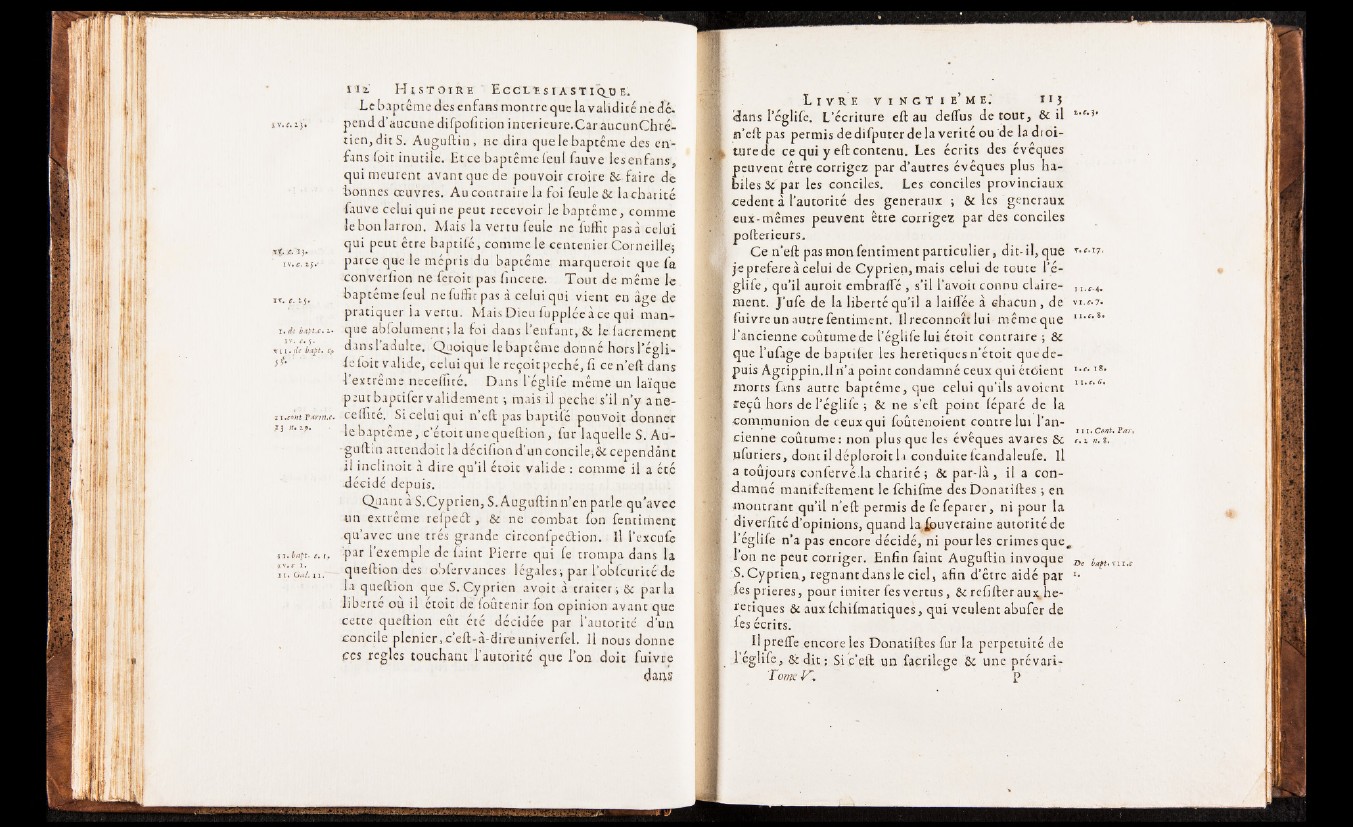
Jtv. C. 1 J*
i . de bapt.c. 2
iv . c. j .
v u » île bajit. <
É$ ‘ ‘
x i,c o n t .T a rm ,c »
¿3 ”*>9>
•i l . bapt- c . i»
r s a ' H i s t o i r e E c c l ï s i a s t i c l ü e .
Le baptême des enfaas montre que la validité ne de.
pend d’aucune difpofition interieure-CaraucunChré-
tien, dit S. Auguf t in, ne dira que le baptême des en-
fans foit inutile. Et ce baptême leul fauve lesenfans,
qui meurent avant que de pouvoir croire & faire dé
bonnes oeuvres. Au contraire la foi feule Sc la charité
fauve celui qui ne peut recevoir le baptême, comme
le bon larron. Mais la vertu feule ne fuffit pas à celui
qui peut être baptifé, comme le centenier Corneille*
parce que le mépris du baptême marqueroit que fa
converfion ne feroit pas fincete. Tou t de même le
baptême ieul ne fuffit pas à celui qui vient en âge de
pratiquer la vertu. MaisDieu fuppléeàce qui manque
abfolument ; la foi dans l’enfant, 8c le lacrement
dans l’adulte. Quoique lebaptême donné hors Tcgli-
fefoit valide, celui qui le reçoitpeché, fi c e n ’eft dans
l ’extrême neceffité. Dans l’églife même un laïque
peut baptifer validement ; mais il peche s’il n’y a neceffité.
Si celui qui n’eft pas baptifé pouvoit donner
lebaptême , c’étoit une queftion, fur laquelle S. Au-
•guftm attendoit la décifion d’un concile;8c cependant
il inclinoit à dire qu’il étoit valide : comme il a été
décidé depuis.
Quant àS.Cyprien, S. Auguftin n’en parle qu’avec
un extrême refpeéf , & ne combat fon fentiment
qu’avec une très grande circonfpe&ion. Il l'excuiè
par l’exemple de faint Pierre qui fe trompa dans la
queftion des obfervances légales; par l’obfcurité de
la queftion que S. C y prien avoit à traiter ; 8c par la
liberté ou il etoit de foûtenir ion opinion avant que
cette queftion eût été décidée par l’autorité d'un
concile plenier .c’eft-à-direuniverfel. Il nous donne
ces réglés touchant l ’autorité que l ’on doit fuivre
dans
si
L i v r e v i n g t i è m e .' i i j
dans l’églife. L’écriture eft au deifus de tout , & il
n ’eft pas permis dedifputer de la vérité ou de la di oi-
turede ce qui y eft contenu. Les écrits des évêques
peuvent être corrigez par d’autres évêques plus habiles
3c par les conciles. Les conciles provinciaux
cedent à l’autorité des généraux ; 8c les généraux
eux-mêmes peuvent être corrigez par des conciles
pofterieurs.
Ce n’eft pas mon fentiment particulier, dit-il, que
je préféré à celui de Cyprien, mais celui de toute l’ég
li fe, qu’il auroit embrafle , s’il l’avoit connu clairement.
J’ufe de la liberté qu’il a laiifée à chacun, de
fuivre un autre fentiment. Il reconnoît lui même que
l ’ancienne coutume de l’églife lui étoit contraire ; &
que l’ufage de bapciier les heretiques n’étoit que depuis
Agrippin.il n’a point condamné ceux qui étdient
morts fans autre baptême, que celui qu’ils avoient
reçu hors de l’églife ; 8c ne s’eft point iéparé de la
communion de ceux qui foûtenoient contre lui l’ancienne
coûtume: non plus que les évêques avares 6c
ufuriers, dont il déploroit la conduite fcandaleufe. il
a toujours confervé.la charité ; 8c par-là, il a condamné
manifeftement le fchifme desDonatiftes ; en
montrant qu’il n’eft permis de fefeparer, ni pour la
diverfité d’opinions, quand la^ipuveraine autorité de
l ’églife n’a pas encore décidé, ni pour les crimes que,
l ’on ne peut corriger. Enfin faint Auguft in invoque
S.Cyprien., regnantdansle ciel, afin d’être aidé par
fes prières, pour imiter fesvertus, Se ref i f te rauthent
iques 8c auxfchifmatiques, qui veulent abufer de
fes écrits.
Il preiTe encore les Donatiftes fur la perpétuité de
l ’églife, 8c dit ; Si ç ’eft un façrilege 8c une prévari-
To,m V , P
v. e . 17.
11.^.4.
v i . c« 7«
11 ,c» S*
ï . c. 1 s.
1 1 . c , 6 »
n i . Cont, Par,
e. 1 n. 8.
De baj>t> v i r . r
1,
I