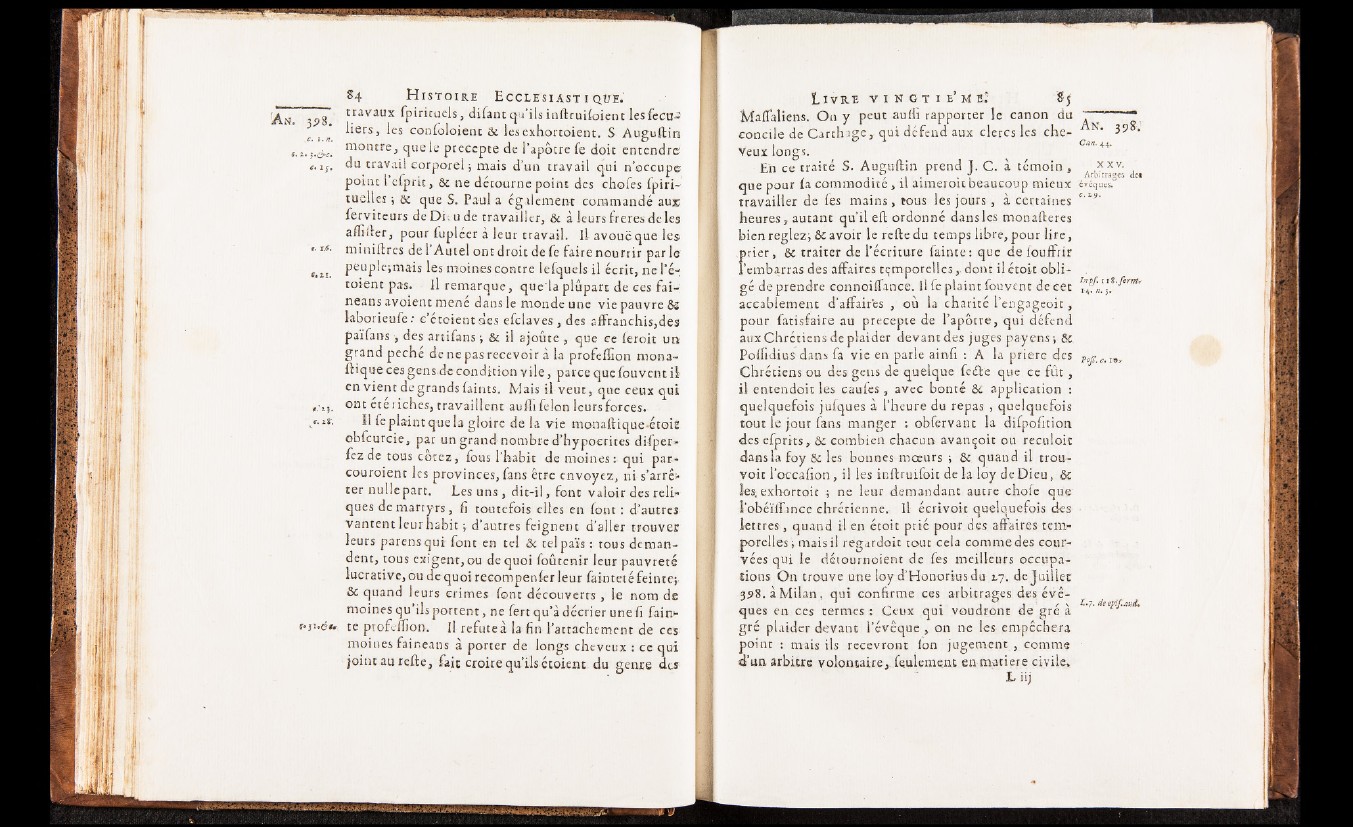
A n. travaux fpiricuels, difant qu’ils inftruiioient lesfecu^
c i n ^ers> ^es c°nioloienc 8c les exhortoient. S Auguft in
mont fe s que le preeepte de l'apôtre fe doit entendre
«. is. du travail corporel ; mais d'un travail qui n’occupe
point l e fp rk , 8c ne détourne point des choies fpiri-
tuelles -, ôc que S. Paul a également commandé aux
ferviteurs de D i .u de travailler, & à leurs freres de les
affilier, pour fupléer à leur travail. Il avoué que le»
». rs. miniftres de l’Autel ont droit de fe faire nourrir parle
». n. peuple;mais les moines contre Iefquels il écrit, ne l’é-r
toient pas. il remarque, que’la plupart de ces fai-
neans avoient mené dans le monde une vie pauvre ôs
taborieufe: e’étoientàes efclaves, des affranchis,des
p aï fans , des artifans ; ôc il ajoute , que ce feroit un
grand péché de ne pas recevoir à la profeffion mona-
ftique ces gens de condition v i l e , parce que fouvent i l
en vient de grands faims. Mais il v e u t , que ceux qui
».-ij. ont ete riches, travaillent auili félon leurs forces.
,».»«•. Il fe plaint que la gloire de la vie monaftique-étoii!
obfcureie, par un grand nombre d’hypocrites difper-
fezde tous co te z , fous l’habit de moines: qui par-
couraient les provinces, fans être envoyez, ni s'airê**
ter nulle part. Les uns , d i t - i l , font valoir des reliques
de mar tyrs, fi toutefois elles en font : d’autres
vantent leur habit ; d’autres feignent d’aller trouver
leurs parensqui font en tel 8c tel pais : tous demandent,
tous exigent, ou de quoi foûtenir leur pauvreté
lucrative, ou de quoi recompenier leur fainteté feinte^
5c quand leurs crimes font découver ts, le nom de
moines qu ils portent , ne fert qu’à décrier une fi fain*-
te profeffion. Il réfuté à la fin l’attachement de ces
moines faineans à porter de longs cheveux : ce qui
joint au refte, fait croire qu’ils étoient du genre des
L i v r e v i n g t i e ’ m e ? S j
Maffaliens. On y peut auifi rapporter le canon du
concile de Ca r tha ge , qui défend aux clercs les cheveux
longs.
En ce traité S. Auguftin prend J. C. à témoin ,
que pour la commodité , il aimeroit beaucoup mieux
travailler de fes mains, tous les jours, à certaines
heures, autant qu’il eft ordonné dans les monafteres
bienreglez; 5cavoir le refte du temps libre,pour lire,
prier, 5c traiter de l’écriture fainte: que de fouffrir
l’embarras des affaires temporelles,. dont il étoit obligé
de prendre eonnoiffance. il fe plaint fouvent de cet
accablement d’affair'es , où la charité l’enga geoi t ,
pour fatisfaire au preeepte de l’apôtre, qui défend
aux Chrétiens de plaider devant des juges payens; ÔC
Poffidius dans fa vie en parle ainfi : A la priere des
Chrétiens ou des gens de quelque feéte que ce fût ,
il entendoit les caufes, avec bonté Ôc application :
quelquefois jufques à l’heure du repas , quelquefois
tout le jour fans manger : obfervant la difpofition.
des efprits* ôc combien chacun avançoit ou reculoit
dans la foy 8c les bonnes moeurs ; Ôc. quand il trou-
v o i t l’occafion, il les inftruifoit delà loy de Dieu, ôc
les- exhortoic ; ne leur demandant * ' autre ch- oie qJue'
l ’obéiffance chrétienne, il écrivoit quelquefois des
lettres , quand il en étoic prié pour des affaires temporelles;
mais il regardait tout cela comme des eour-
vées qui le détournoient de fes meilleurs occupations
On trouve une loy d’Honorius du 2.7. de Juillet
3^8. à Milan , qui confirme ces arbitrages des é v ê ques
en ces termes : Ceux qui voudront de gré à
gré plaider devant l’évêque , on ne les empêchera
point : mais ils recevront ion jugement , comme
d ’un arbitre volontaire,.feulement en matière civile»
L iij
A n . 398.
Can. 44,
XXV.
Arbitrages de*
évêques.
c. 19.
In p f n S .fe rm *
14. n. 3.
PoJ?. a, I O y
Z.7. de epif.aud*