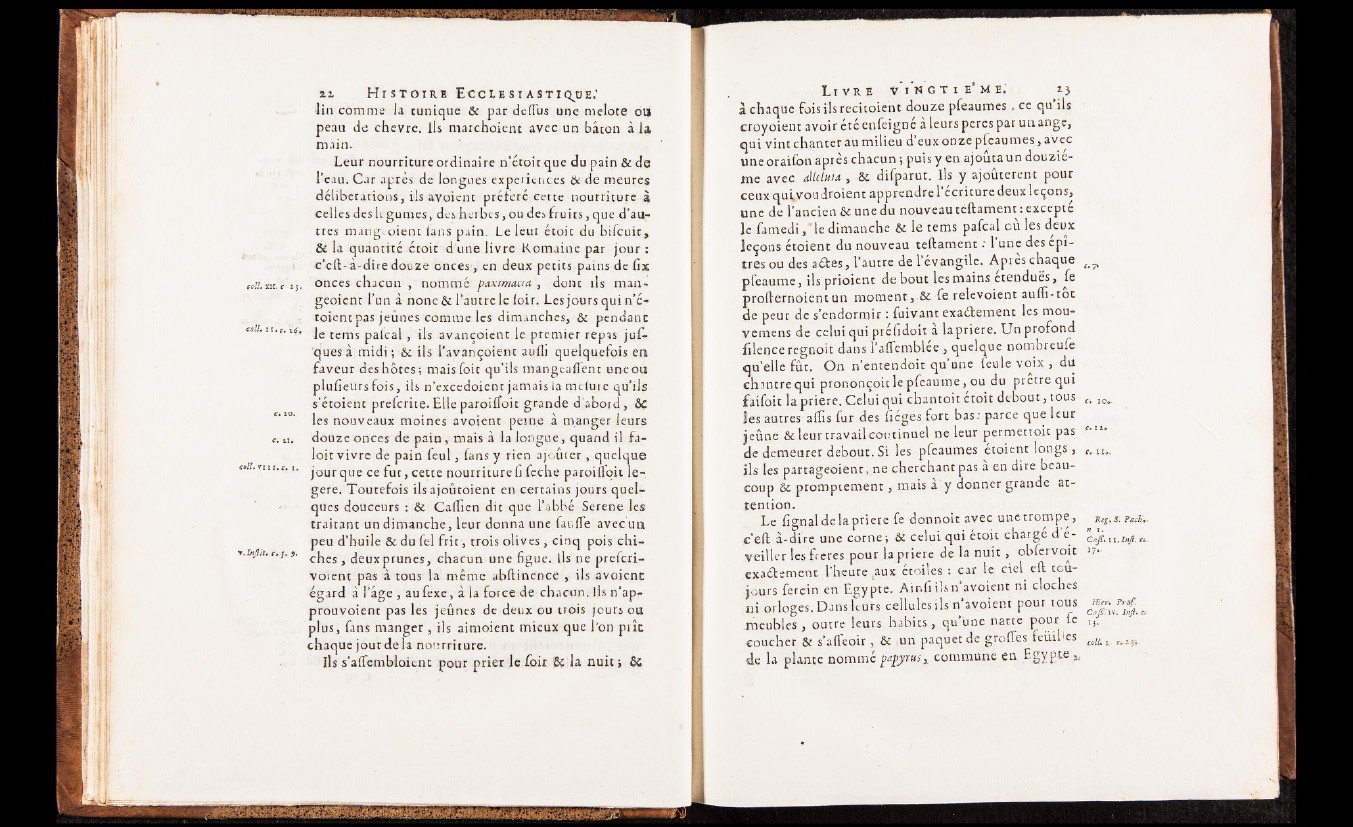
i l H t s t o i r b E c c l e s i a s t i q u e :
l in comme la tunique & par defius une melote ou
peau de chevre. ils marchoient avec un bâton à la
main.
Leur nourritureordinaire n’étoitque du pain & de
l’eau. Car après de longues expériences 6c de meures
délibérations, ils avoient préféré cette nourriture à
celles des lt gumes, des herbes, ou des fruits, que d’autres
mangcoient ians pain. Le leut étoit du bifcuit ,
& la quantité écoic d'une livre Romaine par jour :
c ’eft-à-dire douze onc'es:y en deux petits pains de fix
coll.xii.c i}, onces chacun , nommé paximaaa , dont ils man-
geoient l’un à none 6c l’autre le loir. Les jours qui n’é-
toientpas jeûnes comme les dimanches, 6c pendant
dit. u.c. i<;. je tems pa{cal | ils avançoienc le premier repas juf-
quesà midi ; & ils l’avançoient auili quelquefois en
faveur des hôtes; mais foie qu’ils tnangeaflent une ou
plufieursfois, ils n’excedoient jamais la meiure qu’ils
s’étoient preferite. Elle paroiffoit grande d'abord, &c
e . i o . , 1 . f . y v .
les nouveaux moines avoient peine a manger leurs
c. ii. douze onces de pain, mais à la longue, quand il fa-
loit viv re de pain fe u l , fans y rien ajoûter , quelque
iM .iiu .c . t. j OUrq ue ce fo r , cette nourriture fi feche paroi doit le-
gere. Toutefois ils ajoutoient en certains jours quelques
douceurs : 6c Caffien dit que l’abbé Serene les
traitant un dimanche, leur donna une faufile avec un
peu d’huile & du fel frit , trois o l iv e s , cinq pois chi-
r.injiit. c jjcs ^ deux prunes, chacun une figue, ils ne preferi-
voient pas à tous la même abftinence , ils avoient
égard à l’âge , aufexe, à la force de chacun. Ils n’ap-
prouvoient pas les jeûnes de deux ou trois jours ou
plus, fans manger , ils aimoient mieux que l ’on prîc
chaque jour de la nourriture.
ils s’aflembloienc pour prier le foir & la nuit ; &
à chaque fois ils recitoient douze pfeaumes , ce qu’ils
croyoient avoir été enfeigne à leurs peres par un ange,
qui vint chanter au milieu d eux onze pfeaumes, avec
uneoraifon après chacun ; puis y en ajouta un douzième
avec <t\leluiA , 6c difparut. Ils y ajoutèrent pour
ceux quivoudroient apprendre l’écriture deux leçons,
une de l’ancien 6c une du nouveau teftament : excepte
le famedi, ’ le d imanche 6c le tems pafcal où les deux
leçons étoient du nouveau tef tament : 1 une des cpi-
tres ou des aétes, l’autre de l évangile. Apres chaque
pfeaume, ils prioient de bout les mains etendues, fe
profternoientun moment , & fe relevoient auffi-tot
de peur de s’endormir : fuivant exactement les mou-
vemens de celui qui préfidoit à lapriere. Un profond
illence regnoit dans l’affemblée , quelque nombreufe
qu’elle fût. On n’encendoit qu’une ( e u le v o ix , du
chantre qui prononçoit le p feaume, ou du pretrequi
faifoit la priere. Celui qui chantoit etoit debout , tous
les autres affis fur des fiéges fore bas: parce que leur
jeûne & leur travail continuel ne leur permettoit pas
de demeurer debout. Si les pfeaumes etoient longs ,
ils les partageoient, ne cherchant pas a en dire beaucoup
6c p romptement , mais â y donner grande attention.
Le fignal de la priere fe donnoit avec une trompe,
c ’eft à-dire une corne ; 6c celui qui étoit charge d e-
veiller lesfreres pour lapriere de la n u i t , obfervoit
exactement l'heure ¿aux étoiles : car le ciel eft toujours
ferein en Egypte. Ainf i i lsn avoient ni cloches
ni orloges. Dans leurs cellules ils n’avoient pour tous
.meubles, outre leurs h ab i ts , qu une natte piour fe
coucher & s’afteoir , 6c un paquet de groffes teüilies
de la plante nommé papyrus, commune en Egypte ,,
c* 7»
C» I Oo-
C. 11»
C, lia-
Rëg, S. Pncb\-
n i .
CajH» il.In/ l. a .
1 7 -
H ie r P r o f .
CaJ?.Tv. Inft. a
13.
Coll. L, Cv-l.fi -