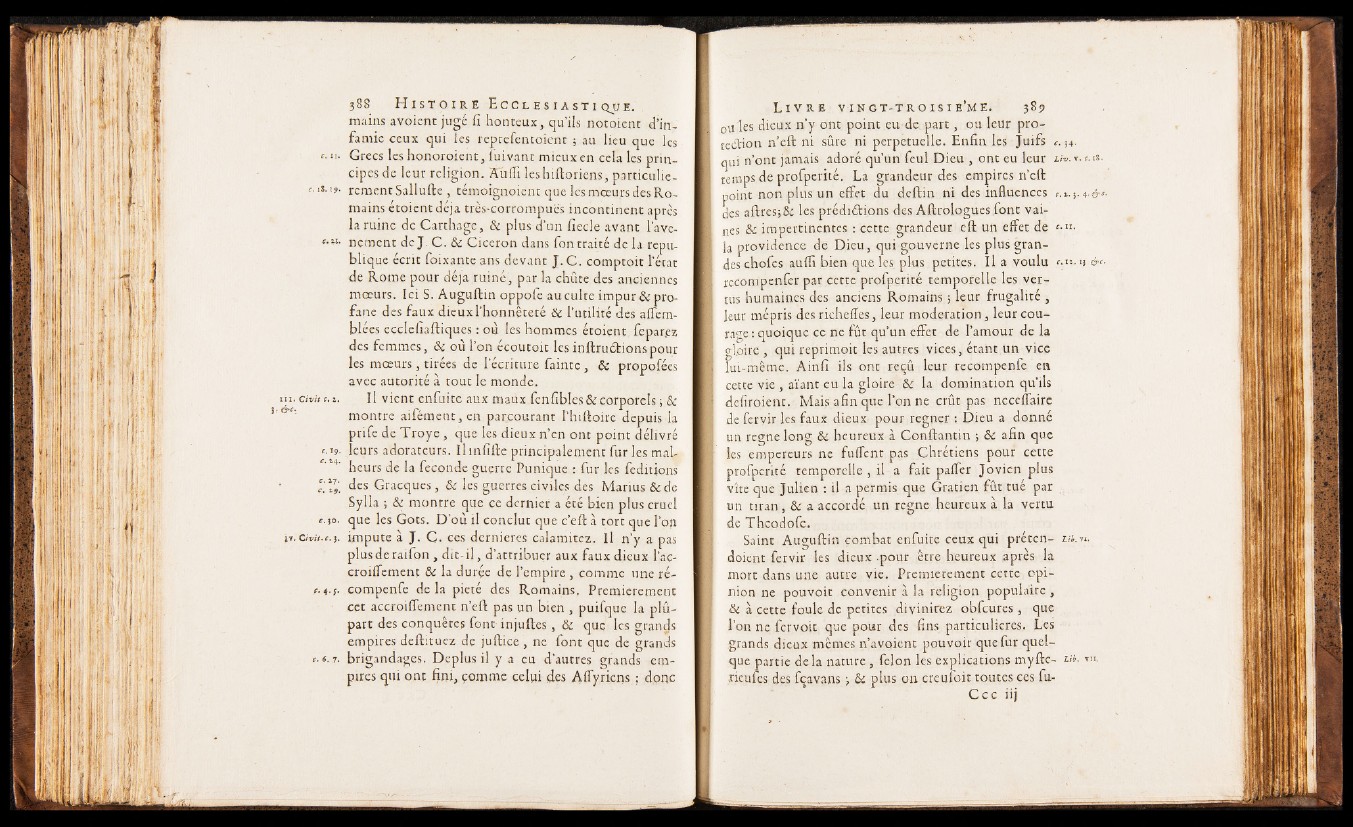
i? &Cr
388 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
mains avoient jugé fi honteux, qu’ils notoient d’infamie
ceux qui les rcprefentoient ; au lieu que les
c. n. Grecs les honoraient , iuivanc mieux en cela les principes
de leur religion. Audi leshiftoriens, particulier
s , i». rement Sallufte , témoignoient que les moeurs des Ro mains
étoient déjà très-corrompuës incontinent après
la ruine de Carthage, & plus d’un fiecle avant l ’avenu.
nement de J. C . 6c Ciceron dans fontraité de la republique
écrit foixante ans devant J. C . comptoir l’état
de Rome pour déjà ruiné, par la chûte des anciennes
moeurs. Ici S. Auguftin oppofe au culte impur & profane
des faux dieux l’honnêteté 5c l ’utilité des affem-
blées ecclefiaftiques : où les hommes étoient fepar,ez
des femmes, 6c où l’on écoutoit les inftruétionspour
les moeurs, tirées de l ’écriture fainte , & propofées
avec autorité à tout le monde.
civit c. t. Il vient enfuite aux mauxffenfibles & corporels 5 &
montre aifément, en parcourant l ’hiftoire depuis la
prife de Troy e , que les dieux n’en ont point délivré
p.i?- leurs adorateurs. Ilinfifte principalement fur les mal-
i ‘ i+' heurs de la fécondé guerre Punique : fur les feditions
à'^'. des Gracques, & les guerres civiles des Ma r iu s&de
Sylia ; & montre que ce dernier a été bien plus cruel
p .jo . que les Gots. D ’où il conclut que c’eft à tort que l ’on
civit.c.5. impute à J. C . ces dernieres calamitez. Il n’y a pas
plusderaifon , d i t - i l , d’attribuer aux faux dieux l’ac-
croiffement 6c la durée de l’empire , comme une ré-
p.4-r- compenfe de là pieté des Romains, Premièrement
cet accroiftement n’eft pas un bien , puifque la plupart
des conquêtes font injuftes, 6c que les grançjs
empires deftituez de juftice , ne font que de grands
c.6. 7. brigandages. Déplus il y a eu d’autres grands empires
qui ont fini, çomme celui des Affyriens ; donc
L i v r e v i n g t -t r o i s i e ’m e . 389
ou les dieux n’y ont point eu de p a r t , ou leur pro-
teélion n’ eft ni sûre ni perpétuelle. Enfin les Juifs c. 54.
qui n’ont jamais adoré qu’un feul Dieu , ont eu leur Uv.v.c.u.
temps de profperité. La grandeur des empires n’eft
p o i n t non plus un effet du deftin ni des influences c.
des aftres;&c les prédiébions des A Urologues font vaines
6c impertinentes : cette grandeur eft un effet de
la providence de Dieu, qui gouverne les plus grandes
chofes aufli bien que les plus petites. Il a voulu *.». u &t-
recompenfer par cette profperité temporelle les vertus
humaines des anciens Romains ; leur frugalité ,
leur mépris des richeiles, leur modération, leur courage
: quoique ce ne fût qu’un effet de l’amour de la
gloire , qui reprimoit les autres vices, étant un vice
lui-même. Ainfi ils ont reçû leur recompenfe en
cette vie , aïant eu la gloire 6c la domination qu’ils
defiroient. Mais afin que l’on ne crût pas neceffaire
de feryir les faux dieux pour regner : Dieu a donné
un regnelong 6c heureux à Conftantin -, 6c afin que
les empereurs ne fuffent pas Chrétiens pour cette
profperité temporelle , il a fait paffer Jovien plus
vite que Julien : il a permis que Gratien fût tué par
un tiran, 8c a. accordé un regne heureux à la vertu
de Theodofe.
Saint Auguftin combat enfuite ceux qui préten- in.n.
doient fervir les dieux .pour être heureux après la
mort dans une autre vie. Premièrement cette opinion
ne pouvoit convenir à la religion populaire ,
& à cette foule de petites divinit tz obfcures , que
l ’on ne fervoit que pour des fins particulières. Les
grands dieux mêmes n’avoient pouvoir que fur quelque
partie delà nature , félon les explications myfte- £>'*■ th.
lieufcs des fçavans ; 6c plus on creufoit toutes ces fu-
9 ' JL ' .
C c c iij