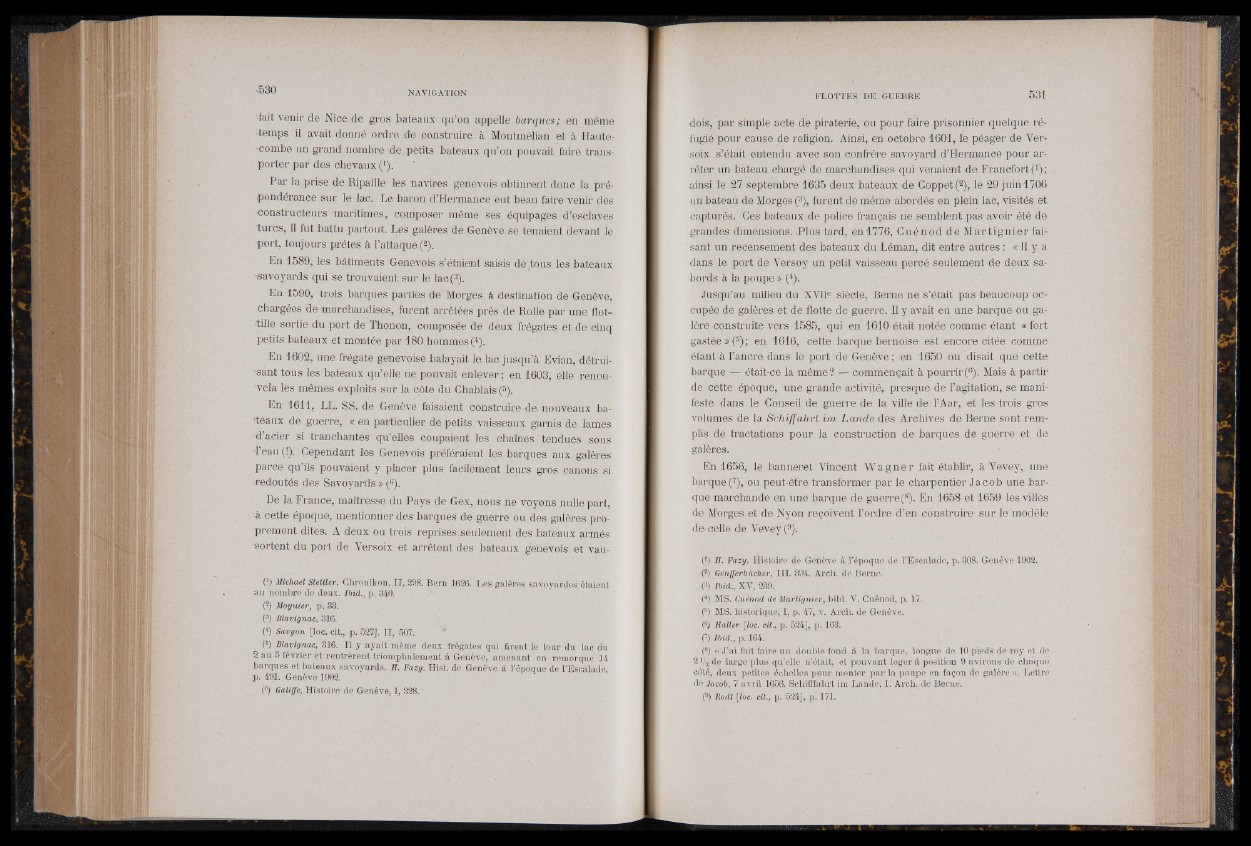
-fait venir de Nice de gros bateaux qu’on appelle barques; en même
■temps il avait donné ordre de construire à Montmélian et à Haute-
'combe un grand nombre de.pètits bateaux qu’on pouvait faire transporter
par des chevaux (*).
Par la prise de Ripaille les navires genevois obtinrent donc la prépondérance
sur le lac. Le baron d’Hermance eut beau faire venir des
constructeurs 'maritimes, composer même ses équipages d’esclaves
turcs, il fut battu partout. Les galères de Genève se tenaient devant le
port, toujours prêtes à l’attaque (2).
En 1589, les bâtiments Genevois s’étaient saisis de tous les bateaux
‘savoyards qui se trouvaient sur le lac(3).
En 1590, trois barques parties de Morges à destination de Genève,
chargées de marchandises, furent arrêtées près de Rolle par une flottille
sortie du port de Thonon, composée de deux frégates et de cinq
petits bateaux et montée par 180 hommes 0 .
En 1602, une frégate genevoise balayait le lac jusqu’à Evian, détruis
a n t tous les bateaux qu’elle ne pouvait enlever ; en 1603, elle renou-
’vela les mêmes exploits sur la côte du Chablais (5).
En 1611, LL. SS. de Genève faisaient construire de nouveaux bateaux
de guerre, « en particulier de petits vaisseaux garnis de lames
•d’acier si tranchantes qu’elles coupaient les chaînes tendues sous'
l’eau (!). Cependant les Genevois préféraient les barques aux galères
parce qu ils pouvaient y placer plus facilement leurs grés canons si
^redoutés des Savoyards » (6).
De la France, maîtresse du Pays de Gex, nous ne voyons nulle part,
à cette époque, mentionner des barques de guerre ou des galères proprement
dites. A deux ou trois reprisés, seulement des bateaux armés
■sortent du port de Versoix et arrêtent des bateaux genevois et vau-
I}) Michael Stettler. Chronikon, II, 298. Bern 1626. Les galères savoyardes étaient
au nombre de deux. Ibid., p. 340.
(?) Moynier, p. 33,'
■ (3) Blavignac, 316.
(4) Savyon Roc. cit., p. 527J. II, 507.
(6) Blavignac, 316. Il y ayait même deux frégates qui firent le tour du lac du
2 au 5 février et rentrèrent triomphalement à Genève, amenant en remorque 14
barques et bateaux savoyards. H. Fazy. Hist. de Genève, à l’époque de l’Escalade,
.p. 491. Genève 1902.
(6) Galiffe, Histoi-rç de Genève, I, 328.
dois, par simple acte de piraterie, ou pour faire prisonnier quelque réfugié
pour cause de religion. Ainsi, en octobre 1601, le péager de Versoix
s’était entendu avec son confrère savoyard d’Hermance pour arrêter
un bateau chargé de marchandises qui venaient de Francfort 0 ;
ainsi le 27 septembre 1635 deux bateaux de Goppet (2), le 29 juin 1706
un bateau de Morges (3), furent de même abordés en plein lac, visités et
capturés. Ces bateaux de police français ne semblent pas avoir été de
grandes dimensions. .Plus tard, enl776, C u é n o d d e M a r tig n ie r faisant
un recensement des bateaux du Léman, dit entre autres : « 11 y a
dans le port de Versoy un petit vaisseau percé seulement de deux sabords
à la poupe >> 0 .
Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, Berne ne s’était pas beaucoup occupée
de galères et de flotte de guerre. Il y avait eu une barque ou galère
construite vers 1585, qui en 1610 était notée comme étant « fort
gastée»(5); en 1616, cette barque bernoise est encore citée comme
étant à l’ancre dans le port de Genève ; en 1650 on disait que cette
barque M-‘était-ce la même? — commençait à pourrir(6). Mais à partir
de cette époque, une grande activité, presque de l’agitation, se manifeste
dans le Conseil de guerre de la ville de l’Aar, et les trois gros
volumes de la Schiffahrt im Lande des Archives de Berne sont remplis
de tractations pour la construction de barques de guerre et de
galères.
En 1656, le banneret Vincent W a g n e r fait établir, à Vevey, une
barque (7), ou peut-êfre transformer par le charpentier Ja c o b une barque
marchande en une barque de guerre (s). En 1658 et 1659 les villes
de Morges et de Nyon reçoivent l’ordre d’en construire sur le modèle
de« celle de Vevey (9).
j|¡ H. Fazy. Histoire de Genève à l’époque de l’Escalade, p. 308. Genève 1902.
(2) Genfferbücher, III. 394. Arch. de Berne,
(3) Ibid., XV, 239-.'
(4) MS. Cuénod de Martignier, bibl. V. Cuénod, p. 17.
(5) MS. historique, I, p. 47, v. Arch. de Genève.
(6^ Haller [loc. cit., p. 524], p. 163.
(7) Ibid., p. 164.
(8) « J ’ai fait faire un double fond à la barque, longue de 10 pieds de roy et de
2 Va de large plus qu’elle n’était, et pouvant loger à position 9 avirons de chaque
«ôté, deux petites échelles pour- monter par la. poupe en façon de galère ». Lettre
■de Jacob, 7 avril 1656. Schifffahrt im Lande^ I. Arch. de Berne.
(9) Rodt [loc. cit., p. 524], p^ 171.