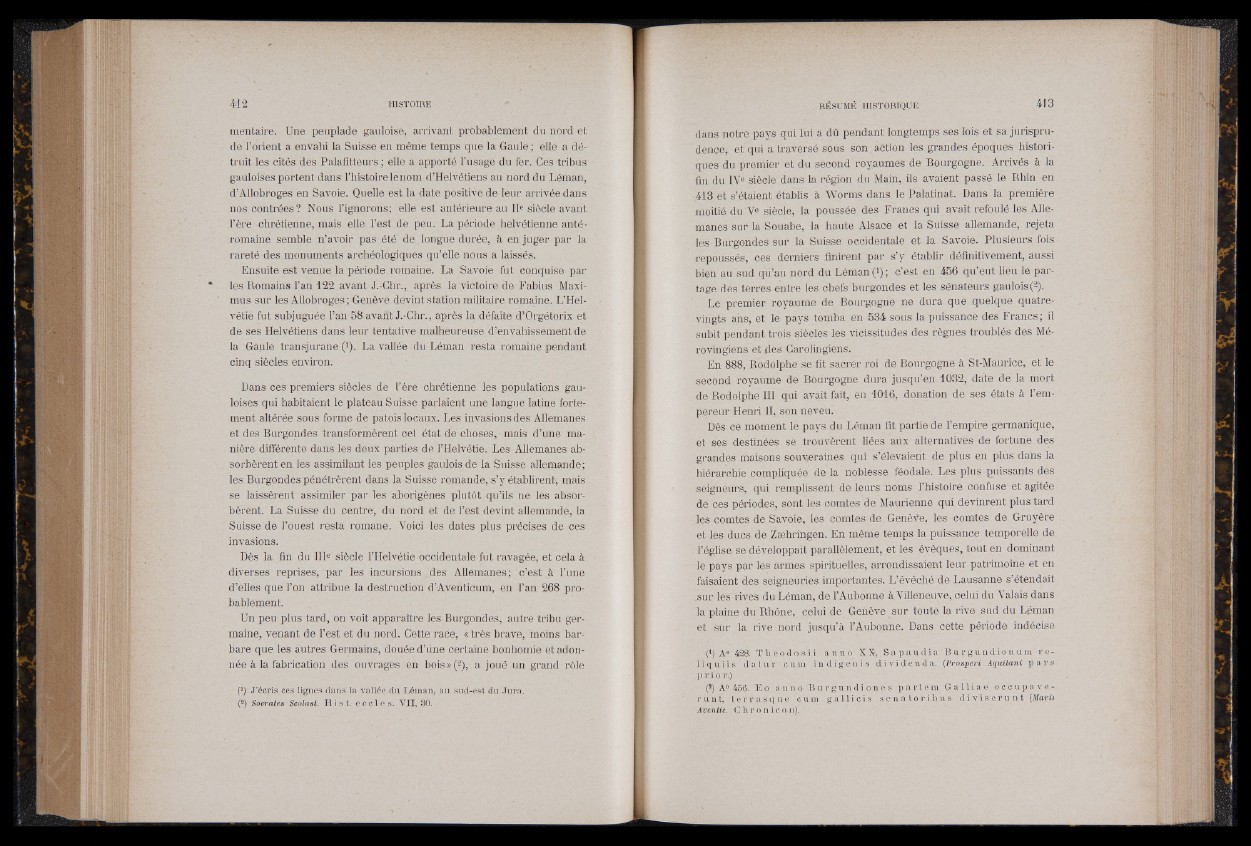
mentaire. Une peuplade gauloise, arrivant probablement du nord et
de l’orient a envahi la Suisse en môme temps que la Gaule ; elle a détruit
les cités des Palafitteurs ; elle a apporté l’usage du fer. Ces tribus
gauloises portent dans l’histoire le nom d’Helvétiens au nord du Léman,
d’Allobroges en Savoie. Quelle est la date positive de leur arrivée dans
nos contrées? Nous l’ignorons; elle est antérieure au IIe siècle avant
l’ère chrétienne, mais elle l’est de peu. La période helvétienne anté-
romaine semble n’avoir pas été de longue durée, à en juger par la
rareté des monuments archéologiques qu’elle nous a laissés.
Ensuite est venue la période romaine. La Savoie fut conquise par
les Romains l’an 122 avant J.-Chr., après la victoire de Fabius Maxi-
mus sur les Allobroges ; Genève devint station militaire romaine. L’Hel-
vétie fut subjuguée l’an 58 avant J.-Chr., après la défaite d’Orgétorix et
de ses Helvétiens dans leur tentative malheureuse d’envahissement de
la Gaule transjurane (*). La vallée du Léman resta romaine pendant
cinq siècles environ.
Dans ces premiers siècles de l’ère chrétienne les populations gauloises
qui habitaient le plateau Suisse parlaient une langue latine fortement
altérée sous forme de patois locaux. Les invasions des Allemanes
et des Burgondes transformèrent cet état de choses,- mais d’une manière
différente dans les deux parties de l’Helvétie. Les Allemanes absorbèrent
en les assimilant les peuples gaulois de la Suisse allemande;
les Burgondes pénétrèrent dans la Suisse romande, s’y établirent, mais
se laissèrent assimiler par les aborigènes plutôt qu’ils ne les absorbèrent.
La Suisse du centre, du nord et de l’est devint allemande, la
Suisse de l’ouest resta romane. Voici lés dates plus précises de ces
invasions.
Dès la fin du IIIe siècle l’Helvétie occidentale fut ravagée, et cela à
diverses reprises, par les incursions des Allemanes; c’est à l’une
d’elles que l’on attribue la destruction d’Aventicum, en l’an 268 probablement.
Un peu plus tard, on voit apparaître les Burgondes, autre tribu germaine,
venant de l’est et du nord. Cette race, «très brave, moins barbare
que les autres Germains, douée d’üne certaine bonhomie et adonnée
à la fabrication des ouvrages en bois » (2), a joué un grand rôle
f1) J'écris ces lignes dans la vallée du Léman, au sud-est du Jura.
(aj Soerales Seolast. Hi s t . e c c l e s . VII, 30.
dans notre pays qui lui a dû pendant longtemps ses lois et sa jurisprudence,
et qui a traversé sous son,action les grandes époques historiques
du premier et du second royaumes de Bourgogne. Arrivés à la
fin du IVe siècle dans la région du Main, ils avaient passé le Rhin en
413 et s’étaient établis à Worms dans, le Palatinat. Dans la première
moitié du Ve siècle, la poussée des Francs qui avait refoulé les Allemanes
sur la Souabe, la haute Alsace et la Suisse allemande, rejeta
lès Burgondes sur la Suisse occidentale et la Savoie. Plusieurs fois
repoussés, ces derniers finirent par s’y établir définitivement, aussi
bien au sud qu’au nord du Léman (*}; c’est en 456 qu’eut lieu le partage
des terres entre les chefs burgondes et les sénateurs gaulois (2).
Le premier royaume de Bourgogne ne dura que quelque quatre-
vingts ans, et le pays tomba en 534 sous la puissance des Francs; il
subit pendant trois siècles les vicissitudes des règnes troublés des Mérovingiens
et des Carolingiens.
En 888, Rodolphe se fit sacrer roi de Bourgogne à St-Maurice, et le
second royaume de Bourgogne dura jusqu’en 1032, date de la mort
de Rodolphe III qui avait fait, en 1016, donation de ses états à l’empereur
Henri II, son neveu.
Dès ce moment le pays du Léman fit partie de l’empire germanique,
et ses destinées se trouvèrent liées aux alternatives de fortune des
grandes maisons souveraines qui s’élevaient de plus en plus dans la
hiérarchie compliquée de la noblesse féodale. Les plus puissants des
seigneurs, qui remplissent de leurs noms l’histoire confuse -et agitée
de ces périodes, sont les comtes de Maurienne qui devinrent plus tard
les comtes de Savoie, les comtes de GenèVe, les comtes de Gruyère
et les ducs de Zæhringen. En même temps la puissance temporelle de
l’église se développait parallèlement, et les évêques, tout en dominant
le pays par les armes spirituelles, arrondissaient leur patrimoine et en
faisaient des seigneuries importantes. L’évèché de Lausanne s’étendait
.sur les rives du Léman, d e l’Aubonne à Villeneuve, celui du Valais dans
la plaine du Rhône, celui de Genève sur toute la rive sud du Léman
et sur la rive nord jusqu’à l’Aubonne. Dans cette période indécise
(l) A° 428. T h é o d o s i i a n n o XX, S a p a u d i a B u r g u n d i o t i um r e-
l i q u i i s d a t u r cum i n d i g e n i s d i v i d e n d a . (Prosperi Aquilani p a r s
p r i o r.)
(*) A° 456. E o a n n o B u r g u n d i o n e ' s p a r t e m Ga l l i a e o c c u p a v e -
runt , t e r r a s q u e cum g a l l i c i s s e n a t o r i b u s d i v i s e r u . n l (Marti
Aventic. Chr oni c on) .