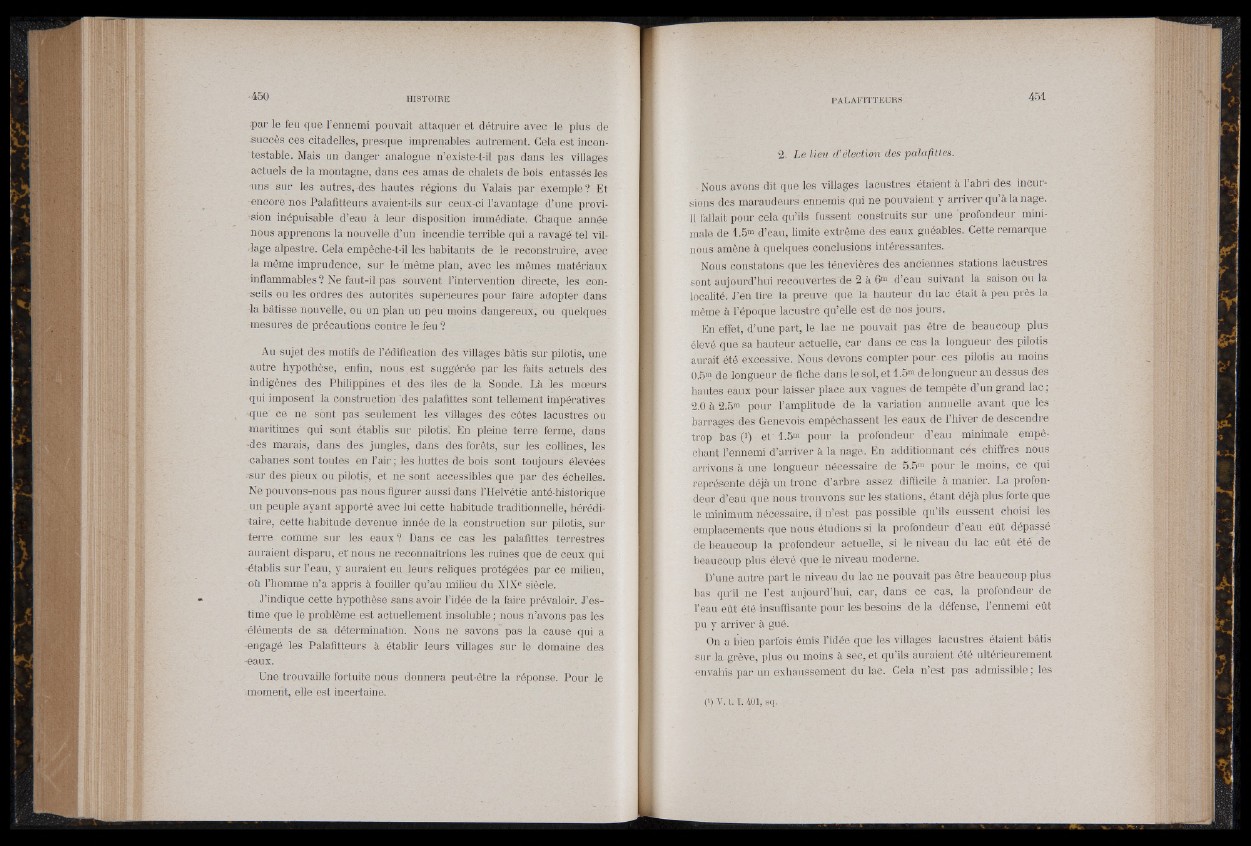
p a r le feu que l'ennemi pouvait attaquer et détruire avec le plus de
succès ces citadelles, presque imprenables autrement. Cela est incontestable.
Mais un danger analogue n’existe-t-il pas dans les villages
actuels de la montagne, dans ces amas de chalets de bois entassés les
Tins sur les autres, des hautes régions du Valais par exemple? Et
-encore nos Palafitteurs avaient-ils sur ceux-ci l’avantage d’une provi-
-sion inépuisable d’eau à leur disposition immédiate. Chaque année
nous apprenons la nouvelle d’un incendie terrible qui a ravagé' tel villa
g e alpestre. Cela empêche-t-il les habitants de le reconstruire, avec
la même imprudence, sur le même plan, avec les mêmes matériaux
inflammables ? Ne faut-il pas souvent l’intervention directe, les con-
-seils ou les ordres des autorités supérieures pour faire adopter dans
-la bâtisse nouvelle, ou un plan un peu moins dangereux, ou quelques
-mesures de précautions contre le feu ?
Au sujet des motifs de l’édification des villages bâtis sur pilotis, une
autre hypothèse, enfin, nous , est suggérée par les faits actuels des
indigènes des Philippines et des îles de la Sonde. Là lés moeurs
qui imposent la construction ‘des palafittes sont tellement impératives
-que ce ne sont pas seulement lés villages des côtes lacustres ou
maritimes qui sont établis sur pilotisl En pleine terre ferme, dans
-des marais, dans des jungles, dans des forêts, sur les collines, les
-cabanes sont toutes en l’air; les huttes de bois sont toujours élevées
« u r des pieux ou pilotis, et ne sont accessibles que par des échelles.
Ne pouvons-nous pas nous figurer aussi dans l’Helvétie anté-historique
. un peuple ayant apporté avec lui cette habitude traditionnelle, hérédita
ire , cette habitude devenue innée de la construction sur pilotis, sur
terre comme sur les eaux? Dans ce cas les palafittes terrestres
auraient disparu, e t nous ne reconnaîtrions les ruines que de ceux qui
-établis sur l’eau, y auraient eu leurs reliques protégées, par ce milieü,
-où l’homme n’a appris à fouiller qu’au milieu du XIXe siècle.
J’indique cette hypothèse sans.avoir l’idée de la faire prévaloir. J’estime
que le problème est actuellement insoluble ; nous n’avons pas les
-éléments de sa détermination. Nous ne savons pas la cause qui a
-engagé les Palafitteurs à établir leurs villages sur le domaine des
eaux.
Une trouvaille fortuite nous donnera peut-être la réponse. Pour le
moment, elle est incertaine.
2. Le lieu d’élection des palafittes.
■ Nous avons dit que les villages lacustres étaient à l’abri des incursions
des maraudeurs ennemis qui ne pouvaient y arriver qu à la nage.
11 fallait pour cela qu’ils fussent construits sur une profondeur minimale
de 1.5m d’eau, limite extrême des eaux guéables. Cette remarque
nous amène à quelques conclusions intéressantes.
Nous constatons que les ténevières des anciennes stations laeustres
sont aujourd’hui recouvertes de 2 à 6“ d’eau suivant la saison ou la
localité. J’en tire la preuve que la hauteur du lac était à peu près la
même à l’époque lacustre qu’elle est de nos jours.
En effet, d’une part, le lac ne pouvait pas être de beaucoup plus
élevé que sa hauteur actuelle, car dans ce cas la longueur des pilotis
aurait été excessive. Nous devons' compter pour- ces pilotis au moins
0,5m do longueur de fiche dans le sol, et 1.5™ delongueur au dessus des
hautes eaux pour laisser place aux vagues de tempête d’un grand lac;
2 .0 à 2 .5m poupt l’amplitude de la variation annuelle avant que les
barrages dés Genevois empêchassent les eaux de l’hiver de descendre
trop bas (') e t' 1.5m pour la profondeur d’eau minimale empêchant
l’ennemi d’arriver à la nage. En additionnant ces chiffres nous
arrivons à une longueur nécessaire de 5.5m pour le moins, ce qui
représente déjà un tronc d’arbre assez difficile à manier. La profondeur
d’eau que nous trouvons sur les stations, étant déjà plus forte que
le minimum nécessaire, il n’est pas possible qu’ils eussent choisi les
emplacements que nous étudions si la profondeur d’eau eût dépassé
de beaucoup la profondeur actuelle, si le niveau du lac eût été de
beaucoup plus élevé que le niveau moderne.
D’une autre part le niveau du lac ne pouvait pas être beaucoup plus
bas qu’il ne l’est aujourd’hui, car, dans ce cas, la profondeur de
l’eau eût été insuffisante pour les besoins .de la défense, l’ennemi eût
pu y arriver à gué.
On a bien parfois émis l’idée que les villages lacustres étaient bâtis
sur la grève, plus ou moins à sec, et qu’ils auraient été ultérieurement
envahis par un exhaussement du lac. Cela n’est pas admissible; les
(fl V. !.. I. 401, sq.