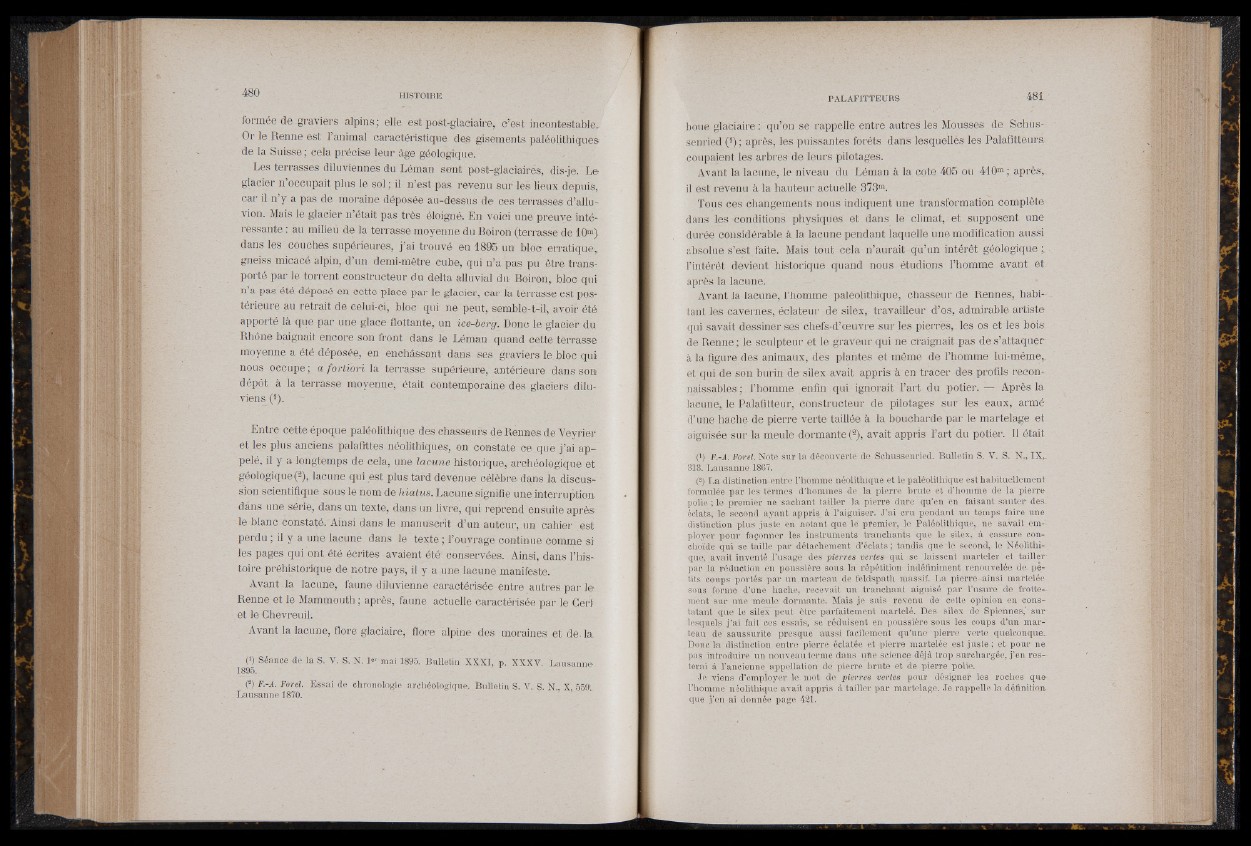
formée de graviers alpins ; elle est post-glaciaire, c’est incontestable.
Or le Renne est l’animal caractéristique des gisements paléolithiques
de la Suisse ; cela précise leur âge géologique.
Les terrasses diluviennes du Léman sont post-glaciairés, dis-je. Le
glacier n occupait plus le sol ; il n’est pas revenu sur les lieux depuis,
car il n’y a pas de moraine déposée au-dessus de ces terrasses d’allu-
vion. Mais le glacier n’était pas très éloigné. En voici une preuve intéressante
: au milieu de la terrasse moyenne du Boiron (terrasse de 10m)
dans les couches supérieures, j ’ai trouvé en 1895 un bloc erratique-,
gneiss micacé alpin, d’un demi-mètre cube, qui n’a pas pu être transporté
par le torrent constructeur du delta alluvial du- Boiron, bloc qui
n’a pas été déposé en cette place par le glacier, car la terrasse est postérieure
au retrait de celui-ci, bloc qui- ne peut, semble-t-il, avoir été
apporté là que par une glace flottante, un ice-berg. Donc le glacier du
Rhône baignait encore son front dans le Léman quand cette terrasse
moyenne a été déposée, en enchâssant dans ses graviers le bloc qui
nous occupe ; a fortiori la terrasse supérieure, antérieure dans son
dépôt à la terrasse moyenne, était contemporaine des glaciers diluviens
(*).
Entre cette époque paléolithique des chasseurs de Rennes de Veyrier
et les plus anciens palaftttes néolithiques, on constate ce que j ’ai appelé,
il y a longtemps de cela, une lacune historique, archéologique et
géologique(2), lacune qui est plus tard devenue célèbre-dans la discussion
scientifique sous le nom de hiatus. Lacune signifie une interruption
dans une série, dans un texte, dans un livre, qui reprend ensuite après
le blanc constaté.'Ainsi dans le manuscrit d’un auteur, un cahier est
perdu ; il y a une lacune dans le texte ; l’ouvragé continue comme si
les pages qui ont été écrites avaient été conservées. Ainsi, dans l’histoire
préhistorique de notre pays, il y a une lacune manifeste.
Avant-la lacune, faune diluvienne caractérisée entre autres par le
Renne et le Mammouth ; après, faune actuelle caractérisée par le Cerf
et le Chevreuil'.
Avant la lacune, flore glaciaire, flore alpine des moraines et de-la
(!) Séance de la S. V. S. N. 1» mai 1895. Bulletin XXXI, p. XXXV Lausanne-
1895.
(2) F.-A. Forel. Essai de chronologie archéologique. Bulletin S. V. S. N., X, 5591
Lausanne 1870.
boue glaciaire : qu’on se rappelle entre autres les Mousses de Schus-
senried (f); après, les puissantes forêts dans lesquellés les Palafitteura
coupaient les arbres de leurs pilotages.
Avant la lacune, le niveau du Léman à la cote 405 ou 410m ; aprè s,
il est revenu à la hauteur actuelle 373m.
Tous ces changements nous indiquent une transformation complète-
dans les -conditions physiques et dans le climat, et supposent une
durée considérable à la lacune pendant laquelle une modification aussi
absolue s’est faite. Mais tout cela n’aurait qu’un intérêt géologique ;
l’intérêt devient historique quand nous étudions l’homme avant et.
après la lacune.
Avant la lacune, l’homme paléolithique, chasseur de Rennes, habitant
les cavernes, éclateur de silex, travailleur d’os, admirable artiste
qui savait dessiner ses chefs-d’oeuvre sur les pierres, les os et les bois
de Renne ; le sculpteur et le graveur qui ne craignait pas de s’attaquer
à la figure des animaux, dès plantes et même de l’homme lui-même,
et qui de son burin de silex avait appris à en tracer des profils reconnaissables
; l’homme enfin qui ignorait l’art du potier. 3 Après la
lacune, le Palafitteur, constructeur de pilotages sur les eaux, armé
d’une hache de pierre verte taillée à la boucharde par le martelage et
aiguisée sur la meule dormante (2), avait appris l’art du potier. Il était
HÜ f.-A. Forel. Note sur la découverte de Schussenried. Bulletin S. V. S. N., IX,.
318. Lausanne 1867.
(2) La distinction entre l’homme néolithique et le palêolilhique est habituellement
formulée par les termes d’hommes de la pierre brute et d’homme de la pierre
polie ; le premier ne sachant tailler la pierre dure qu’en en faisant sauter des,
éclats, le second ayant appris, à l’aiguiser. J’ai cru pendant un temps faire une
distinction plus juste en notant que le premier, le Paléolithique, ne savait employer
pour façonner les instruments tranchants que le- silex, à cassure con-
choïde qui se taille par détachement d’éclats ; tandis que le second, le Néolithique,
avait inventé J’usage des pierres vertes qui se laissent marteler et tailler
par la réduction en poussière sous la répétition indéfiniment renouvelée de- petits
coups portés par un marteau de feldspath massif. La pierre ainsi martelée
sous forme d’une hache, recevait un tranchant aiguisé par l’usure de frottement
sur une meule dormante. Mais je suis revenu de cette opinion en constatant
que le silex peut être parfaitement martelé. Des Silex de Spiennes,*' sur-
lesquels j ’ai fait ces essais, se réduisent en poussière sous les coups d’un marteau
de saussurite presque aussi facilement qu’une pierre verte quelconque-
Donc la distinction entre pierre éclatée et pierre martelée est juste ; et pour ne
pas introduire un nouveau terme dans ufte science déjà trop surchargée, j’en resterai
à l’ancienne_ appellation de pierre brute et de pierre polie.
Je viens d’empïoyer le mot de pierres vertes pour désigner les roches que-
l’homme néolithique avait appris à tailler par martelage. Je rappelle la définition
que j’en ai donnée page 421.