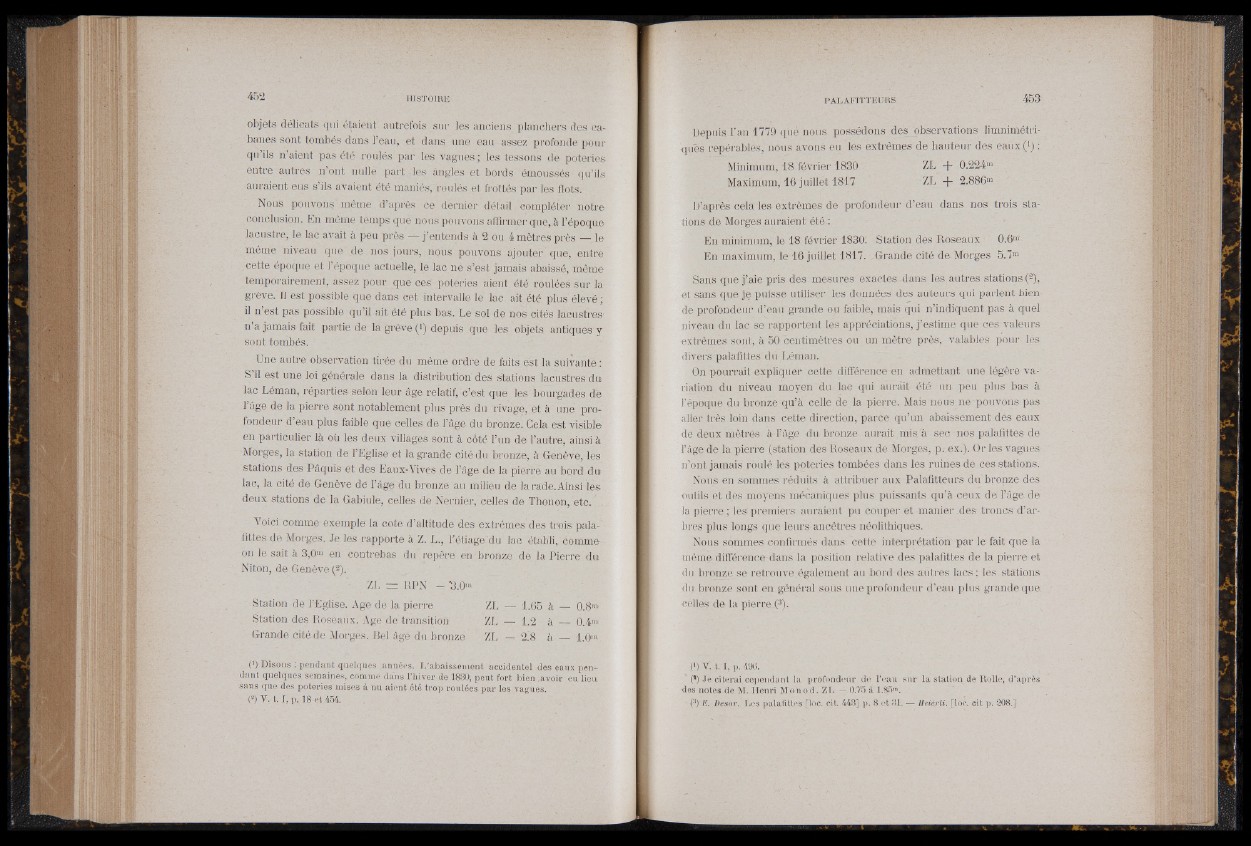
objets délicats qui étaient autrefois sur les anciens planchers des cabanes
sont tombés dans l’eau, et dans une eau assez profonde pour
qu’ils n’aient pas été roulés par les vagues ; les tessons de poteries
entre autres n’ont nulle part ,,les angles et bords émoussés qu’ils
auraient eus s’ils avaient été maniés, roulés et frottés par les flots.
Nouâ pouvons même d’après ce dernier détail compléter notre
conclusion. En môme temps que nous pouvons affirmer que, à l’époque
lacustre, le lac avait à peu près — j ’entends à 2 ou 4 mètres près — le
môme niveau que de nos jours, nous pouvons ajouter que, entre
cette époque et l’époque actuelle, le lac ne s ’est jamais abaissé, môme
temporairement, assez pour que ces poteries aient été roulées sur la-
grève. Il est possible que dans cet intervalle le lac ait été plus élevé ;
il n est pas possible qu’il ait été plus bas. Le sol de nos cités lacustres1
n a jamais fait partie de la grève (') depuis que les objets antiques y
sont tombés.
Une autre observation tirée du même ordre de faits est la suivante :
S’il est une loi générale dans la distribution des stations lacustres du
lac Léman, réparties selon leur âge relatif, c’est que les bourgades de
l’âge de la pierre sont notablement plus près du rivage, ét;à une profondeur
d’eau plus faible que celles de l’âge du bronze. Cela est visible
en particulier là où les deux villages sont à côté l’un de l’autre, ainsi à
Morges, la station de l’Eglise et la grande cité du bronzé, à Genève, les
stations des Pâquis et des Eaux-Vives .de l’âge de la pierre au bord du
lac, la cité de Genève de l’âge du bronze au milieu de la rade. Ainsi les
deux stations de la Gabiule, celles de Nernier, celles de Thonon, e t c / ,
Voici comme-exemple la cote d’altitude des extrêmes des trois palafittes
de Morges. Je les rapporte à Z. L., l’étiage'du lac établi, comme
on le sait à 3,0m en contrebas du repère en bronze de la Pierre du
Niton, de Genève (2).
ZL = RPN - 3.0®
Station de l’Eglise. Age de la pierre ZL — 1.65 à 0.8®
Station des Roseaux. Age de transition ZL — 1,2 à — 0.4®
Grande cité de Morges. Bel âgé du bronze ZL — 2.8 à — 1.0»
0) Disons : pendant quelques années. L’abaissement accidentel des eaux pendant
quelques semaines, comme dans l’hiver de 1880, peut fort bien .avoir eu lieu
sans que des poteries mises à nu aient été. trop roulées par les vagues.
Depuis l’an 1779 que nous possédons des observations limnimétri-
qués repérables, nous avons eu ’les extrêmes de hauteur des e a u x (‘) :
Minimum, 18 février 1830 ZL + 0.224®
Maximum, 16 juillet 1817 ZL + 2.886m
D’après cela les extrêmes de profondeur d’eàu dans nos trois stations
de Morges auraient été :
En minimum, le 18 février 1830'. Station des Roseaux 0.6m'
En maximum, le 16 juillet 1817. ,Grande cité de Morges 5.7®
Sans que j’aie pris des mesures exactes dans les autrés stations (2),
et sans que je puisse utiliser les données des auteurs qui parlent bien
de profondeur d’eau grande ou faible, mais qui n’indiquent pas à quel
niveau du lac se rapportent lés appréciations, j’estime que ces valeurs
extrêmes sont, à 50 centimètres ou un mètre près, valables pour lés
divers palafittes du Léman.
On pourrait expliquer cette différence en admettant une légère variation
du niveau moyen du lac qui aurait été un peu plus bas à
l’époque du bronze qu’à celle de la pierre. Mais nous ne pouvons pas
alier très loin dans cette direction, parce qu’un abaissement des eaux
de deux mètres à-F âge du bronze aurait mis à sec nos palafittes de
l’âge de la pierre (station des Roseaux de Morges, p. ex.). Or les vagues-
n’ont jamais roulé les poteries tombées dans les ruines de ces stations.
Nous en sommes réduits à attribuer aux Palafîtteurs du bronze des
outils et des moyens mécaniques plus puissants qu’à ceux de l’âge de
la pierre ; les premiers auraient pu couper et manier des troncs d’arbres
plus longs que leurs ancêtres néolithiques.
Nous sommes confirmés dans cette interprétation par le fait que la
même différence dans la position relative des palafittes de la pierre et
du bronze se retrouve également au bord des autres lacs; les stations
du bronze sont en général sous une profondeur d’eau plus grande que.
celles de la pierre (3).
(<) V. ,t. I, p. 400.
' (’) Je citerai cependant la profondeur de l'eau sur la station de Rolle, d’après
des notes de M. Henri Monod. Zi. — 0.75 à 1.85m.
(3) E. Desor. Les pala1itt.es [loc. cit. 443] p. 8 et 81. — Heierli. [loc. cit p. 208.]