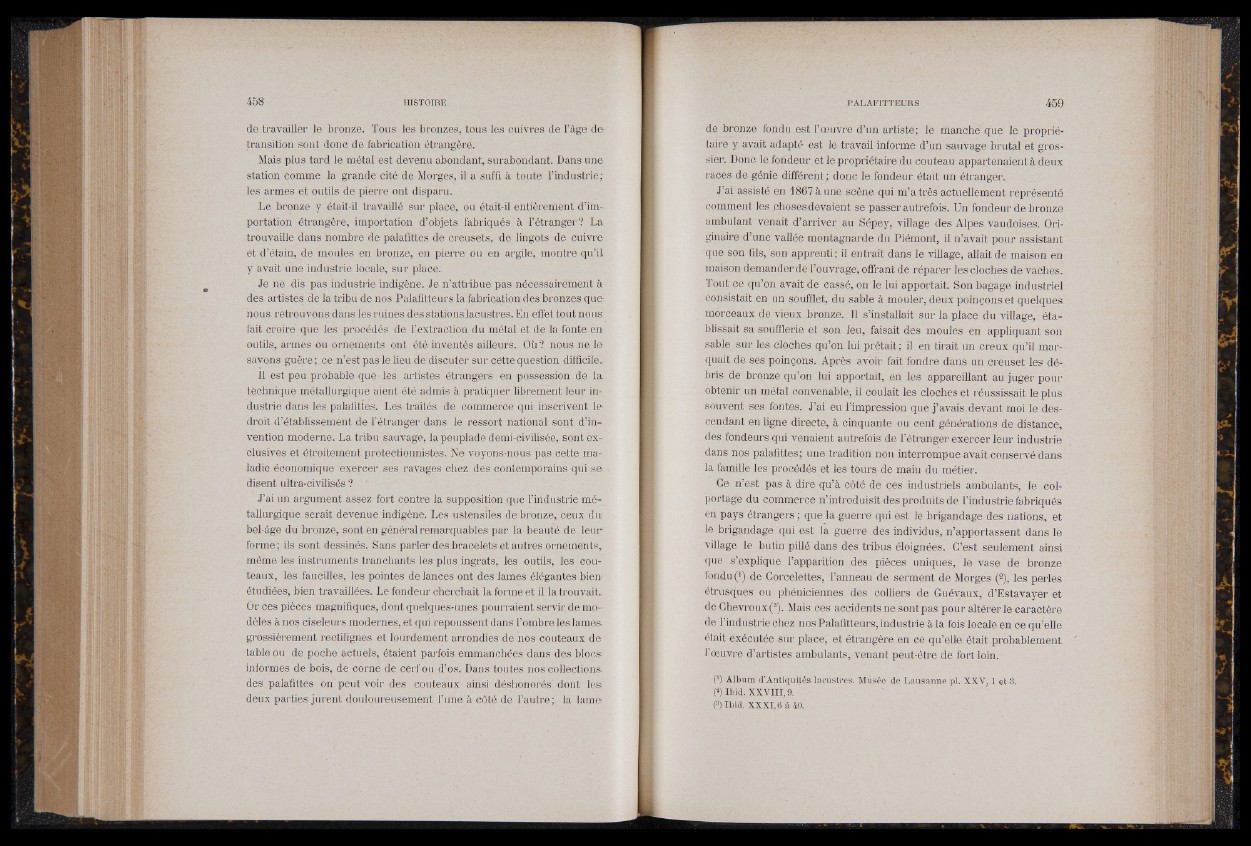
de travailler le bronze. Tous les bronzes, tous les cuivres de l’âge de-
transition sont donc de fabrication étrangère.
Mais plus tard le métal est devenu abondant, surabondant. Dans une
station comme la grande cité de Morges, il a suffi à toute l’industrie;
les armes et outils de pierre ont disparu.
Le bronze y était-il travaillé sur place, ou était-il entièrement d’importation
étrangère, importation d’objets fabriqués à l’étranger? La
trouvaille dans nombre de palafittes de creusets, de lingots de cuivre
et d’étain, de moules en bronze, en pierre ou en argile, montre qu’il
y avait une industrie locale, sur place.
Je ne dis pas industrie indigène. Je n’attribue pas nécessairement à
des artistes de la tribu de nos Palafitteurs la fabrication des bronzes que-
nous retrouvons dans les ruines des stations lacustres. En effet tout nous
fait croire que les procédés de l’extraction du métal et de la fonte en-
outils, armes ou ornements ont été inventés ailleurs. Où ? nous ne le
savons guère ; ce n’est pas le lieu de discuter sur cette question difficile.
11 est peu probable que les artistes étrangers en possession de la
technique métallurgique aient été admis à pratiquer librement leur industrie
dans les palafittes. Les traités de commerce qui inscrivent le-
droit d’établissement de l’étranger dans le ressort national sont d’invention
moderne. La tribu sauvage, la peuplade demi-civilisée, sont exclusives
et étroitement protectionnistes. Ne voyons-nous pas cette maladie
économique exercer ses ravages chez des contemporains qui se.
disent ultra-civilisés ?
J’ai un argument assez fort contre la supposition que l’industrie métallurgique
serait devenue indigène. Les ustensiles de bronze, ceux du
bel-âge du bronze, sont en général remarquables par la beauté de leur
forme; ils sont dessinés. Sans parler des bracelets et autres ornements,,
même les instruments tranchants les plus ingrats, les outils, les couteaux,
les faucilles, les pointes de lances ont des lames élégantes bien
étudiées, bien travaillées. Le fondeur cherchait la forme et il la trouvait.
Or ces pièces magnifiques, dont quelques-unes pourraient servir de modèles
à nos ciseleurs modernes, et qui repoussent dans l’ombre les lames-
grossièrement rectilignes et lourdement arrondies de nos couteaux de
table ou de poche actuels, étaient parfois emmanchées dans des blocs:
informes de bois, de corne de cerf ou d’os. Dans toutes nos collections-
des palafittes on peut-voir des couteaux aipsi déshonorés' dont les.-
deux parties jurent douloureusement l’une à côté de l’autre;, la lame
de bronze fondu est l’oeuvre d’un artiste; le manche que le propriétaire
y avait adapté e s t le travail informe d’un sauvage brutal et grossier:
Donc le fondeur et le propriétaire du couteau appartenaient à deux
races de génie différent ; donc le fondeur était un étranger.
J’ai assisté en 1867 à une scène qui m’a très actuellement représenté
comment les choses devaient se passer autrefois. Un fondeur de bronze
ambulant venait d’arriver au Sépey, village des Alpes vaudoises. Originaire
d’une vallée montagnarde du Piémont, il n’avait pour assistant
que son fils, son apprenti; il entrait dans le village, allait de maison en
maison demander de l’ouvrage, offrant de réparer les cloches de vaches.
Tout ce qu’on avait de cassé, on le lui apportait. Son bagage industriel
consistait en un soufflet, du sable à mouler, deux poinçons et quelques
morceaux de vieux bronze. 11 s’installait sur la place du village, établissait
sa soufflerie et son feu, faisait dès moules en appliquant son
sable sur les cloches qu’on lui prêtait; il en tirait un creux qu’il marquait
de ses poinçons. Après avoir fait fondre dans un creuset les débris
de bronze qu’on lui apportait, en les appareillant au juger pour
obtenir un métal convenable, il coulait les cloches et réussissait le plus
souvent ses fontes. J’ai eu l’impression que j’avais, devant moi le descendant
en ligne directe, à cinquante ou cent générations de distance,
des fondeurs qui venaient autrefois de l’étranger exercer leur industrie
dans nos palafittes; une tradition non interrompue avait conservé dans
la famille les procédés et les tours de main du métier.
Ce n’est pas à dire qu’à côté de ces industriels ambulants, le colportage
du commerce n’introduisît des produits de l'industrie fabriqués
en pays étrangers ; que la guerre qui est le brigandage des nations, et
le brigandage qui est la guerre des individus, n’apportassent dans le
village le butin pillé dans des tribus éloignées. C’est seulement ainsi
que s’explique l’apparition des pièces uniques, le vase de bronze
fondu (') de Corcelettes, l’anneau de serment de Morges (2), les perles
étrusques ou phéniciennes des colliers de Guévaux, d’Estavayer e t
deChevroux(3). Mais ces accidents ne sont pas pour altérer le caractère
de l’industrie chez nos Palafitteurs, industrie à la fois locale en ce qu’elle
était exécutée sur place, et étrangère en ce qu’elle était probablement
l’oeuvre d’artistes ambulants, venant peut-être de fort loin.
(’) Album d’Antiquités lacustres. Musée de Lausanne pl. XXV, 1 et 3.
(a) Ibid. XXVIII, 9.
(3) Ibid. XXXI,6 à 40.