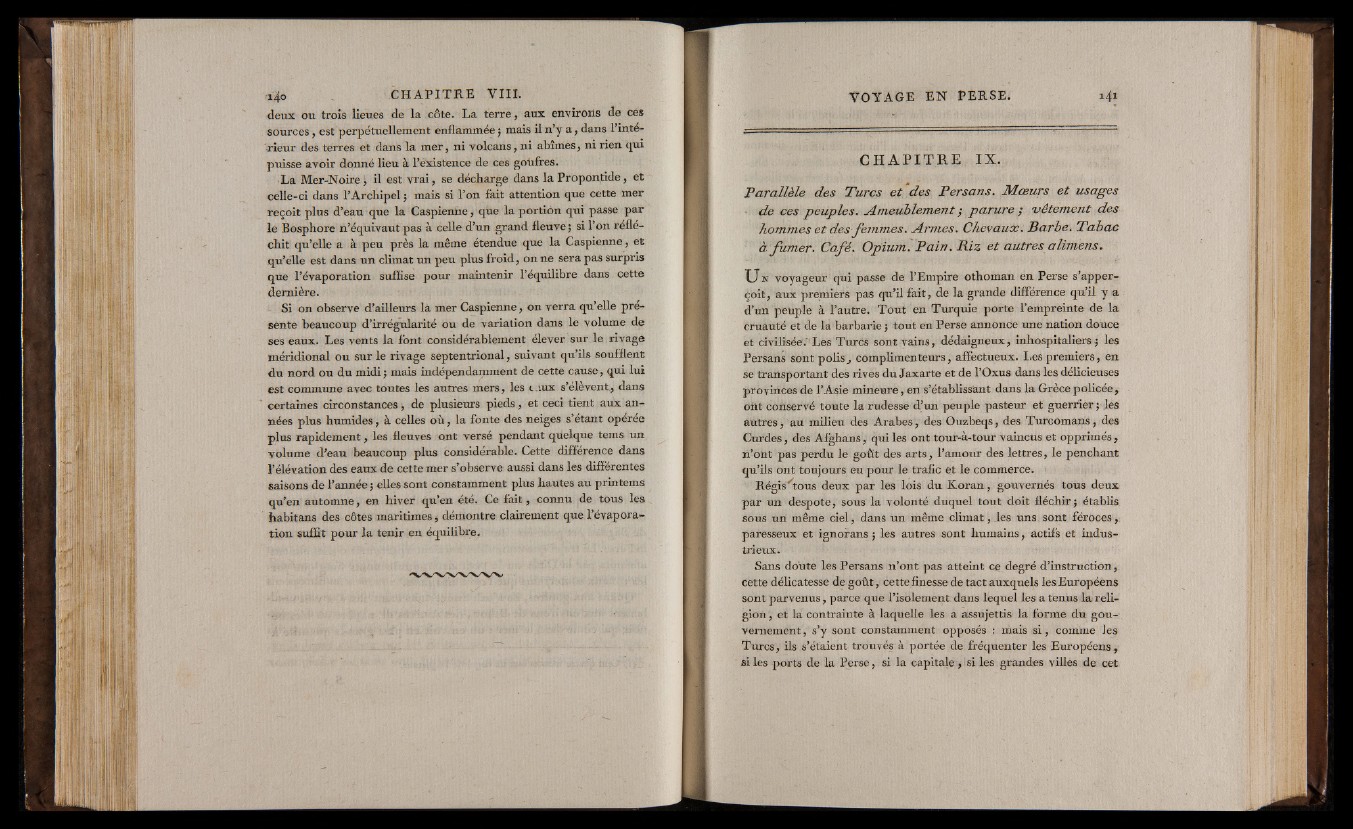
deux ou trois lieues de la côte. La terre , aux enviroiis de ces
sources, est perpétuellement enflammée} mais il n’y a , dans l'intérieur
des terres et dans la mer, ni volcans, ni abîmes, ni rien qui
puisse avoir donné lieu à l’existence de ces goüfres.
La Mer-Noire} il est v ra i, se décharge dans la Propontide, et
celle-ci dans l’Archipel} mais si l’on fait attention que cette mer
reçoit plus d’eau que la Caspieniie, que la portion qui passe par
le Bosphore n’équivaut pas à celle d’un grand fleuve} si l’on réfléchit
qu’elle a à peu près la même étendue que la Caspienne, et
qu’elle est dans un climat un peu plus froid, on ne sera pas surpris
que l ’évaporation suffise pour maintenir l ’équilibre dans cette
dernière.
Si on observe d’ailleurs la mer Caspienne, on verra qu’elle présente
beaucoup d’irrégularité ou de variation dans le volume de
ses eaux. Les vents la font considérablement élever sur le rivage
méridional ou sur le rivage septentrional, suivant qu’ils soufflent
du nord ou du midi} mais indépendamment de cette cause, qui lui
est commune avec toutes les autres mers, les t aux s’élèvent,, dans
certaines circonstances, de plusieurs pieds, et ceci tient aux années
plus humides, à celles o ù , la fonte des neiges s’étant opéree
plus rapidement, les fleuves ont versé pendant quelque tems un
volume d’eau beaucoup plus considérable. Cette différence dans
l ’élévation des eaux de cette mer s’observe aussi dans les différentes
saisons de l ’année} elles sont constamment plus hautes au printems
qu’en automne, en hiver qu’en été. Ce fa i t , connu de tous les
faabitans des côtes maritimes, démontre clairement que l ’évaporation
suffit pour la tenir en équilibre.
C H A P I T R E IX.
Parallèle des Turcs et "des Persans. Moeurs et usages
- de ces peuples. Ameublement y parure ; vêtement des
hommes et des femmes. Armes. Chevaux. Barbe. Tabac
à fumer. Café. Opium. P a in . R iz et autres a limens.
U n voyageur qui passe de l’Empire othoman en Perse s’apper-
çoit, aux premiers pas qu’il fait, de la grande différence qu’il y a
d’un peuple à l’autre. Tout en Turquie porte l’empreinte de la
cruauté et de la barbarie} tout en Perse annonce une nation douce
et civilisée.'Les Turcs sont vains, dédaigneux, inhospitaliers } les
Persans sont polis, complimenteurs, affectueux. Les premiers, en
se transportant des rives du Jaxarte et de l’Oxus dans les délicieuses
provinces de l ’Asie mineure, en s’établissant dans la Grèce policée,
oilt conservé toute la rudesse d’un peuple pasteur et guerrier} les
autres, au milieu des Arabes, des Ouzbeqs, des Turcomans, des
Curdes, des Afghans, qui les ont tour-à-tour vaincus et opprimés,
n ’ont pas perdu le goût des arts, l ’amour des lettres, le penchant
qu’ils ont toujours eu pour le trafic et le commerce, j
Régis tous deux par les lois du Koran , gouvernés tous deux
par un despote, sous la volonté duquel tout doit fléchir} établis
sous un même ciel, dans un même climat, des Uns sont féroces,
paresseux et ignorans} les autres sont humains, actifs et industrieux.
Sans doute les Persans n’ont pas atteint ce degré d’instruction,
cette délicatesse de goût, cette finesse de tact auxquels le&Européens
sont parvenus, parce que l ’isolement dans lequel les a tenus la religion
, et la contrainte à laquelle les a assujettis la forme du gouvernement,
s’y sont constamment opposés : mais s i , comme les
Turcs, ils s’étaient trouvés à portée de fréquenter les Européens,
ailes ports de la Perse, si la capitale, si les grandes villes de cet