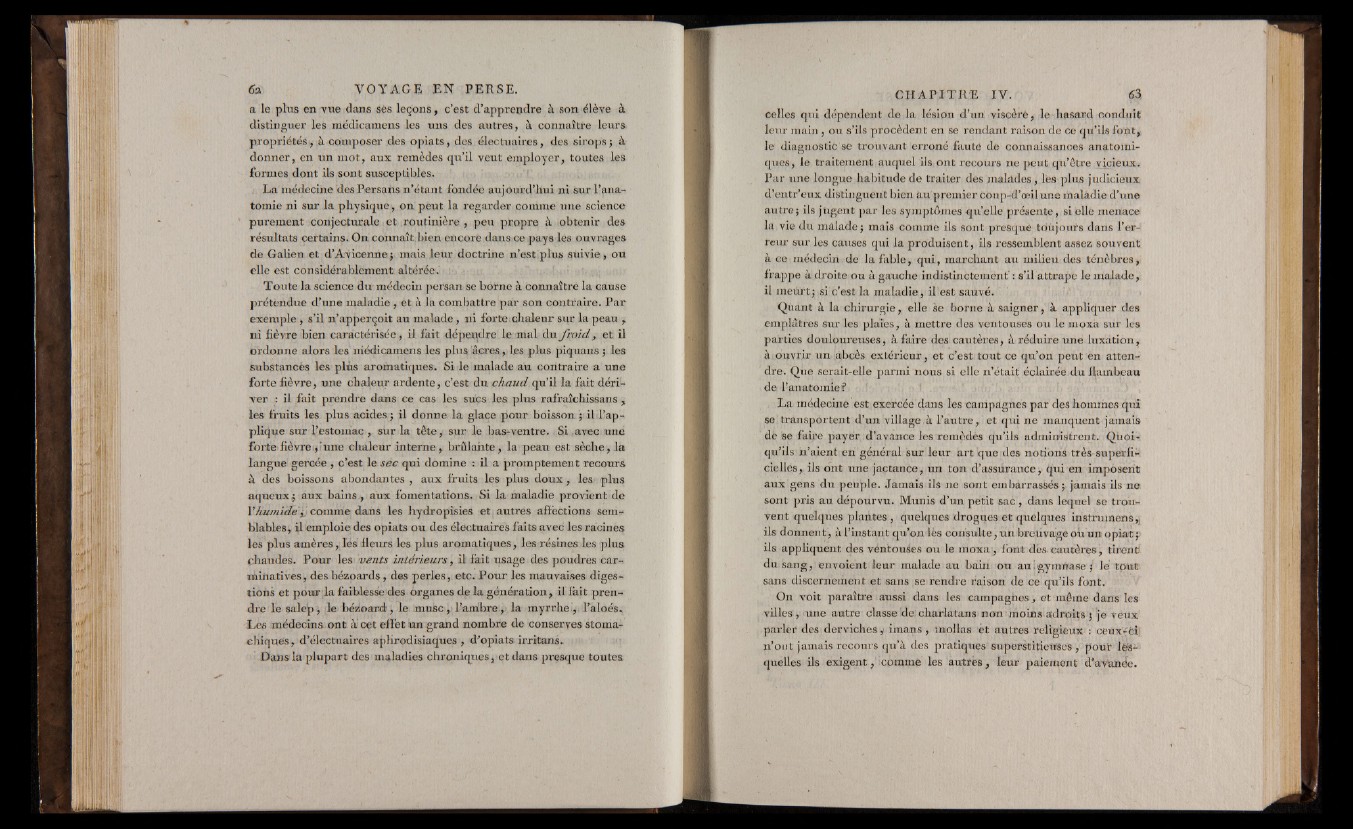
a le plus en vue dans ses leçons, c’est d’apprendre à son élève à
distinguer les médicamens les uns des autres, à connaître leurs
propriétés, à composer des opiats, des électuaires, des sirops; à
donner, en un mot, aux remèdes qu’il veut employer, toutes les
formes dont ils sont susceptibles.
La médecine des Persans n’étant fondée aujourd’hui ni sur l’ana-
tomie ni sur ,1a physique , on peut la regarder comme une science
purement conjecturale et routinière , peu propre à obtenir des
résultats certains. On connaît, bien encore dans ce pays les ouvrages
de Galien et d’Avicenne; mais leur doctrine n’est plus suivie, ou
elle est considérablement altérée.
Toute la science du médecin persan se borne à connaître la cause
prétendue d’une maladie, et à la combattre par son contraire. Par
exemple , s’il n’apperçoit au malade , ni forte chaleur sur la peau ,
ni lièvre bien caractérisée, il fait dépendre le mal du fr o id , et il
ordonne alors les niédicamens les plus acres, les plus piquans ; les
substances les plus aromatiques. Si le malade au contraire a une
forte lièvre, une chaleur ardente, c’est du chaud cfri'A la fait dériver
: il fait prendre dans ce cas les sucs les plus ralraîchissans ,
les fruits les plus acides ; il donne la glace pour boisson ; il l’applique
sur l’estomac, sur la tête, sur le bas-ventre. Si avec une
forte fièvre,,'une chaleur interne, brûlante, la peau est sèche, la
langue gercée , c ’est le sec qui domine : il a promptement recours
à des boissons abondantes , aux fruits les plus d o u x , les plus
aqueux ; aux bains, aux fomentations. Si la maladie provient de
Ydiùmide’ij comme dans les hydropisies et autres affections semblables,
il emploie des opiats ou des électuaires faits avec les racines
les plus amères, les fleurs les plus aromatiques, les résines les plus
chaudes. Pour les vents intérieurs, il fait usage des poudres car-
minatîves, des bézoards, des perles, etc. Pour les mauvaises diges-
tiohs et pour;la faiblesse des organes de la génération, il fait prendre
le sale'p, le bézoard, le musc,’ l’am!bre:, la myrrhe., l’aloés.
Les médecins ont & cet effet un grand nombre de conserves stomachiques,
d’électuaires aphrodisiaques , d’opiats. irritons.
Dans la plupart des maladies chroniques, et dans presque toutes
C H A P I T R E IV . 63,
celles qui dépendent de la lésion d’un viscère, le hasard conduit
leur main, ou s’ils procèdent en se rendant raison de ce qu’ils font,
le diagnostic se trouvant erroné faute de connaissances anatomiques,
le traitement auquel ils ont recours ne peut qu’être vicieux.
Par une longue habitude de traiter des malades, les plus judicieux
d’entr’eux distinguent bien au premier coup-d’oeil une maladie d’une
autre; ils jugent par les symptômes qu’elle présente, si elle menace
la vie du malade; mais comme ils sont presque toujours dans l’erreur
sur les causes qui la produisent, ils ressemblent assez souvent
à ce médecin de la fable, qui, marchant au milieu des ténèbres,
frappe à droite ou à gauche indistinctement : s’il attrape le malade,
il meürt; si c’est la maladie, i f est sauvé.
Quant à la chirurgie, elle se borne à saigner, à appliquer des
emplâtres sur les plaies, à mettre des ventouses ou le moxa sur les
parties douloureuses, à faire des cautères, à réduire Une luxation,
à ouvrir un abcès extérieur, et c’est tout ce qu’on peut en attendre.
Que serait-elle parmi nous si elle n’était éclairée du flambeau
de fanatomie?
La médecine est exercée dans les campagnes par des hommes qui
se transportent d’un village à l’autre, et qui ne manquent jamais
dè se faire payer d’avance les remèdes qu’ils administrent. Quoiqu’ils
n’aient en général sur leur art que des notions très-superficielles,
ils ont une jactance, un ton d’assurance, qui en imposent
aux gens du peuple. Jamais ils ne sont embarrassés ; jamais ils ne
sont pris au dépourvu. Munis d’un petit sac , dans lequel se trouvent
quelques plantes , quelques drogqes et quelques instruinens,,
ils donnent, à l’instant qu’on lès consulte, un breuvage oh un opiat ;
ils appliquent des ventouées ou le moxa , font dés- cautères, tirent
du sang, envoient leur malade au bain ou auigymnase ; le tout
sans discernement et sans se rendre raison de ce qu’ils font.
On voit paraître aussi dans les campaghes, et même dans les
ville si pf une autre classe de: charlatans non moins adroits ; je veux
parler des derviches , imams, îuollas èt autres religieux : ceux-'Ci1
n’ont jamais recours qu’à des pratiques superstitieuses , pour lesquelles
ils exigent, comme les autres, leur paiement d’avance.