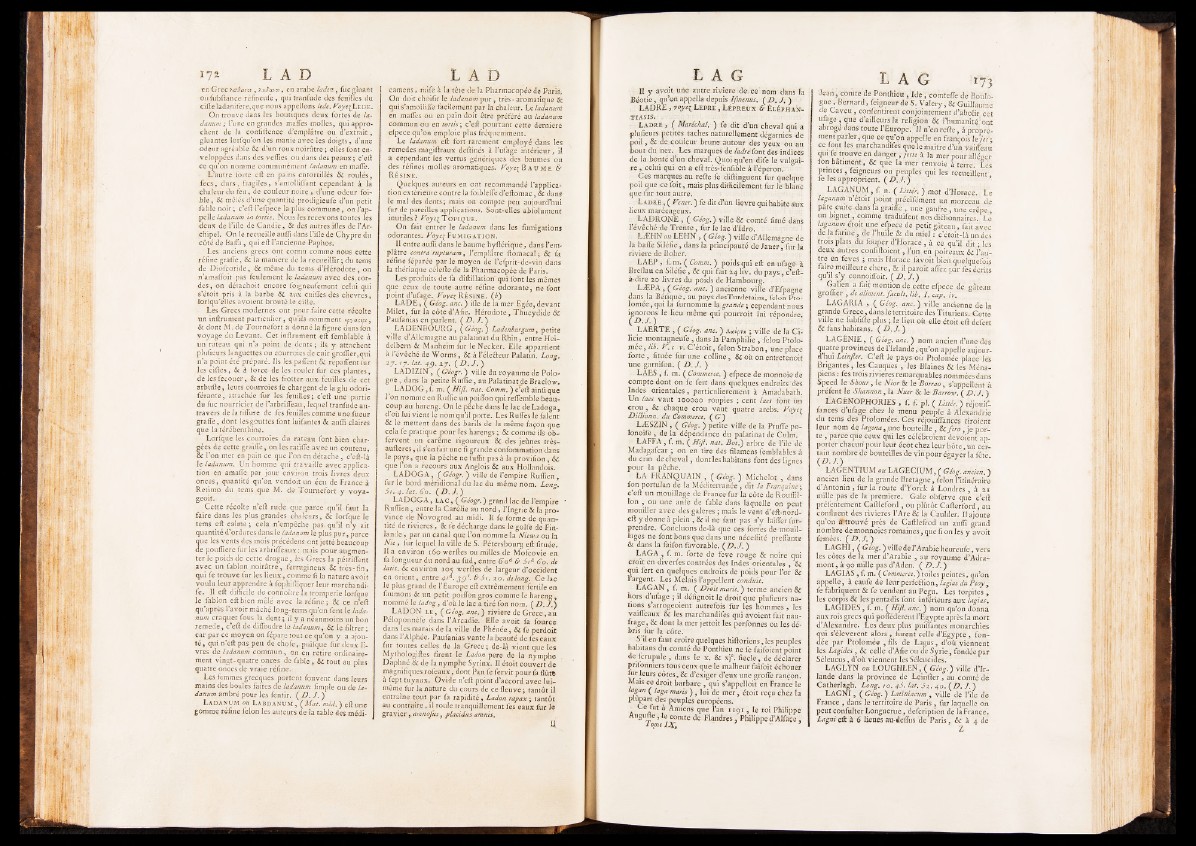
en Grecàa/Woy, XjxTctvov, en arabe laden, lue gluant
ou fubftance réfineufe, qui tranfude des feuilles du
cifteladanifere,que nous appelions kde. Voye^Lede.
On trouve dans les boutiques deux fortes de la-
danum ; l’une en grandes maffes molles, qui approchent
de la confidence d’emplâtre ou d’extrait,
gluantes lorfqu’on les manie avec les doigts, d’une
odeur agréable 6c d’un roux noirâtre ; ellesfont enveloppées
dans des veffies ou dans des peaux; c’ell
ce qu’on nomme communément ladanum en maffe.
L ’autre forte eft en pains entortillés & roulés,
fecs, durs , fragiles, s’amolliffant cependant à la
chaleur du feu, de couleur .noire, d’une odeur foi-
ble, 6c mêlés d’une quantité prodîgieufe d’un petit
fable noir; c’eft l’efpece la plus commune, on l ’appelle
ladanum in tortis. Nous les recevons toutes les
deux de l’ ifle de Candie , & des autres ides de l’Archipel.
On le recueille aulïï dans l’ifle de Chypre du
côté de Baffa , qui ell l’ancienne Paphos,
Les anciens grecs ont connu comme nous cette
réfine grade, 6c la maniéré dé la recueillir; du tems
de Diofcoride, 6c même du tems d’Hérodote, on
n’amaffoit pas feulement le ladanum avec des. cordes,
on détachoit encore foigneufement celui qui
s’étoit pris à la barbe 6c aux cuilfes des chevres,
lorfqu’elles avoient brouté le cille.
Les Grecs modernes ont pour faire cette récolte
un infiniment particulier, qu’ils nomment tpyctçipi,
& dont M ; de Tournefort a donné la figure dans fon
voyage du Levant. Cet infiniment ell femblable à
un rateau qui n’a point de dents ; ils y attachent
plufieurs languettes ou courroies de cuir grolfier,qui
n’a point été préparé. Ils les palfent 6c repaffent fur
les cilles, & à force de les rouler fur ces plantes,
de les fecouer, & de les frotter aux feuilles de cet
arbufte, leurs courroies fe chargent de la glu odoriférante,
attachée fur les feuilles ; c’efi une partie
du fuc nourricier de l’arbrilfeau, lequel tranfude au-
tra vers delatiffure de fes feuilles comme une: fueur
graffe, dont les gouttes font luifantes & aulïï claires
que la térébenthine.
Lorfque les courroies du rateau font bien chargées
de cette graiffe, on les ratifie avec un couteau,
& l’on met en pain ce que l’on en détache , c’eft-là
le ladanum. Un homme qui travaille avec application
en amaffe par jour environ trois livres deux
onces, quantité qu’on vendoit un écu de France à
Retimo du tems que M. dp Tournefort y voya-
geoit.
Cette récolte n’eft rude que parce qu’il faut la
faire dans, les plus grandes chaleurs, 6c lorfque le
tems ell calme ; cela n’empêche pas. qu’il n’y ait
quantité d’ordures dans le ladanum le plus pur, parce
que les vents des mois précédens ont jetté beaucoup
de pouffiere fur les arbriffeaux : mais pour augmenter
le poids de cette drogue, les Grecs la pétrifient j
avec un fablon noirâtre, ferrugineux 6c très-fin, I
qui fe trouve fur les lieux, comme fi la nature avoit
voulu leur apprendre à fophiflïquer leur marchandi-
fe. Il eft difficile de connoître la tromperie lorfque
le fablon eft bien mêlé avec la réfine; 6c ce n’eft
qu’après l’avoir mâché long-tems qu’on fent le ladanum
craquer fous la dent ; il y a néanmoins un bon
remede, c’eft de diffoudre le Ladanum, 6c le filtrer;
car par ce moyen on fépare tout ce qu’on y a ajouté
, qui n’eft pas peu de chofe, puifque fur deux livres
de Ladanum commun, on en retire ordinairement
vingt-quatre onces de fable, 6c tout au plus
quatre onces de vraie réfine.
Les femmes grecques portent fouvcnt dans leurs
mains des boules faites de ladanum fimple ou de ladanum
ambré pour les fentir. ( D . J. )
Ladanum ou Labdanum , (Mat. mld. ) eft une
gomme réfine félon les auteurs de la table des médic
a mens, riiifè à la tête de la Pharmacopée de Paris;
On doit choifir le ladanum pur, très - aromatique &
qui s’amolliffe facilement par la chaleur. Le ladanunï
en maffes ou en pain doit être préféré au ladanum
commun ou en tortis \ c’eft pourtant cette dernieré
efpece qu’on emploie plus fréquemment.
Le ladanum eft fort rarement employé dans les
remedes magiftraux deftinés à î’ufage intérieur, il
a cependant les vertus génériques des baumes où
des réfines molles- aromatiques. Voyez B a u m e &
Résine.
Quelques auteurs en ont recommandé l’application
extérieure contre la foibleffe d’eftomac, 6c dan*
le mal des dents; mais on compte peu aujourd’hui
fur de pareilles applications. Sont-elles absolument
inutiles? Voye^T opique.
On fait entrer le ladanum dans les fumigations
odorantes. Voye{ Fumigation.
Il entre aufli dans le baume hyftérique, dans l’eni-
plâtre contra rupturam, l’emplâtre ftomacal; & fa
réfine féparée par le moyen de l’efprit-de-vin dans
la thériaque céîefte de la Pharmacopée de Paris.
Les produits de fa diftillation qui font les mêmes
que ceux de toute autre réfine odorante, ne font
point d’ufage. Voyez Résine, (é)
LA D E , ( Géog. anc. ) ifle de la mer Egée, devant
Milet, fur la côted’Afie. Hérodote, Thucydide 6c
Paufanias en parlent. ( D . J. )
LADENBOURG, (Géog-.) Ladenburgum, petite
ville d’Allemagne au palatinat du Rhin, entre Hei-
delbern & Manheim fur le Necker. Elle appartient
à l’évêché de V o rm s , 6c à l’éle&eur Palatin. Long,
zy. ty. lat. 49. iy .' ( D . J. )
LÀD IZ IN , ( Géogr. ) ville du royaume de Pologne
, dans la petite Ruffie, au PalatinatdeBraclow.
LA D O G , f. m. ( Hiß. nàt. Comm. ) c’eft ainfi que
l ’on nomme en Ruffie un poiffon quireffemble beaucoup
au hareng. On le pêche dans le lac de Ladoga,
d’où lui vient le nom qu’il porte. Les Ruffes le falent
6c le mettent dans des barils de la même façon que
cela fe pratique pour les harengs ; 6c comme ils ob-
fervent un carême rigoureux 6c des jeûnes très-
aufteres, il s’en fait une fi grande confommation dans
le pays, que la pêche ne fuffit pas à la provifion , &:
que l’on a recours aux Anglois & aux Hollandois.
LA D O G A , ( Géogr. ) ville de l’empire Ruffien,
fur le bord méridional du lac du même nom. Long.
5 t. 4. lat. Go. ( D . J. )
L A D O G A , lac , ( Géogr. ) grand lac de l ’empire *
Ruffien, entre la Carélie au nord, l’Ingrie & la province
de Novogrod au midi. Il fe forme de quantité
de rivières, & fe décharge dans le golfe de Finlande
, par un canal que l’on nomme la Niewa ou la
Nie, fur lequel la ville de S. Pétersbourg eft fituée.
II a environ 160 werftes ou milles de Mofcovie en
fa longueur du nord au fùd, entre 6'od & 5 td G o . de
latit. 6c environ 105 -werftes de largeur d’occident
en orient, entre 4/d. 3 5 '. & 5 t. 20. delong. Ce lac
le plus grand de l’Europe eft extrêmement fertile en
faumons & un petit poiffion gros comme le hareng,
nommé le ladog, d’où le lac a tiré fon nom. ( D . J .)
LADON l e , ( Géog. anc. ) riviere de Grece, au
Péloponnèfe dans l’Arcadie. Elle avoit fa fource
dans les marais de la ville de Phénée, 6c fe perdoit
dans l’Alphée. Paufanias vante la beauté de fes eaux
fur toutes celles de la Grece ; de-là vient que les
Mythologiftes firent le Ladon pere de la nymphe
Daphné 6c de la nymphe Syrinx. II étoit couvert de
magnifiques rofeaux, dont Pan fe fervit pour fa flûte
à fept tuyaux. Ovide n’eft point d’accord avec lui-
même fur la nature du cours de ce fleuve ; tantôt il
entraîne -tout par fa rapidité, Ladon rapax ; tantôt
au contraire, il roule tranquillement fes eaux fur Iç
gravier, arenoßus, placidus amnis.
ü
Il y avoit; Une. autre riviere de.ee nom dans Ta |
Béotie, qu’on appella depuis Ifmenùs. { D . J. )
LADRE, voyez Lepre , Lépreux & Éléphan-
-TIASIS. _
- Ladre , ( Maréchal. ) fe dit d’un cheval qui a !
plufieurs. petites taches naturellement dégarnies de •
.poil, & déjcouleur brune autour des yeux ou’au ‘
bout du nez. Les marques de ladre {ont des indicés
de la bonté d’un cheval. Quoi qu’en dife le vulgaire
celui qui en a eft très-fenfible à l’éperon.- • •
Ces marques au refte fe diftinguent fur quelque
poil que ce foit, mais plus difficilement fur le blanc 1
que fur tout autre.
L adre , ( Vmer. ) fe dit d’un üevre qui habite aux :
lieux marécageux.
LAD R O N E , ( Géog.") ville 6c comté fitué dans i
l’évêché de Trente, fur le lac d’Idro.
LÆHN ou LEH N , ( Géog. ) ville d’Allemagne de 1
la baffe Siléfie, dans la principauté de Jauer ,Tiir là
riviere de Bober.
LAEP , f. m. ( Comm. ) poids qui eft en ufàgèP:à
Breflau en Siléfie, 6c qui fait 24 liv. du p ays, e’eft-
à-dire 20 livres du poids de Hambourg.
LÆPA , ( Géog; anc. ) ancienne ville d’Efpagne
dans la Bétique, au pays desTurdetains, félon Ptor j
(ornée, qui la furnomme la grande ; cependant nous |
(\Z?>rc>n)S le lieu même qui pourroit lui répondre.
LAERTE , ( Geog. anc. ) Aalpr» ; ville de la Ci-
licie montagneufe, dans la Pamphilie, félon Ptôlo-
mée, lib. V. c v. C ’étoit, félon Strabon, une placé
forte, fituee fur une colline, & où on entretenait
une garnifon. ( D . J. )
LAES , f. m. ( Commerce. ) efpece de monnoie de
compte dont on fe fert dans quelques endroits dès
Indes orientales, particulièrement à Am'adabath.
Un laes vaut 100000 roupies ; cent laes font ùn
c ro u , 6c chaque crou vaut quatre arebs. Voyez
Diclionn. du Commerce. { G )
LÆSZIN , ( Géog. ) petite ville de la Pruffe po-
lonoife , de la dépendance du palatinat de Gulm.
LAFFA , f. m. ( Hifl. nat. Bot.) arbre de l’ile-de
Madagafcar ; on en tire dés filamens femblable* à
du crin de ch eval, dont les habitans font des iignes
pour la pêche.
LA FRANQUAIN , ( Géog. ) Michelot , dans
fon portulan de la Mediterranee, dit la Franquine ;
c’eft un mouillage de France fur la côte de Rouffil-
lon , ou une anfe de fable dans laquelle on peut
mouiller avec des galeres ; mais le vent d’eft-nord-
eft y donne à plein , 6c il ne faut pas s’y laiffer fiir-
prendre. Concluons de-là que ces fortes de mouillages
ne font bons que dans une néceffité preflante
& dans la faifon favorable. (Z>. ƒ. )
LAGA , f. m. forte de feve rouge & noire qui
croît en diverfes contrées des Indes orientales , &
qui fert en quelques endroits de poids pour l’or 6c
l’argent. Les Mêlais l’appellent conduit.
LAG AN , f. m. ( Droit marit. ) terme ancien 6c
hors d’ufage ; il défignoit le droit que plufieurs nations
s’arrogeoient autrefois fur les hommes , les
vaiffeaux 6c les marchandifes qui avoient fait naufrage,
6c dont la mer jettoit les perfonnes ou les débris
fur la côte.
S il en faut croire quelques hiftoriens, les peuples
habitans du comté de Ponthieu ne fe faifoient point
de fcrupule, dans le x. 6c xje. fiécle, de déclarer
prifonniers tous ceux que le malheur faifoit échouer
fur leurs côtes, 6c d’exiger d’eux une grofle rançon.
Mais ce droit barbare , qui s’appelloit en France le
agon ( laga maris ) , loi de mer, étoit reçu chez la
plupart des peuples européens.
a ^ 6n Ut ? Al™ens que d i 1 1 9 1 , le roi Philippe
Augulte, le comte de Flandres, Philippe d’Alfa ce,
lome IX , " 1 '
Jean, comte de Ponthieu, Ide, comtefle de Boulogne
»Bernard, feigneur de S. Valéry, 6c Guillaume
de Caveu , confentirent conjointement d’abolir cet
ufage, qüè' d ailleurs la religion 6c l’humanité ' ont
abrogé dans toute l’Europe; Il n’en refte , à proprement
parler, que ce qu’c>n appelle en françois le y « ;
ce font les marchandifes que le maître d’un vaifleau
qmffi trouve en danger ; jette à la mer pour alléger
ion batiment, & que la mer renvoie à terre. Les
princes, Téigneurs ou peuples qui les recueillent
fe les approprient. ( D .J . )
LAGANUM, f n. ( Littér. ) mot d’Horace.. Le
laganum n’etoit point précîfément un morceau de
pâte cuite dans la graiffe , une gaufre , une crêpe
un bignet, comme traduifent nos diélionnaires. Le
laganum étoit une efpece de petit gâteau , fait avec
de la fariné, de l’huile & du miel : c’étoit-là un des
trois plats du fouper d’Horace , à ce qu’il dit ; les
deux autrës confiftoient, l’un en poireaux 6c /’autre
en feyes ; mais Horace favoit bien quelquefois
faire meilleure chere, & il paroît affez par fes écrits
qu’il s’y. connoiffoit. ( D . J. )
Galien a fait mention de .cette efpece de gâteau
groffier , de aliment, façult. lib. I . cap. iv.
LAGARIA , ( Géog. anc. ) ville ancienne de la
grande .Grece, dans le territoire des Tituriens. Cette
ville ne fubfifte plus ; le lieu où elle étoit eft defert
6c fans-habitans. ( D . J. )
LAGÉNIE, ( Géog. anc. ) nom ancien d’une des
quatre provinces de l’Irlande, qu’on appelle aujourd’hui
Leinfier. C’eft le pays où Ptolomée place les
Brigantes, les Cauques , les Blaines 6c les Ménapiens
: fes trois rivières remarquables nommées dans
Speed Ic'Shour, le Neor & le Borrao, s’appellent- à
préfent le Shannon, la Nuer & le Barrow. ( D .J . )
LAGÉNOPHORIES , C. f. p l ( L i „ i t f réjouif-
fances dWage chez le menu peuple il Alexandrie
du tems des Ptolomëès'::Cê?-rejouiffaiïèès tirblent
leur nom de lagena pne bouteille , & f i n , je pop-
te , parce que ceux qui les célébroient devôient apporter
chacun- pour leur écot chez leur hôte, un certain
nombre de bouteilles de vin pour égayer la fête
{ D .J . ) 6 J
LAGENTIUM ou LAGECIUM, ( Géog. ancien, )
ancien lieu de la grande Bretagne, félon l’itinéraire
d’Antonin, fur la route d’Yorck à Londres , à 21
mille pas de la première. Gale obferve que c’eft
préfentement Caftleford , ou plutôt Cafterford, au
confluent des rivières l’Are & la Caulder. Ilajoute
qu’on ^trouvé près de Caftlefrod un auffi grand
nombre de monnoies romaines, que fi on les y avoit
femées. ( D .J . )
LAGHI, ( Géog. ) ville de l’Arabie heureufe, vers
les côtes de la mer d’Arabie , au royaume d’Adra-
mont, à 90 mille pas d’Aden. { D . J . )
LAGIÀS, f. m. ( Commerce.) toiles peintes; qu’on
appelle, à caufe de leur perfection, lagias du Peoy,
fe fabriquent & fe vendent au Pegu. Les torpites ,
les corpis & les pentadis font inférieurs aux lagias.
LAGIDES, f. m. ( Hifl. anc. ) nom qu’on donna
aux rois grecs qui pofféderent l’Egypte après la mort
d’Alexandre. Les deux plus puiffantes monarchies
qui s’élevèrent alors , furent celle d’Egypte , fondée
par Ptolomée , fils de Lagus, d’où viennent
les Lagides, 6c celle d’Afie ou de Syrie, fondée par
Séleucus, d’où viennent les Séleucides.
LAGLYN ou LOUGHLEN, ( Géog. ) ^ ville d’Irlande
dans la province de Leinfter, au comté de
Catherlagh. Long. 1 o. 46. lat. 52.40 . ( D . J. )
LAG N I, ( Géog. ) Latiniacum , ville de l’île de
France , dans le territoire de Paris , fur laquelle on
peut confulter Longuerue ., defeription de la France.
Lagni eft à 6 lieues au-deffus de Paris, 6c à 4 de