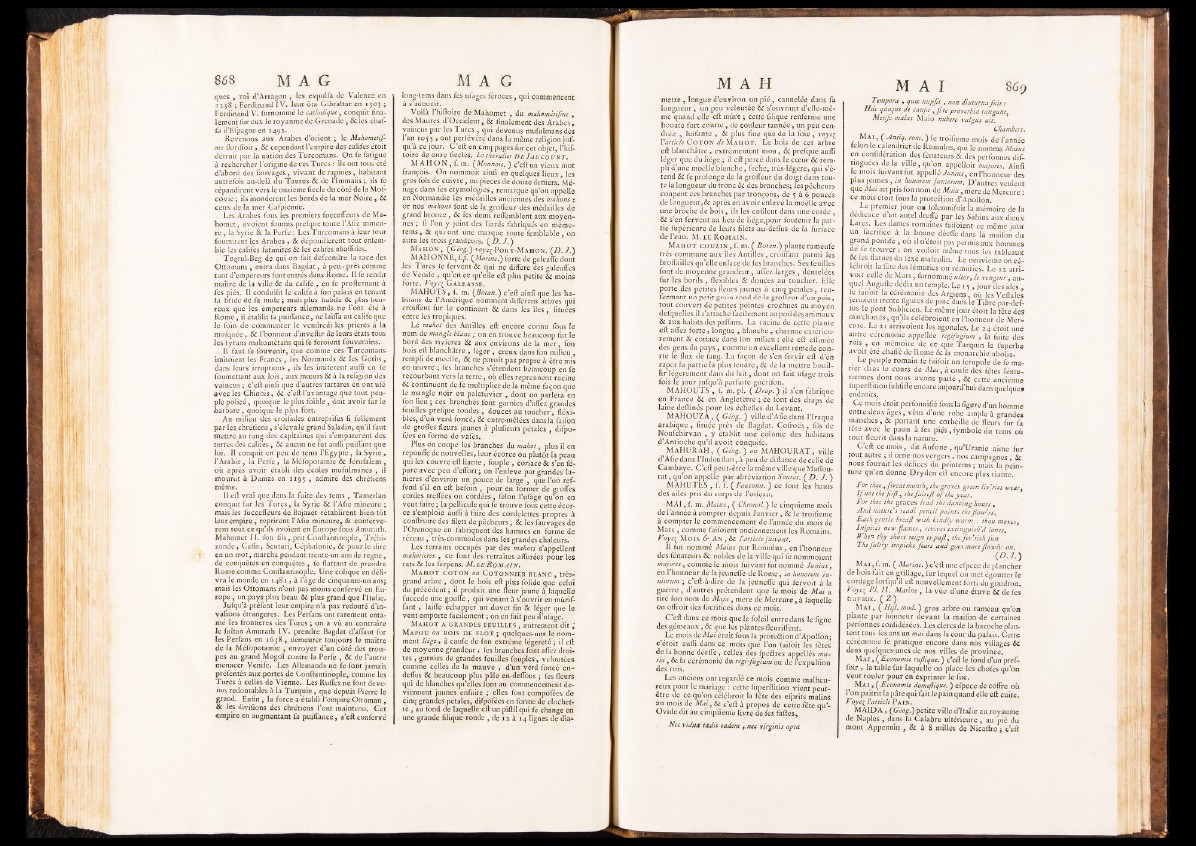
ques , roî d’Ârragon , les expulfa de Valence en
1238 ; -Ferdinand IV . leur ôta Gibraltar en 1303 ;
Ferdinand V. furnommé! e catholique, conquit finalement
fur eux le royaume de Grenade, 6c les chaf-
fa d’Efpagne en 1491.
Revenons aux Arabes d’orient ; le Mahometif-
rnc floriffoit, 6c cependant l’empire des califes étoit
détruit par la nation des Turcoriians. On fe fatigue
à rechercher l ’origine de ces Turcs : ils ont tous été
d’abord des fauvages, vivant de rapines, habitant
•autrefois au-delà du Taurus & de l’Immaüs ; ils fe
répandirent vers le onzième fiecle du côté de la Mof-
covie ; ils inondèrent les bords de la mer Noire, &
•ceux de la mer Cafpienne.
Les Arabes fous les premiers fucceffeurs de Mahomet
, avoient fournis prefque toute l’Alie mineure
, la Syrie & la Perfe : Les Turcomans à leur tour
fournirent les Arabes , & dépouillèrent tout enfem-
ble les califes fatimites & les califes abalïides.
Togrul-Beg de qui on fait defeendre la race des
Ottomans , entra dans Bagdat, à peu - près comme
tant d’empereurs font entrés dans Rome. Il fe rendit
maître de la ville 6c du calife , en fe profternant à
fes pies. Il conduilit le calife à fon palais en tenant
la bride de fa mule ; mais plus habile 6c plus heureux
que les empereurs allemands ne l’ont été à
Rome, il établit fa puiffance, ne laiffa au calife que
le foin de commencer le vendredi les prières à la
mofquéé, &: l’honneur d’inveflir de leurs états tous
les tyrans mahométans qui fe feroient fouverains.
Il faut fe fou venir, que comme ces Turcomans
âmitoient les Francs , les Normands 6c les Goths ,
dans leurs irruptions , ils les imitèrent auffi en fe
foumettant aux lois, aux moeurs & à la religion des
Vaincus ; c ’eft ainfi que d’autres tartares en ont ufé
avec les Chinois, 6c c’efl: l’avantage que tout peuple
policé, quoique le plus foible, doit avoir fur le
barbare , quoique le plus fort.
Au milieu des croifades entreprifes fi follement
par les chrétiens, s’éleva le grand Saladin, qu’il faut
mettre au rang des capitaines qui s’emparèrent des
terres des calites, 6c aucun ne fut aufli puiffant que
lui. Il conquit en peu de tems l’Egypte, la Syrie ,
l’Arabie, la Perfe, la Méfopotamie 6c Jérufalem ,
où après avoir établi des écoles mufulmanes , il
mourut à Damas en 1195 , admiré des chrétiens
même.
Il ert vrai que dans la fuite des tems , Tamerlan
conquit fur les Turc s, la Syrie 6c l’Afie mineure ;
mais les fucceffeurs de Bajazet rétablirent bien-tôt
leur empire, reprirent l’Afie mineure, & conferve-
rent tout ce qu’ils avoient en Europe fous Amurath.
Mahomet II. fon fils, prit Conftantinople, Trébi-
zonde, Caffa, Scutari, Céphalonie, 6c pour le dire
f en un mot, marcha pendant trente-un ans de régné,
de conquêtes en conquêtes , fe flattant de prendre
Rome comme Conftantinople. Une colique en délivra
le monde en 1481, à l’âge de cinquante-un ans;
mais les Ottomans n’ont pas moins confervé en Europe
, un pays plus beau 6c plus grand que l’Italie.
Jufqu’à préfent leur empire n’a pas redouté d’in-
vafions étrangères. Les Perfans ont rarement entamé
les frontières des Turcs ; on a vû au contraire
le fuitan Amurath IV. prendre Bagdat d’affaut fur
les Perfans en 1638 , demeurer toujours le maître
de la Méfopotamie , envoyer d’un côté des troupes
au grand Mogol contre la Perfe , 6c de l’autre
menacer Venife. Les Allemands ne fe font jamais
préfentés aux portes de Conftantinople, comme les
Turcs à celles de Vienne. Les Ruffes ne font devenus
redoutables à la Turquie, que depuis Pierre le
grand. Enfin, la force a établi l'empire Ottoman ,
& les divifions des chrétiens l’ont maintenu; Cet
empire en augmentant fa puiffance, s’eft confervé
long-tems dans fes ulages féroces, qui commencent
à s’adoucir.
Voilà l’hiftoire de Mahomet , du mahomètifme ,
des Maures d’Occident, 6c finalement des Arabes,
vaincus par les Turcs , qui devenus mufulmans dès
1 an 1055 > ont perfeveré dans la même religion juf-
qu à ce jour. C eft en cinq pages fur cet objet, l’hiftoire
de onze fiecles. Le chevalier d e Ja u c o ü r t .
M A .H O N ,f . m. (Monnoie. ) c’eftun vieux mot
françois. On nommoit ainfi en quelques lieux les
gros fols de cuivre, ou pièces de douze deniers. Ménage
dans fes étymologies, remarque qu’on appelle
en Normandie les médailles anciennes des mahons :
or nos mahons font de la groffeur des médailles de
grand bronze, 6c les demi reffemblent aux moyennes
; fi l’on y joint des liards fabriqués en même-
tems, & qui ont une marque toute femblable, on
aura les trois grandeurs; {D .J . )
Mahon , {Géog.) voye^ Po r t -Mahon. {D .J .)
MAH ONNE, f.jf. (Marine.) forte de galeaffe dont
les Turcs fe fervent 6c qui ne différé des galeaffes
de Venife , qu’en ce qu’elle eft plus petite 6c moins
forte. Vo ye ^ G A LE A S SE .
MAHOTS, f. m. (Botan.) c ’eft ainfi que les ha-
bitans de l’Amérique nomment différens arbres qui
croiffent fur le continent 6c dans les île s , fituées
entre les tropiques.
Le mahot des Antilles eft encore connu fous le
nom de mangle blanc ; on en trouve beaucoup fur le
bord des rivières 6c aux environs de la mer, fon
bois eft blanchâtre , léger , creux dans fon milieu ,
rempli de moelle, 6c ne paroît pas propre à être mis
en oeuvre ; fes branches s’étendent beaucoup en fe
recourbant vers la terre, où elles reprennent racine
6c continuent de fe multiplier de la même façon que
le mangle noir ou palétuvier , dont on parlera en
fon lieu ; ces branches font garnies d’affez grandes
feuilles prefque rondes , douces au toucher, fléxi-
bles, d’un verd foncé, 6c entre-mêlées dans la faifon
de groffes fleurs jaunes à plufieurs pétales , difpo-
fées en forme de vafes.
Plus on coupe les branches du mahot, plus il en
repouffe de nouvelles, leur écorce ou plutôt la peau
qui les couvre eft liante, fouple, coriace & s’en fé-
pare avec peu d’effort ; on l’enleve par grandes lanières
d’environ un pouce de large , que l’on reffend
s’il en eft befoin , pour en former de groffes
cordes greffées, ou cordées, félon l’ufage qu’on en
veut faire ; la pellicule qui fe trouve fous cette écorce
s’emploie aufli à faire des cordelettes propres à
conftruire des filets de pêcheurs, & les fauvages de
l’Orenoque en fabriquent des hamacs en forme de
rezeau, tres-commodes dans les grandes chaleurs.
Les terrains occupés par des mahots s’appellent
mahotieres , ce font des retraites aflùrées pour les
rats & les ferpens. M. l e R o m a in .
Mah o t co to n ou C otonnier blan c , très-
grand arbre , dont le bois eft plus folide que celui
du précédent ; il produit une fleur jaune à laquelle
fuccede une goufle, qui venant à s’ouvrir en mûrif-
fan t , laiffe échapper un duvet fin & léger que le
vent emporte facilement ; on en fait peu d’ufage.
Mah o t a grandes feuilles , autrement dit ;
Mapou ou bois de f lo t ; quelques-uns le nomment
liège, à caufe de fon extrême légèreté ; il eft
de moyenne grandeur, fes branches font affez droites
, garnies de grandes feuilles fouples, veloutées
comme celles de la mauve , d’un verd foncé en-
deffus 6c beaucoup plus pâle en-deffous ; fes fleurs
qui de blanches qu’elles font au commencement deviennent
jaunes enfuite ; elles fçnt compofées dé
cinq grandes pétales, difpofées en forme de clochette
, au fond de laquelle eft un piftil qui fe change en
une grande filique ronde , de 12 à 14 lignes de diamétré
, longue d’environ un p ié , cannelée dans fa
longueur, un peu veloutée 6c s’ouvrant d’elle-mê-
me quand elle eft mûre ; cette filique renferme une
houate fort courte, de couleur tannée, un peu cendrée
, luifante , & plus fine que de la foi,è , voyez
Yarticle C o to n de Ma h o t . Le bois de cçt arbre
eft blanchâtre, extrêmement mou, 6c prefque aufli
léger que du liège ; il eft percé dans le coeur 6c rempli
d’une moelle blanche, feche, très-légere, qui s’étend
6c fe prolonge de la groffeur du doigt dans toute
la longueur du tronc 6c des branches; les pêcheurs
coupent ces branches par tronçons, de 5 à 6 pouces
de longueur, & après en avoir enlevé la moëlle avec
une broche de bois, ils les enfilent dans une corde ,
6c s’en fervent au lieu de liège,pour foutenir la partie
fupérieure de leurs filets au-deffus de la furtàce
de l’eau. M. le Rom a in .
Ma h o t co u z in , f. m. ( Botan.') plante rameufe
très-commune aux îles Antilles, croiifant parmi les
broflailles qu’elle enlace de fes branches. Ses feuilles
font de moyenne grandeur, affez larges , dentelées
fur les bords , flexibles & douces au toucher. Elle
porte des petites fleurs jaunes à cinq pétales, renfermant
un petit grain rond de la groffeur d’un pois,
tout couvert de petites pointes crochues au moyen
defquelles il s’attache facilement au poil des animaux
& aux habits des paffans. La racine de cette plante
eft affez forte, longue , blanche, charnue extérieurement
& coriace dans fon milieu : elle eft eftimée
des gens du p ays, comme un excellent remede courte
le flux de lâng. La façon de s’en fervir eft d’en
râper la partie la plus tendre, & de la mettre bouillir
légèrement dans du lait, dont on fait ufage trois
fois le jour jufqu’à parfaite guérifon.
MAHOUTS , f. m. pl. ( Drap. ) il s’en fabrique
en France 6c en Angleterre,; ce font des draps de
laine deftinés pour les échelles du Levant.
MAHOUZA, ( Géog. ) ville d’Afie dans PIraque
arabique, fituée près de Bagdat Cofroëç, fils de
Noufchirvan , y établit une colonie des habitans
d’Antioche qu’il avoit conquife.
MAHURAH, {Géog.) ou MAHOURAT, ville
d’Afie dans PIndouftan, à peu de diftance de celle de
Cambaye. C ’eft peut-être la même ville queMaffou-
rat, qu’on appelle par abréviation Sourat. {D . J . )
MAHUTES , f . f. ( Fauconn. ) ce font les hauts
des ailes pris du corps de l’oifeau.
MAI, f. m. Maius, { Chronol.) le cinquième mois
de l’année à compter depuis Janvier, 6c le troifieme
à compter le commencement de l’année du mois de
Mars , comme faifoient anciennement les Romains.
Voyt{ M o is & A n ,6 c C article fuivant.
Il fut nomme Maius par Romulus, en l’honneur
des fénateurs 6c nobles de la ville qui fe nommoient
majores, comme le mois fuivant fut nommé Junius ,
en l’honneur de la jeuneffe de Rome, in honorem ju -
niorum ; c’eft-à-dire de la jeuneffe qui fervoit à la
guerre, d’autres prétendent que le mois de Mai a
tiré fon nom de Maja, mere de Mercure, à laquelle
on offroit des facrifices dans ce mois.
C ’eft dans ce mois que le foleil entre dans le figne
des gémeaux, 6c que les plantes fleuriffent.
Le mois de Mai étoit fous la protection d’Apollon ;
c’étoit aufli dans ce mois que l’on faifoit les fêtes
de la bonne déeffe, celles des fpeûres appellés mu-
ria, & la cérémonie du regi-fugium ou de l’expulfion
des rois.
Les anciens ont regardé ce mois comme malheureux
pour le mariage : cette fuperftition vient peut-
être de ce qu’on célébroit la fête des efprits malins
au mois de Mai, 6c c’eft à propos de cette fête qu’-
Ovide dit au cinquième livre de fes faites,
Nec yidute tendis eadern , nec virginis apta
Tempora , quee nupjit, non diuturna fuit :
ffac quoque de caufd rjîte proverbia tangunt,
Menfi malas Maïo nubere vulgus ait.
Chambers,
Ma i , .( Arniq. rom.■ le troifieme mois de l ’année
lelon leealendrier de Romiilus, qui le nomma Maïus
en confidéranon des fénateurs & des perfonnes dif-
tinguees de la v ille , qu’on appelloit majores, Ainfi
le mois fuivant fut appelle Junius, en l’honneur des
plus jeunes, in honorem jumarutn. D ’autres veulent
que Mai ait pris fon nom de Ma'ia, mere de Mercure :
ce mois étoit fous la protection d’Apollon.
, b e Prem^er jour o* foîemnifoit la mémoire de la
dédicacé d’un autel drefTé par les Sabins aux dieux
Lares. Les dames romaines faifoient ce même jo\ir
un facrificë à la bonne déeffe dans la maifon du
grand pontife , ou il n’etoit pas permis aux hommes
de le trouver : on voiloit même tous les tableaux
oc les ftatues du fexe mafeulin. Le neuvième on cé-
lebroit la fete des lemuries on rémuries. Le 12 arri-
voit celle de Mars, furnommé ultoryU vengeur, auquel
Augufte dédia un temple. Le 15 , jour des ides ,
le faifoit la cérémonie des Argiens, où les Veftales
jettoient trente figures de jonc dans le T ibre par-def-
lus 1© pont Sublicien. Le même jour étoit la fête des
marchands, qu ils celebroient en l’honneur de Mercure.
Le 21 arrivoient les agonales. Le 24 étoit une
autre cérémonie appellée regifugium , la fuite des
rms , en mémoire de ce que Tarquin le fuperbe
avoit été chafte dé Rome 6c la monarchie abolie.
^ Le peuple romain le faifoit un fcrupule de fe marier
dans le cours de Mai, à caufe des fêtes lému-
riennes dont nous avons parlé , 6c cette ancienne
fuperftition fubfifte encore aujourd’hui dans quelque»
endroits. 1
Ce mois étoit perfonnifié fous la figure d’un homme
entre deux âges, vêtu d’une robe ample à grande*
manches, & portant une corbeille de fleurs fur fa
tete avec le paon a fes pies, fymbole du tems où
tout fleurit dans la nature.
C ’eft ce mois, dit Aufone , qu’Uranie aime fur
tout autre ; il orne nos vergers, nos campagnes, &
nous fournit les délices du printems ; mais la peinture
qu’en donne Dryden eft encore plus riante.
For thee , fweatmonth, thegrovès green livVies wear,
Ifnot tlie firjl, tht fairejl o f tfie year.
For thee the grâces lead the dancing Jiours y
And naturels readi pencil pain 1 s thcûow'rs,
Each gentle brea(l with kindly warrru thou moves,
Infpires new famés, revives extinguis/id loves.
JFhen thy short reign is pajl, the fev’rish fun
Thefultry tropichs fears and goes more Jlowly on.
{D . J , )
Ma ï , f. m. ( Manne. ) c’eft une efpe.ee de plancher
de bois fait en grillage, fur lequel on met égoutter le
cordage lorfqu’il eft nouvellement forti du goudron.
Voye^ Pl. I I . Marine , la vûe d’une étuve 6c de fes
travaux. ( Z )
Maï , ( Hifi. mod. ) gros arbre ou rameau qu’on
plante par honneur devant la maifon de certaines
perfonnes confidérées. Les clercs de la bazoche plantent
tous les ans un mai dans la cour du palais. Cette
cérémonie fe pratique encore dans nos villages 6c
dans quelques-unes de nos villes de province.
Mai , {Economie rujlique. ) c’eft le fond d’un pref-
foir , la table fur laquelle on place les chofes qu’on
veut rouler pour en exprimer le fuc.
Mai , ( Economie domeflique. ) efpece de coffre où
l’on paitrit la pâte qui fait le pain quand elle eft cuite.
Voyeç Yarticle Pa in .
M A ID A , {Géog.) petite ville d’Italie au royaume
de Naples , dans la Calabre ultérieure , au pié du
mont Appennin , 6c à 8 milles de Nicaftro ; c’eft