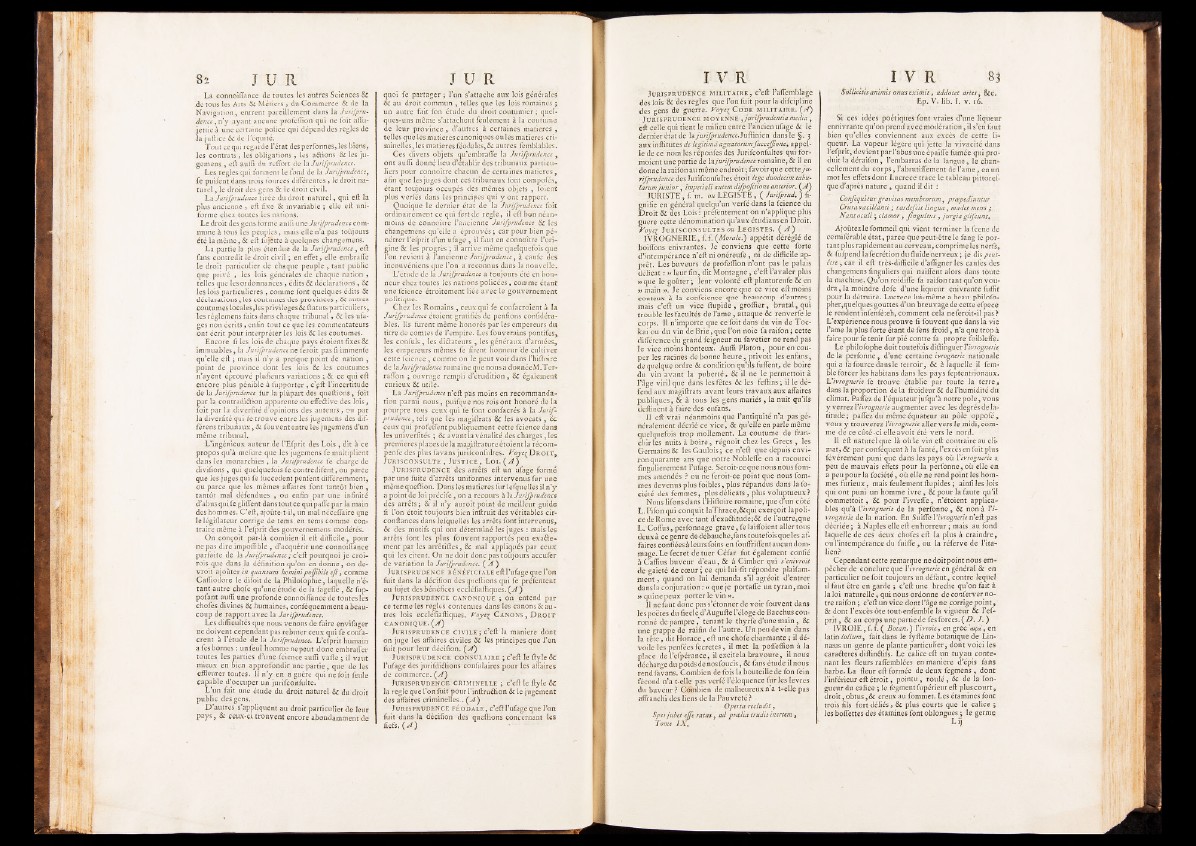
82 J U R
La connoiflance de toutes les autres Sciences &
de tous les Arts & Métiers , du Commerce & de la
Navigation, entrent pareillement dans la JunJpru-
TLetice, n’y ayant aucune profeffion qui ne foit aflu-
jettie à une certaine police qui dépend des réglés de
la juftice & de l ’équité.
Tout cequi regardeTétât des perfonnes, les biens,
les contrats , les obligations , les a étions & les jugemens
, eft aufli du reflort de la Jurijprudence.
Les règles qui forment le fond de la Jurisprudence,
fe puifent dans trois fources differentes, le droit naturel
, le droit des gens & le droit civil.
La Jurifprudence tirée du droit naturel, qui eft la
plus ancienne, eft fixe & invariable ; elle eft uniforme
chez toutes, les nations.
Le droit des gens forme aufli une Jurijprudence commune
à tous les peuples, mais elle n’a pas toujours
été la même, & eft fujltte à quelques changemens.
La partie la plus étendue de la Jurisprudence , eft
fans contredit le droit civil ; en effet, elle embraffe
le droit particulier de chaque peuple , tant public
que privé , les lois générales de chaque nation ,
telles que les ordonnances , édits & déclarations , &
les lois particulières , comme font quelques édits &
déclarations, les coutumes des provinces, & autres
coutumes locales,les privilèges & ftatuts particuliers,
les réglemens faits dans chaque tribunal, & les ufa-
ges non écrits, enfin tout ce que les commentateurs
ont écrit pour interpréter les lois & les coutumes.
Encore fi les lois de chaque pays étoient fixes &
immuables, la Jurisprudence ne feroit pas fi immenfe
qu’elle eft ; mais il n’y a prefque point de nation ,
point de province dont les lois & les coutumes
n’ayent éprouvé plufieurs variations ; & ce qui eft
encore plus pénible à fupporter , c’pft l’incertitude
de la Jurisprudence lur la plupart des queftions, foit
par la contradiétion apparente ou effeétive des lois ,
foit par la diverfité d’opinions des auteurs, ou par
la diverfité qui fe trouve entre les jugemens des dif-
férens tribunaux, & fou vent entre les jugemens d’un
même tribunal.
L’ingénieux auteur de l’Efprit des Lois , dit à ce
propos qu’à mefure que les jugemens fe multiplient
dans les monarchies , la Jurijprudence fe charge de
divifions , qui quelquefois fe contredifent,ou parce
que les juges qui fe fuecedent penfent différemment,
ou parce que les mêmes affaires font tantôt bien ,
tantôt mal défendues , ou enfin par une infinité
d’abus qui fe gliffent dans tout ce quipaffe par la main
des hommes. C’eft, ajoute-t-il, un mal néceffaire que
lelégiflateur corrige de tems en tems comme contraire
même à l’efprit des gouvernemens modérés.
On conçoit par-là combien il eft difficile, pour
ne pas dire impoffible , d’acquérir une connoiflance
parfaite de la Jurijprudence ; c’eft pourquoi je croi-
rois que dans la définition qu’on en donne, on de-
vroit ajoûter in quantum homini pojjibile ejl, comme
Caffiodore le difoit de la Philofophie, laquelle n’étant
autre chofe qu’une étude de la fagefle , & fup-
pofant aufli une profonde connoiflance de toutes les
chofes divines & humaines, conféquemment a beaucoup
de rapport avec la Jurisprudence.
Les difficultés que nous venons de faire envifager
ne doivent cependant pas rebuter ceux qui fe confa-
crent à l’étude de la Jurisprudence. L’efprit humain
a fes bornes : unfeul homme ne peut donc embrafler
toutes les parties d’une fcience aufli vafte ; il vaut
mieux en bien approfondir une partie, que de les
effleurer toutes. Il n’y en a guère qui ne foit feule
capable d’occuper un jurifconfulte.
L ’un fait une étude du droit naturel & du droit
public des gens.
D ’autres s’appliquent au droit particulier de leur
pa ys, & ceux-ci trouvent encore abondamment de
J U R
quoi fe partager ; l’un s’attache aux lois générales
& au droit commun , telles que les lois romaines ;
un autre fait l'on étude du droit coutumier ; quelques
uns même s’attachent feulement à la coutume
de leur province, d’autres à certaines matières ,
telles que les matières canoniques ou les matières criminelles,
les matières féodales, & autres femblables.
Ces divers objets qu’embrafle la Jurisprudence ,
ont aufli donné lieu d’établir des tribunaux particuliers
pour connoître chacun de certaines matières,
afin que les juges dont ces tribunaux font compofés,
étant toujours occupés des mêmes objets , foient
plus verfés dans les principes qui y ont rapport.
Quoique le dernier état de la Jurisprudence foit
ordinairement ce qui fertde réglé, il eft bon néanmoins
de connoître l’ancienne Jurisprudence &c les
changemens qu’elle a éprouvés; car pour bien pénétrer
l’efprit d’un ufage , il faut en connoître l’origine
& les progrès ; il arrive même quelquefois que
l’on revient à Y ancienne Jurijprudence, à caufe des
inconvéniens que l’on a reconnus dans la nouvelle.
L’étude de la Jurijprudence a toujours été en honneur
chez toutes les nations policées, comme étant
une fcience étroitement liée avec le gouvernement
politique.
Chez les Romains , ceux qui fe confacroient à la
Jurisprudence étoient gratifiés de penfions confidéra-
bles. Iis furent même honorés par les empereurs du
titre de comtes de l’empire. Les fouverains pontifes,
les confuls , les diétateurs , les généraux d’armées,
les empereurs mêmes fe firent honneur de cultiver
cette fcience , comme on le peut voir dans l’hiftotre
de la Jurisprudence romaine que nous a donnéeM.Ter-
raffion ; ouvrage rempli d’érudition, & également
curieux & utile.
La JurïSprudence n’eft p'as moins en recommandation
parmi nous, puifque nos rois ont honoré de la
pourpre tous ceux qui fe font confacrés à la Jurisprudence,
tels que les magiftrats & les avocats , &C
ceux qui profeflent publiquement cette fcience dans
les univerfités ; & avantla vénalité des charges, les
premières places de la magiftrature étoient la récom-
penfe des plus fa vans jurifconfultes. Poyc{ D r o it ,
Jurisconsulte , Ju s t ic e , Lo i . ( A )
Jurisprudence des arrêts eft un ufage formé
par une fuite d’arrêts uniformes intervenus fur une
même queftion. Dans les matières fur lefquelles il n’y
a point de loi précife, on a recours à la Jurijprudence
des arrêts ; & il n’y auroit point de meilleur guide
fi l’on étoit toujours bien inftruit des véritables cir-
conftances dans lefquelles les arrêts font intervenus,
& des motifs qui ont déterminé les juges : mais les
arrêts font les plus fouvent rapportés peu exactement
par les arrêtiftes, & mal appliqués par ceux
qui les’ citent. On ne doit donc pas toujours accufer
de variation la Jurisprudence. ( A )
Jurisprudence bénéficiale eftl’ufage que l’on
fuit dans la décifion des queftions qui fe préfentent
au fujet des bénéfices eccléfiaftiques. (A )
Jurisprudence canonique ; on entend par
ce terme les réglés contenues dans les canons & autres
lois eccléfiaftiques. Voye^ C a n o n s , D r o it
CANONIQUE. (A )
Jurisprudence c iv ile ; c’eft la maniéré dont
on juge les affaires civiles & les principes que l’on
fuit pour leur décifion. (-^)
Jurisprudence consu laire ; c’eft le ftyle &
l’ufage des jurifdiétions cônfulaires pour les affaires
de commerce. (^ )
Jurisprudence criminelle ; c’eft le ftyle &
la réglé que l’on fuit pour l’inftruétion & le jugement
des affaires criminelles..’{A')
Jurisprudence féo d al e , c’eft l’ufage que l’on
fuit dans la décifion des queftions concernant les
fiefs, ( A )
I V R
Jurisprudence m il it a ir e , c’eft l’affeniblagë
des lois & des réglés que l’on fuit pour la difciplihë
des gens de guerre. Voye^ ’C ode m il it a ir e . (A)
JURISPRUDENCE MOYENNE JuriSprudentiamedia ;
eft celle qui tient le milieu entre l’ancien ufage & le
dernier état de lajuriJprudence.jiÆnien dans le § . 3
aux inftitutes de légitima agnatorumSuccejfione, appelle
de ce nom lés réponfes des Jurifconfultes qui for-
moient une partie de la jurisprudence romaine j & il en
donne la raifôn au même endroit ; favoir que cette ju risprudence
des Jurifconfultes étoit lege duodecimtabu-
larumjunïot, imperiali autem diSpoJitione anterior. (A)
JURISTE, f. m. ou LÉGISTE, ( Jurifprud. ) lignifie
en général quelqu’un verfé dans la fcience du
Droit & des Lois : préfentement on n’applique plus
guere cette dénomination qu’aux étudians en Droit.
Foye[ Ju r isco n sul tes ou L ég ist e s . ( A )
IVROGNERIE, f.f. {Morale.) appétit déréglé dé
boiflons enivrantes. Je conviens que cette forte
d’intempérance n’eft ni onéreüfe, ni de difficile apprêt.
Les buveurs de profeffion n’ont pas le palais
délicat : » leur fin , dit Montagne, c’eft l’avaler plus
»que le goûter ; leur volonté eft plantureufe & en
» main ». Je conviens encore que ce vice eft moins
coûteux à la confcience que beaucoup d’autres;
mais c’eft un vice ftupide, groffier, brutal, qui
trouble les facultés de l’ame , attaque & renverfele
corps. Il n’importe que ce foit dans du vin de Toc*
kai ou du vin de B rie, que l’on noie fa raifon ; cette
différence du grand feigneur au favetier ne rend pas
le vice moins honteux. Aufli Platon, pour en couper
les racines de bonne heure, privoit les enfàns,
de quelque ordre & condition qu’ils fuflent, de boire
du vin avant la puberté, & il. ne le permettait à
l’âge viril que dans les fêtes &c les feftins ; il le défend
aux magiftrats avant leurs travaux aux affaires
publiques, & à tous les gens mariés , la nuit qu’ils
deftinent à faire des enfans.
Il eft vrai néanmoins que l’antiquité n’a pas généralement
décrié ce vice, & qu’elle en parle même
quelquefois trop mollement. La coutume de ffan*
chir les nuits à boire, régnoit chez les Grecs , les
Germains & les Gaulois ; ce n’eft que depuis envi-4
ron quarante ans que notre Nobleffe en a racourci
fingulierement l’ufage. Seroit-ce que nous nous fom-
mes amendés ? ou ne feroit-ce point que nous fom-
mes devenus plus foibles, plus répandus dans la fo-
ciété des femmes, plus délicats, plus voluptueux?
Nous lifons dans l’Hiftoire romaine, que d’un côté
L. Pifon qui conquit laThrace,&qui exerçoit lapoli*
cedeRome avec tant d’exattitude;& de l’autre,que
L . Coflus, perfonnage grave, fe laiffoient aller tous
deux à ce genre de débauche,fans toutefois que les affaires
confiées à leurs foins en fouffriffent aucun dommage.
Le fecret de tuer Céfar fut également confié
à Caffius buveur d’eau, & à Cimber qui s'enivroit
de gaieté de coeur; ce qui lui-fit répondre plaifam-
ment, quand on lui demanda s’il agréoit d’entrer
dans la conjuration: «que je portafle un tyran, moi
»qui ne peux porter le vin ».
Il ne faut donc pas s’étonner de voir fotrvent dans
les poëtes du fiecle d’Augufte l’éloge de Bacchus couronné
de pampre,* tenant le thyrfe d’une main, &
une grappe de raifin de l ’autre. Un peu de vin dans
la tête, dit H orace, eft une chofe charmante ; il dévoile
les penfées fecretes, il met la pofleffion à la
place de l’efpérance, il excite la bravoure, il nous
décharge du poids de nos foucis, & fans étude il nous
rend fa vans. Combien de fois la bouteille de fon fein
fécond n’a t-elle pas verfé l’éloquence fur les levres
du buveur ? Combien de malheureux n’a t-elle pas
affranchi des liens de la Pauvreté ?
O per ta recludit,
Spes jubet ejft ratas, ad preelia trudit inertem ,
Tome IX ,
I V R 83
Süllicitis animis onuseximit, addocet artes, & c .
Ep. V j lib. I. v . 16.
Si ces idées poétiques font vfaies d’une liqueur
ennivraUte qu’on prend avec modération, il s’en faut
bien qu’elles conviennent aux excès de cette liqueur.
La vapeur légère qui. jette la vivacité dans
l’efprit, devient par l’abus une épaiffe fumée qui pro*
duit la déraifon, l’embarras de la langue, le chan*
cellement du corps, l’abrutiffement de Famé, en un
mot lés effets dont Lucrèce trace le tableau pittoresque
d’après nature, quand il dit i
ÇonSequitur gravitas membrorùm, proepediuntur
Cturavacillanti ; tardeScit lingua, madet mens $
Nant oculi ; clamor , Jingultus , jurgia gliScunt* ■,
Ajôûtezlefommeil qui vient terminer la feene dé
cemiférable état, parce que peut-être le fang fe portant
plus rapidement au cerveau, comprime les nerfs,
& fufpend la fecrétion du fluide nerveux; je dis peut-
être , car il eft très-difficile d’affigner les; caùfes des
changemens finguliers qui naiffent alors dans toute
la machine. Qu’on roidifle fa raifon tant qu’on voudra
, la moindre dofe d’une liqueur enivrante fuffit
pour la détruire. Lucrèce lui-même a beau philofo-
pher,quelques gouttes d’ un breuvage de cette efpece
le rendentinfenféreh,comment cela neferoit-il pas?
L’expérience nous prouve fi fouvent que dans là vie
l’ame la plus forte étant de fens froid, n’a que trop à
faire pour fe tenir fur pié contre fa propre foiblefféi
Le philofophe doit toutefois diftinguer Y ivrognerie
de la perfonne, d’une certaine ivrognerie nationale
quia fafourcedansle terroir, & à laquelle il fem-
ble forcer les habitans dans les pays feptentrionaux.
Uivrognerie fe trouve établie par toute la terre >
dans la proportion de la froideur & de l’humidité du
climat* Paflez de l’équateur jufqu’à notre pôle j vous
y verrez Y ivrognerie augmenter avec les degrés delà*
titude; paflez du même équateur au pôle oppofé,
vous y trou verez Yivrognerie aller vers le midi, comme
de ce côté-ci elle a voit été vers le nord.
Il eft naturel que là où le vin eft contraire au climat,
& par conféquent à la fanté, l’excès en foit plus
févérement puni que dans les pays où Yivrognerie a
peu de mauvais effets pour la perfonne, où elle en
a peu pour la fociété, où elle ne rend point les hommes
furieux, mais feulement ftupides ; ainfi les lois
qui ont puni un homme iv r e , & pour la faute qu’il
commettoit, & pour l’ivrelîe , n’étoient applicables
qu’à Yivrognerie de la perfonne, & non à IV-
vrognerie de la nation. En Suifle Yivrognerie n’eft pas
décriée ; à Naples elle eft en horreur ; mais vau fond
laquelle de ces deux chofes eft la plus à craindre,
ou l’intempérance du fuifle, ou la réferve de l’italien?
Cependant cette remarque nedoitpointnous empêcher
de conclure que Yivrognerie en général & en
particulier ne foit toujours un défaut, contre lequel
il faut être en garde ; c’eft une breche qu’on fait à
la loi naturelle, qui nous ordonne de cooferver notre
raifon ; c’eft un vice dont l’âge ne corrige point,
& dont l’excès ôte tout-enfemble la vigueur & l’efprit
, & au corps une partie de fes forces. (Z). /. )
IVROIE, f. f. ( Botan.') Yivroie, en grec a/pa, en
latin lolium, fait dans le lyftème botanique de Lin-
næus un genre de plante particulier, dont voici les
cara&eres diftinâifs. Le calice eft un tuyau contenant
les fleurs raflemblées en maniéré d’épis fans
barbe. La fleur eft formée de deux fegmens , dont
l’inférieur eft é troit, pointu , roulé , & de la longueur
du calice ; le fegmentfupérieur eft plus court,
droit, obtus, & creux au fommet. Les étamines font
trois fils fort déliés , & plus courts que le calice ;
les bolfettes des étamines font oblongues ; le germe