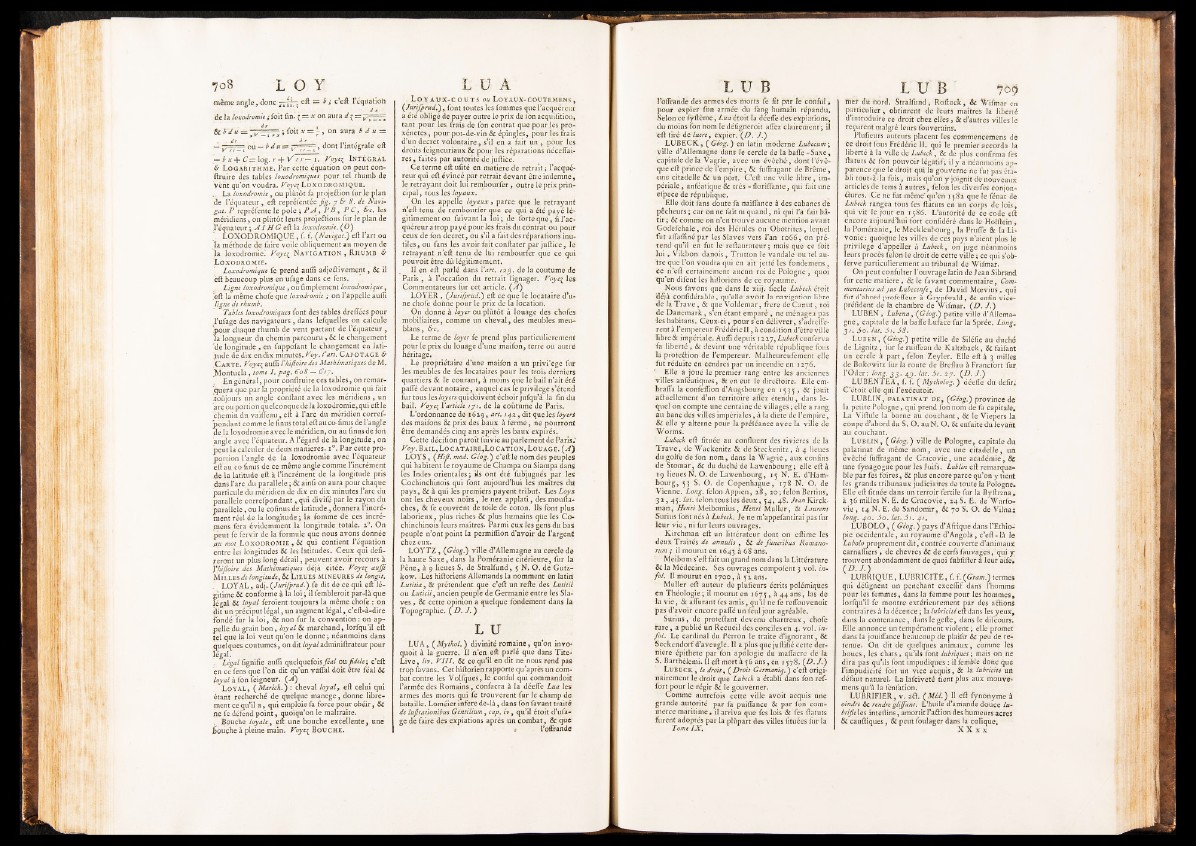
7°8 L O Y
même angle, donc d u ell == b ,* c’eft l’éqitatioh
Üe la loxodromie ; foit fin. { = x on aura d^ = )7 fZ~ x
dx - • tc F d u == ; loït * = - , On aura b d u =
. dr . d r *~'î?77==7 ou b d uzz p rrfi~-, dont l’intégrale eft
— £ 77 + £ = log. r -f V/ r r — i . Voyt{ INTÉGRAL
& Logarithme. Par cette équation on peut con-
ftruire des tables loxodromiques pour tel rhumb de
vërif qu’on voudra. Loxodromique.
.. La Loxodromie, ou plutôt fa projeftion fur le plan
de l’équateur,. eft repréfentée fig. y & 8. de Navi-
[gat. P repréfente le pôle ; P A , P B , P C , &c. les
méridiens, ou plutôt leurs projetions fur le plan de
i’équateur ; A I H G eft la loxodromie. (O)
LOXODROMIQUE, f. f. (Navigue.) eft l’art ou
la méthode de faire voile obliquement au moyen de
la loxodromie. Voye^ Navigation , Rhumb &
L oxodromie.
Loxodromique fe prend aufli adje&ivement, & il
eft beaucoup plus en ufage dans ce fens.
Ligne loxodromique, ou fimplement loxodromique,
eft la même chofe que loxodromie ; on l’àppelle aufli
ligne de rhumb.
Tables loxodromiques font des tables dreflees pour
l’ufage des navigateurs, dans lefquelles on calcule
pour chaque rhumb de vent partant de l’équateur ,
la longueur du chemin parcouru, & le changement
"de longitude, en fuppofant le changement en latitude
de dix endix minutes. P"oy. l'art. Capotage &
.CARTE.Voyt{ aufli Phifloire des Mathématiques de M.
Montucla, tome I. pag. Co8 — Ciy.
' En général, pour conftruire ces tables, on remarquera
que par la propriété de la loxodromie qui fait
Toujours un angle confiant avec les méridiens , un
arc ou portion quelconque de la loxodromie, qui eft le
chemin du vaifleau, eft à l’arc du méridien corref-
jpondant comme le finus total eft au co-finus de l’angle
de la loxodromie avec le méridien, ou au finus de fort
angle avec l’équateur. A l’égard de la longitude, on
peut la calculer .de deux maniérés. i°. Par cette proportion
l’angle de la loxodromie avec l’équateur
eft au co finus de ce même angle comme l’incrément
de la latitude eft à l’incrément de la longitude pris
dans l’arc du parallèle ; & ainfi on aura pour chaque
particule du méridien de dix en dix minutes l’arc du
parallèle correfpondant, qui divifé par le rayon du
parallèle, ou le cofinus de latitude, donnera l’incrément
réel de la longitude ; la fomme dé ces incré-
mens fera évidemment la longitude totale. 2°. On
peut fe fervir de la formule que nous avons donnée
.au mot Loxodromie , & qui contient l’équation
entre les longitudes & les latitudes. Ceux qui defi-
reront un plus long détail, peuvent avoir recours à
Yhijloire des Mathématiques déjà citée. Voye[ auffi
Milles de longitude, & Lieues mineures de longit.
. LOYAL, adj. (Jurifprud.) fe dit de ce qui eft légitime
& conforme à la loi ; il fembleroit par-là que
légal & loyal feroient toujours la même chofe : on
dit un préciput légal, un augment légal, c’eft-à-dire
fondé fur la loi, & non fur la convention : on appelle
du grain bon, loyal & marchand, lorfqu’il eft
tel que la loi veut qu’on le donne ; néanmoins dans
quelques coutumes, on dit loyaladminiftrateur pour
fp gs
, Légal fignifie aufli quelquefois féal ou fidele ; c’eft
en ce fens que l’on dit qu’un vaflal doit être féal &
loyal à fon feigneur. (A)
Loyal, (Maréch.) : cheval loyal, eft celui qui
étant recherché de quelque manege, donne librement
ce qu’il a , qui emploie fa force pour obéir, &
ne fe défend point, quoiqu’on le maltraite,
f Bouche loyale , eft une bouche excellente, une
bouche à pleine main. Voye^ Bouche.
L U A
. L o y a u x - c o û t s ou L o y a u x - c o u t e m e n s ,
(Jurifprud.), font toutes les fommes que l’acquéreur
a été obligé de payer outre le prix de ion acquifition,
tant pour les frais de fon contrat que pour les proxénètes,
pour pot-de-vin & épingles, pour les frais
d’un decret volontaire, s’il en a fait un , pour les
droits feigneurianx & pour les réparations néceflai-
res , faites par autorité de juftice.
Ce terme eft ufité en matière de retrait ; l’acquéreur
qui eft évincé par retrait devant être indemne,
le retrayant doit lui rembourfer , outre lê prix principal,
tous les loyaux.
On les appelle loyau x, parce que le retrayant
rt’eft tenu de rembourfer que ce qui a été payé légitimement
ou fuivant la loi ; de forte que, fi l’acquéreur
a trop payé pour les frais du contrat ou pouf
ceux de fon decret, ou s’il a fait des réparations inutiles
, ou fans les avoir fait conftater par juftice, le
retrayant n’eft tenu de lui rembourfer que ce qui
pouvoit être du légitimement.
Il en eft parlé dans Y art. 12$. de la coutume de
Paris, à l ’occafion du retrait lignager. Voyeç les
Commentateurs fur cet article. (A )
LO YE R , (Jurifprud.) eft ce que le locataire d’une
chofe dohne pour le prix de la location.
On donne à loyer ou plutôt à louage des chofes
mobiliaires, comme un cheval, des meublés meu-
blans, &c.
. Le terme de loyer fe prend plus particulièrement
pour le prix du louage d’une maifon, terré ou autre
héritage.
Le propriétaire d’une maifon a un privi'ege fur
les meubles de fes locataires pour les trois derniers
quartiers & le courant, à moins que le bail rt’ait été
pafle devant notaire, auquel cas le privilège s’étend
fur tous les loyers qui doivent échoir jufqü’à la fin du
bail, f^oyei Y article ly i. de la coutume dé Paris.
L’ordonnance de ’1619, art. 1 4 2 , dit que les loyers
des maifons & prix des baux à fermé, né pourront
être demandés cinq ans après les bàüx expirés.
Cette décifion paroît fuivie au parlement de Paris.’
Voy. B a i l , L o c a t a i r e , L o c a t i o n , L o u a g e . ( A )
LO Y S , (Hijl. mod. Géog.) c’eft le nom des peuples
qui habitent le royaume de Champa ou Siàmpa dans
les Indes orientales; Us ont été fubjugués par les
Cochinchinois qui font aujourd’hui les maîtres du
pays, & â qui les premiers payent tribut. Les Lôys
ont les cheveux noirs, le nez applâti, des moufta*
ches, & fe couvrent de toile de coton. Ils font plus
laborieux, plus riches & plus humains qtte les Cochinchinois
leurs maîtres. Parmi eux les gens du bas
peuple n’ont point la permiflion d’avoir de l’argent
chez eux.
L O Y T Z , (Géog.) ville d’Allemagne au cercle de
la haute Saxe, dans la Poméranie citérieure, fur la
Pêne, à 9 lieues S. de Stralfund, 5 N. O. de Gutz-
kow. -Les hiftoriens Allemands la nomment en latin
Lutitia, & prétendent que c’eft un refte des Lutitii
ou Luticii, ancien peuple de Germanie entre les Slaves
, & cette opinion a quelque fondement dans la
Topographie. ( D . J . )
L U
LU A , ( Mythol. ) divinité romaine, qu’on in vô*
quoit à la guerre. Il n’en eft parlé que dans Tite-
L iv e , liv. V I I I . & ce qu’il en dit ne nous rend pas
trop fa vans. Cet hiftorien rapporte qu’après un combat
contre les Volfques, le conful qui commandoit
l’armée des Romains, confacra à la déefle Lua lesr
armes des morts qui fe trouvèrent fur le champ de
bataille. Loméier inféré de-là, dans fon favant traité
de lujlradonibus Gentilium, cap. i v , qu’il étoit d’ufa-
ge de faire des expiations après un combat, & que
t l’offrande
L U B
l’offrande des armes des morts fe fit par le cônful -,
pour expier fon armée du fane humain répandu.
Selon ce fyftème, Lua étoit la deefle des expiations,
du moins îbn nom le défigneroit aflëz clairement ; il
eft tiré de luere, êxpier. (D . J.)
LUBECK, ( Géog.) en latin moderne Lubecum\
ville d’Allemagne dans le cercle de la baffe-Saxe,
capitale de la Vagrié, avec un évêché, dont l’évêque
eft prince de l’empire, SC fuffragant de Brême >
une citadelle & un port. C’eft une ville libre, impériale
, anféatique & très - floriflante, qui fait une
efpece de république.
Elle doit fans doute fa naiflance à des cabanes de
pêcheurs ; car on ne fait ni quand, ni qui l’a fait bâtir;
& comme on n’en trouve aucune mention avant
Goçlefchale, roi des Héhlles ou Obotrites, lequel
fut aflafliné par les Slaves Vers l’an 1066, on prétend
qü’il en fut le reftaurateur ; mais que ce foit
lu i, Vikbon danois , Trutton le vandale ou tel autre
que l’on voudra qui en ait jette les fondemens,
ce n’eft certainement aucun roi de Pologne , quoi
qu’en difent les hiftoriens de ce royaume.
Nous favons que dans le xiij. fiecle Lubeck étoit
déjà confidérable, qu’elle avoit la navigation libre
de la Trave, & que Voldemar, frere de Canut, roi
de Danemark, s’en étant emparé , ne ménagea pas
feshabitans. Ceux-ci, pour s’en délivrer, s’adreffe-
rent à l’empereur Frédéric II, à condition d’être ville
libre & impériale. Aufli depuis 1227, Lubeckconferva
fa liberté, & devint une véritable république fous
la protedion de l’empereur. Malheureufement elle
fut réduite en cendres par un incendie en 1276.
Elle a joué le premier rang entre les anciennes
villes anféatiques, & en eut le dire&oire. Elle em-
brafla la confeflion d’Augsbourg en 1535 , & jouit
aftuellement d’un territoire a.ffez étendu, dans lequel
on compte une centaine de villages ; elle a rang
au banc des villes impériales, à la diete de l’empire,
& elle y alterne pour lapréléance avec la ville de
"Wortns.
Lubeck eft fituée au confluent des rivières de la
Trave, de"Wackenitz & de Steckenitz, à 4 lieues
du golfe de fon nom, dans la Wagrie, aux confins
de Stomar, & du duché de Lawenbourg; elle eft à
19 lieues N. O. de La^enbourg, 15 N. E. d’Hambourg,
53 S. O. de Copenhague, 178 N. O. de
Vienne. Long, félon Appien, 28, 20 ; félon Bertitis,
3 2,45 . lac. félon tous les deux, 54, 48. Jean Kirck-
man, Henri Meibomius, Henri Muller, & Laurent
Surius font nés à Lubeck. Je ne m’appefantirai pas fur
leur v ie , ni fur leurs ouvrages.'
Kirchman eft un littérateur dont on eftime les
deux Traités de annulis , & de funeribus Romano-
rum ; il mourut en 1643 ^ ans*
Meibom s’eft fait un grand nom dans la Littérature
& la Médecine. Ses ouvrages compofent 3 vol. infol.
Il mourut en 1700, à 52 ans.
Muller eft auteur de plufieurs écrits polémiques
en Théologie ; il mourut en 1675 » ^ 44 ans, las de
la vie, & a durant fes amis, qu’il ne fe reflouvertoit
pas d’avoir encore pafle un fëul jour agréable.
Surius, de proteftant devenu chartreux, chofe
Fare, a publié un Recueil des conciles en 4. vol. infol.
Le cardinal du Perron le traite d’ignorant, &
Seckendorf d’aveugle. Il a plus que juftifié cette dernière
épithete par fon apologie du maflacre de la
S. Barthélemi. Il eft mort à 56 ans, en 1578. (D. J .)
L u b e c k , le droit, (Droit Gérmaniq.) c’eft originairement
le droit que Lubeck a établi dans fon ref-
fort pour le régir & le gouverner.
Comme autrefois cette ville avoit acquis une
grande autorité par fa puiflance & par fon commerce
maritime, il arriva que fes lois & fes ftatuts
furent adoptés par la plûpart des villes fituées fur la
Tome IX .
L U B 709 fttelf du ftord. Stralfund ^ Roftock, & 'Wifmâr en
particulier, obtinrent de leurs maîtres la liberté
d’introduire ce droit chez elles, & d’autres villes le
reçurent malgré leurs fouverains.
Plufieurs auteurs placent les commencernens de
Ce droit fous Frédéric II. qui le premier accorda Iâ
liberté à la ville de Lubeck, & de plus confirma fes
ftatuts & fon pouvoir légatif; il y a néanmoins apparence
que le droit qui la gouverne ne fut pas éta*
bli tout-à-la fois, mais qu’ort y joignit de nouveaux
articles de tems à autres, félon les diverfes conjon*
élures. Ce ne fut même'qu’en 1582 que le fénat de
Lubeck rangea tous fes ftatuts en un Corps de lois,
qui vit le. jour en 1586. L’autorité de ce code eft
encore aujourd’hui fort cortfidéré dans le Holftein j
la Poméranie, le Mecklenbourg, la Prufîe & la Livonie
: quoique les villes de Ces pays n’aient plus lê
privilège d’appeller à Lubeck, on juge néanmoins
leurs procès félon lé droit de cette ville ; ce qui s’ob-
ferve particulièrement au tribunal de Wifinar.
On peut confulter l’Ouvrage latin de Jean Sibrand
fur cette matière, & le favant commentaire, Com*
mentarius ad ju s Lubecenfe, de David Mcevius, qui
fut d’abord profèfleur à Grypfivald, & enfin vice-
préfident de la chambre de Wifmar. (D . J.)
LUBEN, Lubena, (Géog.) petite ville d’Allemagne,
capitale de la bafleLuface fur la Sprée. Long.
3 / . 5 ô. lat. St. 58.
L u b e N , (Géog.) petite ville de Siléfie au duché
de Lignite, fur le ruifleau de. Kaltzback, & faifant
un cercle à pajrt, félon Zeyier. Elle eft à 3 milles
de Bokowitz fur la route de Breflau à Francfort fur
l’Oder: /C/rg. 33. 49. lat. S i. 5.y. (D . J .j
LUBENTEA, f. f. (Mytholog.) déefle du defir.'
C ’étoit elle qui l’exécutoir.
LUBLIN, p a l a t i n a t d e , (Géog.) province d e
la. petite Pologne ,,qui prend fon nom de fa capitale.
La Viftule la borne au couchant, & le Viepers la
Coupe d’abord du S. O. au N. O. & enfuite du levant
au couchant. .
L u b l i n , (Géog.) ville de Pologne, capitale du
palatinat de même nom, avec une citadelle, un
évêché fuffragant de Cracovie, une académie, àc
une fynagogue pour les Juifs. Lublin eft remarquable
par fes foires, & plus encore parce qu’on y tient
les grands tribunaux judiciaires de toute la Pologne.
Elle eft fituée dans un terroir fertile fur la Byftrzna,
à 36 milles N. E. de Cracovie, 24 S. E. de Warfo-
vie f 14 N. E. de Sandomir, 6t 70 S. O. de Vilna;
long. 40. Sô. lat. S i. 41.
LUBOLO, ( Géog.) pays d’Afrique dans l’Ethiopie
occidentale, au royaume d’Angola, c’eft-là le
Lubolo proprement dit, contrée couverte d’animaux
carnafliers, de chevres & de cerfs fauvages,’qui y
trouvent abondamment de quoi fubfifter a leur aife.
WÊË mm I LUBRIQUE, LUBRICITÉ, f. f. (Gram.) termes
qui déûgnent un penchant eiceflif dans l’homme
pô'ur les femmes, dans la femme pour les hommes,
lôrfqu’il fe montre extérieurement par des aélions
contraires à la décence ; la lubricité eft dans les yeux,
dans la contenance, dans le gefte, dans le difeours.
Elle annonce un tempérament violent ; elle promet
dans la jôüiflanee beaucoup de plaifir & peu de retenue.
On dit de quelques animaux, comme les
boucs, les chats, qu’ils font lubriques; mais on ne
dira pas qu’ils font impudiques : il femble donc que
l’impudicité foit un vice acquis, & la lubricité urt
défaut naturel. La lafeiveté tient plus aux mouve*
mens qu’à la fenfation.
LUBRIFIER, v. aâ. (Méd.) Il eft fynonyme à
oindre & rendre glijfant. L’huile d’amande douce lubrifie
les inteftins, amortit l’aélion des humeurs acres
& cauftiques, & peut foülager dans la colique.
X X x x