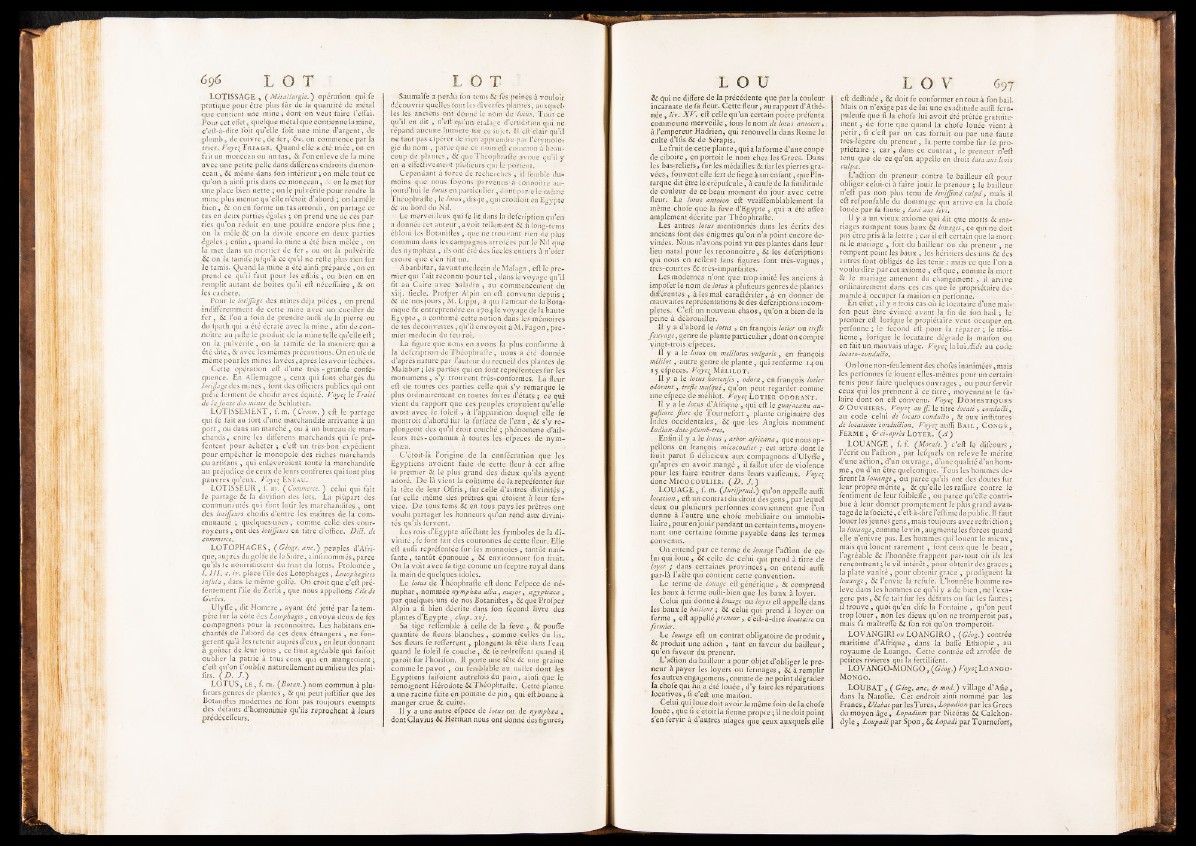
LOTISSAGE , ( Métallurgie. ) opération qui Te
pratique pour être plus lur de la quantité de métal
<|ue contient une mine, dont on veut faire l’effai.
Pour cet effet, quelque métal que contienne la mine,
c’eft-à-dire foit qu’elle foit une mine d’argent, de
plomb, de cuivre, de fer, &c. on commence par la
trier. Faye{TRi\GE. -Quand elle a été triée , on en
fait un monceau ou un tas, & l’on enleve de: la mine
avec une petite pelle dans différens endroits du monceau
, 6c même dans fon intérieur ; on mêle tout ce
•qu’on a ainfi pris dans ce monceau, & on le met fur
une place bien nette ; on le pulvérife pour rendre la
mine plus menue qu’elle n’étoit d’abord ; on la mêle
bien, & on en forme un tas arrondi, on partage ce
tas en deux parties égales ; on prend une de ces parties
qu’on réduit en une poudre encore plus fine ;
on la mêle 6c on la divife encore en deux parties
■ égales ; enfin, quand la mine a été bien mêlée, on
la met dans un mortier de fer, ou on la pulvérife
6c on la tamife jufqu’à ce qu’il ne relie plus rien fur
le'tamis. Quand la mine a été ainfi préparée ,on en
■ prend ce qu’il faut pour les effais , ou bien on en
remplit autant de boîtes qu’il efl néceffaire , & on
les cacheté.
Pour le lotijfage des mines déjà pilées , on prend
■ indifféremment de cette mine avec un cueiller de
fer , 6c Con a foin de prendre aufii de la pierre ou.
du Ipath qui a été écralé avec la mine , afin de con-
noître au juffe le produit de la mine telle qu’elle ell ;
on la pulvérife , on la tamife de la maniéré qui a
été dite, & avec les mêmes précautions. Onenufede
même pour les mines lavées, après les avoir féchées.
Cette opération eft d’une très - grande confé-
quence. En Allemagne , ceux qui font chargés du
lotijjage des mines, font des officiers publics qui ont
prêté ferment de choifir avec équité. Foye[ le Traité
de lafonte des mines de Schlutter.
LOTISSEMENT, f. m. ( Comm.) eft le partage
qui fe fait au fort d’une marchandife arrivante à un
port, ou dans un marché , ou à un bureau de marchands
, entre les différens marchands qui fe pré-
fentent pour acheter ; c’eft un très-bon expédient
pour empêcher le monopole des riches marchands
pu artifans , qui enleveroient toute la marchandife
au préjudice de ceux de leurs confrères qui font plus
pauvres qu’eux, /''oye.ç Eneau.
LOTISSEUR, f. m. ( Commerce. ) celui qui fait
le partage 6c la divifion des lots. La plupart des
communautés qui font lotir les marchandifes , ont
des lotijfeurs choifis d’entre les maîtres de la communauté
; quelques-unes, comme celle des cour-
royeurs, ont des lotijfeurs en titre d’office. Dicl, de
commerce.
LOTOPHAGES, ( Géogr. anc.) peuples d’Afrique,
auprès du golfe de la Sidre, ainfi nommés, parce
qu’ils fe nounilfoient du fruit du lotus. Ptolomée ,
1. 111. c. iv. place l’île des Lotophages , Lotophagites
infula, dans le même golfe. On croit que c’eft pré-
fentement l’île de Zerbi, que nous appelions T île de
Gerbes.
Ulyffe, dit Homere, ayant été jette par la tempête
fur la côte des Lotophages, envoya deux de fes
compagnons pour la reconnoître. Les habitans enchantés
de l ’abord de ces deux étrangers , ne fon-
gerent qu’à les retenir auprès d’eux, en leur donnant
à goûter de leur lotus , ce fruit agréable qui faifoit
oublier la patrie à tous ceux qui en mangeoient ;
c’eft qu’on l’oublie naturellement au milieu des plai-
firs. (D . J.)
LOTUS, l e , f. m. (Botan.) nom commun à plu-
fieurs genres de plantes , & qui peut juftifier que les
Botaniftes modernes ne font pas toujours exempts
des défauts d’hoxnonimie qu’ils reprochent à leurs
prédéceffeurs.
Saumaife a perdu fon tems 6c fes peines à vouloir
découvrir quelles font les diverfes plantes, auxqueb
les les anciens ont dpnné le nom de 'lotus. Tout ce
qu’il en dit , n’eft qu’un étalage d’érudition qui ne
répand aucune lumière fur çe fujet. Il eft ciàir qu’il
ne faut pas efpérer de rien apprendre par l’éîÿmolo?
gie du nom , parce que ce nom eft commun à beaucoup
de plantes, 6c que Théophrafte avoue qu’il y
en -a effeûivement plufièurs qui le portent.
Cependant à force de recherches , il femble du-
moins que nous foyons parvenus*à connoître aujourd’hui
le lotus en particulier, dont parle le même
Théophrufte, le lotus, dis-je, quieroiffoit en Egypte
6c au bord du Nil.
Le merveilleux qui fe lit dans la defeription qu’en
a donnée cet auteur, atfoit tellement 6c fi long-tems
ébloui les Botaniftes -, que ne trouvant rien de plus
commun dans les campagnes arrofées par le Nil que
des nymphæa , ils ont été des liecles entiers à n’ofer
croire que c’en fût un.
Abanbitar, lavant médecin deMalaga , eft le premier
qui l’ait reconnu pour tel, dans le voyage qu’il
fit au Caire avec Saladin , au commencement du
xiij. fiecle. Profper Alpin en eft convenu depuis ;
6c de nos jours, M. Lippi, à qui l’amour de la Botanique
fit entreprendre en 1704 le voyage de la haute
Egypte , a confirmé cette notion dans les mémoires
de les découvertes, q’ü’il envoyoit à M. Fagon, premier
médecin du feu roi.
La figure que nous en avons la plus conforme à
la delcription de Théophrafte , nous a été donnée
d’après nature par l’auteur du recueil des plantes de
Malabar ; les parties qui en font repréfentées fur lés
monumens , s’y trouvent très-conformes. La fleur
eft de toutes ces parties celle qui s’y remarque le
plus ordinairement en toutes fortes: d’états ; ce qui
vient du rapport que ces peuples croy oient qu’elle
a voit avec le foleil , à l’apparition duquel elle fe
montroit d’abord fur la furface de l’eau , 6c s’y re-
plongeoit dès qu’il étoit couché ; phénomène d’ailleurs
très-commun à toutes les efpeces de nym-
phæa.
C’étoit-Ià l’origine de la conféeration que les
Egyptiens avoient faite de cette fleur à cet aftre
le premier & le plus grand des dieux qu’ils ayent
adoré. De là vient la coûtume de la repréfènter fur
la tête de leur Ofiris, fur celle d’autres divinités ,
fur celle même des prêtres qui étoient à leur fer-
vice. De tous tems & en tous pays les prêtres ont
voulu partager les honneurs qu’on rend aux divinités
qu’ils fervent.
Les rois d’Egypte affedant les fymboles de la di-i
vinité, fe font fait des couronnes de cette fleur. Elle
eft aufli repréfentée fur les monnoies , tantôt naif-
fante, tantôt épanouie , 6c environnant fon fruit.
On la voit avec fa tige comme un feeptre royal dans
la main de quelques idoles.
Le lotus de Théophrafte eft donc l’efpece de nénuphar
, nommée nymphæa alba, major, cegyptiaca ,
par quelques-uns de nos Botaniftes, & que Profper
Alpin a fi bien décrite dans fon fécond livre des
plantes d’Egypte , chap. xvj.
■ Sa tige reffemble à celle de la feve , 6c pouffe
quantité de fleurs blanches , comme celles du lis..
Ses fleurs fe refferrent, plongent la tête dans l ’eau
quand le foleil fe couche, & fe redreffent quand il
paroît fur l ’horifon. Il porte une tête 6c une graine
comme le pavot, ou femblable au millet dont les
Egyptiens faifoient autrefois du pain, ainfi que le
témoignent Hérodote & Théophrafte. Cette plante
a une racine faite en pomme de pin, qui eft bonne à
manger crue 6c cuite.
Il y a une autre efpece de lotus ou. de nymphæa ,
dont Cluyius 6c Herman nous ont donné des figures,
& qui ne différé de la précédente que par la couleur
incarnate de fa fleur. Cette fleur, au rapport d’Athé*.
née, liv. XI>r. eft celle qu’un certain poète préfenta
comme une merveille, fous le nom de lotus antoien,.
à l’empereur Hadrien, qui renouvella dans Rome le
culte d’Ifis & de Sérapis.
Le fruit de cette plante, qui a la forme d’une coupe
de ciboire, en portoit le nom chez les Grecs. Dans
les bas-reliefs, fur les médailles & fur les pierres gravées
, fouvent elle fert de fiege à un enfant, que Plutarque
dit être lé crépufcule, à caufe de la fimilitude
de couleur de ce beau moment du jour avec cette
fleur. Le lotus antoien eft vraiffemblablement la
même chofe que la fève d’Egypte , qui a été affez
amplement décrite par Théophrafte.
Les autres lotus mentionnés dans les écrits des
anciens font des énigmes qu’on n’a point encore devinées.
Nous n’avons point vu ces plantes dans leur :
lieu natal pour les reconnoître, & les deferiptions
qui nous en reftént fans figures font très-vagues,
très-courtes 6ç très-imparfaites.
Les modernes n’ont que trop imité les anciens à
impofer le nom de lotus à plufièurs genres dé plantés
différentes , à les mal caraétérifer, à en donner de.
mauvaifes repréfentations & des deferiptions incomplètes.
C’eft un nouveau chaos, qu’on a bien de là
peine à débrouiller.
Il y a d’abord le lotus , en françois lotïer ou trefle
fauvage, genre de plante particulier, dont on compte
vingt-trois efpeces.
Il y a le lotus ou rnelilotus vulgaris, en françois.
mélilot ,• autre genre de plante, qui renferme 14011
15 efpeces. Voye^ Mélilot.
Il y a le lotus hortenjis , odora, en françois lotier
odorant, trefle mufqué, qu’on peut regarder comme
une efpece de mélilot. Voy.e^ L o t ie r o d o r a n t .
Il y a le lotus d’Afrique , qui eft le guajacana au-
gujliore flore de Tournefort, plante originaire des
Indes occidentales, 6c que les Anglois nomment
Lndian- date-plumb- tree.
Enfin il y a le lotus , arbor. africana, que nous appelions
en françois micocoulier ; cet arbre dont le.
fruit parut fi délicieux aux compagnons d’Ulyffe,
qu’après en avoir mangé , il fallut ufer de violence;
pour les faire rentrer dans leurs vaifféaux. Vcye^
donc M i c o c o u l i e r . (D . J.)
LOUAGE , f. m. ( Jurifprud.) qu’on appelle aufli
location, eft un contrat du droit des gens, par lequel
deux ou plufièurs, perfonnes conviennent que l’un
donne à l’autre une,, chofe mobiliaire ou immobi-
liaire, pour en jouir pendant un certain tems, moyennant
une certaine fbmme payable dans les termes
convenus.
On entend par ce terme de louage l’aéfion de celui
qui loue, 6c celle de celui qui prend à titre de
loyer ; dans certaines provinces, on entend aufli
par-là l’afte qui contient cette convention.
Le terme de louage eft générique , & comprend
les baux à ferme aufli-bien que les baux à loyer.
Celui qui donne à louage ou loyer eft appellé dans
les baux le bailleur ; 6c celui qui prend à loyer ou
ferme , eft appellé preneur , c’eft-à-dire locataire ou
fermier.
Le louage eft un contrat obligatoire de produit,
& produit une aftiôn , tant en faveur du bailleur,
qu’en faveur du preneur.
L’attiôn du bailleur a pour objet d’obliger le preneur
à payer les loyers ou fermages , & à remplir
fes autres engagemens, comme de ne point dégrader
la chofe qui lui a été louée, d’y faire les réparations
locatives, fi c’eft une maifon.
Celui qui loue doit avoir le même foin de la. chofe
louée, que fi c étoit la fienne propre ; il ne doit point
$’en fervir à d’autres ufages que ceux auxquels elle
^ w /
eu: deftiriéé , & doit fe conformer en tout à fon bail.
Mais on n’exige pas de lui une exactitude aufli feru-
puleufe que fi la chofe lui avoit été prêtée gratuitement
, de forte que quand la chofe louée vient à
périr, fi c ’eft par un cas fortuit ou par une faute
très-legere du preneur , la perte tombe fur le propriétaire
; car , dans ce contrat, le preneur n’eft
tenu que de ce qu’on appelle en droit lata aut levis
culpa.
L’aCtion du preneur contre le bailleur eft pour
obliger celui-ci à faire jouir le preneur ; le bailleur
n’eft pas non plus tenu de levijjimâ culpâ, mais il
eft refponfable du dommage qui arrive en la chofe
louée par fa faute , latâ aut lèvi.
Il y 3 tin vieux axiome qui dit que morts & mariages
rompent tous baux 6c louages, ce qui ne doit
pas être pris à la lettre ; car il eft certain que la mort
ni le mariage , foit du bailleur ou du preneur , ne
rompent point les baux , les héritiers des uns 6c des
autres font obligés de les tenir : mais ce que l’on a
voulu dire par cet axiome /eft que, comme la.mort
& le mariage amènent du changement., il arrive
ordinairement dans ces cas que le propriétaire demande
à occuper fa maifon en perfonne.
En effet, il y a trois cas.oû le locataire d’une mai--
fon peut être évincé avant la fin de fon bail ; le
premier.eft lorfque.le propiétaire veut occuper en
jîerfonne ; le fécond eft pour la réparer ; le troi-
fieme, lorfque le locataire dégrade la maifon ou
en fait un. mauvais ufage. Foyei la lo iÆde au code-
locato-conducto.
O n loue n o n - fe u lem e n t d e s c h o fe s in a n im é e s , m a is
le s p e r fo n n e s f e lo u e n t e lle s -m êm e s p o u r un c e r ta in
tem s p o u r fa i r e q u e lq u e s o u v r a g e s , o u p o u r f e r v i r
c e u x q u i le s p re n n en t à c e t it re , m o y e n n a n t le fa -
la i r e d o n t o n e ft c o n v e n u . Voyeç D o m e s t i q u e s
& O u v r i e r s . Voyeç au ff. le titre- locati, conducliy
a u c o d e c e lu i de locato conduclo , & a u x in ftitu te s-
de locatione "conduction. Voye^ a u fli B a i l , C o n g é ,
F e r m e , & ci-après L o y e r . ( A )
LOUANGE , f. f. (Morale.') c ’eft le difeours,
l’écrit ou l’a&ion , par lefquels on releve le mérite
d’une afrion, d’un ouvrage, d’une qualité d’un homme,
ou d’un être quelconque. Tous les hommes défirent
la louange , ou parce qu’ils ont des doutes fur
leur propre m érite, 6c qu’elle les raffure contre le
fentiment de leur foibleffe , ou parce qu’elle contribue
à leur donner promptement le plus grand avantage
de la fociété, c’eft-à-dire l’eftime du public. Il faut
louer les jeunes gens, mais toujours avec reftriftion ;
la louange} comme le v in , augmente les forces quand
elle n’enivre pas. Les hommes quriouent le mieux,'
mais qui louent rarement , font ceux que le beau ,
l’agréable & I’hônnête frappent par-tout oit ils les
rencontrent ; le vil intérêt, pour obtenir des grâces ;
la plate vanité , pour obtenir grâce , prodiguent la
louange, 6c l’envie la refufe. L’honnête homme releve
dans les hommes ce qu’il y a de bien, ne l’exa-
gere pas, 6c fe tait fur les défauts ou fur les fautes ;
il trouve , quoi qu’en dife la Fontaine , qu’on peut
trop louer, non les dieux qu’on ne tromperoit pas,
mais fa maîtreffe 6c fon roi qu’on tromperoit.
LOVANGIRI ou LOANGIRO , (Géog.) contrée
maritime d’Afrique , dans la baffe Ethiopie , au
royaume de Loango. Cette contrée eft arrofée de
petites rivières qui la fertilifent.
LOVANGO-MONGO , (Géog.) ^ { L o a n g 'o-
M o n g o .
LOUBAT , ( Géog. anc. & mod. ) village d’Afie,
dan$ la Natolie. Cet endroit ainfi nommé par les
Francs, Ulabat par les Turcs, Lopadion par les Grecs
du moyen âg e, Lopadium par Nicétas 6c Calchon-
d y le , Loupadi par Spon, 6c Lopadi par Tournefort,