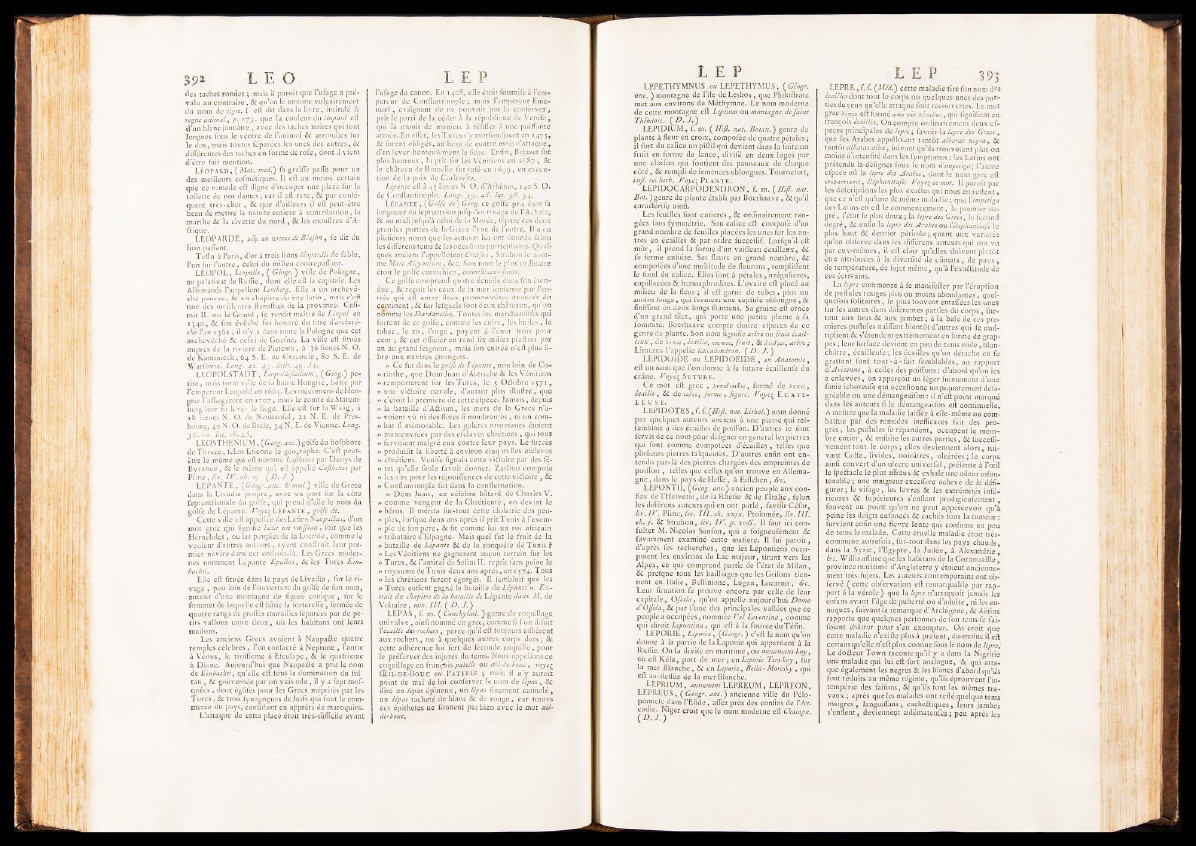
des taches rondes ; mais il paroit que Tufege a prévalu
au contraire, & qu’on le nomme vulgairement
du nom de tigre. I eft dit dans le livre , intitule le
régné animal, p. 273. que la couleur du léopard, eft
d’un blanc jaunâtre , avec des taches noires qui font
longues fous le ventre de l’animal 8c arrondies fur
le dos, mais toutes féparées les unes des autres , 8c
différentes des taches en forme de rofe, dont il vient
d’être fait mention.
Léopard, (Mat. med.) fa graiffe pafle pour un
des meilleurs cofmétiques. Il eft au moins certain
que ce remede eft digne d’occuper une place fur la
toilette de nos dames ; car il eft rare, 8c par confé-
quent très- cher , 8c que d’ailleurs il eft peut-être
beau de mettre la nature entière à contribution, la
marthe 8c la civette du nord , 8c les monftres d’A frique.
-
LÉOPARDÉ, adj. en ternies de Blafon 9 fe dit du
lion paffant.
Teftu à Paris, d’or à trois lions léopardés de fable,
l ’un fur l’autre, celui du milieu contrepaflant.
LÉOPOL, Léo poli s 9 ( Géogr. ) ville de Pologne,
au palatinat de Ruffie, dont elle eft la capitale. Les
Allemands l’appellent Lemberg. Elle a un archevêché
pauvre, 8c un chapitre du rite latin, mais c’eft
une des meilleures ftarofties de la province. Cafi-
mir IL ou le Grand , fe rendit maître de Léopol en
1340, 8c fon évêché fut honoré du titre d'archevêché
l’an 13 61 ; il n’y a dans toute la Pologne que cet
archevêché & celui deGnefne. La ville eft fituée
auprès de la riviere dePietewa , à 36 lieues N. O.
de Kaminieck, 64 S. E. de Cracovie, 80 S. E. de
YEarfovie. Long. 42. 4c). latit. 4g. 62.
LEOPOLSTADT , Leopoldifiadium , ( Géog.') petite,
mais forte ville de la haute Hongrie, bâtie par
l’empereur Léopold en 1665. Les mécontens de Hongrie
Eafliegerent en 1707, mais le comte deStarem-
berg leur fit lever le fiege. Elle eft fur la"Waag, à
38 lieues N. O. de Neuhaufel, 22 N. E. de Pres-
bourg, 40 N. O. de Bude, 34 N. E. de Vienne. Long.
3 6 . /fd. lat. 18. 40.
LEOSTHENIUM, (Géog. anc.) golfe du bofphore
deThrace, l'elon Etienne le géographe. C’eft peut-
être le même qui eft nommé Lajlhenes par Denys de
Byzance, 8c le même qui eft appelle Caflhenes par
Pline , liv. IV. ch. xj. (D . J.')
LÉPANTE, (Géogr. anc. & mod.') ville deGrece
dans la Livadie propre, avec un port fur la côte
feptentrionale du golfe, qui prend d’elle le nom du
golfe deLépante. Voye^ Lépante , golfe de.
Cette ville eftappellée des Latins Naupactus, d’un
mot grec qui fignifie bâtir un vaijfeau, foit que les
Héraclides , ou les peuples de la Locride, comme le
veulent d’autres auteurs , ayent conftruit leur premier
navire dans cet endroit-là. Les Grecs modernes
nomment Lépante Epaclos9 & les Turcs Ein-
bachti.
Elle eft fituée dans le pays deLivadia , fur le rivage
, peu loin de l’ouverture du golfe de fon nom,
autour d’une montagne de figure conique, fur le
fommet de laquelle eft bâtie la fortereffe, fermée de
quatre rangs de groffes murailles féparées par de petits
vallons entre deux, oit les habitans ont leurs
maifons.
Les anciens Grecs avoient à Naupaâe quatre
temples célébrés , l’un confacré à Neptune , l’autre
à Vénus, le troifieme à Efculape, & le quatrième
à Diane. Aujourd’hui que Naupaôe a pris le nom
de Einbachti, qu’elle eft fous la domination du fui
tan , &c gouvernée par un vaivode, il y a fept mof-
quées , deux églifes pour les Grecs méprifés par les
Turcs , 8c trois fynagogues deJuifs qui font le commerce
du pays, confiftant en apprêts de maroquins.
L’attaque de cette place étoit très-difficile avant
l’ufagedu canon. En 1408, elle étoit foumifeà l’etn-
pereur de Conftantinople ; mais l’empereur Ema-
nuel , craignant de ne pouvoir pas la conferver,
prit le parti de la céder à la république de Venife,
qui la munit de maniéré à réfifter à une puiffante
armée. En effet, les Turcs s’y morfondirent en 1475,
& furent obligés, au bout de quatre mois d’attaque,
d’en lever honteufement le fiége. Enfin, Bajazet fut
plus heureux, la prit fur les Vénitiens en 1687 , 8c
le château de Romélie fut rafé en 1699 , en exécution
de la paix de Carlowitz.
Lépante eft à 45 lieues N O. d’Athènes, 140 S. O.
de Conftantinople. Long. 3$. 48. lat. 38. 34.
Lépante , (Golfe de') Géog. ce golfe pris dans fa
longueur du feptentrion jufqu’au rivage de l’Achaïe,
8c au midi jufqu’à celui de la Morée, fépare ces deux
grandes parties de la Grèce l’une de l’autre. Il a eu
plufieurs noms que les auteurs lui ont donnés félon
les différens rems & lcsoccafions particulières. Quelques
anciens l’appelloient Cricefus, Strabon le nomme
Mare Alcyonium, 8cc. Son nom le plus ordinaire
étoit le golfe corinthien, corinthiactis finusli\v
Ce golfe comprend quatre écueils dans fon étendue,
& reçoit les eaux de la mer ionienne par l’entrée
qui eft entre deux promontoires avancés du
continent, 8c fur lefquels font deux châteaux, qu’on
nomme les Dardanelles. Toutes les marchandifes qui
fortent de ce golfe, comme les cuirs, les huiles , le
tabac, le ris, l’o rg e , payent à l’émir trois pour
cent ; 8c cet officier en rend fix milles piaftres par
an au grand feigneur, mais fon entrée n’eft plus libre
aux navires étrangers.
« Ce fut dans le golfe de Lépante, non loin de Co-
» rinthe, que Dom Juan d’Autriche & les Vénitiens
»remportèrent fur les T urcs, le 5 Oèlobre 15 7 1 ,
»une viôoire navale, d’autant plus illuftre,’ que
» c’étoit la première de cette efpece. Jamais, depuis
» la bataille d’A&ium, les mers de la Grèce n’a-
» voient vû ni des flotes fi nombreufes * ni un com-
» bat fi mémorable. Les galeres ottomanes étoient
» manoeuvrées par des efclaves chrétiens , qui tous
» fervoient malgré eux contre leur pays. Le fuccès
» produifit la liberté à environ cinq milles efclaves
» chrétiens. Venife fignala cette viftoire par des fê-
» tes qu’elle feule favoit donner. Zarlino compofa
» les airs pour les réjouiffances de cette v id o ire , 8c
» Conftantinople fut dans la confternation.
» Dom Juan, ce célébré bâtard de Charles V .
» comme vengeur de la Chrétienté, en devint le
» héros. Il mérita fur-tout cette idolâtrie des peu-
» pies, lorfque deux ans .après il prit Tunis à l’exem-
» pie de fon pere, 8c fit comme lui un roi africain
» tributaire d’Efpagne. Mais quel fut le fruit de la
» bataille de Lépante 8c de la conquête de Tunis ?
» Les Vénitiens ne gagnèrent aucun terrein fur les
» Turcs, 8c l’amiral deSelim II. reprit fans peine le
» royaume deTunis deux ans après, en 1 574. Tous
» les chrétiens furent égorgés. Il fembloit que les
» Turcs euffent gagné la bataille de Lépante ». E x trait
du chapitre de la bataille de Lépante dans M. de
Voltaire, tom. I II. ( D . J. )
LEP A S , f. m. ( Conchyliol. ) genre de coquillage
univalve, ainfi nommé en grec, comme fi l’on difoit
Y écaille des rochers, parce qu’il eft toujours adhérent
aux rochers, ou à quelques autres corps durs ; 8c
cette adhérence lui fert de fécondé coquille, pour
le préferver des injures du tems. Nous appelions ce
coquillage en français patelle ou oeil-de-bouc, voye^
(Eil-de-Bouc ou Patelle ; mais il n’y auroit
point de mal de lui conferver le nom de lépas, 8c
dire un lépas épineux, un lépas finement cannelé-,
un lépas tacheté de blanc 8c de rouge, car toutes
ces épithetes ne fonnent pas bien avec le mot ceil-
de-bouc,
LEPETHYMNUS ou LEPETHYMUS ; ( Géogr.
anc. ) montagne de l’île de Lesbos , que Philoftrate
met aux environs de Méthymne. Le nom moderne,
de cette montagne eft Leptimo ou montagne de faine
!Théodore. (Z), ƒ .)
LEPIDIUM, f. m. (H iß . nat. Botan. ) genre de
plante à fleur en croix, compofée de quatre pétales ;
il fort du calice un piftil qui devient dans la fuite un
fruit en forme de lance, divifé en deux loges par
une cloifon qui foutient des panneaux de chaque
côté, 8c rempli de femences oblongues. Tournefort,
infi. rei herb. Voye{ Plante.
LEPIDOCARPODENDRON, f. m. (Hiß . nat.
jBot. ) genre de plante établi par Boerhaave , 8c qu’il
caraèlérife ainfi.
Les feuilles font entières , 8c ordinairement rangées
fans fymmétrie. Son calice eft compofé d’un
grand nombre de feuilles placées les unes fur les autres
en écailles & par ordre fucceflif. Lorfqu’iLeft
mur, il prend la forme d’un vaiffeau écaillenx, 8c
fe ferme enfuite. Ses fleurs en grand nombre, 8c
compofées d’une multitude de fleurons, remplirent
le fond du calice. Elles font à pétales, irrégulières,
capillacées & hermaphrodites. L’ovaire eft placé au
milieu de la fleur ; il eft garni de tubes, plus ou
moins longs , qui forment une capfule oblongue , 8c
finiffent en deux longs filamens. Sa graine eft ornée
d’un grand filet, qui porte une petite plume â fa
fommité. Boerhaave compte douze efpeces de ce
genre de plante. Son nom fignifie arbre ou fruit écailleux
, de Xi'sriç, écaille, xcfüroç, fruit, & S'tvS'pov, arbre;
Linnæus l’appelle leucadendron. (D . J.')
LEPIDOIDE ou LEPfDOEIDE , en Anatomie,
eft un nom que l’on donne à la future écailleufe du
crâne. Voye^ Suture.
Ce mot eft.grec , te-mS'ouS'tç, formé de Xe®-/?,
écaille , 8c de uS'ûç, forme , figure. Voyeç E C A I L-
L E U S E . ;
LEPIDOTES, f. f. (Hijl. nat. Lithol.') nom donné
par quelques auteurs anciens à une pierre qui ref-
l'embloit à des écailles de poiffon. D ’autres le font
fervis de ce nom pour défigner en général les pierres
qui font comme compofées d’écailles , telles que
plufieurs pierres talqueufes. D ’autres enfin ont entendu
par-là des pierres chargées des empreintes de
poiffon , telles que celles qu’on trouve en Allemagne
, dans le pays de Heffe, à Eifleben, &c.
LEPONTII, (Géog. ancY) ancien peuple aux confins
de l’Helvétie, de la Rhétie 8c de l’Italie, félon
les différens auteurs qui en ont parlé, favoir Céfar,
liv. I V . Pline, liv. I I I . ch. xx jx . Ptolomée, liv. III.
ch. j . 8c Strabon, liv. IV. p .2 0 6 . Il faut ici con-
fulter M. Nicolas Sanfon, qui a foigneufement 8c
favamment examiné cette matière. Il lui paroît,
d’après fes recherches, que les Lépontiens occu-
poient les environs du Lac majeur, tirant vers les
Alpes, ce qui comprend partie de l’état de Milan,
8c prefque tous les bailliages que les Grifons tiennent
en Italie, Belliniône, Lugan, Lucarno, &c.
Leur fituation fe prouve encore par celle de leur
capitale, O[cela, qu’on appelle aujourd’hui Domo
d’OJfela, 8c par l’une des principales vallées que ce
peuple a occupées, nommée Val Leventina , comme
qui diroit Lepontina , qui eft à la fource duTéfin.
LEPORIE, Leporia, (Géogr. ) c’eft le nom qu’on
donne à la partie de la Laponie qui appartient à la
Ruflie. On la divife en maritime,ou mourmans-koy,
oii eft Kéla, port de mer ; en Leporie Ters-koy, fur
la mer Blanche, 8c en Leporie, Bella-Moresky, qui
eft au-deffus de la mer Blanche.
LEPRIUM, autrement LEPREUM, LEPREON,
- LEPREUS, ( Géogr. anc. ) ancienne ville du Pélo-
ponnefe dans l’Elide, affez près des confins de l’Arcadie.
Niger çroit que le nom moderne eft Chaiapa.
( A / . ) |
LEPRE, f. f. (Méd.) cette maladie tire fôn nom des
écailles dont tout le corps ou quelques-unes des parties
de ceux qu’elle attaque font recouvertes. Le mot
grec Mwi5« eft formé atso ruv xÎTnS'eey, qui lignifient en
françois écailles. On compte ordinairement deux efpeces
principales de lepre ; favoir la lepre des Grecs -9
que |es Arabes appelaient tantôt albaras nigra9 8c
tantôt albaras alba9 fuivant qu’ils trou voient plus ou
moins d’intenfité dans les fymptomes : les Latins ont'
prétendu la defigner fous le nom A'impétigo \ l’autre
efpece eft la lepre des .Arabes, dont le nom grec eft
iMtpa.vTiaaiç, éléphantiafe. Voye£ ce mot. Il paroît par
les deferiptions les plus exaÔes qui nous en relient,
que ce n’eft qu’une 8c même maladie ; que 1 ‘impétigo
des Latins en eft le commencement, le premier degré,
l’état le plus doux ; la lepre des Grecs, le fécond
degré, 8c enfin la lepre des Arabes ou Y éléphantiafe le
plus haut 8c dernier période ; quant aux variétés
qu’on obferve dans les différens auteurs qui ont vu
par eux-mêmes, il eft.clair qu’elles doivent plutôt
être attribuées à la diverfité de climats , de pays ,
de température, de fujet même, qu’à l’exaftitude de
ces écrivains.
La lepre commence à fe manifefter par l’éruption
de pullules rouges plus pu moins abondantes, quelquefois
folitaires, le plus fouvent entalïees les unes
fur les autres dans différentes parties du corps, fur-
tout aux bras 8c aux jambes ; à la bafe de ces premières
pullules naiffent bientôt d’autres qui fe multiplient
8c s’étendent extrêmement en forme de grappes
; leur furface devient en peu de tems rude, blanchâtre
, écailleufe ; les écailles qu’on détache en fe
grattant font tout- à-fait femblables, au rapport
à!Avicenne, à celles des poiffons : d’abord qu’on les
a enlevées, on apperçoit un léger fuintement d’une
fanie ichoreufe qui ©ccafionne un piquotement défa-
gréable ou une démangeaifon :. il n’eft point marqué
dans les auteurs fi la démangeaifon eft continuelle.’
A mefure que la maladie laiffée à elle-même ou combattue
par des remedes inefficaces fait des progrès,
les puftules fe répandent, occupent le membre
entier, 8c enfuite les autres parties, 8c fuccefli-
vement tout le corps ; elles deviennent alors, fuivant
Celfe, livides, noirâtres, ulcérées ; le corps
ainfi couvert d’un ulcéré univerfel, préfente à l’oeil
le fpeftacle le plus affreux 8c exhale une odeur infou-,
tenable;:une maigreur excelîive achevé de le défigurer
; le vifage, les levres 8c les extrémités inférieures
8c fupérieures s’enflent prodigieufement ,
fouvent au point qu’on ne peut appercevoir qu’à
peine les doigts enfoncés 8c cachés fous la tumeur :
furvient enfin une fievre lente qui confirme en peu
de tems le malade. Cette cruelle maladie étoit très-
commune autrefois, fur-tout dans les pays chauds,
dans la Syrie, l’Egypte, la Judée, à Alexandrie,
&c. Willis allure que les habitans de la Cornouaille
province maritime d’Angleterre y étoieut anciennement
très-fujets. Les auteurs contemporains ont ob-
fervé ( cette obfervation eft remarquable par rapport
à la vérole ) que la lepre n’attaquoit jamais les
enfans avant l’âge de puberté ou d’adulte, ni les eunuques,
fuivant la remarque d’Archigene, 8c Aëtius
rapporte que quelques perfonnes de fon tems fe fai-
foient châtrer pour s’en exempter. On croit que
cette maladie n’exifte plus à préfent, du-moins il eft
certain qu’elle n’eft plus connue fous le nom de leprel
Le do&eur Town raconte qu’il y a dans la Nigritie
une maladie qui lui eft fort analogue, 8c qui attaque
également les negres 8c les blancs d’abord qu’iis
font réduits au même régime, qu’ils éprouvent l’intempérie
des faifons, 8c qu’ils font les mêmes travaux
; après que les malades ont refté quelque tems
maigres , languiffans, cachettiques , leurs jambes
s’enflent, deviennent ædémateufes ; peu après les