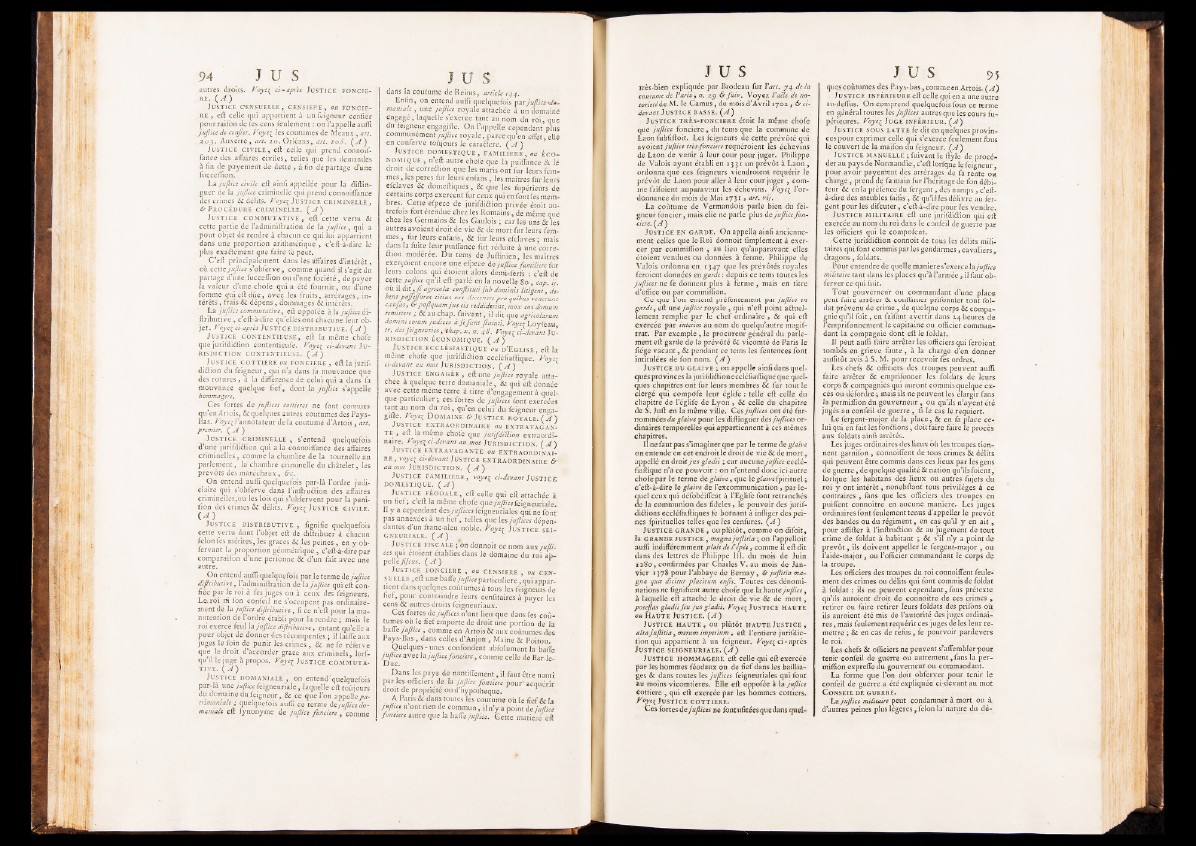
autres droits. Voyc^ ci-dprls JUSTICE FONCIERE.
(^4 )
Just ice censue lle, c e n s ier e , ou fon cièr
e , eft celle qui appartient à un feigneur cenfier
pourraifon de les cens feulement : on l’appelle aulli
jujlict de cenfier. Voye^ les coutumes de Meaux, art.
x 03. Auxerre, an. %o. Orléans, art. io S. ( A J
Ju st ice c iv il e , eft celle qui prend connoif-
fance des affaires civiles, telles que les demandes
à fin de payement de dette , à fin de partage d’une
fucceffion.
La juflice civile eft ainfi appellée pour là diftin-
guer de la jufiice criminelle qui prend connoiffance
des crimes & délits. Voye^ Ju st ic e c r im in e l le ,
& Pro cédu re cr imine lle. (A~)
Ju st ic e c o m m u t a t iv e , eft cette vertu &
cette partie de l’adminiftration de la juflice, qui a
pour objet de rendre à chacun ce qui lui appartient
dans une proportion arithmétique , c’eft-à-dire le
plus exaâement que faire fe peut.
C ’eft principalement dans les affaires d’intérêt,
où cette jufiice s’obferve, comme quand il s’agit du
partage d’une fucceflion ou d’une fociété, de payer
la valeur d’une chofe qui a été fournie, ou d’une
fomme qui eft dûe, avec les fruits, arrérages, intérêts
, frais & dépens , dommages & intérêts.
La jufiice commutative, eft oppofée à la jufiice di-
ftributive, c’eft-à-dire qu’elles ont chacune leur, obje
t. Voyei ci-après JUSTICE DISTRIBUTIVE. ( A )
Just ice co n t en t ieu s e , eft la même chofe
que jurifdiâion contentieufe. Voye^ ci-devant Ju- ;
RISDICTION CONTENTIEUSE. (^4)
Ju st ice co t t ier e ou fon cière , eft la jurifdiâion
du feigneur, qui n’a dans fa mouvance que
des rotures, à la différence de celui qui a dans fa
mouvance quelque fief, dont la jufiice s’appelle
hommagere.
Ces fortes de jufiices cottieres ne font connues
qu’en Artois, & quelques autres coutumes des Pays-
Bas. Voye^ J’annotateur de la coutume d’Artois, art.
premier. ( A )
Ju st ic e criminelle , s’entend quelquefois
d’une jurifdiâion qui a la connoiffance des affaires
criminelles, comme la chambre de la tournelle au
parlement, la chambre criminelle du châtelet, les
prévôts des maréchaux, &c.
On entend auffi quelquefois par-là l’ordre judiciaire
qui s’obferve dans l’inftruâion des affaires
criminelles,ou les lois qui s’obfervent pour la punition
des crimes & délits. Voyez Ju st ic e c iv il e .
Ju st ic e d istr ibu t iv e , fignifie quelquefois
cette vertu dont l’objet eft de diftribuer à chacun
félon fes mérites, les grâces & les peines , en y ob-
fervant la proportion géométrique , c’eft-à-dire par
comparaifon d’une perfonne & d’un fait avec une
autre.
On entend auffi quelquefois par le terme de jufiice
Attributive, l’adminiftration de la jufiice qui eft confiée
par le roi à fes juges ou à ceux des feigneurs.
Le. roi ni fon confeil ne s’occupent pas ordinairement
de la jufiice difiributive, fi ce n’eft pour la manutention
de l’ordre établi pour la rendre ; mais le
roi exerce feul la jufiice difiributive, entant qu’elle a
pour objet de donner des récompenfes ; il Iaiffe aux
juges le foin de punir les crimes , & ne fe réferve
que le droit d’accorder grâce aux criminels, lorf-
qu’il le juge à propos. Voye^ Just ice c om m u t a t
iv e . ( A )
Ju st ic e dom an iale , on entend'quelquefois
par-là une juflice feigneuriale, laquelle eft toujours
du domaine du feigneur, & ce que l’on appelle patrimoniale
■ ; quelquefois auffi ce terme de juflice domaniale
eft fynonyme de jufiice foncière, comme
dans la coutume de Reims, article 144.
Enfin, on entend auffi quelquefois parjufiice 'domaniale
, une jufiice royale attachée à un domaine
laquelle s exerce tant au nom du roi, que
du feigneur engagifte. On l’appelle cependant plus
communément jufiice royale, parce qu’en effet, ellé
en conferve toûjours le caraâere. ( A )
Just ice d om e s t iq u e , f am il iè r e , ou é c o n
om iq ue , n’eft autre chofe que la puiffance & lé
droit de correâion que les maris ont fur leurs femmes
, les peres fur leurs enfans, les maîtres fur leurs
efclaves & domeftiques, & que les fupérieurs de
certains corps exercent fur ceux qui en font les membres.
Cette efpece de jurifdiâion privée étoit autrefois
fort étendue chez les Romains, de même que
chez les Germains & les Gaulois ; car les uns & les
autres avoient droit de vie & de mort fur leurs femmes,
fur leurs enfans, & fur leurs efclaves ; mais
dans la fuite leur puiffance fiit réduite à une correâion
modérée. Du tems de Juftinien, les maîtres
exerçoient encore une efpece de juflice familière fur
leurs colons qui étoient alors demi-ferfs : c’eft de
cette juflice qu’il eft parlé en la novelle 80 , cap. ij.
où il dit )Jî agricoles, conflituti fub dominis litigent, de-
bent poffeffores citius cas dtcernere pro quibus venerunt
caufaSy & poftquamjus eis reddiderint, mox eos domum
remittere ■ & au chap, fuivant, il dit que agricolarum
domini eorum judices à fefunt fiatuti. Voyt^ Loyfeau,
tr. des feignturies, %hap. x . n. 48. Voye^ ci-devant JURISDICTION
ÉCONOMIQUE. ( A )
Ju st ic e e c c l é sia s t iq u e ou d’Eg l is e , eft la
même chofe que jurifdiâion eccléfiaftique. Voyez
ci-devant au mot Ju r isd ic t io n . ( A J
Just ice en gagée , eft une jufiice royale attachée
à quelque terre domaniale, & qui eft donnée
avec cette meme terre à titre d’engagement à quelque
particulier; ces fortes de jufiices font exercées
tant au nom du ro i, qu’en celui du feigneur engagifte.
Voyei D omaine & Ju st ice r o y a l e . ( A )
Just ice extraordin air e ou ex t r a v ag an t
e , eft la meme chofe que jurijdiclion extraordinaire.
Voye^ ci-devant au mot. JURISDICTION. ( A )
Ju st ice ex t r a v ag a n t e ou ex t r ao rd in a ir
e , voyei ci-devant JUSTICE EXTRAORDINAIRE &
au mot Ju r isd ic t io n . ( A ')
Ju st ice f am il iè r e , voyeç ci-devant Ju st ic e
dom estiq ue. ( A )
Ju st ic e f é o d a l e , eft celle qui eft attachée à
un fief; c eft la meme chofe juflice feigneuriale.
Il y a cependant des jufiices feigneuriales qui ne font
pas annexées à un fief, telles que les jufiices dépendantes
d un franc-aleu noble. Voye^ Ju st ic e seigneuriale.
( A f À
Ju st ic e f iscale ; on donnoit ce nom aux jufiices
qui étoient établies dans le domaine du roi ab-
pellé fifeus. ( A ) *
Just ice foncière , ou censiere , où censuelle
, eft une baffe jufiice particulière-, qui appartient
dans quelques coutumes à tous les feigneurs de
fief, pour contraindre leurs cenfitaires à payer les
cens & autres droits feigneuriaux.
Ces fortes de jufiices n’ont lieu que dans les coutumes
où le fief emporte de droit une portion de la
baSe jufiice , comme en Artois & aux coutumes des
Pays-Bas , dans celles d’Anjou , Maine & Poitou.
Quelques-unes confondent abfolumentla baffe
juflice avec la jufiice foncière, comme celle de Bar-le-
Duc.
Dans les pays de nantiffement, il faut être nanti
par les officiers de la jufiice foncière pour’ acquérir
droit de propriété ou d’hypotheque.
A Paris & dans toutes les coutume où le fief & la
jufiice n ont rien de commun , il n’y a point de juflice
foncière autre que la baSe jufiice. Cette matière eft
très-bien expliquée par Brodeau fur Yart. y 4 de la
coutume de Paris , n. xe> & füiv. Voyez l'aat de notoriété
de M. le Camus, du mois d’Avril 1702, & ci-
devant Ju st ic e basse. ([A)
Ju st ice très-foncière étoit la même chofe
que jufiice foncière , du tems que la commune de
Laon fubfiftoit. Les feigneurs de cette prévôté qui
avoient juflice très-fonciere requéroient les échevins
de Laon de venir à leur cour pour juger. Philippe
de Valois ayant établi en 1331 un prévôt à Laon ,
ordonna que ces feigneurs viendroient requérir le
prévôt de Laon pour aller à leur cour juger , comme
faifoient auparavant les échevins. Voyei l’ordonnance
du mois de Mai 1731* art. vij.
La coutume de Vermandois parle bien du feigneur
foncier, mais elle ne parle plus de jufiice foncierCi
(A )
Just ice En g a rd e. On appella ainfi anciennement
celles que le Roi donnoit fimpleiflent à exercer
par conimiffion , au lieu qu’aupàravant elles
étoient vendues ou données à ferme. Philippe de
Valois ordonna en 1347 que les prévôtés royales
feroient données en garde : depuis ce tems toutes les
jufiices ne fe donnent plus à ferme, mais en titre
d’office ou par commiffion.
Ce que l’on entend préfentement par jufiice en
garde , eft une juflice royale , qui rt’eft point aâuel-
lement remplie par le chef ordinaire, & qui eft
exercée par intérim au nom de quelqu’autre magistrat.
Par exemple , le procureur général du parlement
eft garde de la prévôté & vicomté de Paris le
ftége vacant, & pendant ce tems les fenteiïces font
intitulées de fon nom. CA )
Ju st ic e du g la iv e ; on appelle ainfi dans quelques
provinces la jurifdiâion eccléfiaftique que quelques
chapitres ont fur leurs membres & fur tout le
clergé qui compOfe leur églife : telle eft celle du
chapitre de féglife de Lyon , & celle du chapitre
de S. Juft en la même ville. Ces jufiices ont été fur-
nommées«/« glaive pour les diftinguer des jufiices ordinaires
temporelles qui appartiennent à ces mêmes
chapitres.
Il ne faut pas s’imaginer que par le terme de glaive
on entende en cet endroit le droit de vie & de mort,
appellé en droit ju s gladii ; car aucunejuflice eeelé-
fiaftiquê n’a ce pouvoir : on n’entend donc ici autre
chofe par le terme de glaive, que le glaive fpirkué'l ;
c ’eft-à-dire le glaive de l’excommunication, par lequel
ceux qui défobéiffent à l’Eglife font retranchés
de la communion des ficîeles, le pouvoir des jurif-
diâiôns eccléfiaftiques fe bornant à infliger des peines
fpirituelles telles que Jes cenfures. Ça )
Ju st ic e g r a n d e , ou plutôt, comme ondifort,
la GRANDE ju stic e , magna juflida ; on l’appelloit
auffi indifféremment plaît de lepée , comme il eft dit
dans des lettres de Philippe III. du mois de Juin
ï 180,- confirmées par Charles V . au mois de Janvier
1378 pour l ’abbaye de Bernay, & jufiitiü magna
quee dicitur placitum enfis. Toutes ces dénominations
ne lignifient autre chofe que la haute juflice,
à laquelle eft attaché le droit de vie & de mort,
potefias gladii feu ju s gladii. Voyeç JUSTICE HAUTE
ou Haute Ju st ic e . (A )
Justice h a u t e , ou plutôt h au t e Just ice ,
alta jujlitia, merum imperium, eft l’entiere jurifdic-
tion qui appartient à un feigneur. Voye[ ci - après
Ju st ic e seigneuriale. (-4)
Ju st ic e hommagere eft celle qui eft exercée
par les hommes féodaux ou de fief dans les bailliages
& dans toutes les jufiices feigneuriales qui font
Au moins vicomtieres. Elle eft oppofée à la jufiice
cottiere , qui eft exercée par les hommes eottiers.
Voye[ Ju st ic e c o t t ie r e .
Ces fortes de jufiices ne font ufitées que dans quelques'coûtumes
des Pays-bas, comme en Artois. (.A )
Ju st ic e inférieure eft celle qui en a une autre
aiirdeffus. On comprend quelquefois fous ce terme
en général toutes lés jufiices autres que les cours fu-
périeures. Voye^ Juge inférieur. ( v4)
Ju st ice sous l a t t e fe dit en quelques provin-
cespoiir exprimer celle qui s’exerce feulement fous
le couvert de la maifon du feigneur. (’ÎA)
Ju st ic e manuelle ; fuivant le ftyle de procéder
au paysde Normandie', c’eft lorfque le feigneur ,
pour avoir payement des arrérages de fa rente ou
charge, prend, de fa main fur l’héritage de fon débiteur
& en la préfence'du fergent, dès namps, c’eft-
à-dire des meubles faifrs , & qu’il-les déli vre au fer-
gent pour les difçuter, c’eft-à-dire pour les vendre.
Just ice m il it a ir e eft une jurifdiâion qui eft
exercée au nom du roi dans le confeil de guerre par
les officiers qui le compofent.
•Cette jurifdiâion connoît de tou.s les délits militaires
qui font commis par les gendarmes, cavaliers,
dragons , foldats.
Pour entendre de quélle maniéré s’exerce la juflice
militaire tant dans lès places qu’à l’armée , il faut ob-
ferver ce qui fiiit.
Tout gouvérneùr ou commandant d’une place
peut fa-ire arrêter & conftituer pr-ifonnier tout fol-
dat prévenu de crime. de quelque corps & compagnie
qu’il fo it , en faifant avertir dans 24 heures de
l’emprifonnement le capitaine ou officier commandant
la compagnie dont eft le foldàt.
Il peut auffi faire arrêter les officiers qui feroient
tombés en grieve fau te, à la charge d’en donner
auffitôt avis à S. M. pour recevoir fes ordres.
Les chefs & officiers des troupes peuvent auffi
faire arrêter & emprifonner les foldats de leurs
corps & compagnies qui auront commis quelque excès
ou défordre ; mais ils ne peuvent les élargir fans
la permiffion du gouverneur , ou qu’ils n’ayent été
jugés au confeil de guerre , fi le cas le requiert.
Le fergent-major de la place, & en fa place celui
qui en fait lesfonâions, doit faire faire le procès
aux foldats ainfi arrêtés.
Les juges ordinaires des lieux où les troupes tiennent
garnifon , connoiffent de tous crimes & délits
qui peuvent être commis dans ces lieux par les gens
de guerre, de quelque qualité & nation qu’ils foient,
lorfque les habitans des lieux ou autres fujets du
roi y ont intérêt, nonobftant tous privilèges à ce
contraires , fans que les officiers des troupes en
puiffent connoître en aucune maniéré. Les juges
ordinaires font feulement tenus d’appeller le prévôt
des bandes ou du régiment, en cas qu’il y en ait ,
pour affifter à l’inftruâion & au jugement de tout
crime de fbldat à habitant ; & s’il n’y a point de
prévôt, ils doivent appeller le fergent-major , ou
l’aide-major, ou l’officier commandant le corps de
la troupe.
Les officiers des troupes du roi connoiffent feule*
ment des crimes ou délits qui font commis de foldat
à foldat : ils ne peuvent cependant, fous prétexte
qu’ils auroient droit de connoître de ces crimes ,
retirer ou faire retirer leurs foldats des prifons où
ils auroient été mis de l’autorité des juges ordinaires
, mais feulement requérir ces juges de les leur remettre
; & en cas de refus, fe pourvoir pardevers
le roi.
Les chefs & officiers ne peuvent s’ affembler pour
tenir confeil de guerre ou autrement y fans la permiffion
expreffe du gouverneur ou commandant.
La forme que l’on doit obferver pour tenir le
confeil de guerre a été expliquée ci-devant îiu mot
C onseil de guerre.
La jufiice militaire peut condamner à mort ou à
d’autres peines plus légères, félon ltf’nature du dé-.