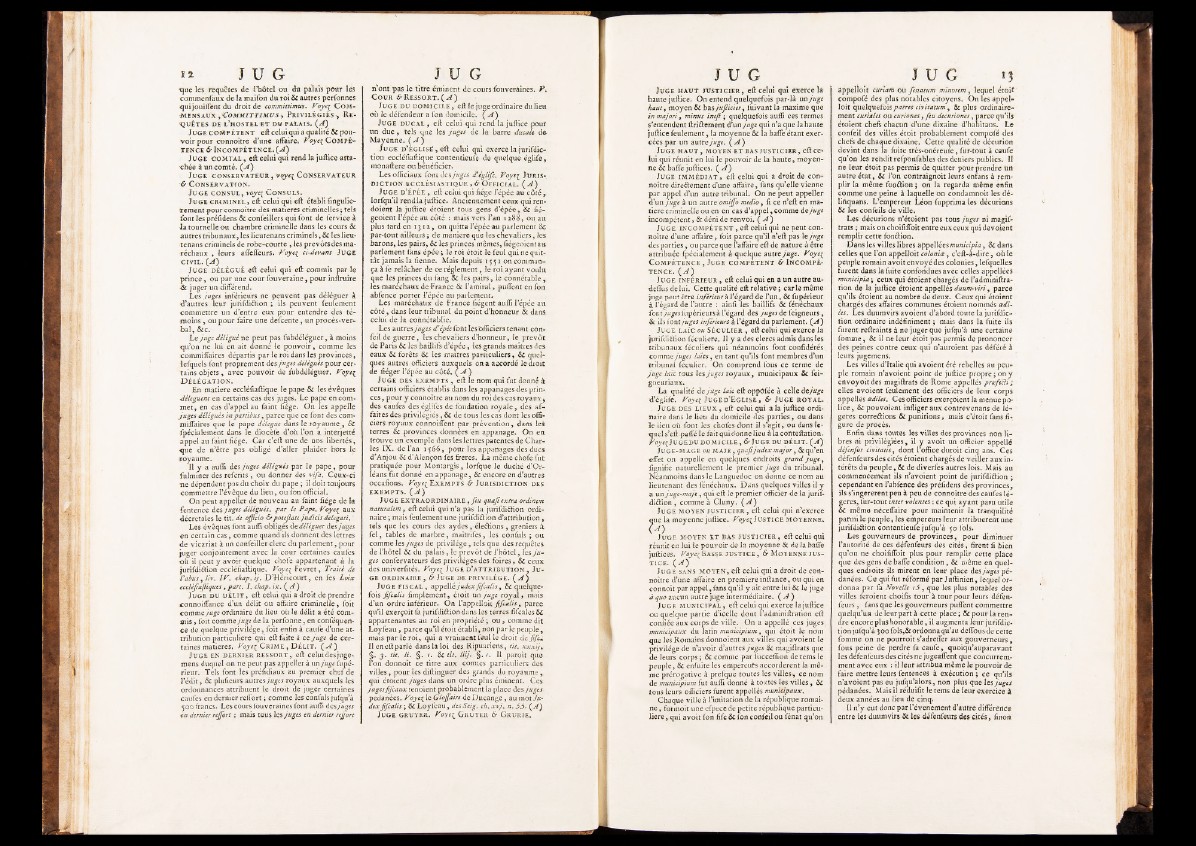
•que les requêtes de l’hôtel ou du palais pour les
commensaux de la maifon du roi & autres personnes
qui jouiffen.t du droit de commitùmus. Voye{ COMMENSAUX
9*COMMITTIMUS > PRIVILÉGIÉS ^ Re -
'Q U ÊTES DE l’hOSTEL ET DW PALAIS. (A )
Juge c o m p é t e n t eft celui qui a qualité & pouvoir
pour connoître d’une affaire. Voyei C ompéte
n c e & In c om p é t en c e . (A )
Juge c o m t a l , eft celui qui rend la juftice attachée
à un comté. (A )
Juge co n s e r v a t eu r , voyc^ C onserv ateur
■ & C o n s e r v a t io n .
Ju g e c o n su l , yoyt[ C onsul s.
Ju ge cr im ine l > eft celui qui eft établi Singulièrement
pour connoître des matières criminelles ; tels
font les préfidens & confeiliers qui font de Service à
latournelleou chambre criminelle dans les cours &
autres tribunaux, les lieutenans criminels, & les lieu-
tenans criminels de robe-courte ,le s prévôts des maréchaux
, leurs aflèfleurs. Voye^ ci-devant Juge
c iv il . {A )
Juge d élégué eft celui qui eft commis par le
prince, ou par une cour Souveraine, pour instruire
■ & juger un différend.
Les juges inférieurs ne peuvent pas déléguer à
d’autres leur jurifdi&ion ; ils peuvent Seulement
commettre un d’entre eux pour entendre des témoins
, ou pour faire une deScente, un procès-verb
a l, &c.
Le juge délégué ne peut pas fubdéléguer, à moins
qu’on ne lui en ait donné le pouvoir, comme les
commiffaires départis par le roi dans les provinces,
lefquels Sont proprement des juges délégués pour certains
objets , avec pouvoir de Subdéléguer. Vqye^
D é l é g a t io n .
En matière eccléfiaftique le pape & les évêques
■ délèguent en certains cas des juges. Le pape en commet,
en cas d’appel au Saint fiége. On les appelle
juges délégués in panibus, parce que ce Sont des com-
miffaires que le pape délégué dans le royaume , &
fpécialement dans le diocèfe d’où l’on a interjetté
appel au Saint fiége. Car c’ eft une de nos libertés,
que de n’être pas obligé d’aller plaider hors le
royaume.
Il y a auffi des juges délégués par le pape, pour
fulminer des referits , ou donner des vifa. Ceux-ci
ne dépendent pas du choix du pape ; il doit toujours
commettre l’évêque du lieu, ou Son official.
On peut appeller de nouveau au Saint fiége de la
Sentence des juges délégués. par le Pape. Veye{ aux
décrétales le tit. de officio & potcjlate judicis delegati. '
Les évêques font auffi obligés de déléguer Adjuges
en certain cas, comme quand ils donnent des lettres
de vicariat à un confeiller clerc du parlement, pour
juger conjointement avec la cour certaines caufes
o ù il peut y avoir quelque chofe appartenant à la
jurifdiâion eccléfiaftique. Voye{ Fevret, Traité de
l'abus, fiv. IV. ckap. ij. D ’Héricourt, en Ses Loix
. eccUJîajhqucs , part. J. ckap. ix. {A ')
Juge du d é l it , eft celui qui a droit de prendre
xonnoiffance d’un délit ou affaire criminelle, fbit
comme juge ordinaire du lieu où Iedélit a été commis
, Soit comme juge de la petfonne, en conséquence
de quelque privilège , Soit enfin à caufe d’une attribution
particulière qui eft faite à ce juge de certaines
matières, Voye£ C rime , D é l it . { A }
Juge en dernier r e s so r t , eft celui desjuge-
mens duquel on ne peut pas appeller à un juge fiipé-
I rieur. Tels font les préfidiaux au premier chef de
l’édit, & plufieurs autres juges royaux auxquels les
ordonnances attribuent le droit de juger certaines
caufes en dernier reffort ; comme les confuls jufqu’à
500 francs. Les cours Souveraines Sont auffi des juges
en dernier reffort ; mais tous les juges en dernier reffort
n’ont pas le titre éminent de cours Souveraines.
C our £ R e s so r t. ( A )
Juge du d o m ic il e , eftlejugeordinaireduïieu
où le défendeur a Son domicile. ( A')
Juge d u c al , eft celui qui rend la .juftice pouf
un d u c , tels que les juges de la barre ducale de
Mayenne. ( A )
Juge d’ églisE , eft celui qui exerce la jurifdic-
tiôn eccléfiaftique contentieufe de quelque églife,
monaftere ou bénéficier»
Les officiaux font des juges â' églife. Voyt{ Ju r is -
d ic t io n e c c l é s ia s t iq u e , & O f f ic ia l . ( A )
Juge d’epée , eft celui qui fiége l’épée au côté ,
lorfqu’il rendla juftice. Anciennement ceux qui ren-
doient la juftice éroient tous gens d’ep é e, & fié-
geoient l’épée au côté : mais vers l’an 1288, ou au
plus tard en 1312., on quitta l’épée au parlement &
par-tout ailleurs ; de maniéré que les chevaliers, les
barons, les pairs, & les princes mêmes, fiégeoientau
parlement fans épée > le roi étoit le Seul qui ne quittât
jamais la fienne. Mais depuis r 5 51 on comman-
ça à Se relâcher de ce réglement, le roi ayant voulu
que les princes du Sang & les pairs, le connétable ,
les maréchaux de France & l’amiral, puffent en Son
abfence porter l’épée au parlement.
. Les maréchaux de France fiégent auffi l ’épée au
cô té , dans leur tribunal du point d’honneur & dans
celui de la connétablie»
Les a utres juges d'épée Sont les Officiers tenant con-
feil de guerre, les chevaliers d’honneur, le prévôt
de Paris Sc les baiilifs d’épée, les grands maîtres des
eaux & forêts & les maîtres particuliers, & quelques
autres officiers auxquels on a accordé le droit
de fiéger l’épée au côté» ( A )
Juge des exempts , eft le nom qui fut donné à
certains officiers.établis dans les appanages des princes
, pour y connoître au nom du roi des cas royaux,
des caufes des églifes de fondation royale, des affaires
des privilégiés, & de tous les cas dont les officiers
royaux connoiffent par prévention, dans le$
terres & provinces données en appanage» On en
trouve un exemple dans les lettres patentes de Charles
IX. de l’an 1566 , pour les appanages des ducs
d’Anjou & d’Alençon fes fferes. La même chofe fut
pratiquée pour Montargis, lorfque le duché d’Orléans
fut donné en appanage, & encore en d’autres
occafions» Voye^ Exem p t s & Ju r isd ic t io n des
EXEMPTS. ( A )
JUGE EXTRAORDINAIRE,y«* quajiextra ordinem
naturalem, eft celui qui n’a pas la jurifdi&ion ordinaire;
mais feulement une jurifdi&ion d’attribution,
tels que les cours des aydes, éle&ions, greniers à
fe l, tables de marbre, maîtrifes, les confuls ; ou
comme les juges de privilège, tels que des requêtes
de l’hôtel & du palais, le prévôt de l’hôtel, les ju ges
confervateurs des privilèges des foires, & ceux
des univerfités. Voyei Juge d’a t t r ib u t io n , Juge
ordinaire , & Juge de p r iv il è g e . ( A )
Juge f is c a l , appellé judexfifcalis, & quelquefois
fifcalis fimplement, étoit un juge ro y a l, mais
d’un ordre inférieur. On l’appelloit fifcalis, parce
qu’il exerçoit fa jurifdiôiondans les terres fifcales &
appartenantes au roi en propriété ; o u , comme dit
Loyfeau, parce qu’il étoit établi, non par le peuple ,
mais par le roi, qui a vraiment Seul le droit de fifei
Il eneft parlé dans la loi des Ripuariens, tit. xx x ij»
§ . j . tic. li. § . /. & tit. liij. § . /. Il paroît que
l’on donnoit ce titre aux comtes particuliers des
villes, pour les diftinguer. des grands du royaume,
qui étoient juges dans un ordre plus éminent. Ces
j ugesfifcaux le noient probablement la place des juges
pedanées. Voyeç le Gloffairc de Ducange, au mot ƒ«-
dexfifcalis ; & Loyfeau, desSeig. ch. xvj. n. 55. (A )
Juge g ru yer. Voyei Gru yer & Grurie,
Juge h a u t ju s t ic ie r , eft celui qui exerce la
haute juftice. On entend quelquefois par-là un juge
haut j moyen & bas jufiieier, Suivant la maxime que
inmajori, minus inejl ; quelquefois auffi ces termes
s’entendent ftriûement d’un juge qui n’a que la haute
juftice Seulement, la moyenne & la baffe étant exercées
par un autre juge, f A )
Ju ge h a u t , mo yen et bas ju st ic ier , eft ce*
lui qui réunit en lui le pouvoir de la haute, moyenne
& baffe juftices. ( A )
Juge im m é d ia t , eft celui qui a droit de con^
noître direûement d’une affaire, fans qu’elle vienne
par appel d’un autre tribunal. On ne peut appeller
d’un juge à un autre omijfo medio, fi ce n’eft en matière
criminelle ou en en cas d’appel, comme de juge
incompétent, & déni de renvoi. ( A )
Juge in com p é t en t , eft celui qui ne peut connoître
d’une affaire, Soit parce qu’il n’eft pas le juge
des parties, ou parce que l’affaire eft de nature à être
attribuée fpécialement à quelque autre juge. Voye1
C om p é te n c e , Juge com p e t e n t & In com p é t
e n c e . ( A )
Ju ge inférieur , eft celui qui en a un autre au-
deffus de lui. Cette qualité eft relative ; carie même
juge peut être inférieure l’égard de l’un, & Supérieur
à l’égard de l’autre : ainfi les baiilifs &c fénéchaux
Sonty Supérieurs à l’égard des juges de Seigneurs,
& ils Sont juges inférieurs à l’égard du parlement. (A )
Juge la ïc ou Séculier , eft celui qui exerce la
jüriSdiâion Séculière. Il y a des clercs admis dans les
tribunaux Séculiers qui néanmoins Sont confidérés
comme juges laïcs, en tant qu’ils font membres d’un
tribunal Séculier. On comprend Sous ce terme de
juge laïc tous les juges royaux, municipaux & Seigneuriaux.
La qualité de juge laïc eft oppôfée à celle àejttge
d’églife. Voye{ Ju g ed ’Eg l is e , 6* Juge r o y a l .
. Juge des lieux , eft celui qui a la juftice ordinaire
dans le lieu du domicile des parties, ou dans
le lieu où font les chofes dont il s’agit, ou dans lequel
s’eft paffé le fait quidonne lieu à la conteftation.
Voye^lVGEBV DOMICILE, & JUGE DU DÉLIT. (A )
Juge-m ag e ou MAJE, quaji judex major, & qu’en
effet on appelle en quelques endroits grand juge,
fignifie naturellement le premier juge du tribunal.
Néanmoins dans le Languedoc on donne ce nom au
lieutenant des fénéchaux. Dans quelques villes il y
a un juge-majt, qui eft le premier officier de la jurit-
d iâ io n , comme à Cluny. ( ^ )
Ju ge m o yen ju st ic ier , eft celui qui n’exerce
que la moyenne juftice. Voyei Ju st ic e m o yen ne»
Juge mo yen et bas Ju s t ic ie r , eft celui qui
réunit en lui le pouvoir de la moyenne & de la baffe
juftices. VoyeiBasse ju s t ic e , & Moyenne jus-,
T ic e . ( ^ )
Ju g e sans m o y e n , eft celui qui a droit de connoître
d’une affaire en première inftance, ou qui en
connoît par appel, Sans qu’il y ait entre lui & le juge
à quo aucun autre juge intermédiaire. ( A )
Juge m u n ic ip a l , eft celui qui exerce la juftice
ou quelque partie d’icelle dont l’adminiftration eft
confiée aux corps de ville. On a appellé ces juges
municipaux du latin municipium, qui étoit le nom
que les Romains donnoient aux villes qui avoient Iç
privilège de n’avoir d’autres juges & magiftrats que
de leurs corps ; & comme par fucceffion de tems le
peuple, & enfuite les empereurs accordèrent la même
prérogative à prefque toutes les villes-, ce nom
de municipium fut auffi donné à toutes les ville s, &
tous leurs officiers furent appellés municipaux.
Chaque ville à l’imitation de la république romaine
, formoit une efpece de petite république particulière
, qui a voit Son fife & Ion confeil ou Sénat qu’on
âppelioit Ciinath ou fenatuni minorent, lequel etoit
compofé des plus notables citoyens. On les appel*»
loit quelquefois patres civitatum, & plus ordinairement
curiales ou curiones , feu decuriones, parce qu’ils
étoient chefs chacun d’une dixaine d’habitans. Le
confeil des villes étoit probablement compofé des
chefs de chaque dixaine. Cette qualité de décufion
devint dans la fuite très-onéreufè, Stir-tout à caufe
qu’on les rehdit refponfables des deniers publics. II
ne leur étoit pas permis de quitter pour prendre un
autre état, & l’on contraignoit leurs enfans à remplir
la même fonction ; on la regarda même enfin
comme une peine à laquelle on condamnoit les dé-
liftquabs. L’empereur Léon Supprima les décurions
& les confeils de ville»
Les décurions n’étoieht pas tous jugés ni magiftrats
; mais on choififfoit entre eux ceux qui dévoient
remplir cette foncrion»
Dans les villes libres üpipeWéesinunicipià, & dans
celles que l’on appelloit colonice, c’eft-à-dire, où le
peuple romain a voit envoyé des colonies, lesquelles
Surent dans la fuite confondues avec celles appellées
municipia ; ceux qui étoient chargés de l’adminiftra-
tion de la juftice étoient appellés duum*viri, parce
qu’ils étoient au nombre de deux. Ceux qui étoient
chargés des affaires communes étoient nommés adi-
les. Les duumvirs avoient d’abord toute la juràfdic-
tion ordinaire indéfiniment ; mais dans la Suite ils
furent reftraints à ne juger que jufqu’à une certaine
Somme, & il ne leur étoit pas permis de prononcer
des peines contre ceux qui n’auroient pas déféré à
leurs jugemens.
Les villes d’Italie qui avoient été rebelles au peu«*
pie romain n’avoient point de juftice propre ; on y
envoyoitdes magiftrats de Rome appelles proefccliz
elles avoient feulement des officiers de leur corps
appellés adilts. Ces officiers exerçoient la menue po*
lic e , & pou voient infliger aux contrevenans de légères
corrections & punitions, mais c’étoit Sans figure
de procès.
Enfin dans toutes les villes des provinces non libres
ni privilégiées, il y avoit un officier appellé
défenfor civitatis, dont l’office duroit cinq ans. Ces
défenfeurs des cités étoient chargés de veiller aux intérêts
du peuple, & de diverfes autres lois. Mais au
commencement ils n’avoient point de jurifdiétion ;
cependant en l’abfence des préfidens des provinces,
ils s’ingererent peu à peu de connoître des caufes légères,
Sur-tout inter voltntts : ce qui ayant paru utile
ôc même néceffaire pour maintenir la tranquilité
parmi le peuple, les empereurs leur attribuèrent une
jurifdiâion contentieufe jufqu’à 50 Sols»
Les gouverneurs de provinces, pour diminuer
l’autorité de ces défenfeurs des cités, firent fi bien
qu’on ne choififfoit plus pour remplir cette place
que des gens de baffe condition, & même en quelques
endroits ils mirent en leur place des juges pé-
danées. Ce qui fut réformé par Juftiniert, lequel ordonna
par fa Novelle i5 , que les plus notables des
villes feroient choifis tour à tour pour leurs défenfeurs
, Sans que les gouverneurs puffent commettre
quelqu’un de leur part à cette place; & pour la rendre
encore plus honorable, il augmenta leur jurifdic-
tion jufqu’à 300 fols,& ordonna qu’au deffous de cette
Somme on ne pourroit s’adreffer aux gouverneurs ,
fous peine de perdre fa caufe, quoiqu’atiparavant
les défenfeurs des cités ne jugeaffent que concurremment
avec eux : il leur attribua même le pouvoir de
faire mettre leurs Sentences à exécution ; ce qu’ils
n’avoient pas eu jufqu’alors, non plus que les juges
pédanées. Mais il réduifit le tems de leur exercice à
deux années au lieu de cinq»
Il n’y eut donc par l’évenement d’autre différence
entre les duumvirs & les défenfeurs des cités, Sinon