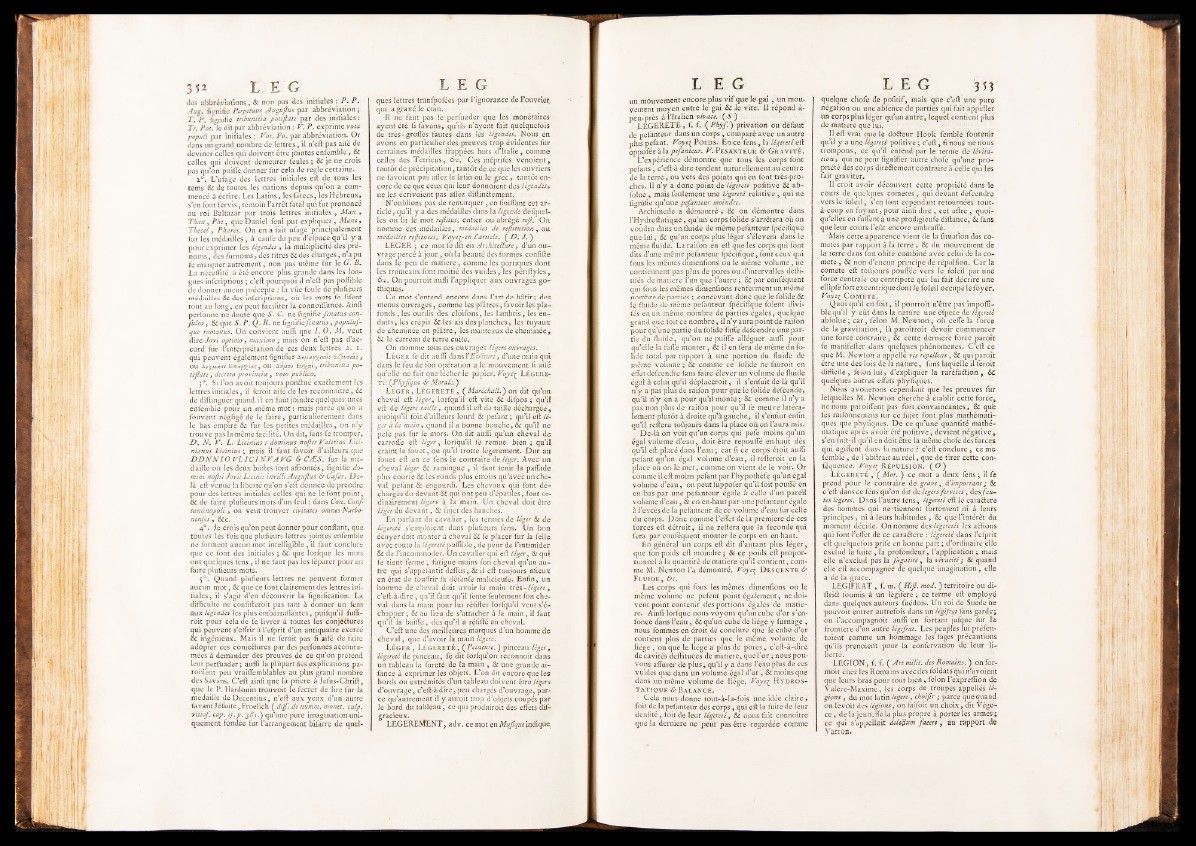
des abbréviations, & non pas des initiales : P. P.
Augk lignifie Perpetuus Augufus par abbreviation ;
T. P. fignifie tribunitia potejlate par des initiales:
Tr. Poe. le dit par abbreviation : V. P . exprime vota
populi par initiales: Poe. Po. parabbréviation. Or
dans un grand nombre de lettres, il n’eft pas.aife de
deviner celles qui doivent être jointes ensemble, 8c
celles qui doivent demeurer feules ; & je ne crois
pas qu’on puiffe donner fur cela de réglé certaine.
2°. L’ufage des lettres initiales eu de tous les
tems 8c de toutes les nations depuis qu’on a commencé
à écrire. Les Latins* les Grecs, les Hébreux,
s’en font fervis, témoin l’arrêt fatal qui fut prononcé
au roi Baltazar par trois lettres initiales , Man ,
T k c iu , P l ie , que Daniel feul put expliquer, Mane ,
T h e c e l , Phares. On en a fait ufage principalement
fur les médailles, à caufe du peu d’elpace qu’il y a
pour exprimer les légendes, la multiplicité des prénoms
, des furnoms, des titres 8c des charges, n’a pu
fe marquer autrement, non pas même fur le G. B.
La néceflité a été encore plus grande dans les longues
infcriptions ; c’eft pourquoi il n’eft pas poflible
de donner aucun précepte : la vue feule de plulieurs
médailles 8c des infcriptions, où les mots fe lifent
tout au long, en peut faciliter la connoiffance. Ainli
perfonne ne doute que S. C. ne fignifie fenatus con-
fulto, & que S. P . Q. R* ne fignifie fenatus, populuf-
que romanus. On convient aulïi que I . O . M. veut
dire Jovi optimo , maximo ; mais on n eft pas d’accord
fur l’interprétation de ces deux lettres a . e .
qui peuvent également lignifier A»//iq>;t/K>K EÇovtr/àc,
OU Aoy/xan Eisapx)a.ç, OU An/zou Eu%cti, tribunitia po-
tejlate , decreto provincice , voto publico.
3°. Si l’on avoit toujours ponttué exactement les
lettres initiales, il feroit aifé de les reconnoître, 8c
de diftinguer quand il en faut joindre quelques-unes
enfèmble pour un même mot : mais parce qu’on a
fouvent négligé de le faire, particulièrement dans
le bas empire 6c fur les petites médailles, on n’y
trouve pas la même facilité. On dit, fans fe tromper,
D . N. V. L, Licinius : dominus nojler Valerius Lici-
nianus Licinius ; mais il faut favoir d’ailleurs que
DD N N 1 0 VL I C I N VA VG & CÆS. fur la médaille
où les deux buftes font affrontés, fignifie do-
tnini nojlri Jovii Licinii invicti Augujlus & Cafar. Delà
eft venue la liberté qu’on s’eft donnée de prendre
pour des lettres initiales celles qui ne le font point,
6c de faire plufieurs mots d’un feul : dans Con. Conf-
tantinopoli, on veut trouver civitates omnes Narbo-
nenfes , 6cc.
4°. . Je crois qu’on peut donner pour confiant, que
toutes les fois que plufieurs lettres jointes enfemble
ne forment aucun mot intelligible, il faut conclure
que ce font des initiales ; 6c que lorfque les mots
ont quelques fens , il ne faut pas les féparer pour en
faire plufieurs mots.
5°. Quand plufieurs lettres ne peuvent former
aucun mot, 8c que ce font clairement des lettres initiales,
il s’agit d’en découvrir la lignification. La
difficulté ne confifteroit pas tant à donner un fens
aux légendes les plus embarraffantes, puifqu’il fuffi-
roit pour cela de fe livrer à toutes les conjéôures
qui peuvent s’offrir à l’efprit d’un antiquaire exercé
6c ingénieux. Mais il ne feroit pas fi aifé de faire
adopter ces conjectures par des perfonnes accoutumées
à demander des preuves de ce qu’on prétend
leur perfuader ; auffi la plupart des explications parodient
peu vraiffemblables au plus grand nombre
des Savans. C ’eft ainli que la priere à Jefus-Chrift,
que le P. Hardouin trou voit le fecret de lire fur la
médaille de Decentius, n’eft aux yeux d’un autre
favant Jéfuite, Froelich ( diJJ. de numm. monet. culp.
vitiof cap. ij. p. 381.') qu’une pure imagination uniquement
fondée fur l’arrangement bifarre de quelques
lettres tranfpofées par l ’ignorance de l’ouvrier,
qui a gravé le coin.
Il ne faut pas fe perfuader que les monétaires
ayent été fi favans, qu’ils n’ayent fait quelquefois
de très-greffes fautes dans les légendes. Nous en
avons en particulier des preuves trop évidentes fur
certaines médailles frappées hors d’Italie, comme
celles des Tetricus, &c. Ces méprifes venoient,
tantôt de précipitation, tantôt de ce que les ouvriers
ne favoient pas affezle latin ou le grec , tantôt encore
de ce que ceux qui leur donnoient des légendes,
ne les écrivoient pas affez diftinétement.
N’oublions pas de remarquer, en finiffant cet article
, qu’il y a des médailles dans la légende defquel-
les on lit le mot rejlitut. entier ou abrégé rejl. On
nomme ces médailles, médailles de rejlitution, ou
médailles reflituèes. Voÿeç-en Üarticle. ( D . J. )
LEGER ; ce mot fe dit en Architecture , d’un ouvrage
percé à jour, où la beauté des formes confifte
dans le peu de matière, comme les portiques dont
les trumeaux font moitié des vuides, les périftyles ,
&c. On pourroit auffi l’appliquer aux ouvrages gothiques.
Ce mot s’entend encore dans l’art de bâtir; des
menus ouvrages, comme les plâtres, favoir les plafonds
, les ourdis des cloifons, les lambris, les enduits
, les crépis 8c les ais des planches, les tuyaux
de cheminée en plâtre, les manteaux de cheminée,
6c le carreau de terre cuite.
On nomme tous ces ouvrages légers ouvrages.
L é g e r fe dit auffi dans Y Ecriture, d’une main qui
dans le feu de fon opération a le mouvement fi aifé
qu’elle ne fait que lécher le papier. Voye^ L é g è r e t
é (Phyjiquc & Morale.)
L é g e r , L é g è r e t é , ( Maréchall. ) on dit qu’un
cheval eft léger, lorfqu’il eft vite 8c difpos ; qu’il
eft de légère taille, quand il eft de taille déchargée
quoiqu’il Ibit d’ailleurs lourd & pefant ; qu’il eft léger
à la main, quand il a bonne bouche, 8c qu’il ne
pefe pas fur le mors. On dit auffi qu’un cheval de
carroffe eft léger, lorfqu’il fe remue bien ; qu’il
craint le fouet, ou qu’il trotte légèrement. Dur au
fouet eft en ce fens le contraire de léger. Avec un
cheval léger 8c ramingue , il faut tenir la paflade
plus courte 6c les ronds plus étroits qu’avec un cheval
pefant 8c engourdi. Les chevaux qui font déchargés
du devant 6c qui ont peu d’épaules, font ordinairement
légers à la main. Un cheval doit être
léger du devant, 8c fujet des hanches.
En parlant du cavalier, les termes de léger 8c de
légèreté s’emploient dans plufieurs fens. Un bon
écuyer doit monter à cheval 8c fe placer fur la felle
avec toute la légèreté poflible, de peur de l’intimider
8c de l’incommoder. Un cavalier qui eft léger, 8c qui
fe tient ferme \ fatigue moins fon cheval qu’un autre
qui s’appefantit deflùs, 8c il eft toujours mieux
en état de fouffrir fa défenfe malicieufe. Enfin, un
homme de cheval doit avoir la main très - légère ,
c’eft-à-dire, qu’il faut qu’il fente feulement fon cheval
dans la main pour lui réfifter lorfiqu’il veut s’échapper
; 8c au lieu de s’attacher à la main, il faut
qu’il la baiffe, dès qu’ il a réfifté au cheval.
C ’eft une des meilleures marques d’un homme de
cheval, que d’avoir la main légère.
L é g e r , L é g è r e t é , ( Peinture. ) pinceau légery
•légèreté de pinceau, fe dit lorfqu’on reconnoît dans
un tableau la fureté de la main , 8c une grande ai-
fance à exprimer les objets. L’on dit encore que les
bords ou extrémités d’un tableau doivent être légers
d’ouvrage, c’eft-à-dire, peu chargés d’ouvrage, parce
qu’autrement il y auroit trop d’objets coupés par
le bord du tableau, ce qui produiroit des effets dif-
gracieux.
LEGEREMENT, adv. ce mot enMujiqueindique
un mouvement encore plus v if que lé gai ,’ un mouvement
moyen ent;re le gai & le vite, il répond à-
peu-près à l’italien vivace. f S j) -..
LÉGÈRETÉ, f. f. ( P by f ) privation ou défaut
de pefanteur. darismn corps, comparé avec un autrp
plus pefant. Voye{ P o i d s . En ce fens, la légèreté eft.
oppoféeàla pefanteur. ^ - P e s a n t e u r G G r a v i t é ;
L ’e x p é r ie n c e d ém o n t r e •q u e to u s le s c o rp s fo u t
p e f a n s , c ’ é ft-à -d ir c t en d e n t n a tu r e llem en t a u c e n t r e
d e la t e r r é , d u v e r s d e s p o in t s q u i e n fo n t t rè s -p r o c
h e s . I l n’y a ,d o n c p o in t d e légèreté p o f i t iv e 8c a b so
lu e , m a is fe u lem e n t u n e légèreté r e la t i v e , q u i n e
fig n ifie q u ’u n e pefanteur moindre.
Archimede a démontré, 8c on démontre dans
l’Hydroftatique, qu’un corps folide s ’arrêtera où on
voudra dans un.fluide de même pefanteur fpécifique
que lu i, & qu’un corps-plus léger s’élèvera dans le
même fluide. La raifon en eft que les corps qui font
dits d’une même pefanteur fpécifique, font ceux qui
fous les mêmes dimenfions ou le même volume, ne
contiennent pas plus de pores ou d’intervalles defti-
tués de matière l’un que l’autre ; & par conféquent
qui fous les mêmes dimenfions renferment un même
nombre de parties ; concevant donc que le folide 6c
le fluide de même pefanteur fpécifique foient divi-
fés en un même nombre de parties égales,- quelque
grand que foit ce nombre, il n’y aura point de raifon
pour qu’une partie du folide faite defoendre une partie
du fluide, qu’on ne puiffe alléguer auffi pour
qu’elle la faffe monter, & il en fera de même du fo:
lidé total par rapport à une portion du fluide de
même volume ; 8c comme ce folide ne fauroit en
effet defcendrefans faire élever un volume de fluide
égal à celui qu’il déplacëroit, il s’enfuit de là qu’il
n’y a pas plus de raifon pour que le folide defcende,
qu’il n’y en a pour qu’il monte ; 8c comme.il n’y a
pas non plus de raifon pour qu’il fe meuve latéralement
plutôt à droite qu’à gauche, il s’enfuit enfin
qu’il reftera toujours dans la place où on l’aura mis.
De-ià on voit qu’un corps qui pefe moins qu’un
égal volume d’eau, doit être repouffé en-haut dès
qu’il eft placé dans l’eau ; car fi ce corps étoit auffi
pefant qu’un égal volume d’eau, il refteroit en la
place où on le met, comme on vient de le voir. Or
comme il eft moins pefant par l’hypothèfe qu’un égal
volume d’eau, on peut fuppofer qu’il foit pouffé en
en-bas par une pefanteur égale à celle d’un pareil
volume d’eau , & en en-haut par une pefanteur égale
à l’excès de la pefanteur de ce volume d’eau fur celle
du corps. Donc comme l’effet de la première de ces
forces eft détruit, il ne reftera que la fécondé qui
fera par conféquent monter le corps en en-haut.
En général un corps eft dit d’autant plus léger,
que fon poids éft moindre ; 8t ce poids eft proportionnel
à la quantité de matière qu’il contient, comme
M. Newton l’a démontré. Voyeç D e s c e n t e &
F l u i d e , & c.
Les corps qui fous les mêmes dimenfions ou le
même volume ne pefent point également-, ne doivent
point contenir des portions égales de matière.
Ainfi lorfque nous voyons qu’un cube d’or s ’enfonce
dans l’eau , 8c qu’un cube de liège y fumage ,
nous fommes en droit de conclure que le cube d’or
contient plus de parties que le même volume de
liège , ou que le liège a plus de pores, c’eft-à-dire
de cavités deftituées de matière, que l’or ; nous pouvons
aflùrer de plus, qu’il y a dans l’eau plus de ces
vuides que dans un volume égal d’o r , 8c moins que
dans un même volume de liège. Voye^ H y d r o s t
a t i q u e & B a l a n c e .
Cela nous donne tout-à-la-fois une idée claire ,
foit de la pefanteur des corps, qui eft la fuite de leur
denfité, foit de leur légèreté, 8c nous fait connoître
que la derniere ne peut pas être regardée comme
quelque chofe de pofitif , mais que c’eft une pure
négation ou une abfence de parties qui fait appeller
un corps plus léger qu’un autre, lequel contient plus
de matière que lui.
Il eft vrai que le doôeur Hook femble foutenir
qu’il y a une légèreté pofitive ; c’e ft , fi nous ne nous
trompons, ce qu’il entend par le terme de lévitation,
qui ne peut fignifier autre chofe qu’iiiie propriété
des corps directement contraire à celle qui les
fait g-ra-viter.
Il croit avoir découvert cette propriété dans de
cours de quelques cometes, qui devant defçendre
vers le foleil, s’en font cependant retournées tout-
à-coup en fuyant, pour ainfi dire , cet aftre , quoiqu’elles
en fuflënt à Une prodigieufe diftancej & fans
que leur cours l’eût encore embraflê.
Mais cette apparence vient de la fitiiâtion des comètes
par rapport à la terre, 8c du moüverticnt de
la terre dans fon ôbitè combiné avec celui de la comète
, 8c non d’aucun principe de répulfion/Car la
comete eft toujours pouflee vers le foleil par une
force centrale ou centripète qui lui fait décrire une
ellipfefort excentrique dont le foleil occupe le foyer.
Voyeç C o m e t e .
Quoi qu’il en foit, il pourroit n’être pas impofli-
ble qu’il y eût dans la nature une efpece de légèreté
abfolueJ;-éar, félon M. Newton, où ceffelâ force
de la gravitation, là paroîrroit devoir commencer
une force contraire, 8c cette derniere force paroît
fe manifefter dans quelques phénomènes; C ’eft ce
que M. Newton a appellé vis repeliens, 8c qui paroît
être une des-lois de la nature , fans laquelle il feroit
difficile, lëion lüi; d’expliquer la raréfaftion, 8c
quelques autres effets phyfiques.
Nous avouerons cependant que les preuves fur
lefquelles M. Newton cherche à établir cette force,
ne nous paroiffent pas fort convaincantes, 8c qu’e
fies raifonnemens for ce fujet font plus mathématiques
qüe phyfiqiifes. De ce qu’une quantité mathématique
api-es avoir été pofitive , devient négative,
s’en luit-il qu’il en doit être la même chofe des forces
qui agiffent dans là nature ? c’eft conclure, ce me
femble , de l’abftrait au réel, que de tirer cette con-
fiéquence; Voyè^ R É PU L S IO N . -( 0 )
L é g è r e t é , ( Mor. ) ce mot a aeux fens ; il fe
prend pour le contraire de grave, d’important,* 8c
c ’eft dans ce fens qu’on dit de légers ftrvices, des fautes
le gérés. Dans l’autre fens, légerèté dft lé çaradere
des hommes qui ne'tiennent fortëtnenf ni à leurs
principes, ni à leurs habitudes, 8c que 1 intérêt du
moment décide. On nomme des légèretés les a étions
qui font l’effet de ce caraétere : légèreté dans l’efprit
eft quelquefois prife en bonne part ; d’ordiqaire elle
exciud là fuite , la profondeur, l’application ; mais
elle n’exelud pas la fugacité, la vivacité ; & quand
elle eft accompagnéè de quelque imagination, elle
a de la grâce.
LEGIFRAT , f. m. ( Hijl. m o i . ) territoire ou di-
ftriéfc fournis à un légiféré ; ce terme eft employé
dans quelques auteurs fuédois. Un roi de Suède ne
pouvoit entrer autrefois dans un légifrat fans garde;
On l’accompagrioit aùffi en fortant jufque fur la
frontière d’un autre légifrat. Les peuplés lui préfien-
toient comme un hômmage les làges précautions
qu’ils prenoient pour là confervàtipn de leur liberté.
LÉGION, f. f. ( Art tnilit. des Romains.') onfor-
moit chez les Romains avec des foldats qui n’a voient
que leurs bras pour tout bien, félon réxprèflïon de
Valere-Maxime,.les corps de troupes appelles légions
, du mot Yàûn legcre, choijir ; parce que quand
on le voit des légions-, on faifiôit.tin choix, dit Végë-
c e , de la jeunelfe là plus propre à porter les armes;
ce qui s’appelloit deleffum faeere , au rapport dé
yarron.