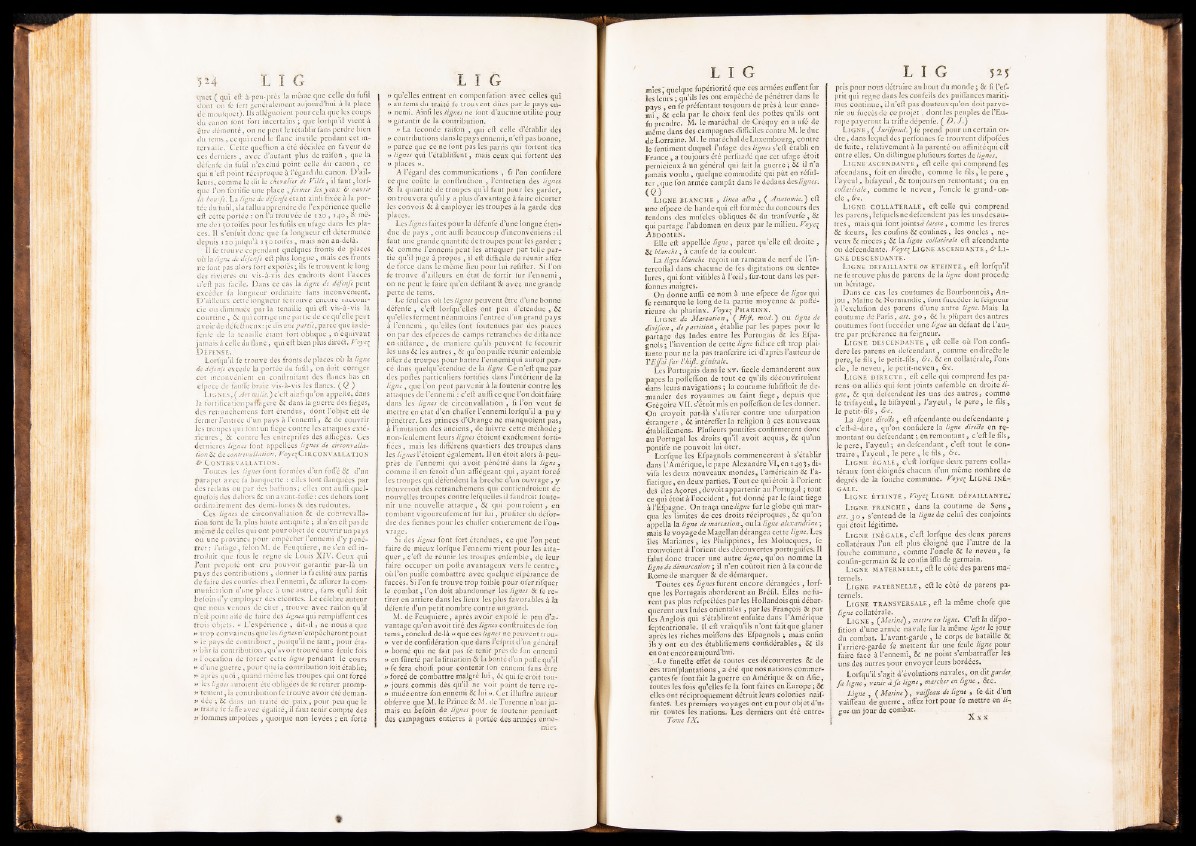
■ tjùèt ( qui eft à-peu-prcs la même que celle du Fufil
dont on fe fert généralement aujourd’hui à la place
de moufquet). Ils alléguoient pour cela que les coups
d u canon font fort incertains ; que lorfqu’il vient à
être démonté, on ne peut le rétablir fans perdre bien
du tems., ce qui rend le'flanc inutile pendant cet intervalle.
Cette queftion a été décidée en faveur de
ces derniers , avec d’autant plus de raifon , que la
défenfe du fufil n’exclud point celle du canon , ce
qui n’eft point réciproque à l’égard du canon. D ’ailleurs,
comme le dit le chevalier de V ille , il faut, lorfque
l’on fortifie une place , fermer les yeu x & ouvrir
là bourfe. La ligne de défenfe étant ainfi fixée à la portée
dufnfil, il a fallu apprendre de l’expérience quelle
eft cette portée : on l’a trouvée de 120 ,14 0 , & même
de 1 «[otoifes pour les fufils en ufage dans les places.
Il s’enfuit donc que fa longueur elt déterminée
depuis 120 jufqu’à 150 toifes, mais non au-dela.
Il fe trouve cependant quelques fronts de places
oh la ligne de défenfe elt plus longue, mais ces fronts
ne font pas alors fort expofés ; ils fe trouvent le long
des rivières ou vis-à-vis des endroits dont l’accès
îi’eft pas facile. Dans ce cas la ligne de défenfe peut
excéder fa longueur ordinaire fans inconvénient.
D ’ailleurs cette longueur fe trouve encore raccourcie
ou diminuée par la tenaille qui eft vis-à-vis la
courtine, & qui corrige une partie de ce qu’elle peut
avoir de défeélueux: je dis une partie, parce que la défenfe
de la tenaille étant fort oblique , n’équivaut
jamais à celle du flanc, qui eft bien plus direéh Voye^
D éfense.
Lorfqu’il fe trouve des fronts de places oîi la ligne
de défenfe excede la portée du fufil, on doit corriger
cet inconvénient en conftruilant des flancs bas en
efpece de fauffe braie vis-à-vis les flancs. ( Q )
L ignes, ( Ar t m ilit.) c’eft ainfiqu’on appelle, dans
la fortification palfagere & dans la guerre des lièges,
des retranchemens fort étendus, dont l’objet eft de
fermer l’entrée d’un pays à l’ennemi, & de couvrir
les troupes qui font un fiége contre les attaques extérieures
, & contre les entreprifes des afliégés. Ces
dernieres lignes font appellées Lignes de circonvallation
& de contrevallation. /''oye^ClRCONVALLATION
6* C o n tr e v a l la t io n .
Toutes les lignes font formées d’un foffé & d’un
parapet avec fa banquette : elles font flanquées par
des redans ou par des battions; elles ont aufli quelquefois
des dehors & un avant-foflé : ces dehors font
ordinairement des demi-lunes & des redoutes.
Ces lignes de circonvallation êc de contrevallation
font de'la plus haute antiquité ; il n’en eft pas de
mêmê de celles qui ont pour objet de couvrir un pays
ou une province pour empêcher l’ennemi d’y pénétrer:
l’iifage , félon M. de Feuquiere, ne s’en eft introduit
que fous le régné de Louis XIV. Ceux qui
l ’ont propofé ont cru pouvoir garantir par-là un
pays des contributions , donner la facilité aux partis
défaire des courfes che2 l’ennemi, & aflùrer la communication
d’une place à une autre, fans qu’il foit
befoin d’y employer des efeortes. Le célébré auteur
que nous venons de citer , trouve avec raifon qu’il
n’eft point ailé de faire des lignes qui rempliffent ces
trois objets. « L’expérience , dit-il, ne nous a que
» trop convaincu* que les lignes n’empêcheront point
» le pays de contribuer, puiiqu’il ne faut, pour éta-
»blir la contribution , qu’a voir trouvé une feule fois
» l’occafion de forcer cette ligne pendant le cours
» d’une guerre, pour que la contribution foit établie;
» après quoi, quand même les troupes qui ont forcé
» les lignes auroient été obligées de ïè retirer promp-
» tement, la contribution fe trouve avoir été deman-
» dée ; & dans un traité de paix, pour peu que le
» traité fe faffe avec égalité, il faut tenir compte des
» fornmes impofées, quoique non leyées ; en forte
» qu’elles entrent en compenfation avec celles qui
» au tems du traité fe trouvent dîtes par le pays en-
» nemi. Ainfi les lignes ne font d’aucune utilité pour
» garantir de la contribution.
» La féconde raifon , qui eft celle d’établir des
» contributions dans le pays ennemi, n’eft pas bonne,
» parce que ce ne font pas les partis qui iortent des
» lignes qui l’établiffent, mais ceux qui fortent des
» places ».
A l’égard des communications , fi l’on confidere
ce que coûte la conftru&ion , l’entretien des lignes
& la quantité de troupes qu’il faut pour les garder,
on trouvera qu’il y a plus d’avantage à faire efeorter
les convois & à employer les troupes à la garde des
places.
Les lignes faites pour la défenfe d’une longue étendue
de pays , ont aufli beaucoup d’inconvéniens : il
faut une grande quantité de troupes pour les garder ;
& comme l’ennemi peut les attaquer par telle partie
qu’il juge à propos , il eft difficile de réunir allez
de force dans le même lieu pour lui refifter. Si l’on
fe trouve d’ailleurs en état de fortir fur l’ennemi,
on ne peut le faire qu’en défilant & avec une grande
perte de tems.
Le feul cas oîi les lignes peuvent être d’une bonne
défenfe , c’eft lorfqu’elles ont peu d’étendue ,
qu’elles ferment néanmoins l’entrée d’un grand pays
à l’ennemi, qu’elles font foutenues par des piaces
ou par des efpeces de camps retranchés de diftance
en diftance, de maniéré qu’ils peuvent fe fecourir
les uns & les autres, & qu’on puifle réunir enfemble
aflez de troupes pour battre l’ennemi qui auroir percé
dans quelqu’étendue de la ligne. Ce n ’eft que par
des poftes particuliers fortifiés dans l’intérieur de la
ligne , que l’on peut parvenir à la foutenir contre les
attaques de l’ennemi : c’eft aufli ce que l’on doit faire
dans les lignes de circonvallation , fi l’on veut fé
mettre en état d’en chaffer l’ennemi lorfqu’il a pu y
pénétrer. Les princes d’Orange ne manquoient pas,
à l’imitation des anciens, de fiiivre cette méthode ;
non-feulement leurs lignes étoient exactement fortifiées
, mais les différens quartiers des troupes dans
les lignes l’étoient également. Il en étoit alors à-peu-
près de l’ennemi qui avoit pénétré dans la ligne,
comme il en feroit d’un afliégeant qui, ayant forcé
les troupes qui défendent la breche d’un ouvrage, y
trouveroit des retranchemens qui contiendroient de
nouvelles troupes contre lcfquelles il faudroit foutenir
une nouvelle attaque, & qui pourroient, en
tombant vigoureufement fur lu i, profiter du défor-
dre des fiennes pour les chafler entièrement de l’ouvrage.
•
Si des lignes font fort étendues, ce que l’on peut
faire de mieux lorfque l’ennemi vient pour les attaquer,
c ’eft de réunir les troupes enfemble, de leur
faire occuper un pofte avantageux vers le centre,
oîi l’on puifle combattre avec quelque efpérance de
fuccès. Si l’on fe trouve trop foible pour ofer rifquer
le combat, l’on doit abandonner les lignes & fe retirer
en arriéré dans les lieux les plus favorables à la
défenfe d’un petit nombre contre un grand.
M. de Feuquiere, après avoir expofé le peu d’avantage
qu’on avoit tiré des lignes conftruites de fon
tems, conclud de-là « que ces lignes ne peuvent trou-
» ver de confidération que dans l’efprit d ’un général
» borné qui ne fait pas fe tenir près de fon ennemi
» en fureté par la fituation & la bonté d’un pofte qu’il
» fe fera choifi pour contenir fon ennemi fans être
'» forcé de combattre maigre lu i, & qui fe croit toti-
» jours, commis dès qu’il ne voit point de terre re-
» muée entre fon ennemi & lui ».Cet illuftre auteur
obferve que M. le Prince & M. deTurenne n’ont jamais
eu befoin de lignes pour fe foutenir pendant
des campagnes entières à portée des armées ennemies
t
L I G
mies \ quelque fupériorité que ces armées euflent fur
les leurs ; qu’ils les ont empêché de pénétrer dans le
pays , en fe préfentant toujours de près à leur ennemi
& cela par le choix feul des poftes qu’ils ont
fu prendre. M. le maréchal de Créquy en a ufé de
même dans des campagnes difficiles contre M. le duc
de Lorraine. M. le maréchal de Luxembourg, contre
le fentiment duquel l’ufage des lignes s’eft établi en
France , a toujours été perfuadé que cet ufage étoit
pernicieux à un général qui fait la guerre ; 6c il n’a
jamais voulu , quelque commodité qui pût en réful-
te r , que fon armée campât dans le dedans des lignes,
( Q ) H |
L i g n e BLAN CHE , linea alla , ( Anatomie. ) eft
une efpece de bande qui eft formée du concours des
tendons des mufcles obliques & du tranfverfe, &
qui partage l’abdomen en deux par le milieu. Voyei
A b d o m e n .
Elle eft appellée ligne, parce qu’elle eft droite ,
& blanche, à caufe de fa couleur.
La ligne blanche reçoit un rameau de nerf de 1 in-
tercoftal dans chacune de fes digitations ou dentelures,
qui font vifibles à l’oe il, fur-tout dans les per-
fonnes maigres.
On donne aufli ce nom à une efpece de ligne qui
fe remarque le long de la partie moyenne & pofté-
rieure du pharinx. Voye^ P h a r i n x .
L i g n e de Mar cation, ( Hifi. mod.') ou ligne de
divijîon, de partition, établie par les papes pour le
partage des Indes entre les Portugais & les Efpa^
gnols ; l’invention de cette ligne fiélice eft trop plai-
iànte pour ne la pas tranferire ici -d’après l’auteur de
FEffai fur Vhift. générale.
Les Portugais dans le x v . liecle demandèrent aux
papes la pofleflion de tout ce qu’ils découvriroient
dans leurs navigations ; la coutume fubfiftoit de demander
des royaumes au faint fiege, depuis que
Grégoire V II. s’étoit mis en pofleflion de les donner.
On croyoit par-là s’aflùrer contre une ufurpation
étrangère , & intérefîer la religion à ces nouveaux
établifîemens. Plufieurs pontifes confirmèrent donc
au Portugal les droits qu’il avoit acquis, & qu’un
jjcTntife ne pouvoit lui ôter.
Lorfque les Efpagnols commencèrent à s’établir
dans l ’Amérique, le pape Alexandre VI, en 1493, di-
vifa les deux nouveaux mondes, l’américain & l’a-
fiatique , en deux parties. Tout ce qui étoit à l’orient
des îles Açores, devoit appartenir au Portugal ; tout
ce qui étoit à l’occident, fut donné par le faint fiege
à l ’Efpagne. On traça une ligne furie globe qui marqua
les limites de ces droits réciproques, &c qu’on
appella la ligne dé marcation, ou la ligne alexandrine ;
mais le voyage de Magellan dérangea cette ligne. Les
îles Marianes, les Philippines, les Molucques, fe
trouvaient à l’orient des découvertes portugaifes. Il
falut donc tracer une autre ligne, qu’on nomme la
ligne de démarcation ; il n’en coûtoit rien à la cour de
Rome de marquer & de démarquer.
Toutes ces lignes furent encore dérangées , lorfque
les Portugais abordèrent au Rréfil. Elles ne furent
pas plus refpe&ées par les Hollandois qui débarquèrent
aux Indes orientales , parles François & par
les Anglois qui s’établirent enfuite dans l ’Amérique
fcptentrionale. Il eft vrai qu’ils n’ont fait que glaner
après les riches moiflbns des Efpagnols ; mais enfin
ils y ont eu des établiffemens confidérables, & ils
en ont encore aujourd’hui.
>Le funefte effet de toutes ces découvertes & de
ées tranfplantations, a été que nos nations commerçantes
fe font fait la guerre en Amérique & en Afie,
toutes les fois qu’elles fe la font faites en Europe ; 8e
elles ont réciproquement détruit leurs colonies naif-
fantes. Les premiers voyages ont eu pour objet d’unir
toutes les nations. Les derniers ont été entre-
Tome IX,
L I G 525
pris pour nous détruire au bout du monde ; & fi Pef-
prit qui régné dans les confeils des puiffances maritimes
continue, il n’eft pas douteux qu’on doit parvenir
au fuccès de ce projet, dont les peuples de l’Europe
payeront la trifte dépenfe. ( D . J.')
Ligne , ( Jurifprud. ) fe prend pour un certain ordre,
dans lequel des perfonnes fe trouvent difpofées
de fuite, relativement à la parenté ou affinité qui eft
entre elles. On diftingue plufieurs fortes de lignes.
Ligne ascendante, eft celle qui comprend les
afeendans, foit en direûe, comme le fils, lepere ,
l’a y eul, bifayeul, & toujours en remontant ; ou en
collatérale y comme le neveu, l’oncle le grand-oncle
, &c.
Ligne collaterale, eft celle qui comprend
les parens, lefquelsnedefcendent pas les uns des autres
, mais qui font joints« latere, comme les freres
& foeurs, les confins & coufines, les oncles , neveux
& nieces ; & la ligne collatérale eft afeendante
ou defeendante. Voye^ Ligne ascendante, & Ligne
descendante.
Ligne defaillante ou eteinte, eft lorfqu’il
ne fe trouve plus de parens de la ligne dont procédé
un héritage.
Dans ce cas les coutumes de Bourbonnois, Anjou
, Maine & Normandie, font fuccéder le feigneur
à l’exclufion des parens d’une autre ligne. Mais la
coutume de Paris, art. 3 0 , & la plûpart des autres
coutumes font fuccéder une ligne au défaut de l ’autre
par préférence au feigneur.
Ligne descendante, eft celle où l’on confidere
les parens en defeendant, comme en direfte le
pere, le fils, le petit-fils, &c. éc en collatérale, l’oncle
, le neveu, le petit-neveu, &c.
Ligne directe , eft celle qui comprend les parens
ou alliés qui font joints enfemble en droite ligne,
& qui descendent les uns des autres, comme
le trifayeul, le bifayeul, l’ayeul, le pere, le fils,
le petit-fils , &c.
La ligne directe, eft afeendante ou defeendante ;
c’eft-à-dire, qu’on confidere la ligne directe en remontant
ou defeendant ; en remontant, c ’eft le fils,
le pere, l’ayeul ; en defeendant, c’eft tout le contraire
, l’ay eul, le pere , le fils, &c.
Ligne égale, c’eft lorfque deux parens collatéraux
font éloignés chacun d’un même nombre de
degrés de la fouche commune. Voyeç Ligne inégale.
Ligne éteinte, Voye{ Ligne défaillante.’
Ligne franche, dans la coutume de Sens,
art. 70 , s’entend de la ligne de celui des conjoints
qui étoit légitime.
Ligne inégale, c’eft lorfque des deux parens
collatéraux l’un eft plus éloigné que l ’autre de la
fouche commune, comme l’oncle & le neveu , le
coufin-germain & le coufin iflii de germain.
Ligne maternel le, eft le côté des parens ma-:
ternels.
Ligne paternelle, eft le côté de parens paternels.
Ligne transversale, eft la même chofe que
ligne collatérale.
Ligne , ( Mariné) , mettre en ligne. C’eft la difpo-
fition d’une armée navale fur la même ligne le jour
du combat. L’avant-garde , lé corps de bataille &
l’arriere-garde fe mettent fur une feule ligne pour
faire facé à l’ennemi, & ne point s’embarrafler les
uns des autres pour envoyer leurs bordées.
Lorfqu’il s’agit d’évolutions navales, on dit garder\
fa ligne, venir à fa ligne, marcher en ligne-, &c.
Ligne , ( Marine ) , vaijfeau de ligne , fè dit d’un
vaiffeau de guerre, affez fort pour fe mettre en fi-
gne un jour de combat.
X x x