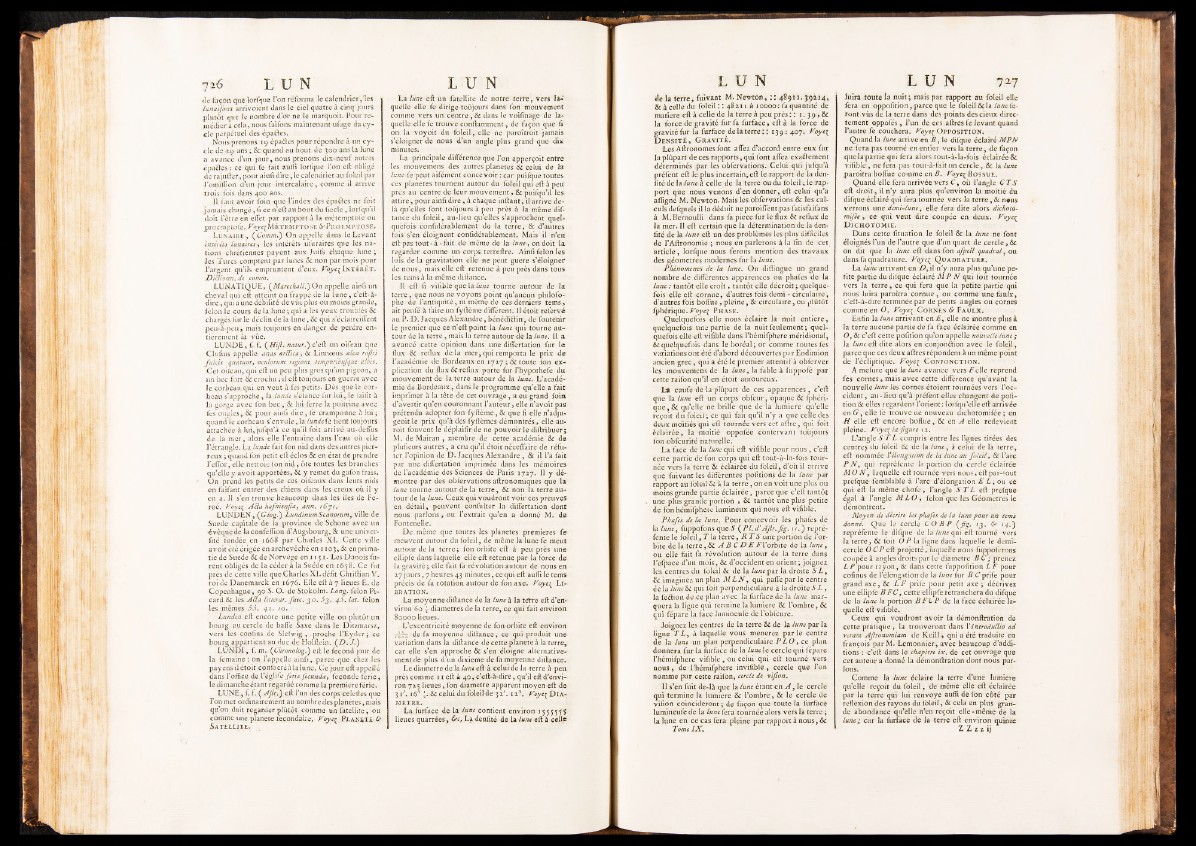
<lc façon què Iorfque l’on réforma le calendrier, les
■ lunaifons arrivoient clans le ciel quatre a cinq jours
.plutôt que le nombre d’or ne le marquoit. Pour remédier
à cela, nous faifons maintenant ufage du cycle
perpétuel des épaôes»
Nous prenons 19 épaéles pour répondre à un cycle
de 2,0-ans ; 6c quand au bout de 300 ans la lune
a avancé d’un Jour, nous prenons dix-neuf autres
épaâtes * ce qui fe fait atiffi Iorfque l’on eft obligé
de rajufter, pour ainfidire, le calendrier au foleil par
Tomiflion d?un jour intercalaire, comme il arrive
trois fois dans 400 ans.
Il faut avoir foin que l’index des épaâes ne foit
jamais changé-, fi ce n’eft au bout du fiecle, iorfqu’il
doit l’être en eft'et par rapport à la métemptoie ou
proemptofe. /^ « çMétemptose ^ P roemptose.
Lunaire-, .( Comm.'j On appelle dans le Levant
intérêts lunaires y les intérêts ttfuraires que les nations
chrétiennes payent aux Juifs chaque lune ;
les Turcs comptent par lunes & non par mois pour
l’argent qu’ils empruntent d’eux, Voyt{ Intérêt.
Diclionn. de comm.
LUNATIQUE, (Marechall?) On appelle ainfi ùn
cheval qui eft atteint ou frappé de la lune, c’eft-à-
dire, qui a une débilité de vue plus ou moins grande,
félon le cours de la lune ; qui a les yeux troublés 6c
chargés fur le déclin de la lune, & qui s’éclairciffent
peu-à-peu, mais toujours en danger de perdre entièrement
la vue.
LUNDE, f. f. [Mift. natur.') c’eft un oifeau que
Clufius appelle anas arclica, & Linnoeus aie a roflri
j'ulcis quatuor, oculorum regione temp'ùribufque àlbis.
Cet oileau, qui eft un peu plus gros qu’un pigeon, a
un bec fort & crochu ; il eft toujours en guerre avec
le corbeau qui en veut à les petits. Dès que le corbeau
s’approche, la lunde s’élance lur lui, le iailit à
la gorge avec fon bec, & lui ferre la poitrine avec
les ongles, 6c pour ainfi dire, fe cramponne à lui ;
auand le corbeau s’ envole, la lunde fe tient toujours
attachée à lui, jufqu’à ce qu’il foit arrivé au-deflus
de la mer, alors elle l’entraîne dans l’eau où elle
l’étrangle. La lunde fait fon nid dans des antres pierreux
; quand fon petit eft éclos 6c en état de prendre
l’effor, elle nettoie fon nid, ôte toutes les branches
qu’elle y avoit apportées, 6C y remet du gafon frais.
On prend les petits de ces oifeaux dans leurs nids
en faifant entrer des, chiens dans les creux où il y
en a. Il s’en trouve beaucoup dans les îles de Féroé.
Voyez -delà hafnicnjïa, ann. 16J 1.
LUNDEN, ( Géog.) LundinumScanorum, ville de
Suede capitale de la province de Schone avec un
évêque de laconfeflion d’Augsbourg, & une univer-
lité fondée en 1668 par Charles XL Cette ville
avoit été érigée en archevêché en 1103, & enprima-
tie de Suede 6c de Norvège en 1151. Les Danois furent
obligés de la céder à la Suède en 1658. Ce fut
près de cette ville que Charles XI. défit Chriftian V.
roi de Danemarck en 1676. Elle eft à 7 lieues E. de
Copenhague, 90 S. O. de Stokolm. Long, félon Picard
& les Acla litterar. fuec. 30. 4,3 • 4-5. lat. félon
les mêmes 55. 42. 70.
Lunden eft encore une petite ville où plutôt un
bourg au cercle de baffe Saxe dans le Ditzmarsz,
vers les confins de SlelVig , proche l’Eyder ; ce
bourg appartient au duc de Holfteio. ( D . L )
LUNDI, f. m. ( Chronolog.) eft le fécond jour de
la femaine : on l’appelle ainfi, parce que chez les
payens ilétoit conlacréàlalune. Ce jour eft appelle
dans l’office de l’églife feriafecunda, fécondé férié,
le dimanche étant regardé comme la première férié.
LUNE, f. f. ( Afir.) e ft l ’un des co rp s ç e le fte s q u e
l’ on m e t o rd in a ir em e n t au n om b re des p la n è te s , mais
q u ’o n d o it r e g a rd e r p lu tô t com m e u n f a t e l li t e , o u
com m e une p lan e te le c o n d a ir e . Voyt^ P l a n e t e -6 S a t e l l i t e .
La lune eft un fatellite de notre terre, vers là*
quelle elle fe dirige toujours dans fon mouvement
comme' vers un centre, 6ç dans le voifinàge de la-
quelle -elle fe trouve conftamment, de façon que fi
on la voyoit du foleil, elle ne paroîtroit jamais
s’éloigner de nous d’un angle plus grand que dix
minutes;
La principale différence que l’on apperçoit entre
les mouvemens des autres planètes 6c celui de la
lunefe peut aifément concevoir : car puifque toutes
ces planètes tournent autour du foleil qui eft à peu
près au centre de leur mouvement, 6c puifqu’il les
attire, pour ainfi dire, à chaque inftant, il arrive delà
qu’elles font -toujours à peu près à la même dif-
tance du foleil, au-lieu qu’elles s’approchent quelquefois
conlidérablement de la terre, & d’autres
fois s’en éloignent conlidérablement. Mais il n’eu
eft pas tout-à - fait de même de la lune, on doit la
regarder comme un corps terreftre. Ainfi félon les
lois de la gravitation elle ne peut guère s’éloigner
de nous, mais elle eft retenue à peu près dans tous
les temsà la même diftance.
Il eft fi vifible que la lune tourne autour de la
terre, que nous ne voyons, point qu’aucun philofo-
phe de l'antiquité, ni même de ces derniers tems,
ait penfé à faire un fyftème différent. Il étoit refervé
au P. D. Jacques Alexandre, bénédi&in, de fouténir
le premier que ce n’eft point la lune qui tourne autour
de la terre, mais la terre autour de la lune. Il a
avancé cette opinion dans une differtation fur le
flux & reflux delà mer, qui remporta le prix de
l’académie de Bordeaux en 1717 ;& toute fon explication
du flux 6c reflux porte fur l’hypothefe du
mouvement de la terre autour de la lune. L’académie
dè Bordeaux, dans le programme qu’elle a fait
imprimer à la tête de cet ouvrage, a eu grand foin
d’avertir qu’en couronnant l’auteur, elle n’avoit pas
prétendu adopter fon fyftème, & que fi elle n’adju-
geoit le prix qu’à des fyftèmes démontrés , elle au-
roit fouvent le dépîaifir de ne pouvoir le diftribuerj
M. de Mairan , membre de cette académie 6c de
plufieurs autres, a cru qu’il étoit néceflaire de réfuter
l’opinion de D. Jacques Alexandre , & il l’a fait
par une differtation imprimée dans les mémoires
de l’académie des Sciences de Paris 1727. Il y démontre
par des obfervations aftronomiques que la
lune tourne autour de la terre, 6c non la terre autour
de la lune. Ceux qui voudront voir ces preuves
en détail, peuvent cônfulter la differtation dont
nous parlons, ou l’extrait qu’en a donné M. dé
Fontenelle.
De même que tontes les planètes premières fe
meuvent autour du foleil, de même la lune fe meut
autour de la terre ; fon orbite eft à peu près une
ellipfe. dans laquelle elle eft retenue par la force de
la gravité ; elle fait fa révolution autour de nous en
27 jours, 7 heures 43 minutes, ce qui eft aufli le tems
précis de fa rotation autour de fon axe. Voye^ L i b
r a t i o n .
La moyenne diftance de la lune à la terre eft d’environ
60 f diamètres de la terre, ce qui fait environ
8ôoôolieues.
L’excentricité moyenne de fon orbite eft environ
; de fa moyenne diftance, ce qui produit une
variation dans la diftance de cette planete à la terre,
car elle s’en approche 6c s’en éloigne alternativement
de plus d’un dixième de fa moyenne diftance.
Le diamètre de la lune eft à celui de la terre à peu
près comme 11 eft à 40 , c’eft-à-dire, qu’il eft d’envi-
, ron 725 lieue.s ,.fon diamètre apparent moyen eft de
a i'i> i6j- b 6c celui du foleil de 32'. 11". Voye{ DIAM
ETRE.
La furface de la lune contient environ 1555555
lieues quarrées, &c, La denfité de la lune eft à celle
de la terre, fuïvant M. Newton, :: 48911. 39114,
& à celle du foleil i l 4811i à 10000: fa quantité de
matière eft à celle de la terre à peu près : : 1. 39, 6c
la force de gravité fur fa furface j eft à la force de
gravité fur la furface de la terre : : 139: 4071 Voyez,
D e n s i t é , G r a v i t é .
Les Aftronomes font affez d’accord entre eux fur
la plûpart de ces rapports, qui font allez exactement
déterminés .par les obfervations. Celui qui jufqu’à
préfent eft le plus incertain, eft le rapport de la denfité
de la dune à. celle de la terre ou du foleil ;.le rapport
que nous venons d’en donner, eft celui qu’a
alfigne M. Newtôn. Mais les obfervations & les calculs
defquels il la déduit ne paroiflent pas fatisfaifans
à M. Bernoulli dans fa.piece fur le flux 6c reflux de
la mer. Il eft certain que la détermination de là denfité
de la lune eft un des problèmes les plus difficiles
de l’Aftronomie ; nous en parlerons à la fin de cet(
article, Iorfque nous ferons mention des travaux
des géomètres modernes fur la lune.
.Phénomènes de la lune. On diftingue un grand
nombre ide différentes apparences ou phafes de la
lune : tantôt elle croît, tantôt elle décroît ; quelquefois
elle eft .cornue, d’autres fois demi - circulaire,
d’autres fois boflùe, pleine, & circulaire, ou plutôt
fphérique. Voyt{ P h a s e .
Quelquefois elle nous éclaire la nuit entière,
quelquefois une partie de la nuit feulement ; quelquefois
elle eft vifible dans l’hémifphere méridional,
& quelquefois dans le boréal ; or comme toutes fes
variations ont été d’abord découvertes par Endimion
ancien grec, qui a été le premier attentif à obferver
les mouvemens de la lune, la fable à fuppofé par
cette raifon qu’il en étoit amoureux.
L* caufe de la plupart de ces apparences, c’eft
que la lune eft un corps obfcur, opaque & fphérique,
& qu’elle ne brille que de la lumière qu’elle
reçoit du foleil ; ce qui fait qu’il n’y a que celle des
deux moitiés qui eft tournée vers cet aftre, qui foit
éclairée , la -moitié oppofée confervant toujours
fon lob'fcurité naturelle.
La face de la lune qui eft vifible pour nous, c’efl:
cette partie de fon corps qui eft tout-à-la-fois tournée
vers la terre & éclairée du foleil, d’où il arrive
que fuivant les différentes pofitions de la lune par
rapport au fdleil 6c à la terre, on en voit une plus ou
moins grande partie éclairée, parce que c’eft tantôt
une plus grande portion , 6c tantôt une plus petite
de fon hémifphete lumineux qui nous eft vifible.
Phafes de la 'lune. Pour concevoir les phafes de
la lune, fuppofons que S (P/, d'AJlr.fig. 11. ) repréfente
le foleil, T la terre, R T S une portion de l’orbite
de la terre, & A B C D E i-Torbite de la lune,
ou elle fait fa révolution autour de la terre dans
l ’efpace d’un mois, 6c d’occident en orient ; joignez
les centres du foleil & de la lune par la droite S L ,
& imaginez un plan M L N , qui paffeparle centre
de la lune 6c qui loit perpendiculaire à la droite S L ,
la feétion de-ce plan avec la furface de la lune marquera
la ligne qui termine la lu-miere 6c l’ombre, &
qui fépare la face lumineufe de l’ôbfcure.
Joignez lgs centres de la terre & de la lune par la
ligne T L , à laquelle vous mènerez parle centre
de la lune un plari perpendiculaire P L O , ce plan
donnera fur la furface de la lune le cercle qui fépare
l’hémifphere vifible, ou celui qui eft tourné vers
nous, de l ’bémifphere invifible, cercle que l’on
nomme par cette raifon, cercle de vijion.
Il s’en fuit de-là que la lune étant en A , le cercle
qui termine la lumière 6c l’ombre, & le cercle de
vifion coincideront ; de façon que toute la furface
lumineufe de la lune fera tournée alors vers la terre ;
la lune en ce cas fera pleine par rapport à nous, 6c
Tome IX %
luira toute la nuit ; mais par rapport au foleil elle
fera en oppofition , parce que le foleil 6c la lune feront/
vus de la terre dans des points descieux directement
oppofés, l’un de ces aftres fe levant quand
l’autre fe couchera. Voye^ O p po s it io n .
Quand la lune arrive en B , le difque éclairé MP N
ne fera pas tourné en entier vers la terre., de façon
que la partie qui fera alors tout-à-la-fois éclairée &
vifible., ne fera pas tout-.à-fait un cercle, & la lune
,paroîtra-boflùe comme en 2?. Voye^ Bossue.
Quand elle fera arrivée vers C , où l’angle C T S
eft droit , il n’y aura plus qu’environ la moitié du
difque éclairé qui ferauournée vers Ja terre, & nous
verrons une demi-lune, elle fera dite alors dichoto-
mifée, ce qui veut dire coupée en deux. Voye^
D i c h o t o m i e .
Dans cette .fituation le foleil 6c la lune ne font
éloignés l’un de l’autre que d’un quart de cercle, &
on dit que la lune eft dansffon afpect quadral, ou
dans fa quadrature. Voyt[ Q u a d r a t u r e .
La luhe arrivant en D , il n’y aura plus qu’une petite
partie du difque éclairé M P N qui foit tournée
vers la terre, ce qui fera que la petite partie qui
nous luira paroîtra cornue , ou comme une faulx,
c ’eft-à-dire terminée par de petits angles ou cornes
comme en O. Voye{ C o r n e s & F a u l x .
Enfin la lune arrivatlt en E, elle ne montre plus à
la terre aucune partie de fa face éclairée comme en
O, & c’efl: cette pofition qu’on appelle nouvelle lune ;
la lune eft dite alors en conjonction avec le foleil,
parce que ces deux aftres répondent à un même point
de l’écliptique. Voyeç C o n j o n c t i o n .
A mefure que la lune avance vers F elle reprend
fes cornes, mais avec cette différence qu’avant la
nouvelle lune les cornes étoient tournées vers l’occident
, au - lieu qu’à préfent elles changent de poli-
tion & elles regardent l’orient: lorfqu’elle eft arrivée
en G , elle fe trouve de nouveau dichotomifée ; ën
H elle eft encore boflùe, 6c en A elle redevient
pleine. Voye^ la.figure 12.
L’angle S T L compris entre les lignes titées des
.centre j du foleil 6c de la lune, à celui de la terre,
eft nommée T élongation de la lune au foleil, & Tare
P N , qui repréfente la portion du cercle éclairée
M O N , laquelle eft tournée vers nous, eft par-tout
prefque femblable à l’arc d’élongation E L-, ou ce
qui eft la même chofe, l’angle S T L eft prefque
égal à l’angle M L O , félon que les Géomètres le
démontrent.
Moy en de décrire les phafes de là lune pour un tems
donné. Que le cercle CO B P (7%. 73. & 14.^
repréfente le difque de la lune qui eft tourné vers
la terre, & foit O P la ligne dans laquelle le demi-
cercle O C P eft projette, laquelle nous fuppoferons
coupée à angles droits par le diamètre B C ; prenez
L P pour rayon, & dans cette fuppofition L F pour
cofinus de l’élongation de la lune lur B C prife pour
grand ax e, 6c L F prife pour petit axe ; décrivez
une ellipfe B F C , cette ellipfe retranchera du difque
de la lune la portion B FC P de la face éclairée laquelle
eft vifible.
Ceux qui voudront avoir la démonftration de
cette pratique, la trouveront dans Yintroduclio ad
veram AJlronomiam dé K e iîl, qui a été traduite en
françois par M. Lemonnier, avec beaucoup d’additions
: c’eft dans le chapitre ix. de cét ouvrage que
cet auteur a donné la démonftration dont nous parlons.
Comme la lune éclaire la terre d’une lumière
qu’elle reçoit du foleil, de même elle eft éclairée
par la terre qui lui renvoyé aufli de fon côté par
reflexion des rayons du foleil, & cela en plus grande
abondance qu’elle n’en reçoit elle-même de la
lune ; car la furface de la terre eft environ quinze