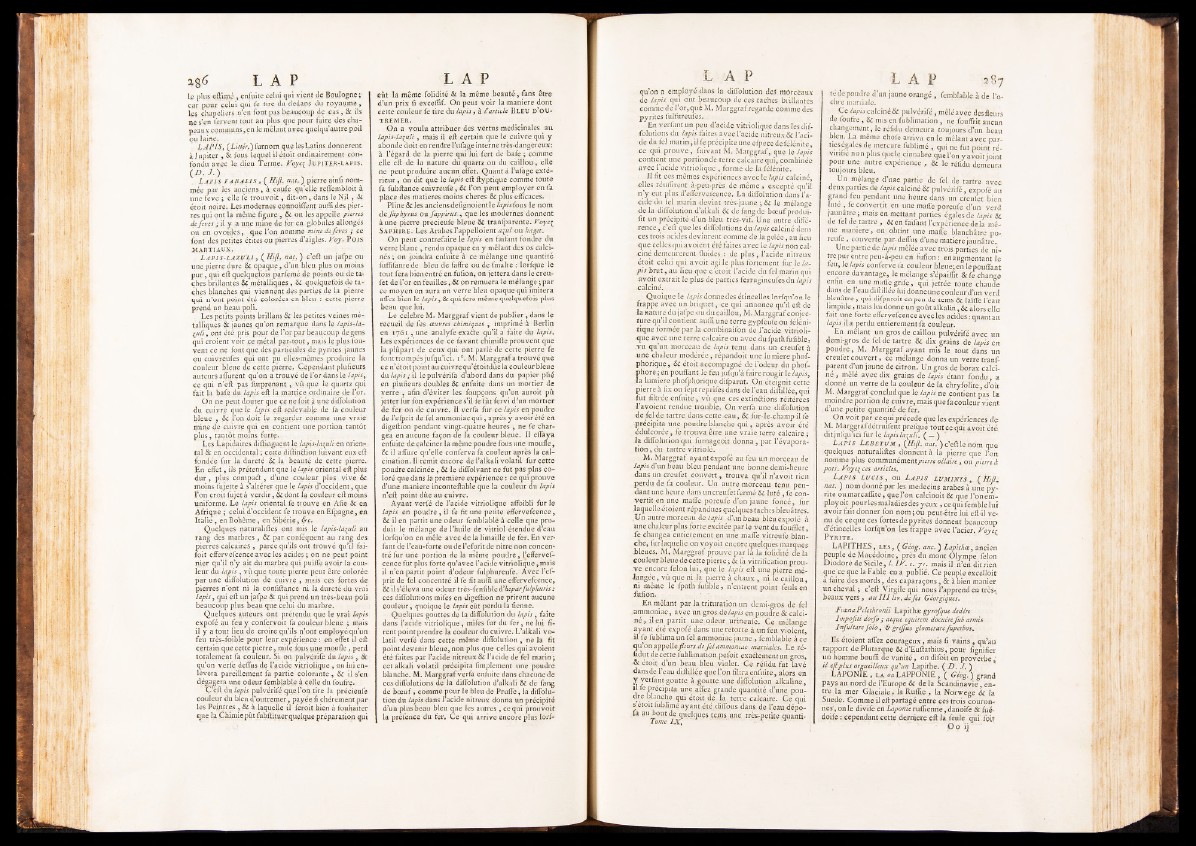
le plus , enfuite ce.luj qui vient de Ifoujogne y
cgf ppur celui qui fe tire du ,dedsn$ du roy,aume ,
les chapeliers n’ep font pas beaucoup de pas., & ils
i>e s’en fervent tout au plus que pour faire des chapeaux
c o n t in s , en le mêlant ayeç qpeiqu’autre poil
ou laine,
LAPIS, ( Littfr,) furnom que les Latins donnèrent
à Jupiter , & fous lequel il pfoit ordinairement cpn*
fondu avec le dien Terme» Foye% J.upitrRtLa pis.
( d . J . ) V ............... • ’ .V .- •.
L a p i s f j p a l i s , ( Hiß. nqt. ) pierre ainfi npm-r
ipée par les anciens, àc au fe qu’elle r.efl'embloit à
line fevé ; elle fe trou voit, dit-on, dans le N il, &
étoit noire. Les modernes Gonnoiffppt auffi .des pierres
qui ont la ippme figure , & on les appelle pierres
defeves ; il y a ppe nfme de fer en. globules allongés
ou en pvoides, que l’on pomme mine defeves ; ce
font des petites étiteson pierres d’aiglgs. Voy. Pois
martiaux.
L a p i s -l a z u Li , ( Hiß. nat, ) c’eft un jafpe ou
une pierre dpre §£ opaque, d’un bleu plus ou moins
pur, qui eft quelquefois parfemé de points ou ,cle taches
brillantes & métalliqqps , §£ quelquefois de taches
blanches qui viennent des parti.es de la pierre
qui n’ont point été colorées en filen : cette pierre
prend un beau poli.
. Les petits points brillans & les petites veines métalliques
& jaune? qu’on remarque dans le lapis-la-
iu li, ont été pris pp.ur d,e l’qr par beaucoup de gens
qui croient voir ,çe ipétal par-rtpijf, mais le plus fou-
yent ce ne font que des particule? ,de pyrites, jaunes
ou cuivreufes qui ont pu eiles-rnêmes produire la
couleur bleue de cette pierre, Cependant plufieurs
auteurs affurent qu’on a trouvé dé l’qr dans le Lapis,
ce qui n’eft pas furpren.ant, vfi qu.e le quartz qui
fait la bafe du lapis eft la ijia.tçice, ordinaire de l’or.
On ne peut douter que çe ne Toit à une diffolution
du cuiyr.e que fe lapis eft redevable de fa couleur
bleue , p£ rpn doit le regarder comme une vraie
min.e de cuivre qui en contient une portion tantôt
plus, tantôt moins forte*
Les Lapidaires diftinguent le. lapçs-laçuli en o.rien-r.
tal & en occidental ; befite diftinêfion fuivant eux eft
fondée fur la dureté ôf la beauté de cette pierre.-
En effet, ils prétendent que le lapis oriental eft plus
d u r , plus compaû , d’une couleur plus vive &
moins fujette à s’altérer que le lapis d’oc.cident, que
l’on croit fujet à verdir, & dont lg couleur eft moins
uniforme. Le lapis oriental fe trouve en Afie & en
Afrique ; celui d’occident fe trouve en Efpagne, en
Italie, en Bohême, en Sibérie, &p.
Quelques naturaliftes ont mis le lapis-la^iili au
rang des marbres , ôç par çonféqiient au rang des
pierres calcaires , parce qu’ils ont trouvé qu’il fai-
foit effervefcence ayeç les acides ; on ne peut point
nier qu’il n’y ait du marbre qui puiffe avoir la couleur
du lapis , vu que toute pierre peut être colorée
par une diffolution de çuiyre , lirais ces fortes de
pierres n’ont ni la confiftançc ni la dureté du vrai
lapis y qui eft un jafpe & qui prend un trèsrbeau poli
beaucoup plus beau que celui du marbre,
Quelques auteurs ont prétendu que le yrai lapis
expofé au feu y confervoit fa couleur bleue ; mais
il y a tout lieu de croire qu’ils n’ont employé qu’un
feu très-Jfoible pour leur expérience : en effet il eft
certain que cette pierre, mife fops iine moufle, perd,
totalement fa couleur. Si on pulyérife du lapis , &
qu’on verfe deffus de l’acide vitriolique , pn lui enlèvera
pareillement fa partie colorante , & il s’en
dégagera une odeur fombfable à celle du foufrç.
Ç ’eft du lapis pulvérifé qu,e l’oi? tire la précieufe
couleur du bleu d’outremer, payée fi chèrement par
lés Peipjtres , & à laquelle il feroit bien à foufiaiter
que la Chimiepût fubftituer quelque préparation qui
eût la même folidité .& la même beauté, fans être
d’un prix fi exceflif. On peut voir la maniéré dont
cette couleur fe tire du lapis , k l'article Bleu d’outremer.
On a voulu attribuer des. vertus médicinales au
lapis-la^uji , mais il eft certain que le cuivre qui y
abonde doit en rendre l’ufage interne très-dangereux:
à l’égard de la pierre qui lui fert de bafe ; comme
elle eft de la nature du quartz ou du caillou, elle
ne peut produire aucun effet. Quant à l’ufage extérieur
, on dit que le lapis eft ftyptique comme toute
fa fubftance cuivreufe, & l’on peut employer en fa
place des matières moins cheres & plus efficaces.
Pline & les. anciensdefignoientle/«/»«fous le nom
de faphy.rns ou fapp.irus, , que les modernes donnent
à une pierre precieufe bleue & tranfparente. Voyt£
Saphire. Les Arabes l’appelloient a^ul ou haget.
On peut contrefaire le lapis en faifant fondre du
yerre blanc , rendu opaque en y mêlant des os calcinés
; on joindra enfuite à ce mélange une quantité
fuffifante.de bleu defaffre oudefmalte : lorfque le
tout.fera bien entré enfufion, on jettera dans le creu-
fet de l’or en feuilles pn remuera le mélange ; par
ce moyen on aura un verre bleu opaque qui imitera
affez bien le lapis, & qui fera même quelquefois plus
beau que lui.
Le cejebre M. Marggraf vient de publier, dans le
recueil de fes oeuvres chimiques , imprime à Berlin
en 1761 , une analyfe exaÛe qu’il a faite du lapis.
Les expériences de ce favant chimifte prouvent que
la plupart de ceux qui pnt parlé de cette pierre fé
font trompés jufqu’ici. 1?. M. Marggraf a trou vé que
ce n’étoit point au cuivrequ’étoitdûe la couleur bleue
àx\ lapis; ‘û. lepulvérifa d’abord dans du papier plié
en plufieurs doubles &C enfuite dans un mortier de
verre , afin d’éyiter les foupçons qu’on auroit pu
jetter fur fon expérience s’il fe fût fervi d’un mortier
de 1er ou d,e cuivre. Il verfa fur ce lapis en poudre
de l’efprit de fel ammoniac qui, après y avoir été en
digeftion pendant vingt-quatre heures > ne fe chargea
en aucune façon de la couleur bleue. Il effàya
enfuite de calciner la irjême poudre fous une moufle,
& il aflure qu’elle conferva fa couleur après la calcination.
Il rpmit encore de l’alkali volatil fur cette
poudre calcinée , & le diflblvant ne fut pas plus coloré
que dans la première expérience : ce qui prouve
d’une maniéré ineonteftable que la couleur du lapis
n’eft point dûe au cuivre.
Ayant verfé de l’acide vitriolique affoibli fur le
lapis en poudre , il fe fit une petite effervefcence,
& il en partit une odeur femblablê à celle que pro-r
duit le mélange de l'huile de vitriol étendue d’eau
lorfqu’on en mêle avec de la limaille de fer. En ver-
fant de l’eau-forte ou de l’efprit de nitre non concentré
fur une portion de la même poudre, l’effervef-
cence fut plus forte qu’avec l’acide vitriolique, mais
il n’en partit point d’odeur fulphureufe. Avec l’efprit
de fel concentré il fe fit auffi une effervefcence,
& il s’éle va une odeur très-fenfible A'hepar fulphuris :
ces diffolutions mifes en digeftion ne prirent aucune
couleur, quoique le lapis eût perdu la fienne.
Quelques gouttes de la diffolution du lapis, faite
dans l’acide vitriolique, mifes fur du fer, ne lui firent
point prendre la couleur du cuivre. L’alkali volatil
verfé dans cette même diffolution, ne la fit
point devenir bleue, non plus que celles qui avoient
été faites par l’acide nitreux &c l’acide de fel marin j
cet alkali volatil précipita Amplement une poudre
blanche. M. Marggraf verfa enfuite dans chacune de
ces diffolutions de la diflblution d’alkali & de fang
de boeuf, comme pour le bleu de Pruffe, la diffolu-
tion du lapis dans l’acide nitreux donna un précipité
d’un plus beau bleu que les autres , ce qui prouvoit
la préfence du fer. Ce qui arrive encore plus lorfqu’on
a employé dans la diflblution des morceaux
de lapis qui ont beaucoup de ces taches brillantes
comme de l’or, que M. Marggraf regarde comme des
pyrites fulfureufes. .
En verfant un peu d’acide vitriolique dans les diffolutions
du lapis faites avec l’acide nitreux & l ’acide
du fel marin, ilfe précipite une efpece defélénite,
ce qui prouve, fuivant M. Marggraf, que le lapis
contient une portion de terre calcaire qui, combinée
avec l’acide vitriolique , forme de la félénite.
Il fit ces mêmes expériences avec le lapis calciné,
elles réu(firent à-peù-près de même , excepté qu’il
n ’y eut plus d’efferveficence. La diflblution dans l’acide
du (el marin devint très-jaune ; & le mélange
de la-diflblution d’alkali & de fang de boeuf produi-
fit un précipité d’un bleu très-vif. Une autre différence
, c’eft que les diffolutions du: lapis calciné dans
ces trois acides devinrent comme de la gelée, au lieu
que celles qui avoient été faites avec le lapis non calciné
demeurèrent fluides : de plus, l’acide nitreux
étoit celui qui, avôit agi le plus fortement fur le lapis
brut, au lieu que e etoit l’acide du fel marin qui
avoit extrait le plus de parties ferrugineufes du lapis
calciné.
Quoique le lapis donne des étincelles lorfqu’on le
frappe avec un briquet, ce qui annonce qu’il eft de
la nature du jafpe ou du caillou, M. Marggraf conjecture
qu’il contient auffi une terre gypfeufe ou féléni-
tique formée par la combinaifon de i ’acide vitriolique
avec une terre calcaire ou avec du fpathfufible,
.vu qu’un morceau de lapis tenu dans un creufet à
•une chaleur modérée, répandoit une lumière phof-
phorique, & étoit accompagné de l’odeur du phof-
phore ; en pouffant le feu jufqu’à faire rougir le lapis,
la lumière phofphorique difparut. On éteignit cette
pierre à fix ou fept rèprifes dans de l’eau diftillée, qui
fut filtrée e n fu i te v û que ces extinctions réitérées
l’avoient rendue trouble. On verfa une diffolution
de fel de tartre dans cette eau, & fur-le-champil fe
-précipita une poudre blanche q ui, après avoir été
édulcorée, fe trouva être une vraie terre calcaire ;
Ja diffolution qui furnageoit donna, par l’évaporation
, du .tartre vitriolé.
M. Marggraf ayant expofé au feu urt morceau de
lapis d un beau bleu pendant une bonne demi-heure
dans un creufet couvert, trouva qu’il n’avoit rien
perdu de fa couleur. Un autre morceau tenu pendant
une heure dans un creufet fermé & luté , fe convertit
en une mafle.poreufe d’un jaune foncé, fur
laquelle étoient répandues quelques taches bleuâtres.
Un autre morceau de Lapis d’un beau bleu expofé à
une chaleur plus forte excitée par le vent du foufflet, 1
fe changea entièrement, en une maffe vitreufe blanche,
fur laquelle on voyoit encore quelques marques
bleues. M. Marggraf prouve par là la folidité de la
couleur bleue de cette pierre ; & fa vitrification prou-
.ve encore félon lui , que 1 e lapis eft une pierre mélangée,
vû que ni la pierre à chaux , ni le caillou,
ni même le fpath fufîblë, n’entrent point feulsen
fufion.
En mêlant par la trituration un demi-gros de fel
.ammoniac, avec un gros d e lapis en poudre & calciné
, il en partit une odeur urineufe. Ce mélange
ayant ete expofe dans unerètorte à un feu violent,
il fe fublima un fel ammoniac jaune , femblable à ce
qif 'on appellejleurs de fe l ammoniac martiales. Le ré- I
fidut de cette lublimation pefoit exa&ementun gros,
& étoit d’un beau bleu violet. Ce réfidu fut lavé
dans de l’eau diftillée que l’on filtra enfuite, alors en
y verfant goutte à goutte une diflblution alkaline,
il fe précipita une affez grande quantité d’une poudre
blanche qui étoit de la terre calcaire. Ce qui
s etoit fublime ayant été diflous dans de l’eau dépo-
fa au bout de quelques teins une très-petite quanti-
Tome IX , ■ J
tédepouire d’un jaune orangé , femblable à de l’o-
chre martiale.
Ce lapis calciné & pulvérifé, mêlé avec des fleurs
de foufre , & mis en fublimation , ne fouffrit aucun
changement, le réfidu demeura toujours d’un beau
bleu. La même chofe arriva en le mêlant avec par-
tiesegales de mercure fublimé , qui ne fut point ré-
vmfie non plus quele cinnabre que l’on y a voit joint
pour une autre expérience , & le réfidu demeura
toujours bleu.
Un mélange d’une partie de fel de tartre avec
deux parties de lapis calciné & pulvérifé, expofé au
grand feu pendant une heure dans un creufet bien
luté , fe convertit en une maffe poreufe d’un vercl
jaunâtre; mais en mettant parties égales de lapis &
de fel de tartre , &cen faifant l’expérience delà même
maniéré, on obtint une maffe blanchâtre po-
reufe, couverte par-deflus d’une matière jaunâtre.
Une partie de lapis mêlée avec trois parties de nitre
pur entre peu-à-peu en fufion : en augmentant le
feu, le lapis conferve là couleur bleue; en le pouffant
encore davantage, le mélange s’épaiffit & fe change
enfin en une mafle grile, qui jettée toute chaude
dans de l’eau diftillée lui donneune couleur d’un verd
bleuâtre , qui difparoît en peu de tems & laiffe l ’eau
limpide, mais lui donne un goût alkalin, & alors elle
fait une forte effervefcence avec les acides : quant au
lapis il a perdu entièrement fa couleur.
En mêlant un gros de caillou pulvérifé avec un
demi-gros de fel de tartre & dix grains de lapis en
poudre, M. Marggraf ayant mis le tout dans un
creufet couvert, ce mélangé donna un verre tranl-
parent d’un jaune de citron. Un gros de borax calciné
, mêlé avec dix grains de lapis étant fondu a
donné un yerre de la couleur de la chryfolite, d’oli
M. Marggraf conclud que le lapis ne contient pas la
moindre portion de cuivre, mais que fa couleur vient
. d’une petite quantité de fer.
On voit par ce qui précédé que les expériences de
M. Marggraf detruifent prefque tout ce qui ayoit été
dit jufqu’ici fur le lapis la^uli. ( — ) * :
L a p i s Le b e tu m , (Hifl. nat. ) c’eft le nom que
quelques naturaliftes donnent à la pierre que l’on
nomme plus communément pierre ollaire > ou pierre à
pots. Voye^ces articles.
L a p i s l u c i s , ou L a p i s l u m in is ( t i i j ll
nat. ) nom donne par les médecins arabes à une pyrite
oumarcaffite, que l’on calcinoit & que l ’onem-
ployoit pour les maladies des yeux , ce qui femble lui
avoir fait donner fon nom ; ou peut-être lui eft-il venu
de ce que ces fortes de pyrites donnent beaucoup
d’étincelles lorfqn’on les frappe avec l’acier. Foyer
Pyrite.
LAPITHES, LES, ( Géog. anc. ) Lapithoe, ancien
peuple de Macédoine, près du mont Olympe félon
Diodore de Sicile, l. IF . c. y t. mais il n’en dit rien
que ce que la Fable en a publié. Ce peuple exceiloit
. à faire des mords, des caparaçons, & à bien manier
un cheval ; c’eft Virgile qui nous l’apprend en très-^
beaux vers , au I I I liv. de fes Géorgiques.
FroenaPelethronii Lapithæ gyrofque dedêre
Impofiti dorfo ; atque equitem docuêre fub armis
Infultare folo, & grejfus glomerare fuperbos.
Ils étoient affez courageux, mais fi vains , qu’au
rapport de Plutarque & d’Euftarhius, pour lignifier
un homme bouffi de vanité, on difoit en proverbe
i l e fl plus orgueilleux qu’un Lapithe. ( D . J. )
LAPONIE, la ou LAPPONIE, ( Géog. ) grand
pays au nord de l’Europe & de la Scandinavie, entre
la mer Glaciale, la Ruflie , la Norvège & la
Suede. Comme il eft partagé entre ces trois couronnes",
on le divife en Laponie ruffienne, danoife & fué-
doife : cependant cette derniere eft la feule qui foit
O o ij