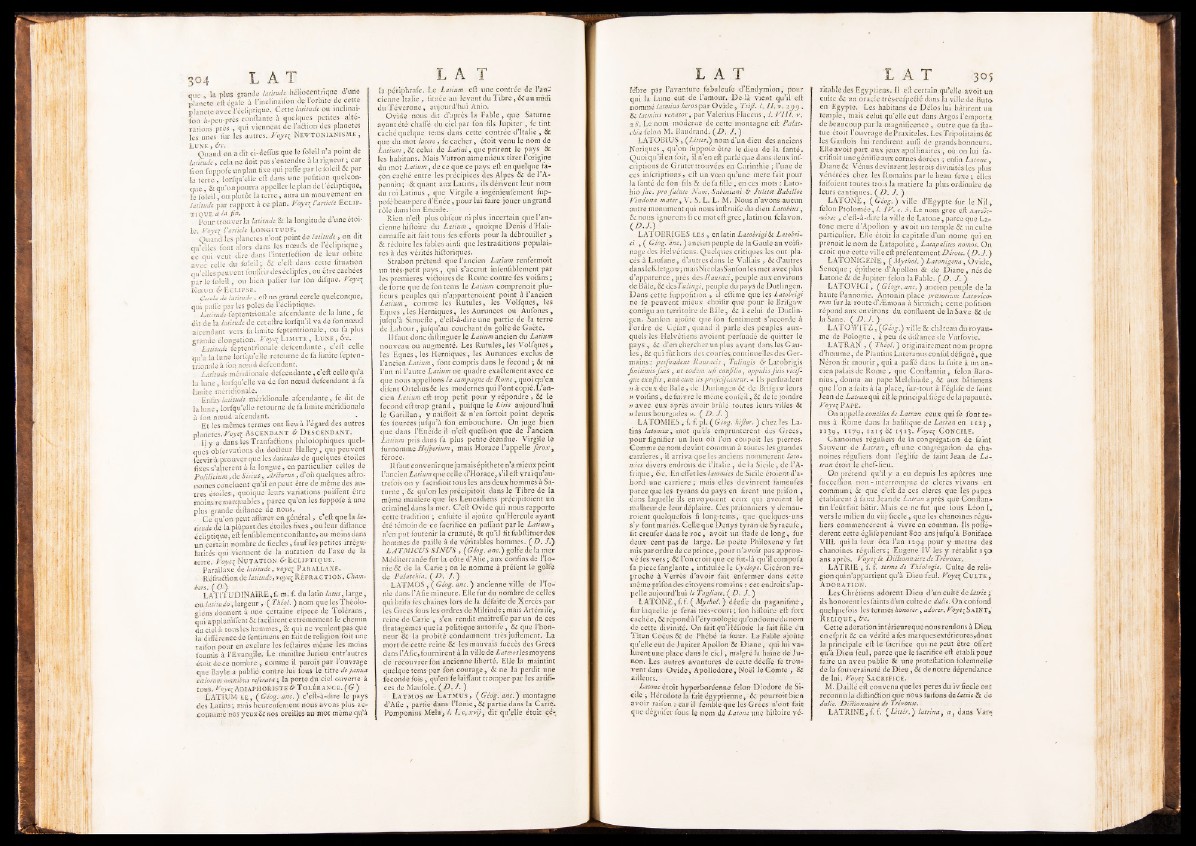
que , la plus grande UAtui* Jiéliacentritpic d’une
planète eft égale à rinclinaifon de forbite de cette
planete avec l’écliptique. Cette lanmii ou inclinai-
l'on à-peu-près confiante à quelques petites alterations
près , qui viennent de l’adion des planètes
les unes fur les autres. Yoyt^ N e w t o n i a n i s m e ,
L u n e , O c.
Quand on à dit ci-defius que le foleu n a point de
latitude, cela ne doit pas s’entendre à la rigueur ; car
fi on fuppofe un plan fixe qui pafle par le loleil 8c pai
la terre , lorfqu’elle eft dans une pofition quelconq
ue , & qu’on pourra appeller le plan de 1 écliptique,
le foleil, ou-plutôt la terre| aura un mouvement en
latitude par rapport à ce plan. Voye^Üarticle E c l i p t
i q u e à la f in . . , „ , . !
Pour trouver la latitude & la longitude d une étoilé.
Voyez l ’article LONGITUDE.
Quand les planètes n’ont point de latitude y on dit
qu’elles font alors dans les noeuds de l’écliptique,
ce qui veut dire dans l’interfeâion de leur orbite
avec celle du foleil; 8c c’eft: dans cette fituation
qu'elles peuvent fouffrir des éclipfes, ou être cachées
par le foleil, ou bien paffer fur fon dilqué. Voye{
Noeud & E c l i p s e .
Cercle, de latitude, eft un grand cercle quelconque,
qui pafle par les polçs de 1 écliptique.
Latitude feptentrionale afcendante de la lune, fe
dit de la latitude de cetaftre lorfqu’il va de fon noeud
afeendant vers fa limite feptentrionale, ou 1a plus
grande élongation. Voyez L i m i t e , L u n e , 6 * c .
Latitude feptentrionale defeendante, c’eft celle
qu'a la lune lorfqu’elle retourne de fa limite fepten-
trionale à fon noeud defeendant.
Latitude méridionale defeendante, c’eft celle qu’ a
la lune lorfqu’elle va de. fon noeud defeendant à fa
limite méridionale. /.
Enfin Latitude méridionale afcendante, fe dit de
la lune lorfqu’elle retourne de fa limite méridionale
à fon noeud afeendant.
Et les mêmes ternies ont lieu à l’égard des autres
p la n e t e s .'/ ^ o j e ç A s c e n d a n t 0 D e s c e n d a n t .
*. i | y a dans lesTranfaâions philofophiques quelques
ubfervations du doûeur Halley, qui peuvent
fervir à prouver que les latitudes de quelques étoiles
f i x e s s’altèrent à la longue , en particulier celles de
Polilicium, de Sinus, ArMurus, d’où quelques aftro-
nomes concluent qu’il en peut être de même des autres
étoiles!, quoique leurs variations puiflent etre
moins remarquables, parce qu’on les fuppofe à une
plus grande diftance de nous«
- Ce” qu’on peut affurer en, général, c’ eft que la latitude
de la plupart des étoiles fixes , ou leur diftance
écliptique, eft lenfiblement confiante, au-moins dans
un certain nombre de fiecles , fauf les petites irrégularités
qui viennent de la nutation de l’axe de la
terre. Voyez N u t a t i o n & E c l i p t i q u e .
Parallaxe de latitude, voyez Parallaxe.
V^èÏTaOtionAe latitude y voyezRÉFRACTION. Cham-
bers. ( Oi) - i . 1 : .
LATITUDINAIREjf. m. f. du latin latus, large,
ou latitudo, largeur, ( Thèol. ) nom que les Théologiens
donnent à une certaine efpece de Tolérans ,
qui a pplanlflent 8c facilitent extrêmement le chemin
du ciel à tous les hommes, & qui ne veulent pas que
la différence de fentimens en fait de religion foit une
raifon pour en exclure les feftaires même les moins
fournis à l’Evangile. Le miniftre Jurieu entr’autres
étoit de ce nombre -, comme il paroît par l’ouvrage
que Bayle a publié contre lui tous le titre dejanua
ccslomm omnibus referata ; la porte du ciel ouverte à
tous. ^oy^ADiAPHORPSTE<& T o l é r a n c e . (G }
LATIUM l e , ( Géog. a ne. ) c’eft-à-dire le pays
des Latins ; mais heureufement nous avons plus accoutumé
nos yeux 8c nos oreilles au mot même qu’à
la périphrafe. Le Latium eft une contrée de l’ancienne
Italie , fituée au levant du T ib re, 6c au midi
du Téverone , aujourd’hui Anio.
Ovide nous dit d’après la Fable, que Saturne
ayant été chaflé du ciel par fon fils Jupiter , fe tint
caché quelque tems dans cette contrée d’Italie , &
que du mot latere, fe cacher, étoit venu le nom de
Latium , 8c celui de Latini, que prirent le pays &
les habitans. Mais Varron aime mieux tirer l’origine
du mot Latium, de ce que ce pays eft en quelque façon
caché entre les précipices des Alpes 6c de l ’A pennin;
8c quant aux Latins, ils dérivent leur .nom
du roi Latinus , que Virgile a ingénieufement fup-
pofè beau-pere d’Enée, pour lui faire jouer un grand
rôle dans fon Enéide.
Rien n’eft plusobfcur ni plus incertain que l ’ancienne
hiftoire du Latium y quoique Denis d’Hali-
carnaffe ait fait tous fes efforts pour la débrouiller »
& réduire les fables ainfi que les traditions populaires
à des vérités hiftoriques.
Strabon prétend que l’ancien Latium renfermoit
un très-petit pa ys , qui s’accrut infenfiblement par
les premières victoires de Rome contre fes voifins;
de forte que de fon tems le Latium comprenoit plu-
fieurs peuples qui n’appartenoient point à l’ancien
Latium, comme les Rutules, les Volfques, les
Eques , les Herniques, les Aurunces ou Aufones ,
jufqu’à Sinueffe, c’eft-à-dire une partie de la terre
de Labour , jufqu’au couchant du golfede Gaëte.
Il faut donc diftinguer le Latium ancien du Latium
nouveau ou augmenté. Les Rutules, les Volfques»
les Eques, les Herniques, les Aurunces exclus de
l’ancien Latium, font compris dans le fécond ; 8c ni
l’un ni l’autre Latium ne quadre exactement avec ce
que nous appelions la campagne de Rome, quoi qu’en
difent Ot telius 8c les modernes qui l’ont copié. L’ancien
Latium eft trop petit pour y répondre, 6c le
fécond eft trop grand , puifque le Liris aujourd’hui
le Garillan, y naiffoit & n’en fortoit point depuis
fes fources jufqu’à fon embouchure. On juge bien
que dans l’Enéide il n’eft: queftion que de l’ancien
Latium pris dans fa plus petite étendue. Virgile le
furnomme Hefperimn, mais Horace l’appelle feroxy
féroce.
Il faut convenir que jamais épithete n’a mieux peint
l’ancien Latium que celle d’Horace, s’il eft vraiqu’au-
trefoison y facrifioit tous les ans deux-hommes à Saturne
, 6c qu’on les précipitoit dans le Tibre de la
même maniéré que les Leucadiens précipitaient un
criminel dans la mer. C ’eft O vide qui nous rapporte
cette tradition ; enfuite il ajoure qu’Hercule ayant
été témoin de ce facrifiee en paffant par le Latium ,
n’en put foutenir la cruauté, & qu’il fitfubftituerdes
hommes de paille à de véritables hommes. ( D. /.)
LATM1CUS S IN U S , (Géog. anc.) golfe de la mer
Méditerranée fur la côte d’Alie, aux confins de Ironie
8c de la Carie ; on le nomme à préfent le golfe
de Paéatckia. ( D . J. )
LATMOS, ( Géog. anc. ) ancienne ville de Ho me
dans l’Afie mineure. Elle fut du nombre de celles
qui brifa (eschaînes lors de la défaite de Xercès par
les Grecs fous les ordres de Miltiade ; mais Artémife,
reine de Carie , s’en rendit maîtreffe par un de ces
ftratagèmes que la politique autorife, 6c que l’honneur
6c la probité condamnent très juftement. La
mort de cette reine 6c les mauvais fuccès des Grecs
| dans l’Afie, fournirent à la ville de Latmosles moyens
I de recouvrer fon ancienne liberté. Elle la maintint
quelque tems par fon courage, & ne la perdit une
fécondé fois, qu’en fe laiffant tromper par les artifices
de Maufole. (D .J . )
L a t m o s ou L a t m u s , (Géog. anc.y montagne
d’Alîe , partie dans l’ Ionie, 8c partie dans la Carie.
Pomponius Mêla, l. /. c-, xvij y dit qu’elle étoit çé-
Jebre par l’avanture fabuleufe d’Endymion ÿ |5our
qui la Lune eut de l’amour. De-Ià vient qu’il eft
nommé latmius héros par Ovide, Triß. I. II. v. xc)C) -,
& latmius venator y par Valerius Flaceus , 7. VIIL. v.
z8 . Le nom moderne de cette montagne eft PaLat-
chia félon M. Baudrand. (D . J. )
LATOBIUS , ( Litter.) nom d’un dieu des anciens
Noriques., qu’on fuppofe être le dieu de la fanté.
Quoi qu’il en foit, il n’en eft parié que dans deux inf-
criptions de Grutertrouvées en Carinthie ; l’une de
ces inferiptions, eft un Voeu qu’une mere fait pour
la fanté de fon fils & de fa fille, en ces mots : Lato-
bio fac. pro falute Nam'. Sabiniani & Julitoe Babilloe
Vindona mater, V . S. L. L. M. Nous n’avons aucun
autre monument qui nous inftruife du dieu Latobius,
6c nous ignorons fi ce mot eft grec., latin ou fclavon. (^•/•) „ ..................... LA I OBRIGES les , en latin Latobrigi8t Latobri-
ci , ( Géog. anc. ) ancien peuple de la Gaule au voifi-
nage des Helvétiens. Quelques critiques les ont placés
àLaufane, d’autres dans le Vallais , 6c d’autres
dansleKletgow; maisNicolasSanfon les met avec plus
d’apparence, près des Rauraci, peuple aux environs
de Bâle, 6c âesTulingi, peuple du pays de Dutlingen.
Dans cette fuppofition , il eftime que les Latobrigi
ne fe peuvent mieux choifir que pour le Brifgaw
contigu au territoire de Bâle, 6c à celui de Dntlin-
gen. Sanfon ajoute que fon fentiment s’accorde à
l ’ordre de Cé far, quand il parle des peuples auxquels
les Helvétiens avoient perfuadé de quitter le
pays , 6c d’en chercher un plus avant dans les Gaules
, 6c qui fut hors des courfes continuelles des Germains:
perfuadent Rauracis , Tulingis & Latobrigis
finitimis fuis , ut eodem ufi confilio, oppidis Juis vicif-
que exußis, unà |um iis proficifcantur. « Ils perfuadent
>* à ceux de Baie, de Dutlingen 6c de Brifgaw leurs
» voifins, defuivre le même conleil, 6c defe joindre
» avec eux après avoir brûlé toutes leurs villes &
» leurs bourgades ». (D . J.')
LATOMIES, f. f. pi. ( Géog. hißor. ) chez les Latins
latomiæ, mot qu’ils empruntèrent des Grecs,
pour lignifier un lieu oit l’on coupoit les pierres*
Comme ce nom devint commun à toutes les grandes
carrières, il arriva que les anciens nommèrent latomies
divers endroits de l’Italie ? de la Sicile, de l’Afrique
, &c. En effet les latomies- de Sicile étoient d’abord
une carrière ; mais elles devinrent fameufes
parce que les tyrans du pays en firent une prifon ,
dans laquelle ils envoyoient ceux qui avoiènt le
ïùalheur de leur déplaire. Ces prifonniers y dernsu-
roient quelquefois fi long-tems, que quelques-uns
s’y font mariés. Celle que D enys tyran de Syracufc,
fit ereufer dans le ro c , avoit un ftade de long, fur
deux cent pas de large. Le poète Philoxene y fut
mis par ordre de ce prince, pour n’avoir pas approuvé
fes vers ; 6c l’on croit que ce fut-là qu’il compofa
fa piece fanglante , intitulée le Cyclope. Cicéron reproche
à Verrès d’avoir fait enfermer dans cette
même prifon des citoyens romains1 : cet endroit s’appelle
aujourd’hui le Tagliate. ( D. J. )
LÂ TÔ N E ,f.f. (Mythol.y déefîe du paganifme,
fur laquelle je ferai très-court ; fon hiftoire eft fort
cachée, 6c répondit l’étymologie qu’ondonnedunom
de cette divinité. On fait qu’Héfiod'e la fait fille du
Titan Coëus 6c de Phébê 1a foeur. La Fable ajoute
qu’elle eut de Jupiter Apollon 6c Diane, qui lui valurent
une place dans le c ie l, malgré la haine de Ju-
non. Les autres avantures de cette déefte fe trouvent
dans Ovide, Apollodore, Noël le Gerate , 6c
ailleurs.
Lato ne étoit hyperboréenne félon Diodore de Sicile
; Hérodote la- fait égyptienne, 8c pourront bien
avoir raifon :• car il fembl'e que les Grecs n’ont feit
que dégmfer fous le nom de f atone une hiftoire véritable
des Egyptiens. II eft certain qu’elle avoit un
culte ôc un oracie très-refpeélé dans la ville de Buto
en Egypte. Les habitans de Délos lui bâtirent un
temple, mais celui qu’elle eut dans Argos l’emporta
de beaucoup par la magnificence , outre que fa fta-
tue étoit l’ouvrage de Praxiteles. LesTripolitains6c
les Gaulois lui rendirent aufil de grands honneurs.
Elle avoit part aux jeux apollinaires , oit on lui facrifioit
unegéniffe aux cornes dorées ; enfin Lztone ,
Diane ôc Vénus devinrent les trois divinités les plus
vénérées chez les Romains par le beau fexe ; elles
faifoient toutes trois la matière la plus ordinaire de
leurs cantiques. (D . J. )
LATONÉ, ( Géog. ) ville d’Egypte fur le N il,
félon Ptolomée, l. IV. c. 5 . Le nom grec eft a«to?ç-
«aroA/f , c ’eft-à-dire la ville de Latpne, parce que La-
tone mere d ’Apollon y avoit un temple 6c un culte
particulier. Elle étoit la capitale d’un nome qui en
prenoit le nom de Latapolite, Latapalites nomos. On
croit que cette ville eft préfentementDérote. (D.J.y
LATONIGENE, ( Mytkol. ) Latonigena, Ovide*
Seneque ; épithete d’Apollon & de Diane, nés de
Latone & de Jupiter félon la Fable. (D . J.')
LA TO V IG I, (Géogr. anc. ) ancien peuple de la
haute Pannonie. Antonin place proetorium Latovico-
rum fur la route d’Æmona à Sirmich; cette pofition
répond aux environs du confluent de la Save 6c de
laSane. ( D . / . ) -
L A TOW IT Z , (Géog.') ville & château du royaume
de Pologne , à peu de diftance de Vàrfovie.
LATRAN , ( Théol. ) originairement nom propre
d’homme, de PlautiusLateranusconfuldéfigné, que
Néron fit mourir, qui a pafle dans la fuite à un ancien
palais de Rome , que Conftantin, félon Baro-
nius , donna au pape Melchiade, 6c aux bâtimens
que l ’on a faits à fa place, fur-tout à i’églife de feint
Jean de Latran qui eft le principal fiége de la papauté.
Voyc^ P a p e .
On appelle conciles de Latran ceux qui fe font tenus
à Rome dans la bafilique de Latran en 1123 *
1139 , 1179, 1215 ôc 1513. Voye^ C o n c i l e .
Chanoines réguliers de la congrégation de faint
Sauveur de Latran, eft'une congrégation de chanoines
réguliers dont l’églife de laint Jean de Latran
étoit le chef-lieu.
On. prétend qu’il y a eu depuis les apôtres une
fucceflion non-interrompue de clercs vivans en
commun; & que c’eft.de ces clercs que les papes
établirent à faint Jean de Latran après que Conftantin
l’eût fait bâtir. Mais ce ne fut que fous Léon I.
vers le milieu du viij fiecle, que les chanoines réguliers
commencèrent à vivre en commun. Ils poffé-
«lerent cette églife pendant 800 ans jufqu’à Boniface
VIII. qui la leur ôta l’an 1294 pour y mettre des
chanoines réguliers ; Eugene IV les y rétablit 150
ans après. Voyelle Dictionnaire de Trévoux.
LATRIE , f. f. terme de Théologie. Culte de religion
qui n’appartient qu’à Dieu feul. Voye^ C u l t e ,
A d o r a t i o n .
Les Chrétiens adorent Dieu d’un culte de Latrie
ils honorent les faints d’im. culte de dulie. On confond
quelquefois les termes honorer, adorer. Voye^ S a i n t *
R e l i q u e , O c.
Cette adoration intérieure que nous rendons à D ieu
enefprit & en vérité a fes marquesextérieures,dont
ta principale eft le facrifiee qui ne peut être offert
qu’à Dien feul, parce que le facrifiee eft établi pouf
faire un aveu public & une proteftation folemnelle
de ta foUveraineté de Dieu , & de notre dépendance
de loi. Voyez S a c r i f i c e .
M. Daillé eft convenu que les peresdu iv ficelé ont
reconnu la diftinâion que nous taif ons de latrie & de
dulie. Dictionnaire de Trévoux.
LATRINE, f. f. ( Littér. ) latrina, datas Vaiv