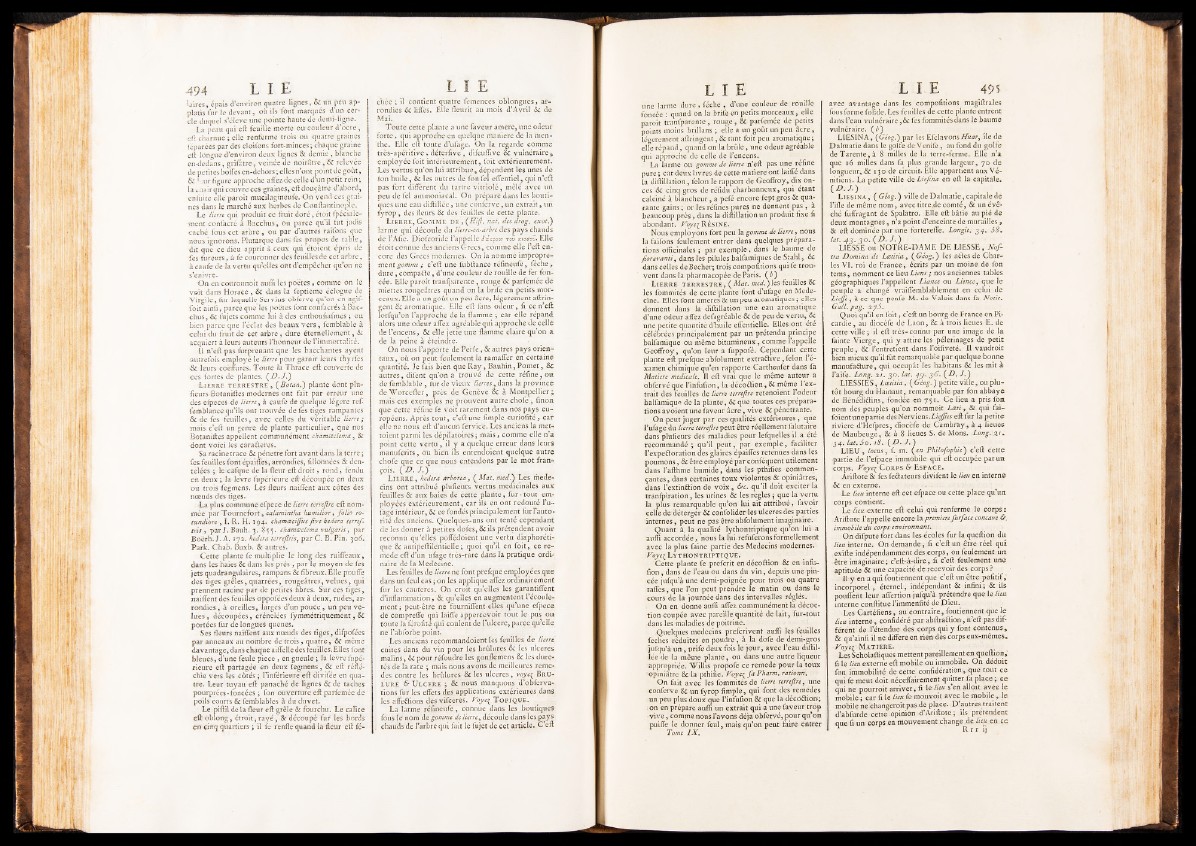
la ires, épais d’environ quatre lignes, & un peu ap-
platis fur le devant, où ils font marqués -d’un cercle
duquel s’élève une pointe haute de demi-ligne.
La peau qui eft feuille morte ou couleur d ’ocre ,
eft charnue; elle renferme trois ou quatre graines
féparées par des cloifons fort-minces; chaque graine
eft longue d’environ deux lignes & demie , blanche
en-dedans, grifâtre, veinée de noirâtre, 6c relevée
de petites boffes en-dehors ; elles n’ont point de goût,
6c 1 nir figure approche allez de celle d’un petit rein ;
la ciiair qui couvre ces graines, eft douçâtre d’abord,
enfuite elle paroît mucilagineufe. On vend ces graines
dans le marché aux herbes de Conftantinople.
Le Lierre, qui produit ce fruit doré,étoit fpéciale-
ment confacré à Bacchus, ou parce qu’il fut jadis
caché fous cet arbre, ou par d’autres raiforts que
nous ignorons. Plutarque dans fes propos de table,
dit que ce dieu apprit à ceux qui étoient épris de
fes fureurs, à fe couronner des feuilles de cet arbre,
à caufe de la vertu qu’elles ont d’empêcher qu’on ne
s’enivre.
On en coùronnôit aufti les poètes, comme on le
voit dans Horace, & dans la feptieme éclogue de
Virgile, fur laquelle Servius obferve qu’on en agif-
foit ainfi, parce que les poètes font confacrés à Bacchus,
6c fujets comme lui à des enthoufiafmes ; ou
bien parce que l’éclat des beaux v e r s , femblable à
celui du fruit de cet arbre , dure éternellement, &
acquiert à leurs auteurs l’honneur de l’immortalité.
11 n’eft pas furprenant que les bacchantes ayent
autrefois employé le lient pour garnir leurs thyrfes
6c leurs coëffures. Toute la Thrace eft couverte de
ces fortes de plantes. (D.Jd)
L ierre terrestre , ( Botan.) plante dont plusieurs
Botaniftes modernes ont fait par erreur une
des efpeces de lierre, à caufe de quelque lég.ere ref-
femblance qu’ils ont trouvée de fes tiges rampantes
ÔC de fes feuilles, avec celles du véritable lierre ;
mais c’eft on genre de plante particulier, que nos
Botaniftes appellent communément chamoeclema, &
dont voici les caraûeres.
Sa racine trace 6c pénétré fort avant dans la terre ;
fes feuilles font épaiffes, arrondies, fillonnées & dentelées
; le cafqwe de la fleur eft droit > rond, fendu
en deux ; la levre fupérieure eft découpée en deux
ou trois fegmens. Les fleurs naiffent aux côtes des
noeuds des tiges.
La plus commune efpece de lierre terrefire eft nommée
par Tournefort, calamintha humilior, folio ro-
tundiorc , I. R. H. 194. ckamaciffus flve hedera terref-
tris, par J. Bauh. 3. 85 5. charrueclema vulgaris, par:
Boërh. J. A. 172. hedera terreflris, par C. B. Pin. 306.
Park. Chab. Buxb. & autres.
Cette plante fe multiplie le lông dés ruifléaux,
dans les haies 6c dans les prés , par le moyen de fes
jets quadrangulaires, rampans 6c fibreux. Elle pouffe
des tiges grêles, quarrées, rougeâtre*, velues, qui
prennent racine par de petites fibres. Sur ces tiges,
naiffent des feuilles oppofées deux à deux, rudes, arrondies
, à oreilles, larges d’un pouce , un peu velues
, découpées, crénelées fymmétriquement, &
portées fur de longues queues.
Ses fleurs naiffent aux noeuds des tiges, difpofées
par anneaux au nombre de trois, quatre, 6c même
davantage, dans chaque aiffelle des feuilles.Elles font
bleues, d’une feule piece, en gueule ; la levre fupérieure
eft partagée en deux fegmens, 6c eft réfléchie
vers les côtés ; l’inférieure eft divifée en quatre.
Leur tuyau eft panaché de lignes & de taches
pourprées - foncées ; fon ouverture eft parfemée de
poils courts & femblables à du duvet.
Le piftil de la fleur eft grêle & fourchu. Le calice
eft oblong, étroit, r a y é , & découpé fur les bords
en cinq quartiers ; il fe renfle quand la fleur eft féchée
; il contient quatre femences oblonguès, arrondies
6c liffes. Elle fleurit au mois d’Avril & de
Mai.
Toute Cëttè pla'nte a une faveur amere, une odeur
forte, qui approche en quelque maniéré dé la menthe.
Elle eft toute d’ufage. On la regarde comme
très-apéïitive, déterfive, difeuflive 6c vulnéraire ,
employée foit intérieurement, foit extérieurement.
Les vertus qu’on lui attribue, dépendent les unes de
fon huile, & les autres de fon fel effentiel, qui n’eft
pas fort différent du tartre vitriolé, mêlé avec un
peu de fel ammoniacal. On prépare dans les boutiques
une eau diftillée, une conferve, un extrait, un
fyrop, des fleurs 6c des feuilles de cette plante.
Lierre, Gomme de , (Rifl. nat. des drog. exot.)
larme qui découle du lierre-en-arbre des pays chauds
de l’Afie. Diofcoride l’appelle S'cUpuov tou xiaeoiï. Elle
ëtoit connue de$iânciens Grecs, comme elle l’eft encore
des Grecs modernes. On la nommé improprement
gomme; c’eft une fubftance réfineufe, féche,
•dure, compacte, d’une couleur de rouille de fer foncée.
Elle paroît tranfpàrente, rouge 6c parfemée de
miettes rougeâtres quand on la brile en petits morceaux.
Elle a un goût un peu âcre, légèrement aftrin-
gent 6c aromatique. Elle eft fans odeur, fi ce n’eft
lorfqu’on rapproché de la flamme ; car elle répand
alors une odeur affez agréable qui approche de celle
de l’encens, 6c elle jette une flamme claire qu’on a
de la peine à éteindre.
On nous l’apporte de Perfe, & autres pays orientaux,
oii on peut feulement la ramaffer en certaine
quantité. Je lais bien que R a y , Bauhin, Pomet, 6c
autres, difent qu’on a trouvé de cette réfine, ou
de femblable , fur de vieux lierres, dans la province
de "Worcefter, près de Genève 6c à Montpellier;
mais ces exemples ne prouvent autre ch ofe, finon
que cette réfine fe voit rarement dans nos pays européens.
Après tout, c’eft une fimple euriofité, car
elle ne nous eft d’aucun fér'vic'e. Les anciens la met-
toient parmi les dépilatoires ; mais, comme elle n’a
point cette vertu , il y a quelque erreur dans leurs
manuferits, ou bien ils entendoient quelque autre
chofe que ce que nous entendons par le mot fran-
çois. ( D . J.')
Lierre, hedera àrborea> ( Mat. med.) Les ihede-
cins ont attribué plufieurs vertus médicinales aux
feuilles & aux baies de Cette plante, fur-tout employées
extérieurement, car ifs en ont redouté l’u-
fage inférieur, 6c ce fondés principalement fur l’autorité
des anciens. Quelqües-uns ont tenté cependant
de les donner à petites dofes, 6c ils prétendent avoir
reconnu qu’elles poffédoient une vertu d iap h on ique
6c antipeffileritielle ; quoi qu*il en foit, ce re-
mede eft d’un ufage très-rare dans la pratique ordinaire
de la Medecine.
Les feuilles de lierre ne font prefque employées que
dans un feul cas ; on les applique affez ordinairement
fur les cautères. On croit qu’elles les garantiffent
d’inflammation, & qu’elles en augmentent l’écoulement
; peut-être ne fourniffent-elles qu’une efpece
de compreffe qui laiffe appercevoir tout le pus ou
toute la férofité qui coulent de l’uIcere, parce quelle
ne l’abforbe point.
Les anciens recommandoient les feuilles de lierre
cuites dans du vin pour les brûlures 6c les uleeres
malins , 6c pour réfoudre les gonflemens & les duretés
de la rate ; mais nous avons de meilleures remèdes
contre les brûlures 6c les ulcérés, voye{ Brûlure
& Ulcéré ; 6c nous manquons- d’obferva-
tions fur les effets des applications extérieures dans
les affeffions desvifeeres. Voye{ T opique.
La larme réfineufe, connue dans les boutiques
(ous le nom de gomme de lierre, découle dans les pays
chauds de l’arbre qui fait le fujet de cet article. C eft
une larme dure, féche , d’une couleur de rouille
foncée : quand on la b rite en petits morceaux, elle
paroît tranfparente, rouge , 6c parfemée de petits
points moins brillans ; elle a un goût un peu âc re,
légèrement aftringent, 6c tant foit peu aromatique;
elle répand, quand on la brûle, une odeur agréable
qui approche de celle de l’encens. • 1 •
La larme ou gomme de lierre n’eft pas une refine
pure ; car deux livres de cette matière ont laiffe dans
la diftillation, félon lé rapport de Geoffroy, dix onces
6c cinq gros de réfidu charbonneux, qui étant
calciné à blancheur, a pefé encore fept gros & quarante
gains ; or les réfines pures ne donnent pas , à
beaucoup près, dans la diftillation un produit fixe fi
abondant. Voye[ Résine.
Nous employons fort peu la gomme de lierre, nous
la faifons feulement entrer dans quelques préparations
officinales ; par exemple, dans le baume de
fioravanti, dans les pilules balfamiques de Stahl, 6c
dans celles deBecher; trois compofitions qui fe trou^
vent dans la pharmacopée de Paris. (£ )
Lierre terrestre, (Mae. mcd.)les feuilles 6c
les fommités de cette plante font d’ufage en Médecine.
Elles font ameres & un peu aromatiques ; elles
donnent dans la diftillation une eau aromatique
d’une odeur affez defagréable & de peu de vertu, &
une petite quantité d’huile effentielle. Elles ont ete
célébrées principalement par un prétendu principe
balfamique ou même bitumineux, comme l’appelle
Geoffroy , qu’on leur a fuppofé. Cependant cette
plante eft prefque abfolument extraftive, félon l’examen
chimique qu’en rapporte Cartheufer dans fa
Matière medicale. Il eft vrai que le même auteur a
obfervé que l’infufion, la décoftion, 6c même l’extrait
des feuilles de lierre terrefire retenoient l’odeuf
balfamique de la plante, & que toutes ces préparations
a voient une faveur âcre, vive & pénétrante.
On peut juger par ces qualités extérieures, que
l’ufage du lierre:terrefire peut être réellement falutaire
dans plufieurs des maladies pour lefquelles il,a ete
recommandé ; qu’il peut, par exemple, faciliter
l’expeftoration des glaires épaiffes retenues dans les
poumons, 6c être employé par conféquent utilement
dans l’afthme humide, dans les pthifies commençantes
, dans certaines toux violentes & opiniâtres,
dans l’extinâion de v o ix , &c. qu’il doit exciter la
tranfpiration, les urines & les,réglés :■ que la vertu
la plus remarquable qu’on lui ait attribué, favoir
celle de déterger 6c confolider les ulcérés des parties
internes, peut ne pas être abfolument imaginaire.
Quant' à. la qualité lythontriptique qu’on lui a
aufli accordée,; nous la lui-refuferonsformellement
avec la plus faine partie des Médecins modernes.
Voye{ Lythontriptique.
Cette plante fe preferit en déeoâion & en infit-
fion, dans de l’eau ou dans du v in , depuis une pincée
jufqu’à une demi-poignée pour trois ou quatre
taffes, que l’on peut prendre le matin ou dans le
cours de la journée dans des intervalles réglés.
On en donne aufli affez communément la décoction
coupée avec pareille quantité de lait, fur-tout
dans les maladies de poitrine.
Quelques médecins preferivent aufli les feuilles
feches réduites en poudre, à la dofe de demi-gros
jufqu’à un , orife deux fois le jour , avec l’eau diftillée
de la même plante, ou dans une autre liqueur
appropriée. 'Willis propofe ce remede pour la toux
opiniâtre 6c la pthifie. Voye^faPharm. ratïonn'.
On fait avec les fommités de lierre terrefire, une
conferve & un fyrop fimple , qui font des remedes
un peu plus doux que l’infufion & que la déedâion;;
;on en prépare aufli un extrait qui a une faveur trop
- v iv e , comme nous l’avons déjà obfervé, pour qu’on
puiffe le donner feul, mais qu’on peut faire entrer
Tome IX ,
avec avantage dans les compofitions magiftrales
fous forme folide. Les feuilles de eette plante entrent
dans l’eau vulnéraire ,6c fes fommités dans le baume
vulnéraire. ’(£)
LIESINA, (Géogi) par les Efclavons//«tfr, île de
Dalmatie dans le golfe de Venife, au fond du golfe
deTaren te,à 8 milles de la terre-ferme. Elle n’a
que 16 milles dans fa plus grande largeur, 70 de
longueur, & 130 de circuit. Elle appartient aux Vénitiens.
La petite v ille de Liefina en eft la capitale.
( D J -)
Liesina , ( Géog. ) ville de Dalmatie, capitale de
l’ifle de même nom, avec titre.de comté, & un évêché
fuffragant de Spalatro. Elle eft bâtie au pié de
deux montagnes, n’a point d’enceinte de murailles ,
& eft dominée par une fortereffe. Longit.yß 4. 58,
lat. A r . 30. (D . J.')
LIESSE ou NOTRE-DAME DE LIESSE, Nofi-
tra Domina de Latitia, ( Géog. ) les a êtes de Charles
VI. roi de France, écrits par un moine de fon
tems, nomment ce lieu Liens ; nos anciennes tables
géographiques l’appellent Liance ou Lience, que le
peuple a changé vraiffemblablement en celui de
Ließe, à ce que penfe M. de Valois dans fa Notit.
GalL. pag. xy5 .
Quoi qu’il en foit, c’eft un bourg de France en Picardie
, au diocèfe de Laon, & à trois lieues E. de
cette ville ; il eft très-connu par une image de la
fainte Vierge, qui y attire les pèlerinages de petit
peuple, 6c l’entretient dansToifiveté. Il vaudroit
bien mieux qu’il fût remarquable par quelque bonne
manufaâure, qui occupât les habitans 6c les mît à
l’aife. Long. 21. 30. lat. 4g..§&.. (D . J.')
LIESSIES, Loetitia, ( Géog. ) petite ville, ou plutôt
bourg du Hainaut, remarquable par fon abbaye
de Bénédiâins, fondée en 751. Ce lieu a pris fon
nom des peuples qu’on nommoit Loeti , & qui fai-
foientune partie des Nerviens.Ließes eft fur la petite
riviere d’Hefpres, diocèfe de Càmbray., à 4 lieues
de Maubeuge, & à 8 lieues S. de Mons. Long:21 :
.34. lat:5'o. 18. (D . )
LIEU, locus, fi m. (en Philofophie) c’eft cette
partie -de. l’efpace immobile qui eft occupée par un
corps, f^oyei C orps 6* Espace.
: Ariftote & fes fe&ateurs divifent le lieu en interne
6c en externe.
•Le lieu interne eft cet efpace ou cette place qu’un
corps contient.
Le lieu externe eft celui qui renferme le corps:
Ariftote l’appelle encore .la première furface concave &,
immobile du corps• environnant.
On difpute fort dans les écoles fur la queftion du
lieu interne. On demande, fi e’eft un être réel qui
exifte indépendamment des eorps, ou feulement un
être imaginaire; c’eft-à-dire, fi c’eft feulement une
aptitude 6c une capacité de recevoir des'corps ?
Il y en a qui foutiennent que c’eft un être pofitif,’
incorporel, éternel, indépendant & infini ; & ils
pouffent leur affertion jufqu’à prétendre que 1 elieu
interne conftitue l’immenfité de D ieu.
Les Cartéfiens, au contraire , foutiennent que le
lieu interne, confidéré par abftraftion, n’eft pas dif- j fërent: de. l’étendue des corps qui y font contenus,
& qu’ainfi il ne différé en rien des corps eux-mêmes,
Voyt^ Mattere. ■ . _
Les Scholaftiques mettent pareillement en queftion,'
fi le lieu externe eft mobile ou immobile. On déduit
fon immobilité de cette' confidératibn , que tout ce
qui fe meut doit néceffairement quitter fa place ; ce
qui ne pourroit arriver, fi le lieu s’en alloit avec le
mobile ; car fi le lieu fe mouvoit avec le mobile, le
mobile ne changèroit pas de place. D autres traitent
d’abfurde cette opinion d’Ariftote ; ils prétendent
aue fi un corps en mouvement change .de Heu en ce
^ R r r ij