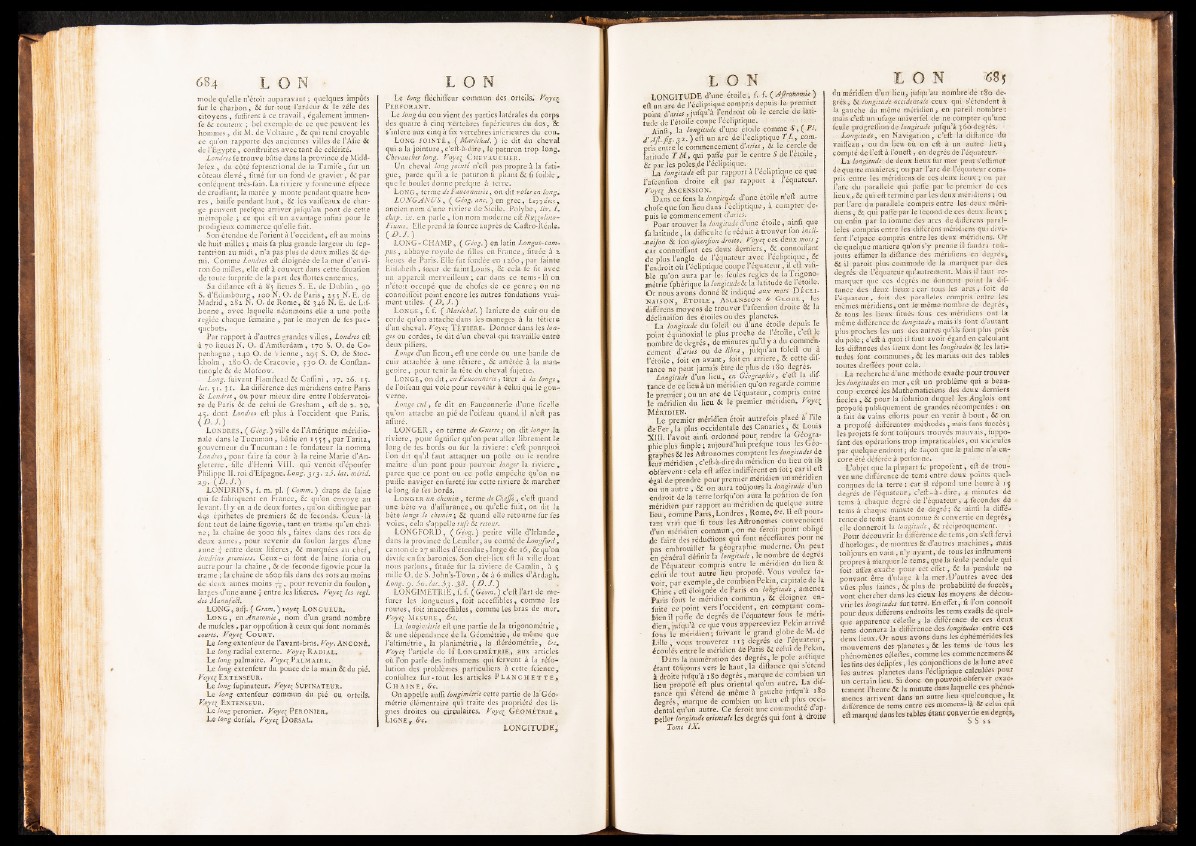
mode qu’elle n’étoit auparavant ; quelques impôts
fur le charbon, 8c fur-tout l’ardeur & le zélé des
citoyens , fuffirent à ce travail, également immen-
fe 8c coûteux ; bel exemple de ce que peuvent les
hommes, dit M. de Voltaire , 8c qui rend croyable
ce qu’on rapporte des anciennes villes de l’Afie &
de l’Egypte , conftruites avec tant de célérité.
Londres fe trouve bâtie dans la province de Midd-
Iefex , du côté feptentrional de la Tamife , fur un
coteau é lev é, fitué fur un fond de gravier, 8c par
conféquent très-fain. La riviere y forme une efpece
de croifl'ant; la marée y monte pendant quatre heures
, baille pendant huit, 8c les vaiffeaux de charge
peuvent prefque arriver jufqu’au pont de cette
métropole ; ce qui eft un avantage infini pour le
prodigieux commerce qu’elle fait.
Son étendue de l’orient à l’occident, eft au moins
de huit milles ; mais fa plus grande largeur du fep-
tentri.on au m idi, n’a pas plus de deux milles Sc de-
mi. Comme Londres eft éloignée de la mer d’environ
60 milles, elle eft à couvert dans cette fituation
de toute furprife de la part des flottes ennemies.
Sa diftance eft à 85 lieues S. E. de Dublin , 90
S. d’Edimbourg, ioo N. O. de Paris, 15 5 N. E. de
Madrid, 281 N. O. de Rome, & 346 N. E. de Lisbonne
, avec laquelle néanmoins elle a une pofte
réglée chaque femaine , par le moyen de fes pac-
quebots. •
Par rapport à d’autres grandes ville s, Londres eft
•à 70 lieues N. O. d’Amfterdam , 1 7 0 S. O. de Copenhague
, 240 O. de Vienne, 295 S. O. de Stockholm
, 280 O. de Cracovie, 530 O. de Conftan-
tinople & de Mofcow.
Long, fuivant Flamftead & Caflini , 17. 26. 15.
■ lut. 5 1 .3 1 . La différence des méridiens entre Paris
& Londres, ou pour mieux dire entre l’obfervatoir
re de Paris 8c de celui de Gresham, eft de 2. 20.
45. dont Londres eft plus à l’occident que Paris. n ............. L o n d r e s , ( Géog.) ville de 1 Amérique méridionale
dans le Tucuman, bâtie en 1555, par T arita,
gouverneur du Tucuman : le fondateur la nomma
Londres, pour faire fa cour à la reine Marie d’Angleterre,
fille d’Henri VIII. qui venoit d’époufer
Philippe IL roi d’Efpagne. Long. 313. zS. lut, mèrid.
9 ( « • • '• )
LONDRINS, f. m. pi. ( Comm. ) draps de laine
qui fe fabriquent en France, 8c qu’on envoyé au
levant. Il y en a de deux fortes, qu’on diftingue par
d^s épithetes de premiers 8c de féconds. Ceux-là
font tout de laine figovie, tant en trame qu’en chaîne;
la chaîne de 3000 fils, faites dans des rots de
deux aunes, pour revenir du foulon larges d’une
aune j entre deux lifieres, 8c marquées au chef,
londrins premiers. C e u x -c i font de laine foria ou
autre pour la chaîne , & de fécondé figovie pour la
trame ; la chaîne de 2600 fils dans des rots au moins
de deux aunes moins , pour revenir du foulon,
larges d’une aune j entre les lifieres. Voye^ les régi,
des Manufact.
LONG, ad ). ( Gram. ) voye^ LO NGU EUR .
L o n g , en Anatomie, nom d’un grand nombre
de mufcles , par oppofition à ceux qui font nommés
courts. Voye£ C o u r t .
L e longe x t e n fe u r de l’ a v a n t -b r a s . Voy. A n c ô n e .
L e long r a d ia l e x te rn e . Voye^ R a d i a l .,
L e longp a lm a i r e . Voye^.P a l m a i r e .
Le long extenfeur du pouce de la main & du pié.
Foye{ E x t e n s e u r .
L e long fu p in a te u r . Foye^ S u p i n a t e u r .
Le long extenfeur commun du pié ou orteils.
Voyei E x t e n s e u r .
L e long p e r o n ie r . Voye{ P e r o n i e r ,
L e long d o r fa l. Voyez D o r s a l .
Le long fléchiffeur commun des orteils,’ Voye%
P e r f o r a n t .
Le long du cou vient des parties latérales du corps
des quatre à cinq vërtebres fupérieures du dos, &
s ’infere aux cinq à fix vertebres inférieures du cou.
L o n g j o i n t e , .( Maréchal. ) fe dit du cheval
qui a la jointure,c’eft-à-dire, le paturon trop long.
Chevaucher long. Voyeç CHEVAUCHER.
Un cheval long jointe n’eft pas propre à la fatigue
, parce qu’il a le paturon fi pliant 8c fi foible ,
que le boulet donne prefque à terre.
L o n g , terme de Fauconnerie, on dit voler en long,
LONG AN U S , ( Géog. anc. ) en grec, I. oyyàroç,
ancien nom d’une riviere de Sicile. Polybe, liv. I .
chap. ix. en parle , fon nom moderne eft Ru^olino-
Fiumt. Elle prend la fource auprès de Callro-Réale.
( -» ƒ . ) H ■ ■ ■ .
LONG-CHAMP, ( Géog.') en latin Longus-cam-
pus, abbaye royale de filles eh France , fituée à a
lieues de Paris. Elle fut fondée en 1260, par fainte
Elifabeth , fceur de faintLouis, Sc cela fe fit avec
un appareil merveilleux; car dans ce tems-là on
n’étoit occupé que de chofes de ce genre ; on ne
connoiffoit point encore les autres fondations vraiment
utiles. ( D . J. )
L o n g e , f. f. ( Maréchal. ) laniere de cuir ou de
corde qu’on attache dans les maneges à la têtiere
d’un cheval. Voye{ T ê t i e r e . Donner dans les longes
ou cordes, le dit d’un cheval qui travaille entre
deux piliers.
Longe d’un licou, eft une corde ou une bande de
cuir attachée à une têtiere, 8c arrêtée à la man-,
geoire, pour tenir la tête du cheval fujette.
L o n g e , on dit, en Fauconnerie, tirer à la longe ,
de Foifeau qui vole pour revenir à celui qui le gouverne.
Longe cul, fe dit en Fauconnerie d’une ficelle
qu’on attache au pié de l’oifeau quand il n’eft pas
alluré.
LONGER, en terme de Guerre ; on dit longer la
riviere, pour lignifier qu’on peut aller librement,le
long de les bords ou für la riviere : c’eft pourquoi
l’on dit qu’il faut attaquer un pofte ou fe rendre
maître d’un pont pour pouvoir longer la riviere,
parce que ce pont ou ce pofte empêche qu’on ne
puiffe naviger en fureté fur cette riviere & marcher
le long de fes bords.
L onger un chemin, terme de ChaJJe, c’eft quand
une bête va d’alïiirance, ou qu’elle fuit, on dit la
bête longe le chemin ; 8c quand elle retourne fur fes
voies, cela s’appelle rufe 8c retour.
LONGFORD, (Géog. ) petite ville d’Irlande,
dans la province de Leinfter, au comté de Longford,
canton de 27 milles d’étendue, large de 1 6 ,8cqu’on
divife en fix baronies. Son chef-lieu eft la ville dont
nous parlons, fituée fur la riviere de Camlin, à ç
mille O. de S. John’s-Town, &£ à 6 milles d’Ardagh.
Long. C). So. lat. 5$ .3 # . ( D .J . )
LONGIMÉTR1E , f. f. ( Géorn. ) c’eft l’art de me-
furer les longueurs, foit acceflibles, comme les
routes , foif.iftaccelfiblës, comme les bras de mer.
V o y t [ M e s u r e , & c.
La longimétrie eft une partie de la trigonométrie ,
& une dépendance de la Géométrie, de même que
l’altimétrie, la planimétrie, la ftéréométrie, &c,
Voye[ l’article de la L o n g i m é t r i e , aux articles
où l’on parle des inftrumens qui fervent à la réfo-
lution des problèmes particuliers à cette fcience,
confultez fur - tout les articles P l a n c h e t t e ,
C h a î n e , 6 c.
On appelle aufli longimétrie. cette partie de la Géométrie
élémentaire qui traite des propriété des lignes
droites ou circulaires. Voye^ G é o m é t r i e ,
L i g n e r &c.
LONGITUDE;
LONGITUDE d’une étoile, f. f. ( Ajlrokomi.e )
eft un arc de l’écliptique compris depuis le- premier
point paries ,-jufqu’à l’endroit où le cercle de; latitude
de l’étoile coupe Fécliptique. , n ,
Ainfi, la longitude d’ppe.étoile comme S , (P I .
d'Afl fig- 32. ) eft un arc ,de"l’écliptique T L , ,conr-
prls entre le commencement dVaries, & le. cercle de
latitude TM , qui paffe pair le centre S de 1’,étoile,
& par. les. poles.de l’écliptique.
La longitude eft par rapport à l’écliptique ce que
Éafcenfion droite eft par rapport à léqua,teur.
V oyei Ascension. . \
Dans ce fens la longitude d’une étoile n’eft autre
çhofequefon lieu dans Fécliptique, à compter depuis
le commencement Varies. | ,
Pour trouver la longitude d’une etoile, ainfi que
fa latitude, la difficulté fe réduit à trouver fon incli-
jiaijon & fon afccnfion droite. Voye[ ces deux fo is ;
car connoiffant ces deux derniers, 8c connoiffant
de plus l’angle de l’équateur avec Fécliptique, &
l’endroit où Fécliptique coupe l’équateur, il eft vifi-
ble qu’on aura par les feules; réglés de. laTrigono-
métne fphérique la longitude & la latitude de 1 étoile.
Or nous avons donné 8c,indique aux mots D É C L I NAISON,
É t o i l e , A s c e n s i o n & G l o b e , les
differe'ns moyens de trouver Fafcenfion droite 8c la
décliriaifon des étoiles bu des planètes.
La longitude du foleîbou d’une étoile depuis le
point équinoxial le plus proche de Fetoile, ce ft je
nombre de degrés, de minutes’ qu’il y a du commencement
(Taries ou de Itéra, jufquau foleil ou à
l’étoile, foit en avant, foit en arriéré, 8c cette diftance
ne peut jamais être dé plus de 180 ^degres.
Longitude d’un lieu., en Géographie, c’eft la dif-
tancè'de ce lieu à un méridien qu’on regardé comme
le premier; ou un arc de l’équateur, compris entre
le méridièn du lieu & le premier méridien. Voye^
M é r i d ï e î î .
Le premier méridien etoit autrefois place à 1 île
de'Fer, la plus occidentale des Canaries, & Louis
XIII. l’avoit ainfi ordonné pour, rendre la Géographie
plus fimple ; aujourd’hui prefque tous les Geo- ‘
graphes & les Aftronomes comptent les longitudes de
leur méridien, c’eft-à-dire du méridien du lieu où ils
obfervent : cela eft affez indifférent en loi ; car il eft
égal de prendre pour premier méridien un méridien
OU Un autre , & on aura toujours la longitude d?un
endroit de la terre Iqrfqu’on aura la pofition de fon
méridien par rapport aü méridien de quelque autre
lieu , comme Paris, Londres, Rome, &c. Il eft pourtant
vrai que fi tous les Aftronomes convenoient
d*un méridien commun , on ne feroit point obligé
de faire des réduûions qui font néceffaires pour ne
pas embrouiller la géographie moderne. On peut
en «énéral définir la longitude, le nombre de degres
de î ’équateur compris entre le méridien du lieu 8c
celui (le tout autre lieu propofé. Vous voulez fa-
Voir par exemple, de combien Pékin, capitale de la
Chine, eft éloignée de Paris en lo%gttude, amenez
Paris fouS le méridien commun, 8c éloignez en-
fuite ce point vers l ’occident, en comptant combien
il paffe de degrés de Féquateur fous le méridien
, jufqif à ce que vous apperceviez Pékin arrive
' fous le méridien ; fuivant le grand globe de M. de
Lille , vous trouverez 113 degrés de Féquateur,
écoulés entre le méridien de Paris & celui de Pekm.
Dans la numération des degrés, le pôle arûique
étant toujours vers le haut, la diftance qui s etend à droite jiifqu’à 180 degrés, marque de combien un
lieu propofe eft plus oriental qu’un autre. La du-
tance qui s’étend de même à gauche jufqu à 186
degrés, marque de combien un lieu eft plus occidental
qu’un autre. Ce feroit une commodité d’ap-
peller longitude orientale les degrés qui font à droite
Tome IX.
du méridien d’un lieu, jùfqu’au nombre de r8o degrés
, & longitude, occidentale ceux qui s’étendent à
la gauche du même méridien, en pareil nombre1:
mais :c*»ft un ufageuniverfel de ne compter qu’une
feule pi'dgrefîion de longitude jufqu’à 3 601 degrés. I
- Longitude., en Navigation, c ’eft la diftance du
vaiffeaiu, ou du lieu où on eft à un ■ autre lieu ;
compté de l’eft à l’oueft, en degrés de l’équateur'.
La longitude de deux lieux fur mer peur s’eftimef
dë quarte maniérés ; ou par l’arc de-Féquateur compris
entre les méridiens, de ces deux lieux ; on par
Faite „du parallèle qui paffe par le premier de ces
lieux,, & qui eft terminé par les deux méridiens ; ou
par' l’arc du parallèle 'compris entre lestdeux méridiens,
8c qui paffe parle lecond de ces deux-fieux;
bu enfin par la fomme:des arcs de différent parallèles
compris entre les différé ns méridiens qui divi-
fentT’elpaee compris entre les deux méridiens. Or
de quelque maniéré qu’on s’y prenne il faudra toujours
eftimer la diftance des méridiens en degrés;
& il paroît plus commode de la marque* par des
degrés de Fequateur qu’autrement. :Mais il’ faut remarquer
que ces degrés .ne donnent point la diftance
des deux lieux: car toits les arcs*.foit de
Féquateur-, foit des parallèles compris entre- les
mêmes méridiens, ont le même nombre de degrés;
8c tous les lieux fitué» fous ces méridiens ont la
même différence de longitude, mais ils font d’autant
plus proches les uns des autres qu’ils font plus près
du pôle ; c’eft à quoi il faut avoir égard en calculant
les diftances des lieux dont les longitudes & les latitudes
font communes, & les marins ont des tables
toutes dreffées pour cela.
La recherche d’une méthode exaéte pour trouver
les .longitudes en mer, eft un problème qui a beaucoup
exercé les Mathématiciens des deux derniers
fiecles , & pour la folittion duquel les Anglois ont
propofé publiquement de grandes récompenfes : on
a fait de vains efforts pour en venir à bout, & on
a propofé différentes méthodes, mais fans fuccès ;
les projets fe font toujours trouvés mauvais , fuppo-
fant des opérations trop impraticables, ou vicieufes
par quelque endroit ; de façon que la palme n’a en-
■ eore été déférée à per fon ne.
L’objet que la plupart fe propofent, eft de trouver
une différence de tems entre deux points quel*-
conques de la terre : car il répond une heure à 15
degrés de Féquateur, c’e f t- à -d ir e , 4 minutes de
tems à chaque degré de Féquateur, 4 fécondés de •
tems à chaque minute de degré; & ainfi la différence
de tems étant connue & convertie en degrés *
elle donneroit la longitude, & réciproquement.
Pour découvrir la différence de tems, on. s?eft fervi
d’horloges, de montres & d’autres machines, mais
toujours en vain, n’y ayant, de tous les inftrumens
propres à marquer le tems , que la feule pendule qui
fo it . affez exaâe pour cet effet, & la pendule ne
pouvant être d’ufage à la mer. D ’autres avec des
vues plus faines, 8c plu9 de probabilité de fuccès,
vont chercher dans les deux les moyens -de découvrir
les longitudes fur terre. En effet,, fi Fon connoît
pour deux différens endroits les tems exaûs de quelque
apparence celefte > la. différence de ces deux
tems donnera la différence des longitudes entre ces
deux lieux. Or nous avons dans les éphémérides les
mouvemens des planètes, & les tems de tous les
phénomènes céleftes, comme les commencemens 8c
les fins des écjipfes, lés conjonctions de la lune avec
les autres planètes dans Fécliptique calculées pour
un certain lieu. Si donc on pouvoit.obferyer exactement
l’heure 8c la minute dans laquelle ces phénomènes
arrivent dans un autre lieu quelconque , la
différence de tems entre ces momens-là 8c celui qui
eft marqué dans les tables étant convertie en degrés,