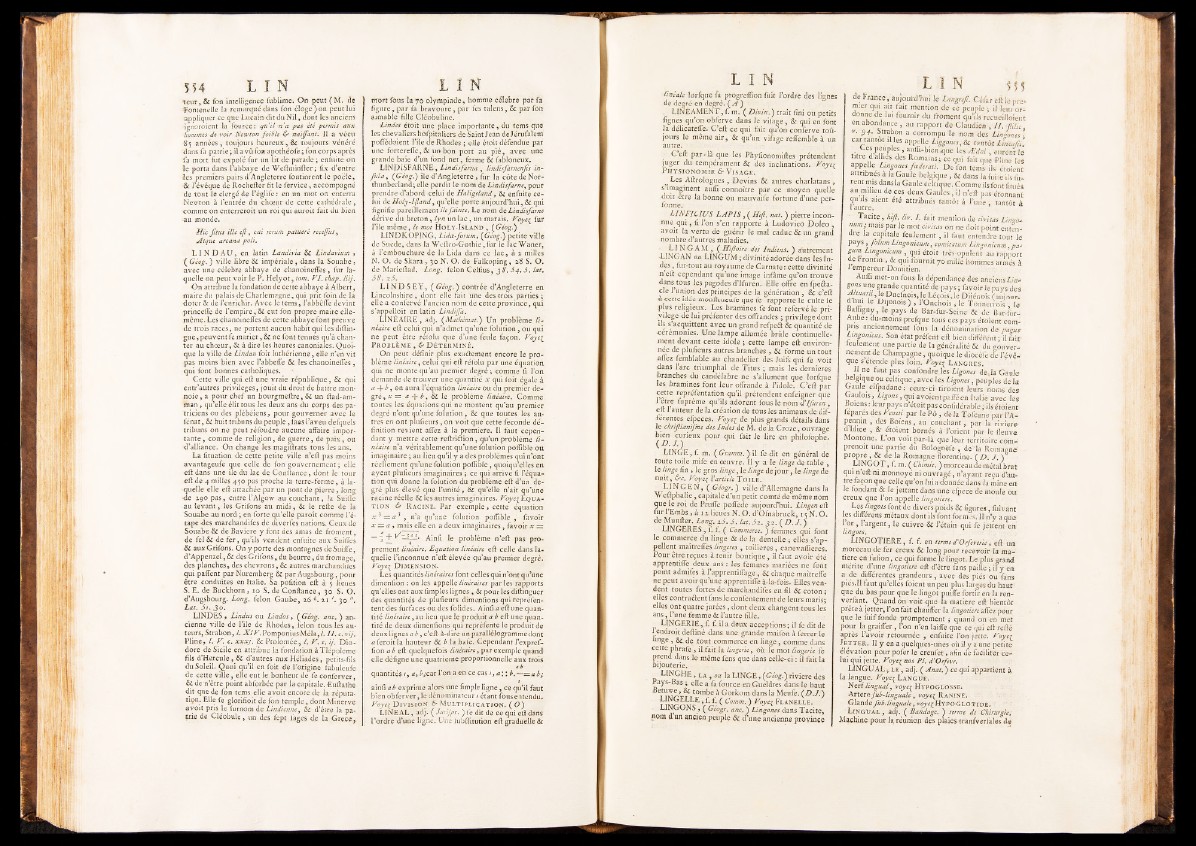
554 L I N
teu r , & fon intelligence fublime. On peut (M . clê
iFontenelie la remarqué clans fon éloge ) on peut lui
appliquer ce que Lucain dit du N il, dont les anciens
ignoroient la fource : qu'il -n’a pas été permis aux
hommes de voir Newton foible ■ & naijfant. Il a vécu
S 5 années, toujours heureux, •& toujours vénéré
dans fa patrie ; il a vu fois apothé'ôfe ; fon corps après
La mort fut expofé fur un lit de païade ; enluite ou
i l porta dans l’abbaye de Wellmirifter; fix d’entre
les premiers pairs d’Angleterre foutinrent le poêle,
& l’évêque de Rochefter fit le fervice, accompagné
de tout le clergé de -l’églife : en un mot on enterra
Newton à l’entrée du choeur de cette cathédrale,
comme on enterreroit un roi qui auroit fait du bien
■ au monde.
Uîc fuus iïle efl, tui renifli pàtuerê reuffiis,
Atque arcana poli.
L I N D A U , en latin Landivia 6c Lindavium ,
( Géog. ) ville libre 6c impériale , dans la Souabe,
avec une célébré abbaye de chanoineffes, fur laquelle
on peut voir le P. Helyot, ïom. VI. chap. liij.
On attribue la fondation de cette abbaye à Albert,
maire du palais de Charlemagne, qui prit foin de la
doter & de l’enrichir. Avec le tems, l’abbêfTe devint
princeffe de l’empire, & eut fon propre maire elle-
mcme. Les chanoineffes de cette abbaye font preuve
de trois races, ne portent aucun habit qui les diftin-
gue, peuvent fe marier, 6c ne font tenues qu’à chanter
au choeur, & à dire les heures canoniales. Quoique
la ville de Lindau foit luthérienne, elle n’en vit
pas moins bien avec l’abbeffe 6c les chanoineffes,
qui font bonnes catholiques.
Cette ville qui eft une vraie république, 6c qui
entr’autres privilèges, jouit du droit de battre mon-
noie, a pour chef un bourgmeffre, 6c un ftad-am-
man, qu’elle élit tous les deux ans du corps des patriciens
ou des plébéiens, pour gouverner avec le
lènat, 6c huit tribuns du peuple, làos l’aveu defquels
tribuns on ne peut réfoudre aucune affaire importante
, comme de religion, de guerre, de paix, ou
d’alliance. On change les magiflrats tous les ans.
La fituation de cette petite ville n’eft pas moins
avantageufe que celle de fon gouvernement ; elle
eft dans une île du lac de Confiance, dont le tour
eft de 4 milles 450 pas proche la terre-ferme, à laquelle
elle eft attachée par un pont de pierre, long
«de 290 pas, entre l’Algow au couchant, la Suiffe
•au lev an t, les Grifons au midi, & le refte de la
Souabe au nord ; en forte qu’elle paroît comme l ’étape
des marchandifes de diverfes nations. Ceux de
Souabe 6c de Bavière y font des amas de froment
de fel 6c de fe r , qu’ils vendent enfuite aux Suiffes
& aux Grifons. On y porte des montagnes deSuifîé,
d ’Appenzel, 6c des Grifons, du beurre, du fromage,
des planches, des chevrons, & autres marchandifes
qui paffent par Nuremberg 6c par Augsbourg, pour
etre conduites en Italie. Sa pofition eft à 5 lieues
S. E. de Buckhorn, 10 S. de Confiance, 30 S. O.
d’Augsbourg. Long, félon Gaube, 26 d. 21 '. 30 ",
L u t . 5 i . J o .
LINDES , Lindus ou Lindos, ( Géog. anc. ) ancienne
ville de l’île de Rhodes, félon tous les auteurs,
Strabon, l. Af/^PomponiusMéla,/. IL c.vij.
Pline, /. V. c. x x x j. 6c Ptolomée, l. V. c.ij. Dio-
dore de Sicile en attribue la fondation à Tlépoleme
fils d’Hercule, 6c d’autres aux Héliades, petits-fils
du Soleil. Quoi qu’il en foit de l ’origine fabuleufe
de cette ville, elle eut le. bonheur de fe conferver
& de n’être point abforbée par la capitale. Euftathe
dit que de fon tems elle avoit encore de la réputa-
tiçn. Elle fe glorifioit de fon temple, dont Minerve
avoit pris le furnom de Lindienney 6c d’être la patrie
de Cléobule, un des fept l'ages de la Grece,
L I N
m”ort fous la 70 olympiade, homme célébré pat f l
figure, par fa bravoure, par fes talens, & parfo'n
aimable fille Cléobuline.
Lindes étoit une place importante, du tems que
les chevaliers hôfpitaliers de Saint Jean de Jérufalem
poffédoient l ’île de Rhodes ; elle étoit défendue par
une fortereffe, & un boii port au pié, avec une
grande baie d’un fond net, ferme 6c fabloneux.
LIND1SFARNE, Lindisfarna , li-ndisfarnenfis in-
fu la y (Géog.') île d’Angleterre, fur la côtedeNot-
thunberland; elle perdit le nom de Lindisfarne, pour
prendre d’abord celui de Hatigeland, 6c enfuite celui
d e Holy-IJland y qu’elle porte aujourd’hui, & qui
lignifie pareillement île fointe. Le nom de Lindisfarnt
dérive du breton, lyn un la c , un matais. Voyez fur
l’île même, le mot H o l y -Is l a n D , (Géog.)
LINDKOPING, Lidoe-forum, (Géog.) petite ville
de Suede, dans la "Wellro-Gothie, fur le lacWaner,
à l’embouchure de la Lida dans ce la c , à 2 milles
N. O. de Skara, 30 N. O. de Falkoping, 28 S. O.
de Marieftad. Long, félon Celfius, 38. 5^ .5 . Ut.
58. 2.5’.
L IN D S E Y , (Géog.) contrée d’Angleterre en
Lincolnshire , dont elle fait une des trois parties ;
elle a confervé l’ancien nom de cette province, qui
s’appelloit en latin Lindijja.
LINÉAIRE , adj, (Matkémat.) Un problème linéaire
eft celui qui n’admet qu’une folution, ou qui
ne peut être réfolu que d’une feule façon. Voye£
Problème , & D éterminé.
On peut définir plus exadement encore le problème
Linéaire, celui qui eft réfolu par une équation
qui ne monte qu’au premier degré ; comme fi l’on
demande de trouver une quantité x qui foit égale à
a -f- b , on aura l’équation linéaire ou du premier degré,
x = a -{- b , 6c le problème linéaire. Comme
toutes les équations qui ne montent qu’au premier
degré n’ont qu’une folution , 6c que toutes les autres
en ont plufieurs, on voit que cette fécondé définition
revient affez à la première. Il faut cependant
y mettre cette reftriéiion, qu’un problème linéaire
n’a véritablement qu’une folution pofliblc ou
imaginaire ; au lieu qu’il y a des problèmes qui n’ont
réellement qu’une folution poflible, quoiqu’elles en
ayent plufieurs imaginaires ; ce qui arrive fi l’équation
qui donne la folution du problème eft d’un degré
plus élevé que l’unité, 6c qu’elle n’ait qu’une
racine réelle 6c les autres imaginaires. Voyeç Equation
& Racine. Par exemple, cette équation
x^ — a^ , n’a qu’une folution poflïble , favoir
x — a , mais elle en a deux imaginaires, favoir x =
— 1 + v z l l l . Ainfi le problème n’eft pas proprement
linéaire. Equation linéaire eft celle dans laquelle
l’inconnue n’eft élevée qu’au premier degré.
Voye^ Dimension.
Les quantités linéraires font celles qui n’ont qu’une
dimenfion : on les appelle linéraires par les rapports
qu’elles ont aux fimples lignes , & pour les diftinguer
des quantités de plufieurs dimenfions qui repréfen-
tent des furfaces ou des folides. Ainfi a eft une quantité
linéraire, au lieu que le produit a b eft une quantité
de deux dimenfions qui repréfente le produit de
deux lignes a b , c’eft-à-dire un parallélogramme dont
a feroit la hauteur 6c b la bafe. Cependant l’expref-
fion a b eft quelquefois linéraire, par exemple quand
elle défigne une quatrième proportionnelle aux trois
a b
quantités /, a, Æ;car l’on a en ce cas t,a\ \ b.——a b;
ainfi ab exprime alors une fimple ligne, ce qu’il faut
bien obferver, le dénominateur / étant fousentendu.
Voye{ Division <5* Multiplication. (O )
LINÉAL, adj. ( Jurijpr. ) fe dit de ce qui eft dans
l ’ordre d’une ligne. Une lubftitution eft graduelle &
L I N
linlale lorfque fa progreflion fuit l’ordre des lignes
de degré en degré. ( A )
■ LINÉAMENT, f. m. ( Divin. ) trait fini ou petits
lignes qu’on obferve dans le vifàge, & qui en font
la délicateffe. C ’eft ce qui fait qu’on conferve toû-
jours le même air, & qu’un vifage reffemble à un
autre.
G eft par-là que les Phyfionomiftes prétendent
juger du tempérament 6c des inclinations. Voye^
Physionomie & Visage.
,. ^es Aftrologues , Devins & autres charlatans ,
s imaginent auflï connoître par ce moyen quelle
doit être la bonne ou mauvaife fortune d’une per<-
fonne.
LINFIC1US L A P IS , ( Hifi. nat. ) pierre inconnue
q u i, fi l’on s’en rapporte à Ludovico Doleo ,
avoit la vertu de guérir le mal caduc 6c un grand
nombre d’autres maladies.
L IN G A M , ( Hifioire des Indiens. ) autrement
-LINGAN 0« LINGUM ; divinité adorée dans les Indes
, fur-tout au royaume de Carnate:,cette divinité
n eft cependant qu’une image infâme qu’on trouve
dans tous les pagodes d’Ifuren.. Elle offre en fpeéla-
cle l’union des principes de la génération, 6c c’eft
à cette idée monftrueufe que fe rapporte le culte le
plus religieux. Les bramines fe font refervé le privilège
de lui préfenter des offrandes ; privilège dont
ils s’acquittent avec un grand refped & quantité de
•ceremonies. Une lampe allumée brûle continuellement
devant cette .idole ; cette lampe eft environnée
de plufieurs autres branches , & forme un tout
affez femblable au chandelier des Juifs qui fe voit
.dans l’arc triumphal de Titus ; mais les dernieres
branches du candélabre ne s’allument que lorfque
les bramines font leur offrande à l ’idole» C ’eft par
cette reprefentation qu’il prétendent enfeigner que
l ’être fuprème qu’ils adorent fous le nom tflfuren ,
eft l’auteur de la création de tous les animaux de differentes
efpeces. Viye£ de plus grands détails dans
le chrifiiamfme des Indes de M. de la Croze , ouvrage
( j™ ieiXX pour flui ^ k ^re en philofophe.
LINGE, f. m. (Gramm. ) il fe dit en général de
toute toile mife en oeuvre. Il y a le linge de table ,
lé linge fin, le gros linge, le linge de jou r, le linge de
nuit, &c. Voye^ M article T oile. :•
L IN GE N , (Xléogr. ) ville d’Allemagne dans la
Weftphalie, capitale d’un petit comté de même nom
que le roi de Pruffe poffede aujourd’hui. Lingen eft
for I’Embs, à. 12 lieues N. O. d’Ofnabruck, 15 N. O»
de Munfter. Long. a i . 5 . lat. 5z . 32. ( D. J . )
LINGERES, f. f. ( Commerce. ) femmes qui font
le commerce du linge & de la dentelle ; elles s’appellent
maîtreffes lingeres , toilieres , canevaflîeres»
Pour êtrereçues à tenir boutique, il faut avoir été
apprentiffe deux ans : les femmes mariées ne font
point admifes à l’apprentiffage, & chaque maîtreffe
ne peut avoir qu’une apprentiffe à-là-fois. Elles vem
dent toutes fortes de marchandifes en fil & coton ;
elles contraélent fans le confentement de leurs maris;
elles ont quatre jurées, dont deux changent tous lés
ans, l’une femme & l’autre fille.
LINGERIE, f. f. il a deux acceptions; il fe dit de
1 endroit deftiné dans une grande maifon à ferrer le
Lnge , & de .tout commerce en linge, comme dans
cette phrafe, il fait la Lingerie, oit le mot lingerie fe
prend dans le même fens que dans celle-ci : il fait la
bijouterie.
LINGHE, la , ou la L INGE, (Géog.) riviere des
Pays-Bas ; elle a fa fource. en Gueldres dans le haut
Betuwe, & tombe à Gorkom dans la Meufe. (D .J .)
( Comm.;) Voye{ Flanelle.
^ j , C Géogr. anc. ) Lingonjcs dans Tacite,
nom d un ancien peuple 6c d’une ancienne province
L I N 555
de F i l i c e , aujourd'hui le Langtcjî. Cëfar èftie pre1
mier qui ait fait mention de eè peuple ; il leur or*
aonne.de lui fournir du froment qu’ilsïeftteilloient
en abondance , au rapport de Ciaildien , ll-.'-UUic'.
*.«54. Straiioti a corrompu le nom des Lïngmis .
cartantot .1 les appelle Uggôms.tk tantôt lîncafii.
H S m B S I I a“ ffi-b‘en .que Us Ædhi-, eurent lé
titre d allies des Romains ; ce qui fait que Pline les
appelle Lmgones feedemi. De fon tems ils étaient
attribues à: la Gaule belgique , 8c dans-la fuite iis fu~
rent mis-dansla Gaule celtique. Comme ils fontfitués
au milieu de ces deux Gaules, il n’eft pas-’ étonnant
qu ils -aient été attribués Uantât à Furie -, tantôt à
1 autre»
Tacite , hifi. liv. I. fait mention de civitas Lingot
num; mais par le mot civitas on ne doit point entent
dre la capitale feulement , il faut entendre tout lé
Pay s ■> folum Lingonicum, comitatum Lingonicuni, pa±
gum Lingonicum , qui étoit très-opulent au rapport
de Frontin , & qui fournit 70 mille hommes armés!
1 empereur Domitien»
Aufli met-on fous la dépendance des anciensZ/'/z-*
gons une grande quantité de pays ; favoir le pays des
Altuaru » le Duefnois, le Léçois, le Dijénois (aujour-
dhm le Dijonois ) , l’Onchois , le Tori'nerrois , le'
Bafligny, fo pays de Bar-fur-Seine & de Bar-fur-
Aube : du-moins prefque tous ces pays éfoient compris
anciennement fous la dénomination dè pagus
Ltngomcus. Son état préfent eft bien different; il fait1
leulement une partie de la généralité & du gouvernement
de Champagne, quoique le diocèfe de l’évêque
S etende plus loin. Voye{ Langres'.
Il ne faut pas confondre les Ligones devla Gaule
Belgique ou celtique, avec les Ligones, peuplés de la
Gaule cifpadane: ceux-ci tiroient leurs noms des
Gaulois , Ligons, qui avoientpafféen Italie avec les
Boiens : leur pays n’étoitpas confidérable ; ils étoient
lepares des Veneti par le P ô , de la Tofcane par l’A pennin
, des Boïens, au couchant, par-la riviere
dldice , & étoient bornés à l’orient par le fleuve
Montone. L’on voit par-là que leur territoire com-
prenoit une partie du Bolognèfe , deNa Romagne
propre , 8c de la Romagne florentine. ( D . J . ) •
L IN G O T , f. m. ( Chimie. ) morceau de métal brut
qui n’eft ni monnoyé ni ouvragé, n’ayant reçu d’autre
façon que celle qu’on lui a donnée dans la mine en
le fondant & le jettantdans une efpece de moule ou
creux que l’on appelle lingodere.
Les lingots font de divers poids 6c figures, ftiivant
les différens métaux dont ils font formés. Il n’y a que
l o r , 1 argent , le cuivre 6c l’étain qui fe jettent eii
lingots.
LINGOTIERE, f. f» en termed'Orfeverie, eft un
morceau de fer creux 6c long pour recevoir la matière
en fufion, ce qui forme le lingot. L e plus grand
mérite d’une lingotiere eft d’être lans paille ; il ÿ en
a de différentes grandeurs, avec des piés ou fans
piés.II faut qu’elles foient un peu plus larges du haut-
que du bas pour que le lingot puiffe fortir en la ren-
verfant. Quand on voit que la matière eft'bientôt-
pfeteà jetter, Fon fait chauffer la lingotiere affez pour
que le foif fonde promptement ; quand on en met
pour la graiffer , l’on n’en laiffe que ce qui eft relié
après l’avoir retournée , enfuite l’on jette. Voye^
Jetter. Il y en a quelques-unes o ît ily a une petite
élévation pour pofer le creufet, afin de faciliter celui
qui jette. Voye^ nos PI. d'Orftvr.
LINGUAL, le , adj. ( Anat. ) ce qui appartient à
la .langue. Voye[ Langue.
Nerf lingual, voye^ H y p o GLOSSE»
Artere Jub-linguale , voye^ Ranine»
Glande Jub-lingualei voye^HYPOGLO'Tl'DÊt
Lingual , adj. ( Bandage. ) terme de Chirurgié-
Machine pour 1^ réunion des plaies tranfverfales de