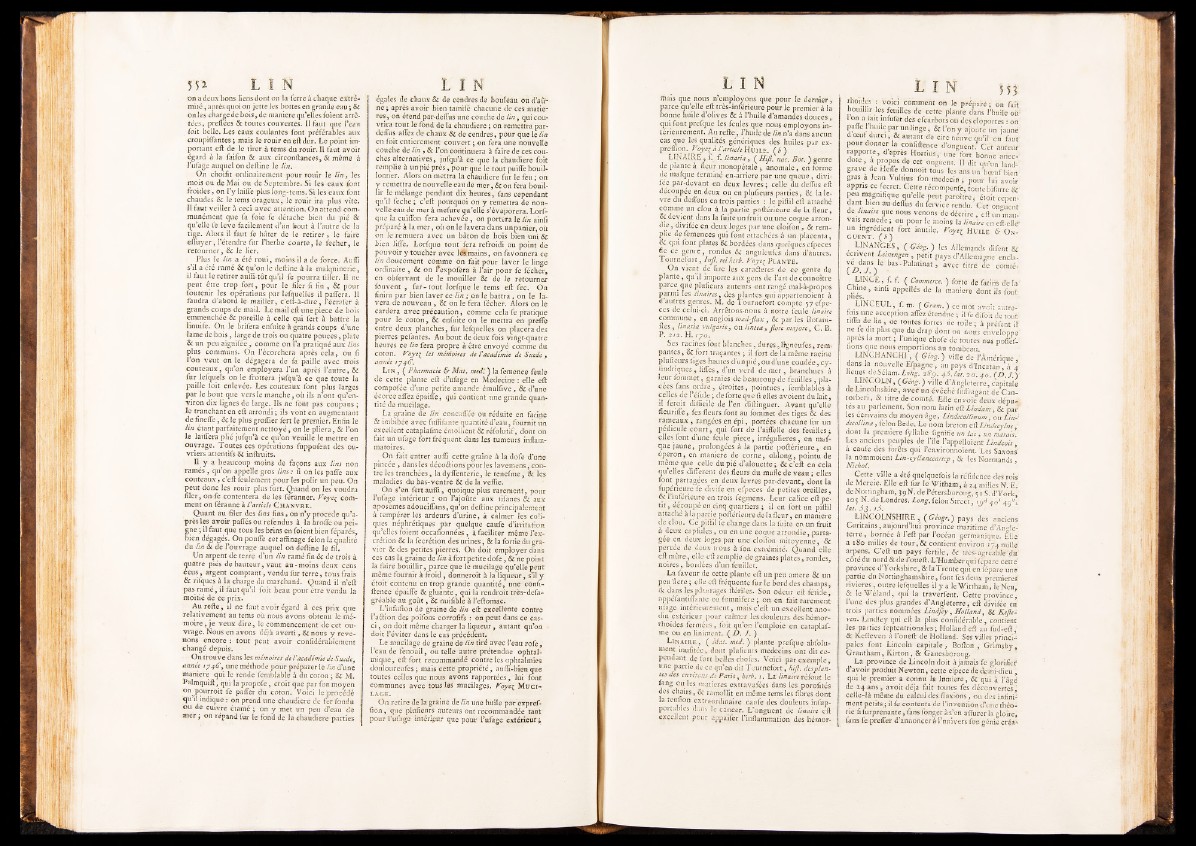
on a deux bons liens dont on la ferre à chaque extrémité
, après quoi on jette les bottes en grande eau ; &c
on les charge de bois, de maniéré qu’elles foient arrêtées,
preflees & toutes couvertes. Il faut que l’eau
foit belle. Les eaux coulantes font préférables aux
croupiflantes ; mais le rouir en eft dur. Le point im-
çortant eft de le tirer à tems du rouir. Il faut avdir
égard à la faifon & aux circonftanceS, & même à
i’ufage auquel on deftine le lin.
On choifit ordinairement pour rouir le lin , les
mois ou de Mai ou de Septembre. Si les eaux font
froides, on l’y laifi'e plus long-tems. Si les eaux font
chaudes & le tems orageux, le rouir ira plus vite.
Il faut veiller à ceci avec attention. On attend communément
que fa foie fe détache bien du pié &
qu’elle fe leve facilement d’un bout à l’autre de la
tige. Alors il faut fe hâter de le retirer, le faire
eflùyer, l’étendre fur l’herbe courte, le fécher, le
retourner, & le lien
Plus le lin a été roui, moins il a de force. Aufli
s’il a été ramé & qu’on le deftine à la malquinerie,
il faut le retirer auffitôt qu’il fe pourra tiller. Il ne
peut être trop fort, pour le filer fi fin , & pour
foutenir les opérations par lefqueîles il paffera. Il
faudra d’abord le mailler, c’eft-à-dire, l’écrafer à
grands coups de mail. Le mail eft une piece de bois
emmenchée & pareille à celle qui fert à battre la
linuife. On le brifera enfuite à grands coups d’une
lame de bois, large de trois ou quatre pouces, plate
& un peu aiguifée, comme on l’a pratiqué aux lins
plus communs. On l’écorchera après cela, ou fi
l’on veut on le dégagera de fa paille avec trois
couteaux, qu’on employera l’un après l’autre, &
fur lefquels on le frottera jufqu’à ce que toute la
paille foit enlevée. Les couteaux font plus larges
par le bout que vers le manche, oit ils n’ont qu’en-
viron dix lignes de large. Ils ne font pas coupans ;
le tranchant en eft arrondi ; ils vont en augmentant
de finefîe, & le plus groflier fert le premier. Enfin le
lin étant parfaitement nettoyé, on le pliera, & l’on
le laiffera plié jufqu’à ce qu’on veuille le mettre en
ouvrage. Toutes ces opérations fuppofènt des ouvriers
attentifs & inftruits.
H j a beaucoup moins de façons aux lins non
rames, qu’on appelle gros lins : fi on les paffe aux
couteaux, c’eft feulement pour les polir un peu. On
peut donc les rouir plus fort. Quand on les voudra
filer, on fe contentera de les féranner. Foye{ comment
on féranne à l'article C h an v r e .
Quant au filer des lins fins, on n’y procédé qu’a-
près les avoir paffés ou refendus à la broffe ou peigne
; il faut que tous les brins en foient bien féparés,
bien dégagés. On pouffe cet affinage félon la qualité
du lin & de l’ouvrage auquel on deftine le fil.
Un arpent de terre d’un lin rainé fin ôc de trois à
cjuâtre piés de hauteur, vaut au-moins deux cens
eeus, argent comptant * vendu fur terre, tous frais
& rifques à la charge du marchand. Quand il n’eft
pas ramé, il faut qu’il foit beau pour être vendu la
moitié de ce prix.
Au refte, il ne faut avoir égard à ces prix que
relativement au tems où nous avons obtenu le mémoire,
je veux dire, le commencement de cet ouvrage.
Nous en avons déjà averti, & nous y revenons
encore : tout peut avoir confidérablement
changé depuis.
On trouve dans les mémoires de l'académie de Suède,
année 174G, une méthode pour préparer le lin d’une
maniéré qui le rende femblablé à du coton ; & M.
Palmquift, qui la propofe, croit que par fon moyen
On,P?urr0*t fe Palfet du .coton. Voici le procédé
qu’il indique : on prend une chaudière de fer fondu
ou de cuivre étamé ; on y met un peu d’eau de
mer ; on répand fur le fond de la chaudière parties ;
égales de chaux & de cendres de bouléau ou d’aune
; après avoir bien tamifé chacune de ces matières,
on étend par-deffus une couche de lin , qui couvrira
tout le fond de la chaudière ; on remettra par-
deffus affez de chaux & de cendres, pour que le lin
en foit entièrement couvert ; ©n fera une nouvelle
couche de lin , & l’on continuera à faire de ces couches
alternatives, jufqu’à ce que la chaudière foit
remplie à un pié p rès, pour que le tout puiffe bouillonner.
Alors on mettra la chaudière fur le feu ; on
y remettra de nouvelle eau de mer, & on fera bouillir
le mélange pendant dix heures, fans cependant
qu’il feche ; c’eft pourquoi on y remettra de nouvelle
eau de mer à mefure qu’elle s’évaporera. Lorf-
que la cuiffon fera achevée, on portera le lin ainfi
préparé à la mer, où on le lavera dans un panier, où
on le remuera avec un bâton de bois bien uni &
bien Jiffe. Lorfque tout'fera refroidi au point dé
pouvoir y toucher avec léfemains, on faVonnera ce
lin doucement comme on fait pour laver le linge
ordinaire , & on Fexpofèra à l’air pour fe fécher,
en obfervant de le mouiller & de le retourner
fouvent , fur-tout lorfque le tems eft fec. On
, finira par bien laver ce lin ; on le battra , on le la-
: vera de nouveau , & on le fera fécher. Alors on le
cardera avec précaution, comme cela fë pratique
pour le coton, & enfuite on le mettra en preffe
entre deux planches, fur lefqueîles on placera des
pierres pefantes. Au bout de deux fois vingt-quatre
heures ce lin fera propre à être envoyé comme du
coton. Foye^ les mémoires de l'académie de Suede ,
année 1746".
Lin , ( Pharmacie & Mat. med*. ) la femence feule
de cette plante eft d’ufage en Medecine : elle eft
compofée d’une petite amande émulfive, & d’une
écorce affez épâiffe, qui contient une grande quantité
de mucilage.
La graine de lin concaffée ou réduite en farine
& imbibée avec fuffifante quantité d’eau, fournit un
excellent cataplafine émollient & réfolutif, dont on
fait un ufage fort fréquent dans les tumeurs inflammatoires.
On fait entrer aufli cette graine à la dôfe d’une
pincée , dans les décodions pour les lavemens, contre
les tranchées, ladyffenterie, le renefme, & les
maladies du bas-ventre & de la veflie.
On s’en fert aufli, quoique plus rarement, pour
l’ufage intérieur : on l’ajoute aux tifanes & aux
aposèmes adouciffans, qu’on deftine principalement
à tempérer les ardeurs d’urine, à calmer les coliques
néphrétiques pkr quelque caufe d’irritation
qu’elles foient occafionnées, à faciliter même l’excrétion
& la fecrétion des urines, & la fortie du gravier
& des petites pierres. On doit employer dans
ces cas la graine de lin à fort petite dofe, & ne point
la fairé bouillir, parce que le mucilage qu’elle peut
même fournir à froid, donneroit à la liqueur, s’il y
étoit contenu en trop grande quantité, une confidence
épaiffe & gluante, qui la rendroit très-defa-
gréable au goût, & nuifible à l’eftomac.
L’infùfion de graine de lin eft excellente contre
l’aftion des poifons corrofifs : on peut dans ce cas-
ci , on doit même charger la liqueur, autant qu’on •
doit l’éviter dans le cas précédent.
Le mucilage de graine de lin tiré avec l’eau rofe
l’eau de fenouil, ou telle autre prétendue ophtalmique
, eft fort recommandé contre les ophtalmies
douloureufes; mais cette propriété, aufti-bienque
toutes celles que nous avons rapportées, lui font
communes avec tous les mucilages. Foye^ Muci-,
LA G E . ;
On retire de la graine de tin une huile par expref-
fion, que plufieurs auteurs ont recommandée tant
pour l’ufage intérieur que pour l’ufage extérieur;
hiais que nous n’employôns que pour le dernier,
parce qu’elle eft très-inférieure pour le premier à la
bonne huile d’olives & à l’huile d’amandes douces ,
qui font prefque les feules que nous employons intérieurement.
Au refte, l’huile de lin n’a dans aucun
cas que les qualités génériques dés huiles par ex-
prëfîiqn. Voyc{ à l'article Huile, ( h )
LINÂIRE, f. f. linaria, ( Nifl. nat. Bot. ) genre
de plante a fleur monopétale $ anomale, en forme
de mafque terminé en-arriere par une queue , divi-
fee par-devant en deux levres ; celle du deffus eft
decoupee en.deux ou en plufieurs parties, & la le-
vre du deffous en trois parties : le piftil eft attaché
comme un clou à la partie poftérieure de la fleur,
& devient dans la fuite un fruit ou une coque arrondie
, divifée en deux loges par une eloifon, & remplie
defëmences qui font attachées à un placenta,
& qui font plates & bordées dans quelques efpeces
Üe ce genre, rondes & anguleufes dans d’autres.
Tournefort, Inß. reiherb. Foye* PLANTE.
On vient de lire les carafteres de ce genre de
plante, qu’il importe aux gens de l’art de connoître
parce^ que plufieurs auteurs ont rangé inal-à-propos
parmi les tinaires, des plantes qui appartenoient à
d autres genres. M. de Tournefort compte 57 efpeces
de celui-ci. Arrêtons-nous à notre feule linaire
commune, en anglois toad-flax, & par les Botani-
ft.es., linaria vulgaris, ou lintea, flore majore. C. B.
P. 2/2. H. ,7 o. J J y
Ses racines font blanches, dures,ligneufes, rem-
pantes, & fort traçantes ; il fort de la même racine
plufieurs tiges hautes d’un pié, ou d’une coudée, c y lindriques
, liffes , d’un verd de mer, branehues à
leur fommet, garnies de beaucoup de feuilles , placées
fans ordre, étroites, pointues, femblables à
celles de i’éfule ; de forte que fi elles a voient du lait ^
il feroit difficile de l’en diftinguer. Avant qu’elle
fleuriffe , fes fleurs font au fommet des tiges & des
rameaux , rangées en épi, portées chacune fur un
pédicule court, qui fort de l’aiffelle des feuilles ;
elles font d’une feule piece, irrégulières, en mafque
jaune, prolongées à la partie poftérieure, en
cperon, en maniéré de corne, oblong , pointu de
même que celle du pié d’alouette ; & c ’eft en cela
qu’elles different des fleurs du mufle de veau ; elles
font partagées en deux levres par-devant, dont la
fupérieure fe divife en efpeces de petites oreilles ,
& 1 inférieure en trois fegmens. Leur calice eft petit
, découpé en cinq quartiers ; il en fort un piftil
attache à la partie poftérieure de la fleur, en maniéré
de clou. Ce piftil fe change dans la fuite en un fruit
à deux capfules, ou en une coque arrondie, partagée
en deux loges par une cloffon mitoyenne, &
percée de deux trous à fon extrémité. Quand elle,
eft mûre, e ik eft remplie de graines plates, rondes,
noires, bordées d’un feuiller.
La faveur de cette plante eft un peu amere & un
peu‘âcre ; elle eft fréquente fur le bord des champs *
à dans les pâturages flériies. Son odeur eft fétide,
appéfantiffaiLte ou fomnifere ; on en fait rarement
ufage intérieurement, mais c’eft un excellent anodin
extérieur pour calmer les douleurs des hémor-
rhoïdes fermées, foit qu’on l’emploie en cataplaf-
me ou en Intiment. ( D . J. )
Lin air e , ( Mat. med. ) plante prefqiie abfolu-
Ment inufitee, dont plufieurs médecins ont dit cependant
de fort belles chofes. Voici par exemple,
une partie de ce qu’en dit Tournefort, hiß. des plantas
des environs de Paris, herb. 1. La linaire réfout le
lang ou les matières extravafées dans les porofités
des chairs, & ramollit en même tems les fibres dont
la tenfion extraordinaire caufe des douleurs infup-
portables dans le cancer. L’onguent de linaire eft
excellent pour appaifer l’inflammation des hémorrhoideV
: voici cômmeht bh le pféparé ; bn fait
bouillit les feuilles de cette plante dans l’huile oit
lt.‘nfufér des efcarbbts ou dei'clopbrtes : on’
patte thuile par unlinge -, & l ’on y ajoute tm jaune
cl(je.ufj |ü r c .i .&autant de cite héuve àu’il'en faut'
pour donner la confidence tfongitent. C e t àuteùf
rappotte, d apres Hortuisy tme fort bonnfc anec-’
dote, k propos de cet ongoefm II dit landf
grave de Heffe donnbit tous les ans un hçstif bien
gras a Jean Vultius f&n médecin ; pour lui avoir
appris ce fecret; Cette récompenfë, toute bifarre &
peu magnifique qu’elle peut paroître; étoit cependant
bien au-deffus du fervice rendu. Cet onguent
de/maire que nous venons de décrire , eft un mauvais
remede ; ou pour le moins la linaire en eft-ellé*
un ingrédient fort inutile. Foyer Huile & O n
GUENT. ( b )
LINANGES, ( Géog. ) Ies Allemands difént &c
écrivent Leuiengen , petit pays d’Allemagne encla-
v e^m s le bas - Palatinat, avec titré de comté*
LÏNCE f. F. ( Commerce. ) forte dé fatiiiS dë la'
Ohine, ainfi appellés de la maniéré dont ils font
pues.
LINCEUL, f. m. ( Gram. ) ce mot a voit autrefois
une acception affez étendue ; il fe difoit de toufc!
tiffu de lin, cie toutes fortes de toile ; à préfent il
ne fe dit plus que du drap dont on nous enveloppe
apres la mort ; l’unique chofe de toutes nos pofîef-
fions que nous emportions au tombeau.
LINCHANCHI, ( Géog.) ville de l’Amérique,
dans la nouvelle Efpagne, au pays d’Incatan , à 4
lieues de$elam.£o/z£. 28 9 . 4 6 .la t .2 0 . 40. ( D . J . \
LINCOLN, {Géog. ) ville d’Angleterre, capitale
de Lincolnshire, avec un évêché fuffragant.de Can-
torberi, & titre de comté. Elle envoie deux dépu-s
tes au parlement. Son nom latin eûLindum, & pa/
les écrivains du moyen âge, Lindecollinùm -, ou LinJ
decollina, félon Bede. Le nom breton eft Lindecylne
dont la première fÿllabe fignifie un lac, un marais,
Les anciens peuples dé l’île l’appelloient Lindcoit,
à .caufe des forêts qui l’environnoient. Les Saxons'
la nommoient Lin-cyllanceartep, & les Normands ,
Nichol.
Cette ville a été quelquefois la féfidehee des rois
de Mercie. Elle eft fur lé Withâm, à 24 milles N. E;
deNottingham, 39N. de Pétersboroug, 51 S.d’York*
105 N. de Londres. Long, félon Streèt'i- / od 4 0 ' W V
U t. 5 3 . >5 . ■ ‘ J •
LINCOLNSHIRE, ( Géogr. ) pays dés anciens
Coritains, aujourd’hui province maritime d’An oie-
terre , bornée à l’eft par l’océan germanique. Elle
a 180 milles de tour, & contient environ 174 mille
. arpens. C ’eft un pays fertile, & très-agréable du
côté du nord & de l’oueft. L’Humber qui fcpare cette
province d’Yorkshire, & la Trente qui en fepare une
partie du Nottinghamshire, font fes deux premières'
rivières, outre lefqueîles il y a leWittham, leNeu,
& leV é la n d , qui la traverfent. Cette province,
i une aes plus grandes d Angleterre, eft divifée en
trois parties nommées Lindfey, Holland, & Rifle-
ven. Lindfey qui eft la plus confidérabi.e, contient
les parties feptentrionales ; Holland eft au fud-eft,
& Kefteven à I’oueft de Holland. Ses villes principales
font Lincoln capitale, Bofton , Grirtisby,
Grantham, Kirton, & Ganesboroug.
La province de Lincoln doit à jamais fe giorifief
d’avoir produit Newton, cette efpecede demi-dieu ,
qui le premier à Connu la lumière, & qui à l’ âgé
de 24 ans ', avdit déjà fait toutes fes découvertes ■
celle-là même du calcul des fluxions, dît des infiniment
petits,; il fe contenta de l’invention d’une théorie
fifurprenante, fans fonger à s’en affurer la gloire,
fans fe preffer d’annoncer à l’nnivers fon génie créai