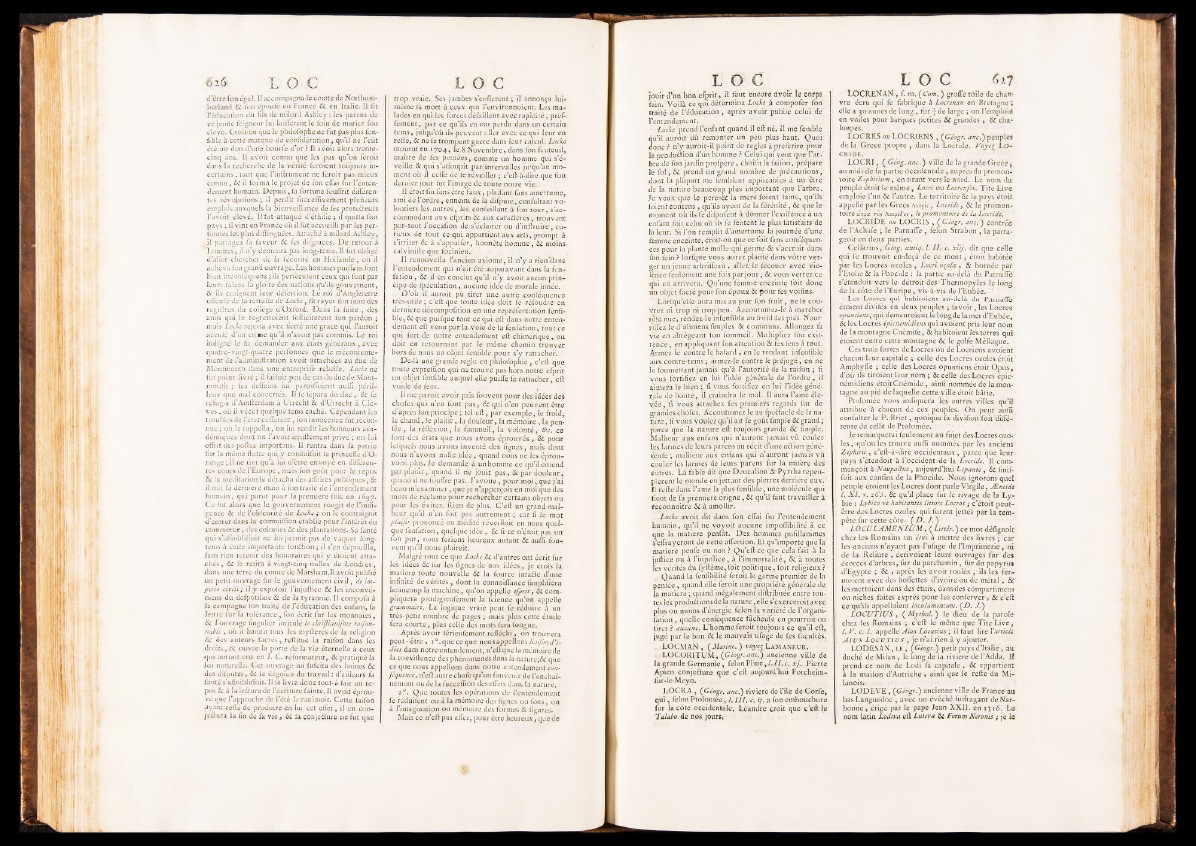
«26 I O C L O C d’être fon égal. Il accompagna le cointe dé Northùrfi-
berland. & Ion époufe en France 6c en Italie. Il fit-
l ’éducation du fils de milord Ashiey: les parens de
ce jeune fëigneur lui laiflerent le foin de marier fon
éleve. Croit-on que le philofophe ne fut pas plus fenfible
à, cette marque, dé confédération, qu’il ne l’eût
été au don d’une bourfe d’or ?;II avoit alors trente-
cinq ans.. Il avoit connu que les pas qu’on feroit
dans la recherche de la vérité feroient toujours incertains
, tant que l’inftrument ne feroit pas mieux
connu, 6c il forma le projet de fon effai fur l ’entendement
humain; Depuis,fa fortune fouffrit différentes
révolutions ; il perdit fuccefïivement plufieurs
emplois auxquels la bienveillance de fes protecteurs
l’àvoit élevé. I l fut attaqué d’éthifie ; il quitta fon
pays ; il vint en France oiiii fut accueilli par les per-
fonnes les plus diftinguées. Attaché à milord Ashiey,
.il partagea fa faveur 6c fes difgraces. De retour à
Londres-, il-n’ÿ demeura pas long-tems. Il fut obligé
d’aller chercher de la fécurité en Hollande , où il
acheva fon grand ouvrage. Les hommes puiffans font
bien inconféquens ; ils perfécittent ceux qui font par
leurs taleris la gloire des nations qu’ils gouvernent,
& ils craignent leur défertion. Le roi d’Angleterre
oitenfé de la retraite de Locke, fit rayer fon nom des
regiftres. du collège d’Oxford. Dans la fuite , des
amis qui le regrettoient folliciterent fon pardon ;
mais Locke rejetta avec fierté une grâce qui l’auroit
acculé d’un crime qu’il n’avoit pas commis. Le roi
indigné' le fit demander aux états généraux, avec
quatre-vingt-quatre perfonnes que le mécontentement
de J’àdminiftration avoit attachées au duc de
Montmouth dans une entreprife rebelle. Locke ne
fut point ;livré ; il failoit peu de cas du duc de Montmouth
; fes deffeins lui paroilfoient auflî périlleux
que mal concertés^ Il fe fépara du duc, 6c fe
réfugia d’Amfterdam à Utrecht & d’Utrecht à Cle-
v e s , où il vécut quelque tems caché. Cependant les
troubles de l’état cefferent, fon innocence fut reconnue
;• on le râppella, on lui rendit les honneurs académiques
dont on l’avoit injuftemenr privé ; on lui
offrit des poftes importans. Il rentra dans fa patrie
fur la même flotte qifoy conduifoit la princeffe d’O-
range ;>il ne tint qu’à lui d’être efivoyé en différentes
cours de l’Europemais fon goût pour de repos
6c la méditation le détacha des affaires publiques, &
il mit la dernière main à fon traité de l’entendement
humain, qui parut pour la première fois en 1697;
C e fut alors que lé gouvernement rougit de l ’indigence
& de l’obfcurité de Locke ,• on le contraignit
d ’entrer dans la commifîion établie pour l’intérêt du
commerce j des colonies 6c des plantations.-Sa fanté
qui s’affoibliffoit ne lui permit pas de vaquer long-
lems à cette importante fonûion ; il s’en dépouilla,
fans rien retenir des honoraires qui y étoient attachés
, 6c fe .retira à vingt-cinq milles de Londres,
dans une terre du comte de Marsham.il avoit publié
lin petit ouvrage fur le gouvernement c ivil, de im-
perio civili; il y expofoit l’injuffice 6c les inconvé-
niens du defpotifme & de la tyrannie. Il compofa à
la campagne fon traité de l’éducation des enfans, fa
lettre fur la tolérance , fon écrit fur les monnoies,
6c l’ouvrage fingulier intitulé Le chriflianifme raifon-
nable, pù il bannit tous les mÿfteres de la religion
&c des auteurs, lacrés, reftitue la raifon dans fes
droits,.ôc ouvre la porte de la vie éternelle à ceux
qui auront cru en J. C. réformateur, & pratiqué la
loi naturelle. Cet ouvrage lui fufeita des haines 6c
.des difputes, 6c le dégoûta du travail : d’ailleurs fa
fanté s’aftbibliflbit. Il lé livra donc tout-à-fait au repos
& à la lecture de l’écriture fainte. Il avoit éprouvé
que l’approçhe de l’été le ranimoit. Cette faifon
ayant ceffé de, produire en lui cet effet, il en conjectura
la fin de fa y ie , & fa conjecture ne fut que
trop vraie. Ses jambes s’enflerent ; il annonça lui-
même fa mort à ceux qui l’environnoient. Les ma-
. la des en qui les forces défaillent avec rapidité, pref-
fentent, par ce qu’ils en ont perdu dans un certain
tems, jufqu’où ils peuvent aller avec ce qui leur en
refte, & ne fe trompent guere dans leur calcul. Locke
monruten 1704-, le:.8 Novembre, dans fon fauteuil,
maître de fes penlées, comme un homme qui s’éveille
& qui s’affoupit par, intervalles jusqu’au moment
où il ceffe de fe réveiller ; c’eft-à-dire que fon
dernier jour lut l’image dç loute notre vie.-..
Il étoit fin fans être faux, plaifant fans amertume,
ami de l’ordre, ennemi de là difpute, confultant volontiers
les autres, les confeillant à fon tour, s’accommodant
aux efprits 6c aux caraCleres, trouvant
par-tout l’occafion de s’éclairer ou d’inftruire, curieux
de tout ce qui appartient.aux arts, prompt à
s’irriter & à s’appaifer, honnête homme, 6c moins
calvinifte que focinien.
Il renouvella l’ancien axiome, il n’y a rien’dans
l ’entendement qui n’ait été auparavant dans la fenfation
, 6c il en conclut qu’il n’y avoit aucun principe
de fpéculation, aucune idée de morale innée.
D ’où il auroit pu .tirer une autre conféquence
très-utile ; c’eft que toute idée doit fe réfoudre en
derniere décompofition en une repréfentation fenfible,
& que puifque tout.cequi eft dans notre entendement
êft venu par la voie.de la fenfation, tout ce
qui fort de notre entendement eft chimérique, ou
doit en retournant par le même chemin trouver
hors de nous un objet fenfible pour s’y rattacher.
De-là une grande régie en philofophie , c’eft que
toute expreflion qui ne trouve pas hors notre efprit
un objet fenfible auquel elle puiffe fe rattacher, eft
Vuide de fens.
Il me paroît avoir pris fouvent pour des idées des
ehofes.qui n’en font pas, 6c qui n’en peuvent être
d’après.fon principe; tel eft, par exemple, le froid,
le chaud, le plaifir, la douleur, la mémoire , la pen-
fé e , la réfléxiôn, le fommeil, la volonté , &c. ce
font des états que nous avons éprouvés, & pour
lefquels nous avons inventé des lignes, mais dont
nous n’avons nulle idée, quand nous ne les éprouvons
pins. Je demande à un homme ce qu’il entend 13&r plaifir^ quand il ne jouit pas, & par douleur,
quand il ne fouffre pas. J’a voue, pour moi, que j’ai
beau m’examiner, que je n’apperçois en moi que des
mots de réclame pour rechercher certains objets ou
pour les éviter. Rien de plus. C ’eft un grand malheur
qu’il n’en foit pas autrement ; car fi le mot
plaifir prononcé ou médité réveilloit en nous quelque
fenfation, quelque idée , & fi ce n’étoit pas un
Ion pur, nous ferions heureux autant 6c auflî fou-
vent qu’il nous plairoit.
Malgré tout ce que Locke 6c d’autres ont écrit fur
les idees 6c fur les lignes de nos idées., je.crois la
matière toute nouvelle 6c la fource intade. d’une
infinité de vérités, dont la connoiffance fimplifiéra
beaucoup la machine , qu’on appelle efprit, & compliquera
prodigieufement la fcience qu’on appelle
grammaire. La logique vraie peut fe réduire à un
très-petit nombre de pages ; mais plus cette étude
fera courte, plus celle des mots fera longue.
Après avoir férieufement réfléchi, on trouvera
peut - être , i ° . que ce que nous appelions liaifond'i*
dées dans notre entendement, n’eftque la mémoire de
la coexiftence des phénomènes dans la nature;& que
ce que nous appelions dans notre entendement con*
fèquence, n’eft autre chofe qu’un fouvenir de l’enchaînement
ou de la fucceflion des effets dans la nature. :
z ° . Que toutes les opérations de l’entendement
fe réduifent ou à la mémoire des fignes ou fons, ou
à l’imagination ou mémoire des formes & figures.
Mais ce n’eft pas affez, pour être heureux, que de
L O C
jouir fttn bon eiptit, il faut encôîfé avoir le COfpS
fain. Voilà ce qui détermina Locke à compofer fon
traité de l'éducation, après avoir publié celui de
l’entendement. . ;
; Locke ' prend l’ehrant quand il eft né. Il me fèiiiblq
qu’il aufôit dû remonter üh peu plus haut. Qùoi;
donc ? n’y auroit-il point de réglés à preferire pour
lh production d’un homme ? Celui qui veut que l’arbre
de fon jardin profpere, choîfit la faifon, prépare
le fo l, 6c prend un grand nombre de précautions,
dont la plûpart me femblent applicables à, un être
de la nature beaucoup plus important que l’arbre.
Je veux que le pere»& la fnere foient fains, qu’ils ,
foient eonrens , qu’ils ayent de la férénité, 6c que le
moment où ils fe difpofent à donner l’exiftéhce à un
enfant foit celui où ils fe fentént le plus fatisfaits de
là leur. Si l’on remplit d’amertume la journée d’une.
femme enceinte, croit-on que ce foit fans coriféquen-
ces pour la plante molle qui germé & s’accroît dans
fon lein } lorfqùe vous aurez planté dans vôtre verger
un. jeune a.rbriffeau , allez.' le fècouer avec violence
feulement une fois par jou r , & vous verrez ce.
qui en arrivera.- Qu’une femme enceinte foit donc
lin objet facré pour fon époux &-poùr fes voifins. :
: Lorfqu’elle aura mis au jour fon fruit, ne le couvrez
ni trop ni trop peu. Àccoutumez-le à marcher
teténue, réndez-Ie infenfible au froid des piés. Nour-
rî.ffez-le d’alimens fimples & communs. Allongez fa
vie eh abrégeant fon fommeil. Multipliez fon exif-.
tence, en appliquant fon attention & fes fens à tout.
Armez- le contre lé h a fard, en le rendant infenfible
aux contrë-tems ; àrmez-le contre le préjugé, en pe
lé foumettant jamais qu’à l’autorité de la raifon ; fi
vous .fortifiez en lui l’idée générale de l’ordre, il
aimera le bien ; fi'vôus. fortifiez en lui l’idée gérié-r
râlé dé honte', il craindra lé mal. Il aura l’ame éle- '
y é e , fi vous attachez fes premiers'regards fur de
grandes çhôfès. '.Accoutumez le au fpeftacle de la nature
, fi vous voulez qu’il ait le goût fimple & grand ;
parce que la nature eft toujours grande & limple.
Malheur aux enfans qui n’auront jamais vu couler
lès larmes dé leurs parens au récit d’une aftion géné-
reùfe ; malheur aux enfans qui n’auront jamais vu
couler lés larmes de leurs parens fur la mifèrè des
Autres. La fâblë'di't que Deucàlion & Pyrrha repeuplèrent
le.monde en jettant des pierres derrière eux. '
II.refte daîis i’ame la plus fenfible, une molécule qui
tient de fa premierë.origne, 6t qu’il faut travailler à
f econnoitre 6c à amollir.
' Locke avoit dit dans fon èffai fur l’entendement
humain, qu’il né voyoit aucune impoffibilité à ce
que la matière penfât. Des hommës pufillanimes
s’effrayeront de cette affertion. Et qu’importe que la
matière penfe pu non ? Qu’eft- ce, que cela fait à la
iuftice ou à l’injuftice, à l’immortalité, 6c à toutes
îes vérités du fyftême, foit politique, foit religieux ?
. ,Quand la fenfibilité feroit 1e germé premier dé,la
penfée, quand elle feroit une propriété générale de
îa matière ; quand inégalement,diffrjbuée entre toutes
les. productions de la nature, elle s’ëxerceroit .avec
plus ou moins d’énergie, felon-,^ variété de l’orgahi-
îation, quelle conféquence fâcHêu'le en pourroit-on
tirer ? aucune. L’homme.ferpit tôüjôurs ce qu’il ëff,
jugé par le bon & le mauvais ufage de fes facultés.
, LOCMAN , ( Marine. ) vâye^ Lamaneu r.
. LO COR ITUM, (Gèogr: anc.f ancienne ville de
la grande Germanie, félon Pline, L.II. c. x j. Pierre
Apien conjecture que c’eft aujourd’hui Forçheim-
fur-le-Meyn.
LO C R A , ([Géogr. anc.) riviere de Hle de Gorfe,
q u i, félon Ptolomée, L. I II. c\ ij. a fon embouchure
fur la côte occidentale, Léandre croit que c ’eft le
Talabo de nos jours.
L O C 627
LÔCRËNAN) f. m. (Corn. ) groffe toile de chah1
vre écru qui fe fabrique à Locrenan en Bretagne ;
elle a 30 aunes de long, fur y de large ; on l ’emploiô
en voiles pour barques petites & grandes , 6c cha*
loupes.
LOCRES ou LOCRIÈNS , (Géogr. péùpîes
de la Grece propre , dans la Locride. Voye^ Lo*
GRIDÉ.
LO C R I , ( Géog. anc.) ville de la grande G recôf
au midi de fa partie Occidentale , auprès du promontoire
Zephirium, en tirant vers le nord. Lé nom dit
peuple étoit le même , Locri ou Locrenfes. Tite-Live
emploie l’un & l’autre. Le territoire 6c le pays étoit
a'ppellé par lés Grecs Aoy.p)ç ^ Locride, & le promon*
tôire dupa THf Loxpifoc , le prômôntoire de la Locride.
LOCRIDE ou LOCRIS , (Géogr, anc.') Contréé
dé l ’Achaié ; le Parrtaffe , félon Strabon , la parta-
geoit en deux parties.
- Gellarius Géog. antiq. I. I I ; c. xiij. dit que celle
qui fe troùvoit en-deçà de ce mont, étoit habitée
par les Locres ozoles , Locn.o^oloe, & bôriiée pat?
l’Etolie & la Phocide : la partie au-delà du Parnaffe
s?étendoit vers le détroit des Tliermopylès le long
de la- côte? de l’Euripe, vis-à-vis de l’Eubée. !
•. Les Locres qui habitoient au-delà du Pârnaffe
étoiênt divifés en deux peuples ; favoir, les Locres
opuntiens, qui demeuroient le long de la mer d’Eubée,
6c les Locres épicnemidiens qui avoient pris leur nom
de la montagne Gnémife , & habitoient les terres qui
étoient entre cette montagne 6c le golfe Méliague.
Ces trois fortes de Locres ou de Locriens avoient
chacun lcur capitale ; celle des Locres ozoles étoit
Amphyffe ; celle des Locres opuntiens étoit O.pus ,
d’où ils tiroient léur nom ; & celle des Locres épie-*
némidiens étoit Cnémide, ainfi nommée de la montagne
au pié de laquelle cette ville étoit bâtie.
Ptolomée vous indiquera le.s autres villes qu’il
attribue à chacun de ces peuples. Ou peut auflî
confulter le P. Briet, quoique fa divifion foit différente
de eellè de Ptolomée.
Je remarquerai feulement au fujet des Locres ozô*'
les, qu’on les trouve auflî nommés par les anciens'
Zephirii, c’eft-à-dire occidentaux, parce que leur
pays s’ètendoit à l’occident de la Locride. Il coih-
mençoit à Naupaclus, aujourd’hui Lépante, 6ç finif-
foit aux confins de la Phocido. Nous ignorons quel
peuple étoient les Locres dont parle Virgile, Æneidt
l. XI. v. 2,65. 6c qu’il place fur le rivage de la Ly-
bie : Lybico ve habitantes littore Locros ; c’étoit peut-
être des Locres ozoles qui furent jettes par la tempête
fur cette côte. (D . —
LOGULAM.ENTUM. y (Littèr.) ce mot défignoit
chez les Romains un étui à mettre des livres ; car
les anciens n’ayant pas Pufage de l’Imprimerie, ni
de la Reliure , écrivoient leurs ouvrages fur des
écorces d’arbres, fur du parchemin, fur du papy tus
d’Egypte ; 6c , après les avoir roulés , ils lés fer*
moient avec des boffettes d’ivoire ou de métal, &
les mettoient dans des étuis, dans des cômpartimens
ou niches faites-exprès pour les conferver > & c ’eft:
ce qu’ils appelloient loculamentum. (D . J.)
LO CUT IU S, (Mythol.) .le dieu de la parolë
chez les Romains ; c’eft le même que Tite-Live,
l. V . c. L. appelle Aius Locutius ; il faut lire l’article
A i v s L o c u t i u s , je rr’ai rien à y ajouter.
LODESAN, LE, (Géogr.) petit pays d’Italie, au
duché de Milan , le long de la riviere de l’Adda. II
prend ce nom de Lodi fa capitale, 6c appartient
à la maifon d’Autriche , ainfi que le refte du Mi-
lanois.
LO D E V E , (Géogr.) ancienne ville de France au
bas Languedoc , avec un évêché fùffragant de Narbonne
j érigé par le pape Jean XXII. en 1316. Lé
nom latin Lodeya eft Luteva 6c Forum Neronis ; je lô