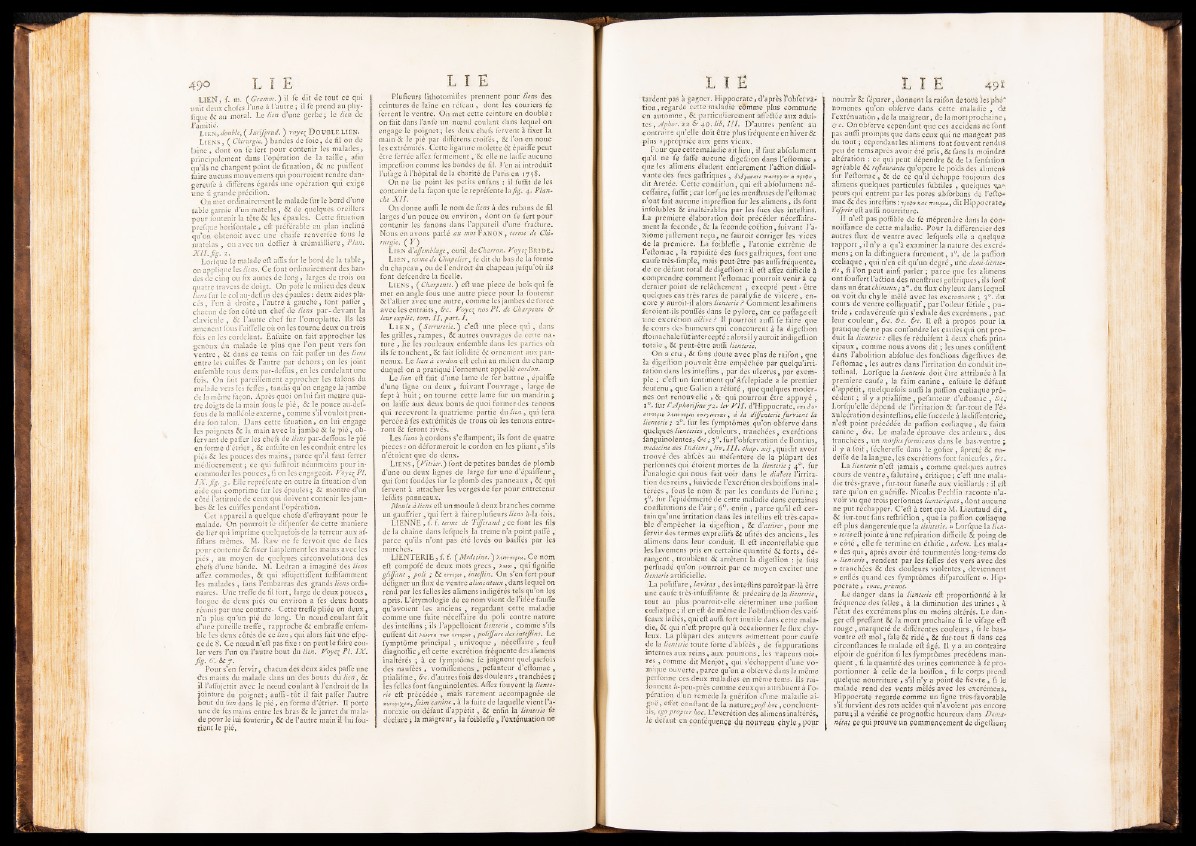
LIEN, f. m. ( Gramm.) il (e dit de tout ee qui
unit deux chofes l’une à L’autre ; il te prend au phy-
fique & au moral. Le lien d’une gerbe; le lien de
l ’amitié.
L ien, double, ( Jurifprud. ) voye^ D O U B L E LIEN.
L iens , ( Chirurgie. ) bandes de foie, de fil ou de
laine, dont on fe fert pour contenir les malades,
principalement dans l’opération de la taille, afin
qu’ils ne changent point de fituation, & ne puiffent
faire aucuns mouvemens qui pourroient rendre dan-
gereufe à différens égards une opération qui exige
line fi grande précifion.
On met ordinairement le malade fur le bord d’une
table garnie d’un matelas, & de quelques oreillers
pour foutenir la tête & les épaules. Cette fituation
prefque horifontale, eft préférable au plan incliné
qu’on obtenoit avec une chaife renverfée fous le
matelas , ou avec un doflîer à crémailliere, Plan.
X I I . fig. 2.
Lorfque le malade eft afîis fur le bord de la table,
on applique les liens. Ce font ordinairement des bandes
de cinq ou fix aunes de long, larges de trois ou
quatre travers de doigt. On pofe le milieu des deux
liens fur le col au-deffus des épaules : deux aides placés
, l’un à droite, l’autre à gauche, font pafl'er ,
chacun de fon côté un chef de liens par-devant la
clavicule , & l ’autre chef fur l’omoplatte. Ils les
amènent fous l’aiffelle où on les tourne deux ou trois
fois en les cordelant. Enfuite on fait approcher les
genoux du malade le plus que l’on peut vers fon
ventre, & dans ce tems on fait paffer un des liens
entre les cuiffes & l’autre par dehors ; on les joint
enfemble tous deux par-deffus, en les cordelant une
fois. On fait pareillement approcher les talons du
malade vers les feffes, tandis qu’on engage la jambe
de la même façon. Après quoi on lui fait mettre quatre
doigts de la main fous le pié, & le pouce au-def-
fous de la malléole externe, comme s’il vouloit prendre
fon talon. Dans cette fituation, on lui engage
les poignets & la main avec la jambe & le p ié , ob- N
fervant de paffer les chefs de liens par-deffous le pié
en forme d’étrier, & enfuite on les conduit entre les
pies & les pouces des mains, parce qu’il faut ferrer
médiocrement ; ce qui fuffiroit néanmoins pour incommoder
les pouces , fi on les engageoit. Voye{ PI.
IX . fig. 3. Elle repréfente en outre la fituation d’un
aide qui comprime fur les épaules.; & montre d’un
côté l’attitude de ceux qui doivent contenir les jambes
& les cuiffes pendant l’opération.
Cet appareil a quelque chofe d’effrayant pour le
malade. On pourroit fe difpenfer de cette maniéré
de lier qui imprime quelquefois de la terreur aux af-
fiftans mêmes. M. Raw ne fe fervoit que de lacs
pour contenir & fixer Amplement les mains avec les
piés , au moyen de quelques circonvolutions des
chefs d’une bande. M. Ledran a imaginé des liens
affez commodes, & qui affujettiffent fuffifamment
les malades , fans l’embarras des grands liens ordinaires.
Une treffe de fil fort, large de deux pouces,
longue de deux piés ou environ a fes deux bouts
réunis par une couture. Cette treffe pliée en deux,
n’a plus qu’un pié de long. Un noeud coulant fait
d’une pareille treffe, rapproche & embraffé enfemble
les deux côtés de ce lien, qui alors fait une efpe-
ce de 8. Ce noeud n’eft pas fixe : on peut le faire couler
vers l’un ou l’autre bout du lien. Voyeç Pl. IX .
fig. C.-ècÿ'.
Pour s’en fervir, chacun des deux aides paffe une
des mains du malade dans un des bouts du lien, &
il l’affujettit avec le noeud coulant à l’endroit de la
jointure du poignet; aufli-tôt il fait paffer l’autre
bout du lien dans le pié, eh forme d’étrier. Il porte
une de fes mains entre les bras & le jarret du malade
pour le lui foutenir, & de l’autre main il lui fou-
tient le pié.
Plufieurs lithotomiftes prennent pour liens des
ceintures de laine en réfeau , dont les couriers fe
ferrent le ventre. On met cette ceinture en double:
on fait dans l’anfe un noeud coulant dans lequel on
engage le poignet ; les deux chefs fervent à fixer la
main & le pié par différens croifés, & l’on en noue
les extrémités. Cette ligature molette & épaiffe peut
être ferrée affez fermement, & elle ne laiffe aucune
impreflion comme les bandes de fil. J’en ai introduit
l’ufage à l’hôpital de la charité de Paris en 1758.
On ne lie point les petits enfans : il fuffit de les
contenir de la façon que le reprélente la fig. 4. Planche
X I I .
On donne aufli le nom de liens à des rubans de fil
larges d’un pouce ou environ, dont on fe fert pour
contenir les fanons dans l’appareil d’une fraéture.
Nous en avons parlé au mot Fa n o n , terme de Chi- mrgie. ( ry
L ien ôl ajjemblage, outil deCharron. V sye^BRiDE.
L ie n , terme de Chapelier, fe dit du bas de la forme
du chapeau, ou de l’endroit du chapeau jufqu’où ils
font defeendre la ficelle.
L i e n s , ( Charpente. ) eft une piece de bois qui fe
met en angle fous une autre piece pour la foutenir
& l’allier avec une autre, comme les jambes de force
avec les entraits, &c. Voyeç nos P l. de Charpente &.
leur explic. tom. I I . part. I.
L i e n , ( Serrurerie. ) c’eft une piece q u i, dans
les grilles, rampes, & autres ouvrages de cette nature
, lie les rouleaux enfemble dans les parties où
ils fe touchent, & fait folidité & ornement aux panneaux.
Le lien à cordon eft celui au milieu du champ
duquel on a pratiqué l’ornement appellé cordon.
Le lien eft fait d’une lame de fer battue , épaiffe
d’une ligne ou deux , fuivant l’ouvrage , large de
fept à huit ; on tourne cette lame fur un mandrin ;
on laiffe aux deux bouts de quoi former des tenons
qui recevront la quatrième partie du lien, qui fera
percée à fes extrémités de trous où les tenons entreront
& feront rivés.
Les liens à cordons s’eftampent; ils font de quatre
pièces : on déformeroit le cordon en les pliant -, s’ils
n’étoient que de deux.
L i e n s , ( Vitrier.) font de petites bandes de plomb
d’une ou deux lignes de large fur une d’épaiffeur ,
qui font foudées fur le plomb des panneaux , Sc qui
fervent à attacher les verges de fer pour entretenir
lefdits panneaux.
Moule à liens eft un moule à deux branches comme
un gauffrier, qui fert à faire plufieurs liens à-la-fois.
LIENNE , f. f. terme de TiJJerand ; ce font les fils
de la chaîne dans lefquels la treme n’a point paffé ,
parce qu’ils n’ont pas été levés ou baiffés par les
marches.
LIENTERIE, f. f. ( Médecine. ) XmvTcpta.. Ce nom
eft compofé de deux mots grecs , xtiov, qui lignifie
glijfant, poli ; & tvTtpov, inteflin. On s’en fert pour
défigner un flux de ventre alimenteux, dans lequel on
rend par les Celles les alimens indigérés tels qu’on les
a pris. L’étymologie de ce nom vient de l’idée fauffe
qu’avoient les anciens , regardant cette maladie
comme une fuite néceffaire du poli contre nature
des inteftins ; ils l ’appelloient lienterie , comme s’ils
euffent dit Miot» tm tvnpm, polijfure des intefiins. Le
fymptôme principal , univoque , néceffaire , feul
diagnoftic, eft cette excrétion fréquente des alimens
inaltérés ; à ce fymptôme fe joignent quelquefois
des naufées, vomiffemens , pefanteur d’eftomac ,
ptialifme, &c. d’autres fois des douleurs, tranchées ;
les felles font fanguinolentes. Affez fouvent la lienterie
eft précédée , mais rarement accompagnée de
kinopi%ia,faim canine, à la fuite de laquelle vient l’anorexie
ou défaut d’appétit , & enfin la lienterie fe
déclare ; la maigreur, la foibleffe, l’exténuation ne
tardent pas à gagner. Hippocrate, d’après Fobfefvâ-
tion, regarde cette maladie cÔmme plus commune
en automne, & particulièrement aftèâce aux adultes
, Aphor. z z & 40. lib. I II. D ’autres penfent aü
contraire qu’elle doit être plus fréquente en hiver &
plus appropriée aux gens vieux.
Pour que cette maladie ait lieu, il faut abfolumeht
qu’il ne fe fâffe aucune digeftion dans l’eftomac ,
que les alimens éludent entièrement I’aétion diffol-
vante des fucs gaftriques , S'iS'pti&zti Traftpyor fi rpoip» ,
dit Aretée. Cette condition, qui eft abfolument néceffaire,
fuffit ; car lorfque les menftrues de l’eftomac
n’ont fait aucune impreflion fur les alimens, ils font
infolubles & inaltérables par les fucs des inteftins.
La première élaboration doit précéder néceffaire-
ment la fécondé, & la fécondé coétion, fuivant l ’axiome
juftement reçu, ne fauroit corriger les vices
de la première. La foibleffe , l’atonie extrême de
l’eftomac, la rapidité des fucs gaftriques, font une
caufe très-fimple, mais peut-être pasauffifréquente,
de ce défaut total de digeftion : il eft affez difficile à
comprendre comment l’eftomac pourroit venir à ce
dernier point de relâchement , excepté peut - être
quelques cas très-rares de paralyfie de vifcere, encore
y auroit-il alors Lienterie? Comment les alimens
feroient-ils pouffés dans le pylore, car ce paffageeft
une excrétion active? Il pourroit aufli fe faire que
le cours des humeurs qui concourent à la digeftion
ftomachale fût intercepté : alors il y auroit indigeftioh
totale , & peut-être aufli lienterie.
On a c ru , & fans doute avec plus de raifon , que
la digeftion pouvoit être empêchée par quelqu’irri-
tation dans les inteftins , par des ulcérés, par exemple
; c’eft un fentiment qu’Afclepiade a le premier
foutenu, que Galien a réfuté , que quelques modernes
ont renouvellé , & qui pourroit être appuyé ,
i° . fur VAphorifmeyz. liv VII. d’Hippocrate, S'uinvripni
MttvTtpi» vniyivvTctt, a la difienterie furvient la
lienterie ; z°. fur les fymptômes qu’on obferve dans
quelques lienteries, douleurs, tranchées, excrétions
fanguinolentes, &c; 30. furl’obfervation de Bontius,
medecine des Indiens, liv. I I I . chap. x i j , qui dit avoir
trouvé des abfcès au méfentere de la plupart des
perfonnes qui étoient mortes de la lienterie ; 40. fur
l’analogie qui nous fait voir dans le diabete l’irritation
des reins, fuiviede l’excrétion desboiffons inaltérées
, fous le nom & par les conduits de l’urine ;
$°. fur l’épidémicité de cette maladie dans certaines
conftitutions de l’air ; 6°. enfin , parce qu’il eft certain
qu’une irritation dans les inteftins eft très-capable
d’empêcher la digeftion , & d’attirer, pour me
fervir des termes expreffifs & ufités des anciens, les
alimens dans leur conduit. Il eft inconteftable que
les lavemens pris en certaine quantité & forts, dérangent
, troublent & arrêtent la digeftion : je fuis
perfuade qu’on pourroit par ce moyen exciter une
lienterie artificielle.
La poliffure, loevitas , des inteftins paroît par-là être
une caufe très-infuffifante & précaire de la lienterie,
tout au plus pourroit-elle déterminer une paflion
coeliaque ; il en eft de même de l’obftruûion des vaif-
feauX la&és, qui eft aufli fort inutile dans cette mala-
die, & qui n’eft propre qu’à ocCafionner le flux chyleux.
La plupart des auteurs admettent pour caufe
de la lienterie toute forte d’abfcès , de fuppuratiorts
internes aux reins, aux poumons , les vapeurs noires
, comme ditMenjot, qui s’échappent d’une vo-
nvque ouverre, parce qu’on a obfervé dans la même
perfonne ces deux maladies en même tems. Ils rai-
fpnnent à-peu-près comme ceux qui attribuent à-l’o peration
d’un remede la guérifon d’une maladie aiguë
, effet confiant de la nature;/»©/? hoc, concluent-
ils, ego propter hoc. L ’excrétion des alimens inaltérés,
le défaut en çqnfcquençe du nouveau çhyle ? pour
nourrir & fépafèr, donherit la raifon detôtis les phé*
nomenes qu’on obferve darts cette maladie , dè
l’exténuation, de la maigreur, de là mottprochaine *
&c. On obferve cependant que ces acciderts né font
pas aufli prompts que darts ceux qui ne mangent pas
du tout ; cependant les alimehs font foiivent rendus
peu de tems après avoir été pris, & fans là moindrô
altération : ce qui peut dépendre & de la fehfatîoa
agréable & refiaùrànte qu’opere le poids des alinlénà
fur l’eftomac, & de ce qu’il échappe toujours des
alimens quelques particules fubtiles , quelques v,aA.
peurs qui entrent par les pores abforbâns de l’efto*
mac & des inteftins : rpo<pn kcu 7muu*, dit Hippocrate^’
I’’cfprit eft aufli nourriture.
H n’eft pas poflible de fe méprendre dans la côit*.
noiffance de cette maladie. Pour la différencier des
autres flux de ventre avec lefquels elle a quelque
rapport, il n’y a qu’à examiner la nature des èxcré-
mens; on la diftinguera furement, 1°. de la paflion
coeliaque , qui n’en eft qü’un degré, ufte demi-liinte-\
rie, fi l’on peut ainfi parler ; parce que les alimens
Ont fouffert l’a&ion des menftrues gaftriques, ils font
dans un état chimeux; z ° . du flux chyleux dans lequel
on voit du chyle mêlé avec les excrehiens ; 30. cia
cours de ventre colliquatif, par l’odeur fétide , putride
, cadavéreufe qui s’exhale des excrémens , par1,
leur couleur, &c. &c. &c. Il eft à propos pour là
pratique de ne pas confondre les caufes qui ont pro-*'
duit la lienterie : elles fe réduifeht à deux chefs principaux
, comme nous avons dit ; les unes confiftent
dans l’abolition abfolue des fondions digeftives dé.
l’eftomac , les autres dans l’irritation du conduit in-,
teftinal. Lorfque la lienterie - doit être attribuée à là'
première caufe , la faim Canine , enfuite le défaut
d’appétit, quelquefois aufli la paflion coeliaque précédent
; il y a ptialifme , pefanteur d’eftomac , &c*
Lorfqu’elle dépend de l’irritation & fur-tout de l’é-
«ulcération desinteftins, elle fuCCedé à là diffenterie,'
n’eft point précédée de paflion coeliaque , dé fairri
canine, &c. Le malade éprouve des ârdeürS, des
tranchées , un morfns formicans dans lé bas-ventre ;
il y a foif, féchereffe dans le gofier , âpreté & ru-
deffe de la langue, les excrétions font fanieufes, &c.
La lienterie n’eft jamais , comme quelques autres
côurs de ventre, falutaire, critique ; c’éft une maladie
très-grave * fur-tout funefte aux vieillards : il eft:
rare qu’on en guériffe. Nicolas Peehlin raconte n’avoir
vu que trois perfonnes lientériques. dont aucune
ne put réchapper. C ’eft à tort que M. Lieutaud d it ,
& fur-tout fans reftriélion , que la paflion coeliaque
eft plus dangereufe que la Lienterie. « Lorfque la lien-
» série eft jointe à une refpiration difficile & poing de
» côté , elle fe termine en éthifie, tabtm. Les mala-'
» des q u i, après avoir été tourmentés long-tems de
» lienterie, rendent par les felles des vers avec des
» tranchées & des douleurs violentes, deviennent
» enflés quand ces fymptômes difparoiflént ». Hippocrate,
coac. prtenoti.
Le danger dans la lienterie eft proportionné à là
fréquence des felles , à la.diminution deS Urines , à
l’état des excrémens plus ou moins altérés. Le danger
eft preffànt & la mort prochaine fi le vifage eft
rOugé , marqueté de différentes couleurs , fi le bas-
ventre eft mol, fais & ridé , & fur-tout fi dans ces
circonftances le malade eft âgé. Il y a au contraire
efpoir de guérifon fi les fymptômes precédens manquent
, fi la quantité des urines commencé à fe proportionner
à celle de la boiffon, f ile corps prend
quelque nourriture , s’il n’y a point de fievre , fi le
malade rend des vents m.êlés avec les excrémens.
Hippocrate regarde comme un figne très-favorable
s’il furvient des rots acides qui rt’avoient pas encore
paru; il a vérifié ce prognoftic heureux dans Dema*
nçta; çe qui prouve un commencement de digeftion;