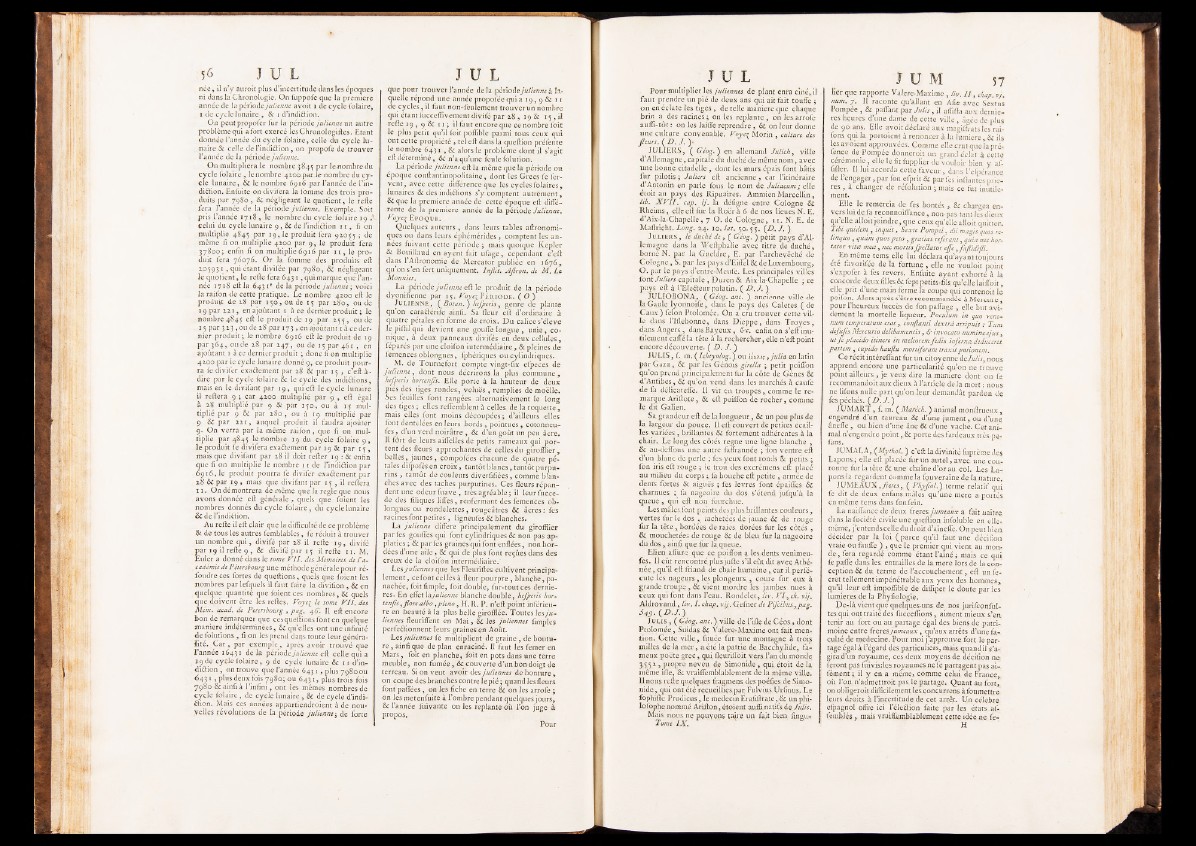
née, il n’y auroit plus d’incertitude dans les époques
ni dans la Chronologie. On fuppofe que la premiere
année de la période julienne avoit i de cycle folaire,
i de cycle lunaire , & i d’indi&ion.
On peut propofer fur la période julienne un autre
problème qui a fort exercé lesChronologiftes. Etant
donnée l’année du cycle folaire, celle du cycle lunaire
& celle de l’inaiftion, on propofe de trouver
l ’année de la période julienne.
On multipliera le nombre 3845 par lenombredu
cy cle folaire , le nombre 4200 pât-le* nombre du cy cle
lunaire, Si le nombre 6916 par l ’année de l’in—
diftion. Enfuite on divifera la fomme des trois produits
par 7980, Si négligeant le quotient, le relie
fera l’année de la période julienne. Exemple. Soit
pris l’année 1718 , le nombre du cycle folaire 19
celui du cycle lunaire 9 , & de l’indiélion 1 1 , fi on
multiplie 4845 par 19, le produit fera 91055 ; de
même fi on multiplie 4200 par 9 , le produit fera
37800 ; enfin fi on multiplie 6916 par 1 1 , le produit
fera 76076. Or la fomme des produits elt
20593 1 , qui étant divifée par 7980, Si négligeant
le quotient, le relie fera 6 431, qui marque que l’année
1718 ell la 643 Ie de la période julienne ; voici
la raifon de cette pratique. Le nombre 4200 ell le
produit de 28 par 150, ou de 15 par 280, ou de
19 par 221, enajoûtant 1 à ce dernier produit ; le
nombre 4845 ell le produit de 19 par 255, ou de
15 par 323 ,ou de 28 par 173 , en ajoûtant 1 à ce dernier
produit ; le nombre 6916 ell le produit de 19
par 364, ou de 28 par 247, ou de 15 par 461 , en
ajoutant 1 à ce dernier produit ; donc fi on multiplie
4200 par le cycle lunaire donné 9, ce produit pourra
fe divifer exaûement par 28 Si par 15 , c’eft à -
dire par le cycle folaire Si le cycle des indiétions,
mais en le divifant par 19 , qui ell le cycle lunaire
il reliera 9 ; car 4200 multiplié par 9 , cil égal
à 28 multiplié par 9 & par 150, ou à 15 multiplié
par 9 Si par 280 , ou à 19 multiplié par
9 Si par 2 21, auquel produit il faudra ajoûter
9. On verra par la même raifon, que fi on multiplie
par 4845 le nombre 19 du cycle folaire 9 ,
le produit fe divifera exaûement par 19 & par 15 ,
mais que divifant par 28 il doit relier 19 : & enfin
que fi on multiplie le nombre 11 de l’indiélion par
6916 ,1e produit pourra fe divifer exa&ement par
28 Si par 1 9 , mais que divifant par 15 , il reliera
1 1 . On démontrera de même que la regie que nous
avons donnée ell générale, quels que foient les
nombres donnés du cycle folaire, du cycle lunaire
Si de l’indiélion.
Au relie il ell clair que la difficulté de ce problème
& de tous les autres femfilables, fe réduit à trouver
un nombre q u i, divifé par 28 il relie 19 , divifé
par 19 il relie 9 , Si divifé par 15 il relie 1 1. M.
Euler a donné dans le tome VII. des Mémoires de l'académie
de Pétersbourg une méthode générale pour réfoudre
ces fortes de queftions, quels que foient les
nombres par lefquels il faut faire la divifion , Si en
quelque quantité que foient ces nombres, Si quels
que doivent être les reliés. Voye{ le tome VU. des
Ment. acad. de Pétersbourg, pag. 46'. Il ell encore
bon de remarquer que ces queftions font en quelque
maniéré indéterminées, Si qu’elles ont une infinité
de folutions , fi on les prend dans toute leur général
i t é .C a r , par exemple, après avoir trouvé que
l ’année 16431 de la périod0 julienne ell celle qui a
j 9 de cycle folaire, 9 de cycle lunaire & 11 d’in-
diftion , on trouve que l’année 6431, plus 7980 ou
6431 , plus deux fois 7980; ou 6431, plus trois fois
7980 & a in fià l ’infini, ont les mêmes nombres de
cycle folaire, de cycle lunaire , & de cycle d’indi-
âion. Mais ces années appartiendroient à de nouvelles
révolutions de la période julienne ; de forte
que pour trouver l’année delà période julienne à laquelle
répond une année propofée qui a 19, 9 & 11
de cy cles, il faut non-feulement trouver un nombre
qui étant fucceffivement divifé par 28 , 19 & 15 , il
refte 19 , 9 Si 11 ; il faut encore que ce nombre foit
le plus petit qu’il foit poffible parmi tous ceux qui
ont cette propriété , teleft dans la queftion préfente
le nombre 6431 , Si alors le problème dont il s’agit
eft déterminé, Si n’a qu’une feule folution.
La période julienne eft la même que la période ou
époque conftantinopoütaine, dont les Grecs fe fervent,
avec cette différence que les cycles folaires,
lunaires & des indiélions s’y comptent autrement,
& q u e la première année de cette époque eft différente
de la première année de la période Julienne.
Voye^ Epoq ue.
Quelques auteurs , dans leurs tables aftronomi-
ques ou dans leurs éphémérides, comptent les années
fuivant cette période ; mais quoique Kepler
& Bouillaud en ayent fait ufage, cependant c’eft
dans l’Aftronomie de Mercator publiée en 1676,
qu’on s ’en fert uniquement, lnjlit. Afiron. de M. Le
Monnier.
La période julienne eft le produit de la période
dyonifienne par 15. Voye^ PÉRIODE. ( O )
Julienne, ( Botan. ) hefperis, genre de plante
qu’on caraélérife aiçfi. Sa fleur eft d’ordinaire à
quatre pétales en forme de croix. Du calice s’élève
le piftil qui devient une gouffe longue, unie, conique
, à deux panneaux divifés en deux cellules,
féparés par une cloifon intermédiaire, & pleines de
femences oblongues, fphériques ou cylindriques.
M. de Tournefort compte vingt-fix elpeces de
julienne, dont nous décrirons la plus commune ,
hefptris honenfis. Elle porte à la hauteur de deux
piés des tiges rondes, velues ,'remplies de moelle.
Ses feuilles font rangées alternativement le long
des tiges ; elles reffemblent à celles de la roquette ,
mais elles font moins découpées; d’ailleurs elles
font dentelées en leurs bords, pointues , cotonneu-
fes, d un verd noirâtre , & d’un goût un peu âcre.
Il fôrt de leurs aiffelles de petits rameaux qui portent
des fleurs approchantes de celles du girofflier,
belles, jaunes, compofées chacune de quatre pétales
difpofés en croix, tantôt blancs, tantôt purpurins
, tantôt de couleurs diverfifiées, comme blanches
avec des taches purpurines. Ces fleurs répandent
une odeur fuave, très agréable ; il leurfucçe-
de des filiques liffes, renfermant des femences ôb-
longues ou rondelettes, rougeâtres Si âcres: fes
racines font petites, ligneufes Si blanches.
La julienne différé principalement du girofflier
par fes gouffes qui font cylindriques Si non pas app
u ie s ; Si par fes graines qui font enflées, non bordées
d’une aile, Si. qui de plus font reçues dans des
creux de la cloifon intermédiaire.’
Los juliennes que Jes Fleuriftès cultivent principalement,
ce font celles à fleur pourpre , blanche, panachée,
foit fimple, foit double, fur-tout ces dernières.
En effet lajulienne blanche double, hefptris hor-
tenfs, flore albo,pleno, H. R. P. n’eft point inférieure
en beauté à la plus belle girofflée. Toutes les ju liennes
fleuriffent en Mai, Si les juliennes Amples
perfectionnent leurs graines en Août.
Los juliennes fe multiplient de graine , de bouture
, ainfi que de plan enraciné. Il faut les femer en
Mars, foit en planche, foit en pots dans une terre
meuble, non fumée, & couverte d’un bon doigt de
terreau. Si on veut avoir des juliennes de bouture,
on coupe des branches contre le pié ; quand les fleurs
font paffées, on les fiche en terre Si on les arrofe ;
on les met enfuite à l ’ombre pendant quelques jours,
& l’année fuivante on les replante où Ton juge à
propos.
Pour
Pour multiplier les juliennes, de plant enra cihé,,iî
faut prendre un pié de deux ans qui ait fait touffe ;
on en éclate les tiges, de telle maniéré que chaque
brin a des racines ; on les replante , on les, arrpfe
auflî-tôt : on les laifle reprendre , & on leur donne
une culture convenable* Voye? Morin , culture des
fleurs. ( D . J. )-
JULIERS, ( G éog. ) en allemand Julicli, ville
d’Allemagne, capitale du duché de même nom, avec
une bonne citadelle , dont les murs épais font bâtis
fur pilotis ; Juliers eft ancienne, car l’itinéraire
d’Antonin en parle fous, le nom de Juliacum • elle
étoit au pays des Ripuaires. Ammien M arcellin,
lib. X V I I . cap.. ïj. la défigne entre Cologne Si
Rheims., elle eft fur la Roërà 6 de nos lieues N. E.
d’Aix-la-Chapelle, 7 O. de Cologne, 11. N. E. de
Maftricht. Long. 24. 10. lat. 50,. 55. (JD.. J. ),
Ju l ie r s , le duché d e , ( G.éog. ) petit pays d’Allemagne
dans la ’Weftphalie avec titre de duché,
borné N. par la Gueldre, E. par l’archevêc.hé de
Cologne, S. par les. pays d’Eiffel Si de Luxembourg,
O . par le pays d’entre-Meufe. Les principales villes
font Juliers capitale , Duren & Aix-la-Chapelle ; ce
pays eft à l’Ele&eur- palatin. ( D.. J. )
JULIOBONA, ( G éog. anc. ). ancienne ville de
la Gaule lyortnoife ; dans le pays, des Caletes. f de
C au x ) félon Ptolomée. On a cru trouver cette ville
dans Plflebonne, dans Dieppe, dans Tro y e s ,
dans Angers, , dansBaycux, &c. enfin on s’eft inutilement
cafte la tête à la rechercher, elle n’eft point
encore découverte. ( D . J.')
JUL1S., f. m. ( Iqjityolog. j ou ijuXiç, julia en latin
par G aza, Si par les Génois girella ; petit poiflon
qu’on prend principalement fur la côte de G.enes Si
d’Antibes, Si qu’on vend dans les marchés à caufe
de fa déliçarefte. Il vit en troupes, comme le remarque
Ariftote, & eft poiflon de rocher, comme
le dit Galien,
Sa grandeur eft de la longueur, Si un peu plus de
la largeur du pouce. II. eft-couvert de petites écailles
variées., brillantes Si fortement adhérentes à la
chair. Le long des côtés régné une ligne blanche ,
Si au-deflbus. une autre faffrannée » fon ventre eft
d’un blanc d.e perle ; fes yeux font ronds Si petits ;
fon iris eft rouge ; le trou des excrémens. eft placé
au milieu du corps ; fa bouçhe eft petite , armée de
dents fortes Si aiguës ; fes levres font épailles Si
charnues, ; fa nageoire du dos s’étend jufqu’à la
queue , qui eft non. fourchue.
Les rnâles.font peints, des plus,brûlantes couleurs,
vertes fur le dos , tachetées, de jaune Si de rouge
fur la tête ,. bordées de raies, dorées fur les côtés ,
Si mouchetées de rouge Si de bleu fur la nageoire
du dos, ainfi, que fur la, queue.
Elien, afl'ure que ce poiflon a les. dents venimeu-
fes. 11 eut rencontré, plusjufte s’il efit dit avqç Athén
é e , qu’il eft friand de chair humaine, çar il perfé-
cute les nageurs, les plongeurs , coure fur eux à
grande troupe , Si vient mordre les jambes nues à
ceux qui font dans l’eau. Rondelet, Ijv. VIyc)i, v.ij|
Aldroyand, liv. I. chap, yij,. Gefner de Pifcibuf..pag.
34 c , . (D . J . )
J u n s , ( Géog. anc.. ), ville de l’ifle de Céqs,,dont
Ptolomée, Suidas Si Valere-Maxime ont fait mention.
Cette ville , fituée fur une montagne à trois
milles de la mer, a été la patrie de Bacchylide, fàr
meux pocte grec, qui fleurifloit vers. l’an, du,monde
3.5,5 2 , propre neveu de Simonide , qui, étoit de la
meme ille, Si vraiflemblablement delà même ville-.
U nous refte quelques fragment des poéfie.s dç Simonide
, qui ont été recueillies,par Fulvius, Vrfinus,. Le
fophifte Prodicus, le médecin Erafiftrat.e ,.Ô£ un phi-
lolbphenpmmé Arifton,étoient auflinatifs.de Ju/is.
Mais nous ne pouvons taire un fait bien, fingu-
Torne IX .
lie* que rapporte Valere-Maxime, AV. i l , chap. vj.
nUTii. y,. ^Il raconte qu allant en AJic avec Sex-tus
Pompée , & paffant par M i s , il affifla aux dernières
heures, d’une dame de cette v ille , âgée de plus
de 90 ans. Çlle avoir déclare aux magiftrats les rai-
fons qui la portqient à renoncer à la lumière, 8c ils
les avaient approuvées. Comme elle crut que la pré-
fence de Pompée donneroit un grand éclat à cette
cérémonie,, elle le fit fuppliqr de vouloir bien y n[-
fifer. Il lui accorda cette faveur,, dans, l’efpérançe
de l’engager, par fon efprir & par fes inftantes prière,
s., à changer de réi'olution ; mais ce fut mutile-
ment.
Elle le remercia de fes bontés, Si chargea envers
lui de,fa reconnoifîance, non-pas tant les dieux
qu’elle alloit joindre, que ceux qu’elle alloit quitter.
Tib.i quidem. , inquit, S ex te Pompei, dii magjs. qu,os re-
linquo, quam quos peto , grattas référant 5 quia nec hor-
tator vitee mece, nec mords fpeclator ejfe yfaflidifli.
' En meme tems elle lui déclara.qu’ayant toujours
cte fayonfee de la fortune, elle ne vouloir point
s’expofer à fes revers. Enfuite ayant exhorté à la
concorde deux filles Si fept petitSrfils qu’elle laiffoit,
elle prit d’une main ferme la coupe qui contenoit le
poifon. Alors après s’être recommandée à Mercure ,
pour l’heureux fuccès de fon paflage , elle but avidement
la mortelle liqueur. Poculum in quo v.ene-
num temperatum erat, confland dextrâ arripuit : Tum
defufis Mercurio delibamentis , 6’ invocato numineejus ,
utjeplacido idnere in melioretnftdis inferntzdeduceret
partent, cupido haufiu mordferam traxit podonem.
Ce récit intéreffant fur un citoyenne deJulis, nous
apprend encore une particularité qu’on ne trouve
point ailleurs , je veux dire la maniéré dont on fe
recommandoitaux dieux à l’article delà mort : nous
ne lifons nulle, part qu’on.leur demandât pardon de
fes péchés. ( D . J. )
JUMART, f. m. ( Maréch.') animal monftrueux,
engendré d’un taureau Si d’une jument, ou d’une
ânefle , ou bien d’une âne Si d’une vache. Cet animal
n’engendre point, Si porte des fardeaux très-pe-
fans.
JUMALA, (My.th.ol;, ) c’eft la divinité fuprème des
Lapons; elle eft placée fur un autel, avec une couronne
fur la tête Si une chaîne d’or au col. Les La--
pons. la regardent comme la fçmveraine de. la nature.
JUMEAUX ^frères, f Phyfiol.') terme relatif qui
fe dit de deux enfans mâles qu’une mere a portés
en même tems dans fonfein.
La naiflance de deux freres jumeaux a fait naître,
dans.la fociété civile une queftion infoluble en elle-,
même, j’entendscelle du droit d’aîneflè. On peut bien
décider par la loi ( parce qu’il faut une déçifion
vraie ou faufte ) ,, que le premier qui vient au mondée,
fera regardé comme étant l’aîné ; mais ce qui
fe pafle dans les entrajlles.de la mere lors de la conception
Si du terme de l’accouchement, eft un fç-
cret tellement impénétrable aux yeux des hommes»
qu’il leur eft impoffible de difliper le doute par les
lumières de la Phyfiologie.
De-.là vient que quelques-uns de nos jurifconful-
tes qui ont traité des fücceffions, aiment mieux s’en
tenir au fort ou au partage égal des biens de pat ri-,
moine entre freres jumeaux, qu’aux arrêts d’une fa-,
çulté de médecine. Pour moi j ’approuve fort le partage
égal à l’égard des particuliers, mais, quand.il s’a-
gira d’un royaume, c,es deux moyens de déçifion no
lèroni; pas. fuivis:les royaumes.ne fi? partagent pas ai-
fément ;, il y en a même» comme celui de France,
où l’oti n’a.dmettrojt pas. le partage* Quant a,u fort,
on obligeroif difficilement les conçurrens à foumettre
leurs droits à l’incertitude de cet arrêt. IJn. célébré
efpagnol offre ici l’éleQion faite par les états, af-
femblçs, mais vraiftèmblablement cette idée ne fe-
H