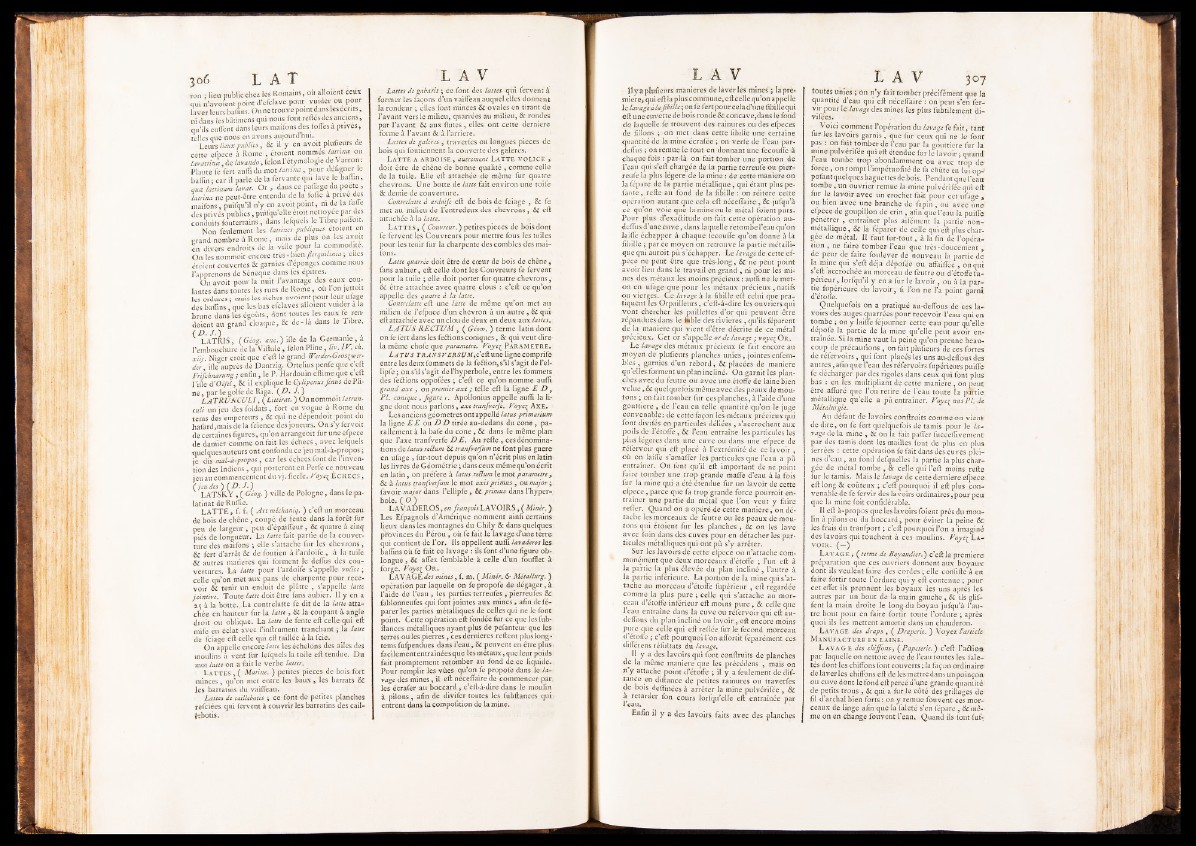
ron : lieu public chez les Romains, où aboient ceux
qui nVwoient point d’efclave pour vmder ou pour
laver leurs baffins. On ne trouve point dansles écrits,
ni dans iesbâtimens qui nous font relies des anciens,
qu’ils euffent dans leurs maifons des foffes à prives,
telles que nous en avons aujourd’hui.
Leurs lieux publics j ’.&t il y en avoit plufieurs de
cette efpece à Rome , étoient nommés lairmce ou
lavatrinoe, de Inxnnio, félon l’étymologie de Varron :
Plaute fe fert aufli du mot lu t in e , pour défigner le
badin : car il parle de la fervante qui lave le badin,
nue latniuauh-vat. Or , idàns ce paffage du poete ,
UiLrïna ne peut-être entendu de la foffe à prtvedes
maifons, puifqu’il n’y en avoit point, ni de la foffe
des privés 'publies, puifqu’elle étoit nettoyée par des
conduits fouterrains, dans lefqnels le Tibre paffoit.
Non feulement les latrines publiques etolent en
grand nombre à RoméI mais de plus on .les avoir
lu divers endroits de la ville pour la commodité.
Onles nommoit encore très - bien flajulima ; elles
étoient couvertes & garnies d’éponges,comme nous
l’apprenons de Séne'que dans les epitres, ;
On avoir pour la nuit l’avantage des eauxïieour
lantes dans toutes les rues de Rome , où 1 on jeîtoit
les ordures ; mais les riches avaient pour leur ufage
des baffins, que les bas efclaves alloient vmder a la
brune dans les cgoitts, dont toutes les eaux le rem
doient au grand cloaque, & de - là dans le Tibre.
( D . J . ) . x
LATRIS, (Géog. anc.) ifle de la Germanie, à
l’embouchure de la Viftule, félon Pline, liv. IV. ch.
xiij. Niger croit que c’eft le grand IFerder-Gros^wer-
der, ifle auprès de Dantzig. Ortelius penfe que c’eft
Frifchnarung; enfin, le P. Hardouin eftime que c’efl:
l ’ifle d’OëJ'el, & il explique le Cylipmus Jînus de Pline,
par le golfe de Riga. ( D . J.')
LATRUJJCULI, ( Littèrat. ) On nommoit latrun-
culi un jeu des foldats , fort en vogue à Rome du
tems des empereurs , & qui ne dépendoit point du
hafard,mais de la feienoe des joueurs. On s’y fervoit
de certaines figures, qu’on arrangeoit fur une efpece
de damier comme on fait les échecs, avec lefquels
quelques auteurs ont confondu ce jeu mal-à-propos ;
je dis mal-à-propos, car les échecs font de l’invention
des Indiens , qui portèrent en Perfe ce nouveau
jeu au commencement du vj. fiecle. Voyt^ Échecs ,
( jeu des') (D .J .') , , t
LATSK.Y , ( Géog. ) ville de Pologne, dans le palatinat
de Ruffie.
LA T T E , f. f . ( A n méchaniq. ) c’efl: un morceau
de bois de chêne, coupé de fente dans la forêt fur
peu de largeur , peu d’épaiffeur , & quatre à cinq
piés de longueur. La latte fait partie de la couverture
des maifons ; elle s’attache fur les chevrons,
& fert d’arrêt & de foutien à l’ardoife , à la tuile
& autres matières qui forment le deflus des cou^
vertures. La latte pour l’ardoife s’appelle volice ;
celle qu’on met aux pans de charpente pour recevoir
& tenir un enduit de plâtre , s’appelle Latte
jointive. Toute latte doit être fans aubier. Il y en a
25 à la botte., La contrelatte fe dit de la latte attachée
en hauteur fur la latte , & la coupant à angle
droit ou oblique. La latte de fente eft celle qui eft
mife en éclat avec l’inftrument tranchant ; la latte
de feiage eft celle qui eft taillée à la feie.
On appelle encore latte les échelons des ailes des
moulins à vent fur lefquels la toile eft tendue. Du
mot latte on a fait le verbe lutter. ^
L a t t e s , . ( Marine. ) petites pièces de bois fort
minces , qu’on met entre, les baux , les bar rats &
les barratins du vaifleâu., ■ •-
Lattes de caillebotis ; ce font de petites planches
refeiées qui fervent à couvrir les barratins des cail-
iebotis.
Lattes de gabarit ; ce-font des lattes qui fervent à
former les façons d’un vaiffeau auquel elles donnent
la rondeur ; elles font minces & ovales en tirant de
l’avant vers le milieu, quarrées au milieu, & rondes
par l’avant & aux flûtes , elles ont cette derniere
forme à l’avant & à l’arriere.
Lattes de galères , traverses ou longues pièces de
bois qui foutiennent la couverte des gàleres.
Latte a ardoise, autrement Latte volice ,
doit être de chêne de bonne qualité , comme celle
de la tuile. Elle eft attachée de même fur quatre
chevrons. Une botte de latte fait environ une toife
& demie de couverture.
Contrelatte à ardoife eft de bois de feiage , & fe
met au milieu de l’entredeux des chevrons, & eft
attachée à la latte.
Lattes , ( Couvreur. ) petites pièces de bois dont
fe fervent les Couvreurs pour mettre fous les tuiles
pour les tenir fur la charpente des combles des mai-
fons.
Latte quarrèe doit être de coeur de bois de chêne,
fans aubier, eft celle dont les Couvreurs fe fervent
pour la tuile ; elle doit porter fur quatre chevrons ,■
&c être attachée avec quatre clous : c’eft ce qu’on
appelle des quatre à la latte.
Contrelatte eft une latte de même qu’on met au
milieu de l’efpace d’un chevron à un autre, & qui
eft attachée avec un clou de deux en deux aux lattes.
LATUS R E C TUM , ( Gèom. ) terme latin dont
on fe fert dans les feftions coniques, & qui veut dire-
la même chofe que paramétré. Foye[ Paramétré.
L a t u s t r a n s v e r s uMjC’qH une ligne comprife
entre les deuxfommets de la feûion, s’il s’agit de l’el-
lipfe ou s’il s’agit de l’hyperbole, entre les fommets
des ferions oppofées ; c’eft ce qu’on nomme aufli
grand axe , ou premier axe ; telle eft la ligne E D ,
PI. conique, figure ». Apollonius appelle aufli la ligne
dont nous parlons, axe tranfverfe. Foye[ Axe. ■
Les anciens géomètres ont appellé latus primarium
la ligne E E ou D D tirée au-dedans du cône , pa-
rallement à la bafe du cône, & dans le même plan,
que l’axe tranfverfe D E . Au refte , ces dénominations
de latus rectum & tranfverfum ne font plus guere
en ufage , fur-tout depuis qu’on n’écrit plus en latin
les livres de Géométrie ; dans ceux même qu’on écrit,
en latin, on préféré à latus rectum le mot paramétré ,
& à latus tranfverfum le mot axisprimus, ou major ;
favoir major dans l’ellipfe, & primus dans l’hyperbole.
( O )
LAVADEROS, en françois LAV OIRS, ( Miner. )
Les Efpagnols d’Amérique nomment ainû certains
lieux dans les montagnes du Chily & dans quelques
pfovinces du Pérou , oii fe fait le lavage d’une terre
qui contient de l’or. Ils appellent aufli lavaderos les
baffins où fe fait ce lavage : ils font d’une figure ob-
longue, & aflez femblable à celle d’un foufflet à
forge. Voye^ Or .
LAVAGE des mines, f. m. ( Miner. & Métallurg. )
opération par laquelle on fe propofe de dégager, à
l’aide de l’eau , les parties terreufes , pierreufes &
fablonneufes qui font jointes aux mines, afin de fé-
parer les parties métalliques de celles qui ne le font
point. Cette opération eft fondée fur ce que les fub-
ftances métalliques ayant plus de pefanteur que les
terres ouïes pierres, ces dernieres reftent plus long-
tems fufpendues dans l’eau, & peuvent en être plus.
facilement entraînées que les métaux, que leur poids
fait promptement retomber au fond de ce liquide. ;
Pour remplir les vues qu’on fe propofe dans le Az-
vage des mines, il eft néceflaire de commencer par,
les écrafer au boccard , c’eft-à-dire dans le moulin
à pilons, afin de divifer toutes les fubftancès quL
entrent dans la compofition de la minç.
î î y a plufieurs maniérés de laver lés mines'; îaprè4
miere, qui eft la plus commune* eft celle qu’on appelle
le lavage à la fibille ; on fe fert pour cela d’une fibille qui
eft une cuvette de-bois ronde&concave,dans le fond
de laquelle fe trouvent des rainures ou desefpeces
de filions ; on met dans> eetre fibille une certaine
quantité de la:mine écrafée ; on verfe de l’eau par-
deflus ; on remue le tout en donnant une fecoufle -à
chaque fois : par-là on fait tomber une portion dé
l’eau qui s’eft chargée de la partie terreufe ou pier-
reufe la plus légère de la mine : de cette manière on
la fépare de la partie métallique, qui étant plus pe-
fante, refte au fond de la fibille : on réitéré cette
opération autant que cela, eft néceflaire , & jufqu’à
ce qu’on, voie que la mine ou le métal foientpurs.
•Pour plus d’exaâitude on fait cette opération au-
deflus.d’une cu v e , dans laquelle retombe l’eau qu’on
faille échapper à .chaque;fecoufle qu’on donne à la
fibille ; par ce moyen on retrouve la partie métallique
qui auroit pû s ’échapper. Le lavage dè-cette ef-
.pece ne peut être que très-long, & ne peut point
avoir lieu dans le travail en grand , ni pour lès mines
des métaux les moins précieux : auffi nefe met-
on en ufage1 que pour les métaux précieux, natifs
ou vierges. Qo lavage à la fibille.eft celui que pratiquent
les Orpailleurs, e’eft-àr’dire les ouvriers qui
.vont chercher les paillettesld’or qui peuvent être
répandues dans le Able des rivières , qu’ils féparent
de la manière qui vient d’être décrite de ce métal
précieux. Cet or s’appelle or de lavage ; voye{ O r.
Le lavage des métaux précieux fe fait encore au
moyen de plufieurs planches unies, jointes enfem-
bles , garnies, d’un rebord, & placées de maniéré
quelles forment un plan incliné. On garnit les planches
avec du feutre ou avec une'étoffe de laine bien
velue, & quelquefois même avec des peaux de moutons
; on fait tomber fur ces planches, à l’aide d’une
gouttière , de l’eau en telle quantité qu’on le juge
convenable: de cette façon les métaux précieux qui
font divifés en particules déliées , s’accrochent aux
poils de l’étoffe, & l’eau entraîne les particules les
plus légères clans une cuve ou dans une efpece de
réfervoir.qui eft placé à l’extrémité de ce lavoir ,
où on Iaifle s’amaffer les particules que l’eau a pû
entraîner. On lent qu’il eft important de né point
faire tomber une trop grande mafîe d’eau à la fois
fur la mine qui a été étendue fur un lavoir de cette
efpece, parce que fa trop grande force pourroit entraîner
une partie du métal que l’on veut y faire
refter. Quand on a opéré de cette maniéré, on détache
les morceaux de feutre ou les peaux de moutons
qui étoient fur les planches , & on les lave
avec loin dans des cuves pour en détacher les particules
métalliques qui ont pû s’y arrêter.
Sur les lavoirs de cette efpece on n’attache com-
munémènt que deux morceaux d’étoffe ; l’un eft à
la partie la plus élevée du plan incliné , l’autre à
la partie inférieure. La portion de la mine qui s’attache
au morceau d’étoffe fupérieur , eft regardée
comme la plus pure ; celle qui s’attache au morceau
d’étoffe inférieur eft moins pure, & celle que
l’eau entraîne dans la cuve ou réfervoir qui eft au-
deffous du plan incliné ou lavoir., eft encore moins
pure que celle qui eft reliée fur le fécond morceau
d étoffé ; c’eft pourquoi l ’on affortit féparément ces
différens réfultats du lavage.
Il y a des lavoirs qui font conftruits de planches
de la même maniéré que les précédens , mais on
n’y attache point d’étoffe ; il y a feulement de dif-
tance en diftance de petites rainures ou traverfes
de bois deftinées à arrêter la mine pulvérifée , &
à retarder fon cours lorfqu’elle eft entraînée par
1 eau.
Enfin il y a des lavoirs faits avec des planches
tôiités ttnîes ; ôn n’y fait tomber précifémeht que la
quantité d’eau qui eft néceflaire : on peut s’en fer-
vir pour lé lavage des mines les plus fubtilement di-
vifées.
Voici comment l’opération du lavage fe fait, tant
fur les -lavoirs garnis, que fur ceux qui ne le font
pas»: on fait tomber de l’eau par la gouttière fur la
mine pulvérifée qui eft étendue fur le lavoir ; qûand
l’eau tombe trop abondamment ou avec trop de
force, on rompt rimpétüofité de fa chûte en lui op-*
pofant quelques baguettes de bois. Pendant que l’eau
tombe, un ouvrier remue la mine pulvérifée qui eft
fur le- lavoir avec un crochet fait pour cet ufage %
ou bien avec une branche de fapin, ou avec une
efpece de goupillon de crin , afin que l’eau la puiffe
pénétrer , entraîner plus aifément la partie'«non-
métallique , & la féparer dé celle qui eft plus chargée
de métal. Il faut fur-tout, à la fin de l’opération
, ne faire tomber l’eau que très-doucement ,
de peur de faire foulever de nouveau la partie de
la mine qui s’eft déjà dépoféè ou affaiflee-, ou qui
s’eft accrochée au morceau de feutre ou d’étoffe fu-
périeur, lorfqu’il y en a fur le lavoir, ou à la partie
fuperieiire du lavoir, fi l’on ne l’a point garni
d’étoffe.
Quelquefois on a pratiqué au-defîous de ces lavoirs
des auges quarrées pour recevoir l’eau qui en
tombe ; on y Iaifle féjourner cette eau pour qu’ellè
depofe la partie de la mine qu’elle peut avoir entraînée.
Si la mine vaut la peine qu’on prenne beaucoup
de précautions , on fait plufieurs de ces fortes
de réfervoirs, qui font placés les uns au-deflbu.s des
autres, afin que l’eau des réfervoirs fupérieurs puiffe
fe décharger par des rigoles dans ceux qui font plus
bas : en les multipliant de cette maniéré , on peut
être affuré que l’on retire de l’eau toute la pfltie,
métallique qu’elle a pu entraîner. Voye^ nos PI: de
Mètalufgie.
Au defaut de lavoirs conftruits comme on vient
de dire, on fe fert quelquefois de tamià pour le lavage
de la mine , & on la fait paffer fuccefîivement
par des tamis dont les mailles font de plus en plus
ferrées : cette opération fe fait dans des cuves pleines
d’eau, au fond defquelles la partie la plus chargée
de métal tombe , & celle qui l’eft moins refte
lur le tamis. Mais le lavage de cette derniere efpece.
eft long & coûteux ; c’eft pourquoi il eft plus convenable
de fe fervir des lavoirs ordinaires,pour peu
que la mine foit confidérable.
Il eft à-propos que les lavoirs foient près du moulin
à pilons ou du boccard, pour éviter la peine &
les frais du tranfport ; c’eft pourquoi l’on a imaginé
des lavoirs qui touchent à ces moulins. Voye{ La-
yoiR. (—)
Lavage , ( terme de Boyaudier.') c’eft la première
préparation que ces ouvriers donnent aux boyaux
dont ils veulent faire des cordes ; elle confifte à en
faire fortir toute l’ordure qui y eft contenue ; pour
cet effet ils prennent les boyaux les uns apres les
autres pair un bout de la main gauche , & ils glif-
fent la main droite le long du boyau jufqu’à l’autre
bout pour en faire fortir toute l’ordure ; après
quoi ils les mettent amortir dans un chauderon.
Lavage des draps , ( Draperie. ) Voyez tarticle
Manufacture en laine.
L a v a g e des chiffons, ( Papeterie.) c’eft l’aâion
par laquelle on nettoie avec de l’eau toutes les fale-
tes dont les chiffons font couverts ; la façon ordinaire
de laver les chiffons eft de les mettre dans un poinçon
ou cuve dont le fond eft percé d’une grande quantité
de petits trous , & qui a fur le côté des grillages de
fil d’archal bien forts : on y remue fouvent ces morceaux
de linge afin que la faleté s’en fépare , & même
on en change fouvent l’eau. Quand ils font fuf;