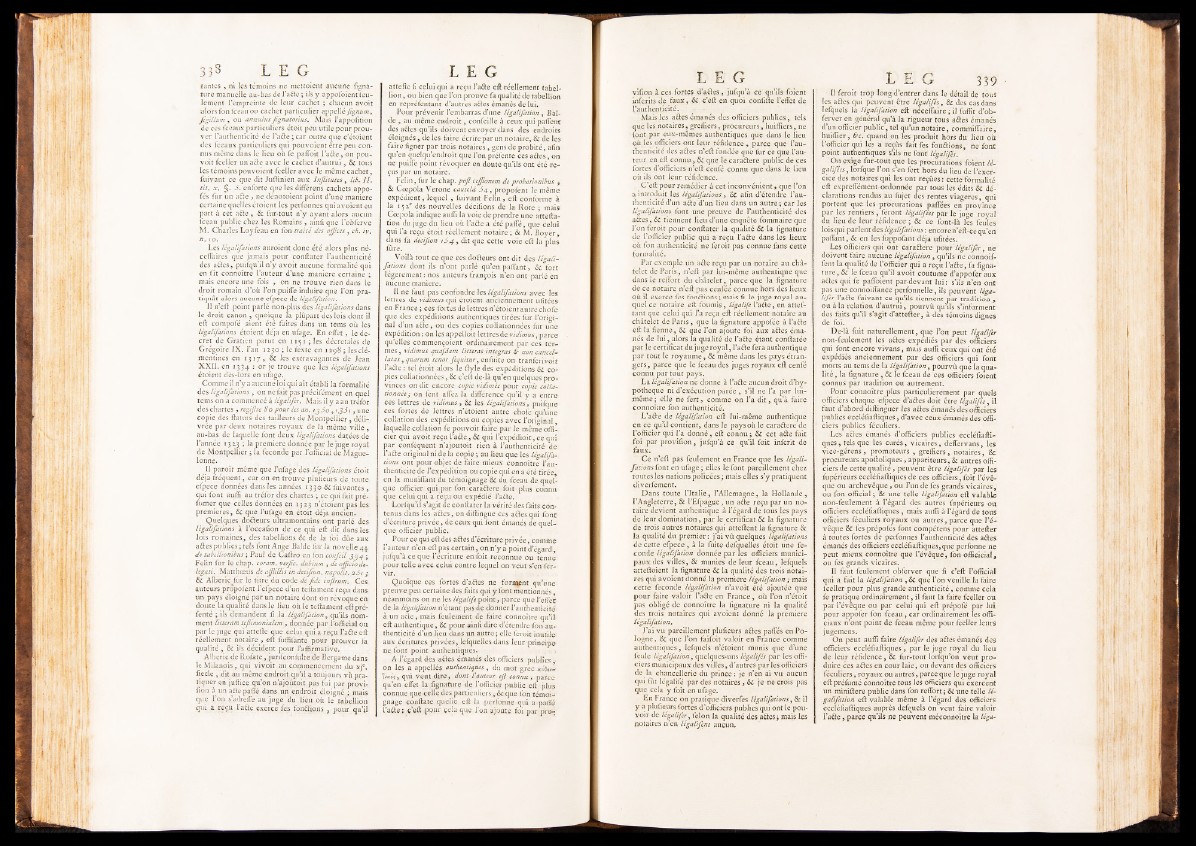
3?S L E G
tantes , ni les témoins ne mettoient aucune figna-
ture manuelle au-bas de l’aâ e ; ils y appofoient feu-
lement l’empreinte de leur cachet ; chacun avoit
alors fon fceau ou cachet particulier appelle jignum,
Jigillum , ou annulusJîgnatorius. Mais l’appofition
de ces fceaux particuliers étoit peu utile pour prouver
l’authenticitc de l ’aâe ; car outre que c’étoient
des fceaux particuliers qui pouvoient être peu connus
même dans le lieu où fe pàffoit l ’a â e , on pou-
voit fceller un aâe avec le cachet d’autrui, & tous
les témoins pouvoient fceller avec le même cachet,
fuivant ce que dit Juftinien aux Inftitutes, lib. II.
tit. x. § . 5. enforte que les différens cachets appo-
fés fur un a â e , ne dénotoient point d’une maniéré
certaine quelles étoient les perfonnes qui avoient eu
part à cet aüe , & fur-tout n’y ayant alors aucun
fceau public chez les Romains , ainfi que l’obferve
M. Charles Loyfeau en fon traité des offices, ch. iv.
n. io.
Les lègalifations auroient donc été alors plus né-
ceflaires que jamais pour conftater l’authenticité
des a de s, .puifqu’il n’y avoit aucune formalité qui
en fît connoître l’auteur d’une maniéré certaine ;
mais encore une fois , on ne trouve rien dans le
droit romain d ’où l’on puiffe induire que l’on pratiquât
alors aucune efpece de légalifacion.
Il n’eft point parlé non-plus des Lègalifations dans
le droit canon , quoique la plupart des lois dont il
eft compofé aient été faites dans un tems où les
lègalifations étoient déjà en ufage. En effet, le decret
de Gratien parut en 1 1 51 ; les décrétales de
Grégoire IX. l’an 1230 ; le fexte en 1298 ; les clémentines
en 1 3 1 7 , & les extravagantes de Jean
XXII. en 13 34 : or je trouve que les lègalifations
étoient dès-lors en ufage.
Comme il n’y a aucune loi qui ait établi la formalité
des lègalifations , on ne fait pasprécifément en quel
tems on a commencé à légalifer. Mais il y a au trefor
des chartes , regifre 8o pour les an. t j J o , / j~Si, une
copie des ftaturs des tailleurs de Montpellier, délivrée
par deux notaires royaux de la même ville
au-bas de laquelle font deux lègalifations datées de
l’année 1323 ; la première donnée par le juge royal
de Montpellier ; la fécondé par l’officiai de Mague-
lonne.
Il paroît même que l’nfage des lègalifations étoit
déjà fréquent, car on en trouve plufieurs de toute
efpece données dans les années 1330 & fuivantes
qui font auiïi au tréfor des chartes ; ce qui fait pré-
lumer que celles données en 13 23 n’étoient pas.les
premières, &c que l’ufage en étoit déjà ancien.
Quelques doâeurs ultramontains ont parlé des
lègalifations à l’occafion de ce qui eft dit dans les
lois romaines, des tabellions & de la foi due aux
aâes publics ; tels font Ange Balde fur la novelle 44,
de tabellionibus ; Paul de Caftro en fon confeil Jcj/f. ;
Félin fur le chap. coram. vcrfic. dubium , de officio de-
legati. Matthoeus de ajfliclis in decifion. napolit. 2S1 ;
& Alberic fur le titre du code de fide injlrum. Ces
auteurs propofent l’efpece d’un teftament reçu dans
un pays éloigné par un notaire dont on révoque en
doute la qualité dans le lieu où le teftament eftpré-
fenté ; ils demandent fi .la lègalifation, qu’ils nomment
litteram tefimonialem , donnée par l ’official ou
par le juge qui attefte que celui qui a reçu l’aâe eft
réellement notaire , eft fuffifante pour prouver fa
qualité , & ils décident pour l’affirmative.
Aiberic de Rofate, jurifconfulte de Bergame dans
le Milanois, qui vivoit au commencement du xje.
fiecle ,.dit au même endroit qu’il a toujours vu pratiquer
en juftice qu’on n’ajoutait pas foi par provision
à un aâe paffé dans.un endroit éloigné ; mais
que l’on s’adreffe au juge du .lieu-où le tabellion
qui a reçu l’aâe exerce fes fon&ions , pour qu’il
L E G
attefte fi celui qui a reçu l’aâ e eft réellement tabellion
, ou bien que l’on prouve fa qualité de tabellion
en repréfentant d’autres aâes émanés de lui.
Pour prévenir l’embarras d’une lègalifation, Balde
, au même endroit, confeille à ceux qui partent
des a êtes qu’ils doivent envoyer dans des endroits
éloignés , de les faire écrire par un notaire, & de les
faire ligner par trois notaires , gens de probité, afin
qu’en quelqu’endroit que l ’on préfente ces a â e s , on
ne puifle point révoquer en doute qu’ils ont été reçus
par un notaire.
Félin, fur le chap. pof ccfjionem de probationïbus ,
& Coepola Verone cautelâ 5 4 , propofent le même
expédient, lequel , fuivant Félin, eft conforme à
la 152e des nouvelles décifions de la Rote : mais
Coepola indique aufli la voie de prendre une attefta-
tion du juge du lieu où l’aâ e a été paffé, que celui
qui l’a reçu étoit réellement notaire; & M. Boyer,
dans fa dècijion 1 S 4 , dit que cette voie eft la plus
fûre.
Voilà tout ce que ces doâeurs ont dit des légali-
fations dont ils n’ont parlé qu’en partant, & fort
légèrement : nos auteurs françois n’en ont parlé en
aucune maniéré.
Il ne faut pas confondre les lègalifations avec les
lettres de vidimus qui étoient anciennement ufitée9
en France ; ces fortes de lettres n’étoient autre chofe
que des expéditions authentiques tirées fur l’original
d’un a â e , ou des copies collationnées fur une
expédition : on les appelloit lettres de vidimus, parce
qu’elles commençoient ordinairement par ces termes
, vidimus quafdam liitéras intégras & non cancel-
latas, quarum ténor fequitur, enfuite on tranfcrivoit
l’aâ e : tel étoit alors le ftyle des expéditions & copies
collationnées, & c’eft de-là qu’en quelques provinces
on dit encore copie vidimèe pour copie collationnée;
on fent a fiiez la différence qu’il y a entre
ces lettres de vidimus y & les lègalifations, puifque
ces fortes de lettres n’étoient autre chofe qu’une
collation des expéditions ou copies avec l’original,
laquelle collation fe pouvoit faire par le même officier
qui avoit reçu l’aâe., & qui l’expédioit, ce qui
par conféquent n’ajoutoit rien à l’authenticité de
l’aâ e original ni de la copie ; au lieu que les légalift-
dons ont pour objet de faire mieux connoître l’au-
thenticité de l’expédition ou copie qui en a été tirée,
en la muniflant du témoignage & du fceau de quelque
officier qui par fon caraâere foit plus connu
que celui qui a reçu ou expédié l’aâe.
Lorfqu’il s’agit de conftater la vérité des faits contenus
dans les a â e s , on diftingue ces aâes qui font
d’écriture privée, de ceux qui font émanés de quelque
officier public.
Pour ce qui eft des aâes d’écriture privée, comme
Fauteur n’en eft pas certain, on n’y a point d’égard,
jufqu’à ce que l’écriture en foit reconnue ou tenue
pour telle avec celui contre lequel on veut s’en fer-1
vir.
Quoique ces fortes d’aâes ne f o r i n t qu’une
preuve peu certaine des faits qui y font mentionnés,
néanmoins on ne les légalife point, parce que l’effet-
de la lègalifation n’étant pas de donner l’authenticité
à un a â e , mais feulement de faire connoître qu’il
eft authentique, & pour ainfi dire d’étendre fon authenticité
d’un lieu dans un autre ; elle feroit inutile'
aux écritures privées, lefquelles dans leur principe
ne. font point authentiques.
A l’égard des aâes émanés des officiers publics y
on les a appellés authentiques, du mot grec août/-1
hy.oç, qui Veut-dire, dont l'auteur e f connu, parce
qu’en effet la fignanire de l’officier public eft plus
connue que celle des particuliers, & que fon témoignage
conftate quelle eft la perfonne qui a paffé
l’aâe ; c’eft pour cela que l’on ajoute foi par pro-
L E G
vifion à ces fortes d’a â e s , jufqu’à ce qu’ils foient
inferits de faux, & c’eft en quoi confifté l’effet de
l’authenticité.
Mais les aâes émanés des officiers publics, tels
que les notaires, greffiers, procureurs., huiffiers, ne
font par eux-mêmes authentiques que dans le lieu
çù le s .officiers ont leur réfidence , parce que l’authenticité
des aâes n’eft fondée que fur ce que l’auteur
en eft connu, & que lé caraâere public de ces
fortes d’officiers n’eft cenfé connu que dans le lieu
où ils ont leur réfidence.
C ’eft pour remédier à cet inconvénient, que l’on
a introduit les lègalifations, & afin d’étendre l’authenticité
d’un aâe*d’un lieu dans un autre ; car les
lègalifations font une preuve de l’authenticité des
actes, & tiennent lieu d’une enquête fommaire que
l ’on feroit pour conftater la qualité & la fignature
de l’officier public qui a reçu l’aâ e dans les lieux
où fon authenticité ne feroit pas connue fans cette
formalité.
Par exemple un a â e reçu par un notaire au châtelet
de Paris, n’eft par lui-même authentique que
dans le reffort du châtelet, parce que la fignature
de ce notaire n’eft pas cenfée connue hors des lieux
où il exerce fes fonâions ; mais fi le juge royal auquel
ce notaire eft fournis, légalife l’a â e , en attestant
que celui qui l’a reçu eft réellement notaire au
châtelet de P aris, que la fignature appofée à l’aâ e
eft la fienne, & que l’on ajoute foi aux aâes émanés
de lui, alors la qualité de l’a â e étant conftatée
par le certificat du juge royal, l’aâ e fera authentique
par tout le royaume, & même dans les pays étrangers,
parce que le fceau des juges royaux eft cenfé
connu par tout pays.
La lègalifation ne donne à l’aâe aucun droit d’hypotheque
ni d’exécution parée , s’il ne l’a par lui-
même ; elle ne fert, comme on l’a d it , qu’à faire
connoître fon authenticité.
L ’a â e de lègalifation eft lui-même authentique
en ce qu’il contient, dans le pays où le caraâere de
l’officier qui l’a donné, eft connu ; & cet a â e fait
foi par provifioh, jufqu’à ce qu’il foit inferit de
faux.
Ce n’eft pas feulement en France que les lègalifations
font en ufage ; elles le font pareillement chez
toutes les nations policées ; mais elles s’y pratiquent
diverfement.
Dans toute l’Italie, l’Allemagne, la Hollande,
l ’Angleterre, & l’Efpagae, un aâe reçu par un notaire
devient authentique à l’égard de tous les pays
de leur domination, par le certificat & la fignature
de trois autres notaires qui attellent la fignature &
la qualité du premier : j’ai vil quelques lègalifations
de cette efpece, à la fuite defquelles étoit une fécondé
lègalifation donnée par les officiers municipaux
des villes, & munies de leur fceau, lefquels
atteftoient la fignature & la qualité des trois notai-.
res qui avoient donné la première lègalifation; mais
cette fécondé lègalifation n’avoit été ajoutée que
pour faire valoir l’aâ e en France, où l’on n’étoit
pas obligé de connoître la fignature ni la qualité
des trois notaires qui avoient donné la première
lègalifation.
J’ai vu pareillement plufieurs aâes partes en Pologne
, & que l’on faifoit valoir en France comme
authentiques, lefquels n’étoient munis que d’une
feule lègalifation, quelques-uns lègalifès par les officiers
municipaux des villes, d’autres par les officiers
de la chancellerie du prince : je n’en ai vu aucun
qui fût légalifé par des notaires , & je ne crois pas
que cela y foit en ufage.
En France on pratique diverfes lègalifations, & il
y a plufieurs fortes d ’officiers publics qui ont le pouvoir
de légalifer, félon la qualité des aâes; mais les
notaires n’en lègalifent aucun.
L E G 339
II feroit trop long d’entrer dans le détail de tous
les aâes qui peuvent être lègalifès, & des cas dans
lefquels la lègalifation eft néceffaire ; il fuffit d’ob-
ferver en général qu’à la rigueur tous aâes émanés
d’un officier public, tel qu’un notaire, commiffaire,
huirtier, &c. quand on les produit hors du lieu où
l ’officier qui les a reçus fait fes fonâions, he font
point authentiques s’ ils ne font lègalifès.
On exige fur-tout-que les procurations foient lè-
galifèes, lorfque l’on s’en fert hors du lieu de l’exercice
des notaires qui les ont reçûes : cette formalité
eft expreffément ordonnée par tous les édits & déclarations
rendus au fujet des rentes viagères, qui
portent que les procurations paffées en province
par les rentiers , feront lègalifies par le juge royal
du lieu de leur réfidence ; & ce font-là les feules
lois qui parlent des lègalifations : encore n’eft-ce qu’en
partant, & en les fuppofant déjà ufitées.
Les officiers qui ont caraâere pour 'légalifer > ne
doivent faire aucune lègalifation y qu’ils ne connoif-
fent la qualité de l’officier qui a reçu l ’a â e , fa fignature
, & le fceau qu’il avoit coutume d’appofer aux
aâes qui fe paffoient par-devant lui: s’ils n’en ont
pas une connoiffance perfonnelle, ils peuvent légalifer
l’aâ e fuivant ce qu’ils tiennent par tradition ,
ou à la relation d’autrui, pourvû qu’ils s’informent
des faits qu’il s’agit d’attefter, à des témoins dignes
de foi.
De-là fuit naturellement, que l’on peut légalifer
non-feulement les aâes expédiés par des officiers
qui font encore vivans, mais aufli ceux qui ont été
expédiés anciennement par des officiers qui font
morts au tems de la lègalifation, pourvû que la qualité
, la fignature, & le fceau de ces officiers foient
connus par tradition ou autrement.
Pour connoître plus particulièrement par quels
officiers chaque efpece d’aâes doit être légalise, il
faut d’abord diftinguer les aâes émanés des officiers
publics eccléfiaftiques, d’avec ceux émanés des officiers
publics féculiers.
Les aâes émanés d’officiers publics eccléfiaftiques
, tels que les curés, vicaires, deffervans, les
vice-gérens, promoteurs , greffiers, notaires, &:
procureurs apoftoliques, appariteurs, & autres officiers
de cette qualité, peuvent être lègalifès par les
fupérieurs eccléfiaftiques de ces officiers, foit l’évêque
ou archevêque , ou l’un dé fes grands vicaires,
ou fon official; & une telle lègalifation eft valable
non-feulement à l’égard des autres fupérieurs ou
officiers eccléfiaftiques , mais aufli à l’égàrd de tous
officiers féculiers royaux ou autres, parce que l’évêque
& fes prépofés font compétens pour attefter
à toutes fortes de perfonnes l’authenticité des aâes
émanés des officiers eccléfiaftiques, que perfonne ne
peut mieux connoître que l’évêque, fon officicial,
ou fes grands vicaires.
Il faut feulement obferver que fi c’eft l’official
qui a fait la lègalifation , & que l’on veuille la faire
lceller pour plus grande authenticité, comme cela
fe pratique ordinairement, il faut la faite fceller ou
par l’évêque ou par celui qui eft prépofé par lui
pour appofer fon fceau, car ordinairement les officiaux
n’ont point de fceau même pour fceller leurs
jugemens.
On peut aufli faire légalifer des aâes émanés des
officiers eccléfiaftiques, par le juge royal du lieu
de leur réfidence, & fur-tout lorfqu’on veut produire
ces aâes en cour laie, ou devant des officiers
féculiers, royaux ou autres, parce que le juge royal
eft préfumé connoître tous les officiers qui exercent
un miniftere public dans fon reffort ; & une telle lè-
galifation eft valable même à l’égard des officiers
eccléfiaftiques auprès defquels on veut faire valoir
l’a â e , parce qu’ils ne peuvent méconnoître la léga