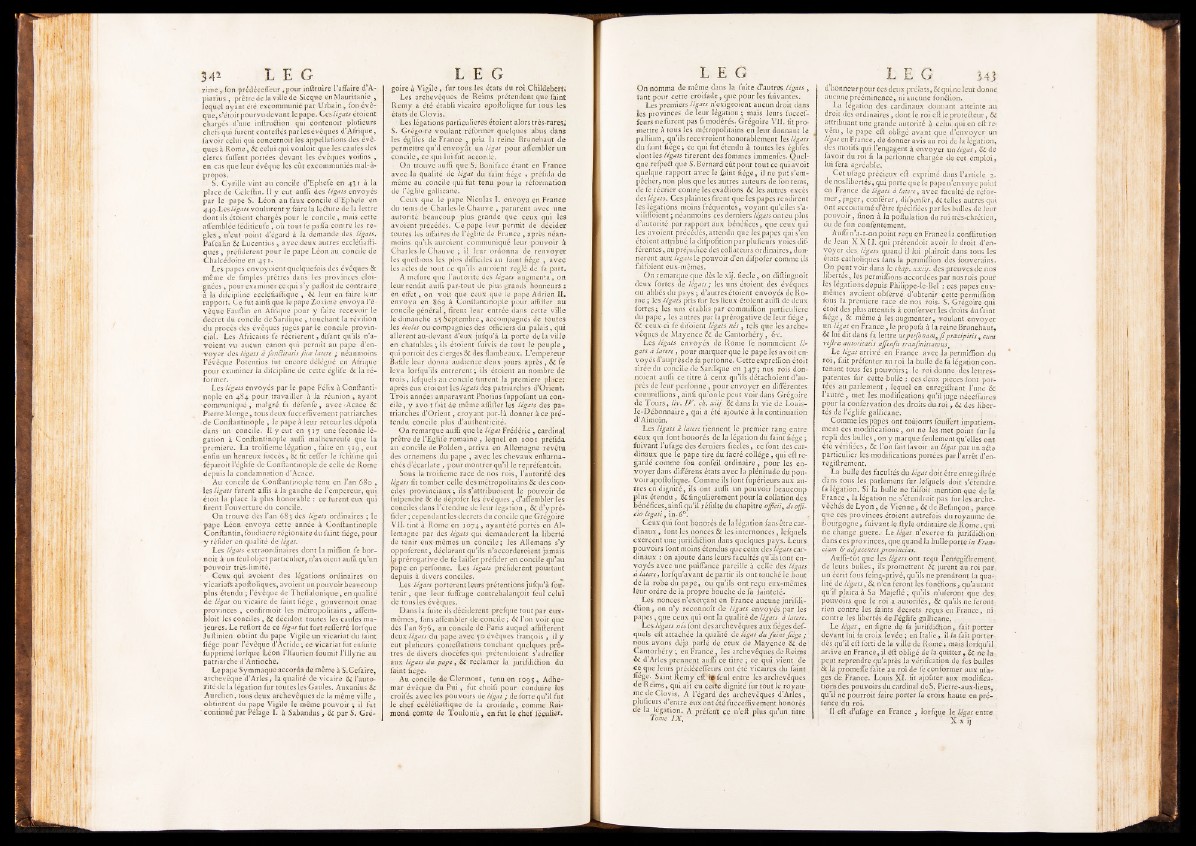
zime, fon prédéceffeur ,pour inftruire l ’affaire d A-
piarius , prêtre de la ville de Sicque en Mauritanie ,
lequel ayant été excommunié par Urbain, fon évêque,
s’étoir pourvu devant le pape. Ces légats étoient
chargés d’une inftruftion qui contenoit plufieurs
chefs qui furent eonteftés parlesévêques d’Afrique,
favoir celui qui concernoit les appellations des évêques
à Rome, 6c celui qui vouloit que les caufes des
clercs fuffent portées devant les evêques voifins ,
en cas que leur évêque les eût excommuniés mal-à-
propos.
S. Cyrille vint au concile d’Ephefe en 431 à la
place de Céleftin. Il y eut auffi des légats envoyés
par le pape S. Léon au faux concile d’Ephelé en
449.Les légats voulurent y faire la le&ure de la lettre
dont ils étoient chargés pour le concile, mais cette
affemblée léditieufe , oîi tour le pafla conire les réglés
, n’eut point d’égard à la demande des légats.
Pafcalin & Lucentius , avec deux autres eccléfiafti-
ques, préliderent pour le pape Léon au concile de
Chalcédoine en 451.
Les papes envoyoient quelquefois des évêques &
même de fimples prêtres dans les provinces éloignées
, pour examiner ce qui s’y paffoit de contraire
à la difcipline eccléfiaftique , 6c leur en faire leur
rapport. Ce fut ainfi que le pape Zozime envoya l’é vêque
Fauftin en Afrique pour y faire recevoir le
decret du concile de Sardique , touchant la révifion
du procès des évêques jugés par le concile provincial.
Les Africains fe récrièrent, difant qu’ils n’a-
voient vu aucun canon qui permît au pape d’envoyer
des légats à fanclitatis Juoe latere ; néanmoins
l’évêque Potentats fut encore délégué en Afrique
pour examiner la difcipline de cette églil'e & la réformer.
Les légats envoyés par le pape Félix à Conftanti-
nople en 484 pour travailler à la réunion , ayant
•communiqué, malgré fa défenfe, avec'Acace 6c
Pierre Monge, tous deux fucceffivemqnt patriarches
.de Conftantinople , le pape à leur retour les dépofa
dans un concile. Il y eut en 517 une fécondé légation
à Conftantinople auffi malheureufe que la
première. La troifieme légation , faite en 519, eut
enfin un heureux fuccès, 6c fit ceffer le fchifme qui
féparoit l’églife de Conftantinople de celle de Rome
depuis la condamnation d’Acace.
Au concile de Conftantinople tenu en l’an 680 ,
les légats furent affis à la gauche de l’empereur, qui
étoit la place la plus honorable : ce furent eux qui
' firent l’ouverture du concile.
On trpuve dès l’an 683 des légats ordinaires ; le
pape Léon envoya cette année à Conftantinople
Conftantin,foudiacre régionaire du faint fiége, pour
y réfider en qualité de légat.
Les légats extraordinaires dont la million fe bor-
noit à un feul objet particulier, n’avoient auffi qu’un
pouvoir très-limité.
Ceux qui avoient des légations ordinaires ou
■ vicariafè apoftoliques, avoient un pouvoir beaucoup
plus étendu ; l’évêque de Thefialonique, en qualité
de légat ou vicaire de faint fiége , gouvernoit onze
provinces , confirmoit les métropolitains , affem-
bloit les conciles , 6c décidoit toutes les caufes majeures.
Le reffort de ce légat fut fort refferré lorfque
Juftinien obtint du pape Vigile un vicariat du faint
• fiége pour l’évêque d’Àcride ; ce vicariat fut enfuite
■ fupprimé lorfque Léon l’Ilaurien fournit l’Illyrie au
patriarche d’Antioche.
Le pape Symmaque accorda de même à S.Cefaire,
archevêque d’Arles, la qualité de vicaire & l’autorité
de la légation fur toutes les Gaules. Auxanius 6c
Aurelien, tous deux archevêques de la même v ille ,
obtinrent du pape Vigile le même pouvoir ; il fut
' continué par Pélage I. à Sabandus, 6c par S . Grégoire
à V ig ile, fur tous les états du roi Childebeft*
Les archevêques de Reims prétendent que faint
Remy a été établi vicaire apoftolique fur tous les
états de Clovis.
Les légations particulières étoient alors très-rares.'
S. Grégoire voulant réformer quelques abus dans
les égliles de France , pria la reine Brunehaut de
permettre qu’il envoyât un légat pour affembler un
çancile, ce qui lui fut accordé.
On trouve auffi que Sv Boniface étant en France
avec la qualité de légat du faint fiége , préfida de
même au concile qui fut tenu pour la réformation
de l’églife gallicane.
Ceux que le pape Nicolas I. envoya en France
du tems de Charles-le-Chauve , parurent avec une
autorité beaucoup plus grande que ceux qui les
avoient précédés. Ce pape leur permit de décider
toutes les affaires de l’églife de France , après néanmoins
qu’ils auroient communiqué leur pouvoir à
Charles-le-Chauve ; il leur ordonna de renvoyer
les queftions les plus difficiles au faint fiége , avec
les a des de tout ce qu’ils auroient réglé de fa part.
A mefure que l’autorité des Légats augmenta, on
leur rendit auffi par-tout de plus grands honneurs :
en effet, on voit que ceux que le pape Adrien IL
envoya en 869 à Conftantinople pour affifter au
concile général, firent leur entrée dans cette ville
le dimanche 25 Septembre, accompagnés de toutes
les écoles ou compagnies des officiers du palais, qui
allèrent au-devant d’eux jufqu’à la porte de la ville
en chaiubles ; ils étoient fuivis de tout le peuple,
qui portoic des cierges & des flambeaux. L ’empereur
Bafile leur donna’ audience deux jours après , 6c fe
leva lorfqu’ils entrèrent ; ils étoient au nombre de
trois, iefquels au concile tinrent la première place:
après eux étoient les légats des patriarches d’Orient.
Trois années auparavant Photius fuppofant un concile,
y avoit fait de même affifter les légats des .patriarches
d’Orient, croyant par-là donner à ce prétendu
concile plus d’authenticité.
On remarque auffi que le légat Frédéric , cardinal
prêtre de l’Eglife romaine , lequel en 1001 préfida
au concile de Polden , arriva en Allemagne revêtu
des ornemens du pape , avec les chevaux enharnachés
d’écarlate , pour montrer qu’il le repréfentoit.
Sous la troifieme race de nos rois, l’autorité des
légats fit tomber celle des métropolitains 6c des conciles
provinciaux ; ils s’attribuoient. le pouvoir de
fufpendre & de dépofer les évêques , d’affembler les
conciles dans l ’étendue de leur légation, 8c d’y pré-
fider ; cependant les decrets du concile que Grégoire
VII. tint à Rome en 1074, ayant été portés en Allemagne
par des légats qui demandèrent la liberté
de tenir eux-mêmes un concile; les Allemans s’y
oppoferent, déclarant qu’ils n’accorderoient jamais
la prérogative de fe laiffer préfider en concile qu’au
pape en perfonne. Les légats préfiderent pourtant
depuis à divers conciles.
Les légats portèrent leurs prétentions jufqu’à fou-
tenir, que leur fuffrage contrebalançoit feul celui
de tous les évêques.
Dans la fuite ils décidèrent prefque tout par eux-
mêmes, fans affembler de concile ; 6c l’on voit que
dès l’an 876, au concile de Paris auquel affifterent
deux légats du pape avec 50 évêques françois , il y
eut plufieurs conteftations touchant quelques prêtres
de divers diocèfes qui prétendoient s’adreffer
aux légats du pape , 6c reclamer la j urifdiéHon du
faint fiége.
Au concile de Clermont, tenu en 1095 , Adhe-
mar évêque du P u i, fut choifi pour conduire les
croifés avec les pouvoirs de légat ; de forte qu’il fut
le chef ecéléfiaftique de la croifade, comme Raimond
comte de Touloufe, en futlech efféculier.
On nomma de même dans la fuite d’autres légats ,
tant pour cette croifade, que pour les fuivantes.
Les premiers légats n’exigeoient aucun droit dans
les provinces de leur légation ; mais leurs fuccef-
feurs ne furent pas fi modérés. Grégoire VII. fit promettre
à tous les métropolitains en leur donnant le
pallium, qu’ils rece^roient honorablement les légats
du faint fiége ; ce qui fut étendu à toutes les églifes
dont les légats tirèrent desfommes immenfes. Quelque
refpeét que S. Bernard eut pour tout ce qui avoit
quelque rapport avec le teint fiége, il ne put s’empêcher,
non plus que les autres auteurs de fon tems,
de fe récrier contre les exa&ions 6c les autres excès
des légats. Ces plaintes firent que les papes rendirent
les légations moins fréquentes, voyant qu’elles s’a-
viliflbient ; néanmoins ces derniers légats ont eu plus
d’autorité par rapport aux bénéfices, que ceux qui
les avoient précédés, attendu que les papes qui s’en
étoient attribué la difpofition par plufieurs voies différentes,
au préjudice des collateurs ordinaires, donnèrent
aux légats le pouvoir d’en difpofer comme ils
faifoient eux-mêmes.
On remarque que dès le xij. fiecle, on diftinguoit
deux fortes de légats; les uns étoient des évêques
ou abbés du pays ; d’autres étoient envoyés de Rome
; les légats pris fur les lieux étoient auffi de deux
fortes ; les uns établis par commiffion particulière
du pape, les autres par la prérogative de leur fiége,
6c ceux-ci fë difoient légats nés , tels que les archevêques
de Mayence 6c de Cantorbéry, &c.
Les légats envoyés de Rome fe nommoient légats
à latere, pour marquer que le pape les avoit envoyés
d’auprès de fa perfonne. Cette expreffion étoit
tirée du concile de S.ardique en 347; nos rois don-
noient auffi ce titre à ceux qu’ils détachoient d’auprès
de leur perfonne, pour envoyer en différentes
commiffions , ainfi qu’on le peut voir dans Grégoire
de Tours, liv. IV. ch. xiij. 8c dans la vie de Louis-
Ie-Débonnaire, qui a été ajoutée à la continuation
d’Aimoin.
Les légats à lattrt tiennent le premier rang entre
ceux qui font honorés de la légation du faint fiége ;
fuivant l’ufage des derniers fiecles, ce font des cardinaux
que le pape tire du facré collège, qui eft regardé
comme fon confeil ordinaire, pour les env
o y e r dans différens états avec la plénitude du pouvoir
apoftolique. Comme ils font fupérieurs aux autres
en dignité, ils ont auffi un pouvoir beaucoup
plus étendu, 8c fingulierement pour la collation des
bénéfices, ainfi qu’il réfulte du chapitre ojficiiy de offi-
cio legati, in-6°.
■ Ceux qui font honorés de la légation fans être cardinaux
, font les nonces & les internonces, Iefquels
exercent une jurifdiélion dans quelques pays. Leurs
pouvoirs font moins étendus que ceux des légats cardinaux
: on ajoute dans leurs facultés qu’ils iont envoyés
avec une puiffance pareille à celle dès légats
à latere, lorfqu’avant de partir ils ont touché le bout
de la robe du pape, ou qu’ils ont reçu eux-mêmes
leur ordre de la propre bouche de fa fainteté.
Les nonces n’exerçant en France aucune jurifdi-
élipn, on n’y reconnoît de légats envoyés par les
papes, que ceux qui ont la qualité de légats à latere.
Les légats nés font des archevêques aux fiéges def-
qüels eft attachée la qualité de légat du faint fiége j
nous avons déjà parlé de ceux de Mayence 6c de
Cantorbéry ; en F rance, les archevêques de Reims
6c d’Arles prennent auffi ce titre ; ce qui vient de
ce que leurs prédécëffeurs ont été vicaires du faint
ffége. Saint Remy eft l^feul entre les archevêques
de Reims, qui ait eu certe dignité fur tout le royaume
de Clovis. A l’egard des archevêques d’Arles,
plufieurs d’entre eux'ontétéfucceffivement honorés ,
de la légation. A préferft ce n’eft plus qu’un titre
Tome IX , '
d’honneur pour ces deux prélats, 6c quine leur donné
aucune prééminence, ni aucune fonction.
La légation des cardinaux donnant atteinte ait
droit des ordinaires, dont le roi eft le prote&eur, 6c
attribuant une grande autorité à celui, qui en eft re-,
vêtu , le pape eft obligé avant que d ’envoyer un
légat en France, dé donner avis au roi de la légation,
des motifs qui l’engagent à envoyer un légat , 6c de
favoir du roi fi la perfonne chargée de cet emploi,
lui fera agréable.
Cet ufage précieux eft exprimé dans l’article 2*
de nos libertés, qui, porte que le pape n’envoye point
en France de légats à latere, avec faculté de réfor-
mer f jl,ger> conférer, difpenfer, 6c telles autres qui
ont accoutumé d’être fpécifiées par les bulles de leur
pouvoir, finon à la poftulation du roi très-chrétien,
ou. de fon confentement.
Auffi n’a-t-on point reçu en France ta conftitution
de Jean X X I I . qui prétendoit avoir le droit d’envoyer
des. légats quand il lui plairoit dans tous les
états catholiques fans la permiftîon des fouverains.
On peut voir dans le chap. xxiij. des preuves de nos
libertés, les permiffions accordées par nos rois pour
les légations depuis Philippe-le-Bel : ces papes eux-
memes avoient obfervé d’obtenir cette permiffion
foiis la première race de nos fois. S. Grégoire qui
etoit des plus attentifs à conferver les droits du faint
fiege, & même à les. augmenter,, voulant envoyer
un légat en France , 1e propofa à la reine Brunehaut,
6c lui dit dans fa lettre utperfonatntfiproteipitis, cunt
veflrce autoritatis ajfenfu tranfmittamust
Ee légat arrivé en France àvecJa permiffion du
roi, fait préfenter au roi la bulle de fa légation contenant
tous fes pouvoirs; le roi donne des lettres-
patentes fur cette bulle ces deux pièces font portées
au parlement, lequel en enregiftrant l’une 6c
l ’autre, met les modifications qu’il juge néceffaires
pour la confervation des, droits du roi., & des libertés
de l’églife gallicane.
Comme les pâpes ont toujours fouffert impatiemment
ces modifications , on ne les met point fur le
repli des bulles, on y marque feulement qu’elles ont-
été vérifiées, 6c l’on fait favoir au légat par un afte
particulier les modifications portées par l’arrêt d’en-
regiftrement.
La bulle des facultés du légat doit être enregiftrée
dans tous les parlemens fur Iefquels doit s’étendre
fa légation. Si la bulle ne faifoit mention que de la
France , la légation ne s’étendroit pas fur les archevêchés
de L y on , de Vienne, 6c de Befançon, parce
que ces provinces étoient autrefois du royaume de
Bourgogne, fuivant le ftyle ordinaire de Rome, qui
ne change guere.' Le légat n’exerce, fa jurifdi&jori-
dans ces provinces, que quand la bulle porte inFran-
ciam & adjacentes provincias.
Auffi-tôt que les légats ont reçu l’enfegiffrement
de leurs bulles, ils promettent 6c jurent au roi par>
un écrit fous feing-privé, qu’ils ne prendront la qua-;
lite de légats, 6c n’en feront les fonctions, qu’autant
qu’il plaira à Sa Majefté; qu’ils n’uferont que des.
pouvoirs que le roi a autorifés, 6c qu’ils ne feront
rien contre les faints decrets reçus en France, ni
contre les libertés de l’églife gallicane.
Le légat y en ligne de fa jurifdiftiqn, fait porter
devant lui fa croix levée ; en Italie, il la fait porter
dès qu’il eft forti de la ville de Rome ; mais lorfqu’il
arrive en France, il eft obligé de la-quitter,,6c ne la
peut reprendre qu’après la vérifieatiçn de fes bulles
& la promefle faite au roi de le conformer aux ufa-
ges de France. Louis XI. fit ajouter aux modificaf
tiorisdes pouvoirs du cardinal deST Pierre-aux-lieos,.
qu’il ne pourroit faire porter fa croix haute en pré-
lence du roi.
Il eft d’ufage en France , lorfquè le légat entre
X x ij