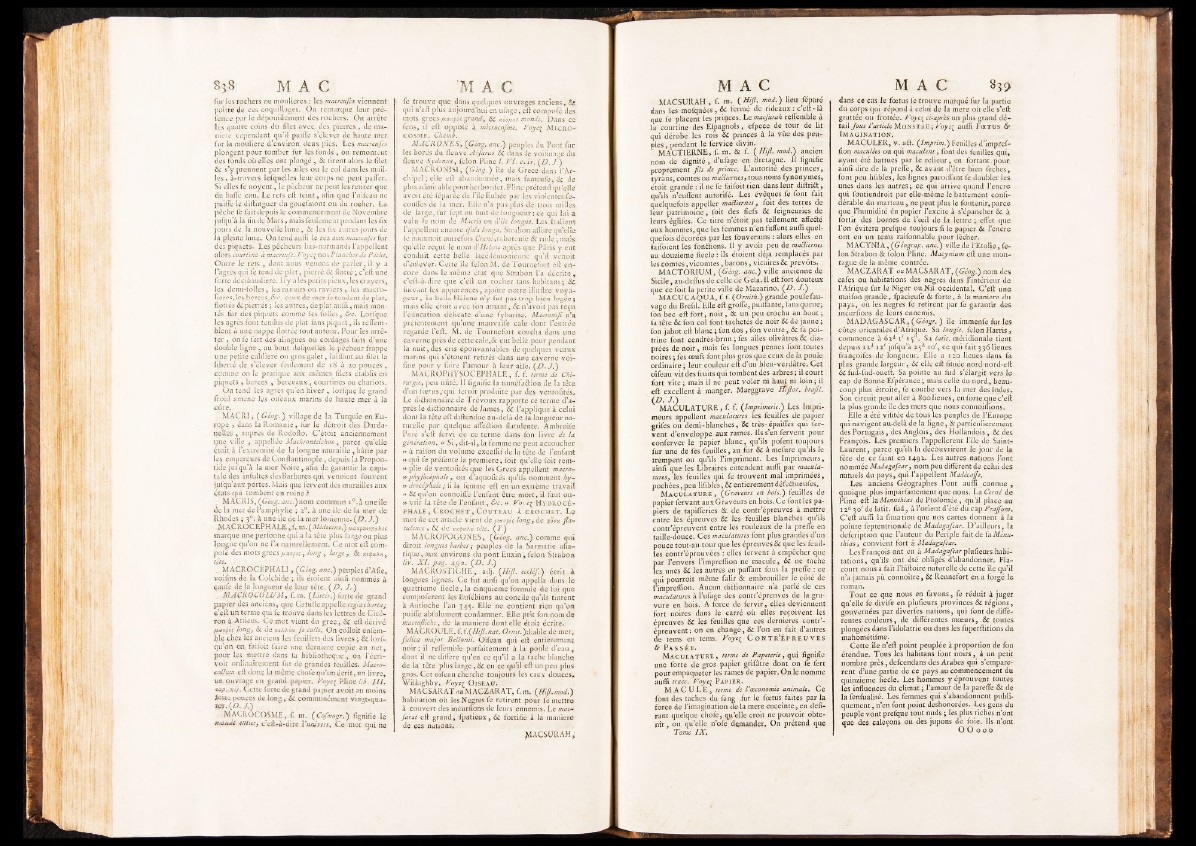
fur les rochers ou moulieres : les macreufes viennent
paître de ces coquillages. On remarque leur pré-
ience par le dépouillement des rochers. On arrête
les quatre coins du filet avec des pierres , de maniéré
-cependant qu’il puiûe s’élever de haute mer
fur k mouliere d’environ deux pies. Les macreufes
plongent pour tomber fur les fonds , ou remontent
des fonds où eUes ont plongé , & tirent alors le filet
•& s’y prennent par les ailes ou le col dans les mailles
> à-travers lefquelles leur corps ne peut paffer.
Si elles le noyent, le pêcheur ne peut les retirer que
de bafle eau. Le rets eft teint, afin que l’oifeau ne
puiffe le diftinguer du gouefmont ou du rosher. La
pêche fe fait depuis Le commencement de Novembre
jufqu’à la fin de Mars, mais feulement pendant les fix
jours de la nouvelle lune , & les fix autres jours de
la pleine lune. On tend aufli le rez aux macreufes fur
des .piquets. Les pêcheurs bas-normands l’appellent
alors courtine àmaereufe. Voye^ nos Planches de Pêche,
Outre le rets , dont nous venons de parler, il y a
l’agrès qui fe tend de plat, pierre 6c flotté ; c’eft une
forte de cibaudiere. Il y a les petits pieux, les crayers,
les demi-folles, les ravoirs ou raviers , les macro-
lieres,les berces, fcc. ceux de mer fe tendent de plat,
flottés & pierrés ; les autres, de plat auiïi, mais montés
lur des piquets comme les folles, &c. Lorfque
les agrès font tendus de plat fans piquet, ils reffem-
blent à une nappe flottée tout autour. Pour les arrêter.,
on fe fert des alingues .ou cordages faits d’une
double ligne , au bout defquelles le pêcheur frappe
une petite cabliere ou gros galet, laiffant au filet la
liberté de s’élever feulement de 18 à 20 pouces,
comme on le pratique anx mêmes filets établis en
piquets , berces , berceaux, courtines ou chariots.
On tend les agrès qu’en hiver , lorfque le grand
froid amene les oifeâux marins de haute mer à la
côte.
MACRI ; ( Géog. ) village de la Turquie en Europe
, dans la Romanie, fur le détroit des Dardanelles
, auprès de Rodofto. C ’étoit anciennement
qnq ville f appellée Machronteichos , parce qu’elle
était à l’extrémité de la longue muraille, bâtie par
les empereurs de Conftantinople, depuis la Propon-
tide jufqu’à la mer Noire, afin de garantir la capitale
des infultes desBarbares qui venoient fouvent
jnfqu’aux portes. Mais que fervent des murailles aux
états qui tombent en ruine ?
. MACRIS, (Géog. anc.) nom commun t°. à une île
de la mer de Pamphylie ; 2,°, à une île de la mer de
Rhodes ; 30. à une île de la mer Ionienne. (JD. J.)
MACROCÉPHALE m, (Médecine.) fxaxpox^aXoç
marque une perfonne qui a la tête plus large ou plus
longue qu’on ne l ’a naturellement. Ce mot çft com-
pofé des mots grecs pxxpoe, long, large , & xt^xXti,
tjte.
. MACROCÊPHALI, ( Géog. anc.) peuple? d’A fie,
yoifins de la Colchide ; ils étoient ainfi nommés à
caufe de la longueur de leur tête. (D . J .)
.. MACRO CO LUM y f. m. (Lit tir.) forte de grand
papier des anciens, que Catulle appelle regiacharta;
c ’eft un terme qui fe trouve dans les lettres de Cicéron
à Atticus. Ce mot vient du grec, & eft dérivé
IMLKpoç long, & de xoxxîa je colle. On colloit enfem-
ble chez les anciens les feuillets des livrés ; & lorf-
qu’on en faifoit faire une derniere copie au net,
pour les mettre dans fa bibliothèque, on lecri-
Yoit ordinairement- fur de grandes feuilles. Macro-
colhun eft donc la mêmç chofeq-u’unécrit,un livre,
un ouvrage en grand papier. Voye{ Pline lib. I I I .
cap. x ïj. Cette forte de grand papier avoit au moins
ieiac pouces de long, Si.communément vingt-ciua-
*$-,(£>.ƒ,) - 1
MACROCOSME, f. m. ( Cofmogr. ) fignifie le
■ monde entier, c’eft-à-dire l ’univers.. Ce mot qui ne
fe trouve que dans quelques ouvrages anciens, &
qui n’eft plus aujourd’hui en ufage, eft compofé des
mots grecs /xaxpéç grand, 6c koh/j.cç monde. Dans ce'
fens, il eft oppofé à rnicrocofme. yoyt£ M ic r o - '
COSME. Chamb.
MACRONES, (Géog. anc.) peuples du Pont fur
les bords du fleuve Abfarus 6c dans le voifinage du
fleuve Sydenus, félon Pline /. VI. c. iv. (D J )
MA.CRONLSI, (Géog.)Ale de Grece dans l’Archipel;
elle eft abandonnée, mais fameufe, 6c de
plus admirable pour herborilèr. Pline prétend qu ’elle
avoit été féparee de Tile Eubée par les violentes fe-
couffes de la mer. Elle n’a pas plus de trois milles
de large, fur fept ou huit de longueur : ce qui lui a
valu )e nom de Macris ou drUe longue. Les Italiens
l’appellent encore ifola longa. Strabon allure qu’elle
fe nommoit autrefois C/ïz«t:',raboteufe & rude ; mais
qu’elle reçut le nom d’Helene après que Pâris y eut
conduit cette belle lacédémonienne qu’il venoit
d’enlever. Cette île félon M. de Tournefort eft encore
dans le même état que Strabon l’a décrite
c’eft-à-dire que c’eft un rocher fans habitans; 6c
fuivant les apparences, ajoute notre illuftre voya-
geur, la belle Hélene n’y fut pas trop bien logée ;
mais elle étoit avec l'on amant, 6c n’avoit pas reçu
l’éducation délicate d’une fybarite. Macroniji n’a
prélentement qu’une mauvaife cale dont l’entrée
regarde l’eft. M. de Tournefort coucha dans une
caverne près de cette cale,& eut belle peur pendant
la nuit, des cris épouvantables de quelques veaux
marins qui s’étoient retirés dans une caverne voi-,
fine pour y faire l’amour à leur aife. (D . J.)
M a C R O PH Y SQ C É PH A L E , f. f. terme de Chirurgie,
peu ufité. Il fignifie la tuméfaction de la tête
d’un foetus,-qui leroit produite par des ventofités.
Le dictionnaire de Trévoux rapporte ce terme d’après
le dictionnaire de James, 6c l’applique à celui
dont la tête eft diftendue au-delà de là longueur naturelle
par quelque affeCtion flatulente. Ambroile
Paré s’eft fervi de ce terme dans fon livre de la
génération. « S i , dit-il, la femme ne peut accoucher
» à railon du volume exceffif de la tête de l’enfant
» qui fe préfente la première, foit qu’elle foit rem-
» plie de ventofités que les Grecs appellent macro-
» phyfocéphale, ou d’aquofités qu’ils nomment hy-
» drocéphale; fi la femme eft en un extrême travail
» & qu’on connoiffe l’enfant être mort, il faut ou-
» vrir la tête de l’enfant, &c. » Voyeç H y d r o c é p
h a l e , C r o c h e t , C o u t e a u à c r o c h e t . L q
mot de cet article vient de paxpoç long, de fêcx flatulence
, & de xn<p*x» tête. (T )
MACROPOGONES, (Géog. anc.) comme qui
diroit longues barbes ; peuples de la Sarmatie afia-*
tique, aux environs du pont Euxin, félon Strabon
liv. X I . pag. 49 z. (D . J.)
MACROST1CH E , adj. (Hift. eccléf. ) écrit à
longues lignes. Ce fut ainfi qu’on appella dans le
quatrième fiecle, la cinquième formule de foi que
compoferent les Eufébiens au concile qu’ils tinrent
à Antioche l’an 345. Elle ne contient rien qu’on
puiffe abfolumçnt condamner. Elle prit fon nom des
macroJlichey de la maniéré dont elle étoit écrite.
MACROULE, f. f.(Hifl.nat. Omit.)diable de mer,'
fulica major Bdlonïi. Oifeau qui eft entièrement,
noir : il reffemble parfaitement à la poule d’eau ,
dont il ne différé qu’en ce qu’il a la tache blanche*
de la tête plus large, Ôc en ce qu’il eft un peu plus
gros. Cet oifeau cherche toujours les eaux douces*
\yillughby. Voye^ O is e a u .
M A C SA R A T obM A C Z A R A T , f. m. (Hif.mod.)
habitation où les Ne,grès fe retirent pour fe mettre
à couvert des incurfions de leurs ennemis. Le mac-,
farat eft grand, fpatieux, & fortifié à la maniéré
de ces nations.
^ï a c s ü r a h ;
MACSURAH, f. m. (Hifi. mod.) lieu Réparé
dans les mofquées, & ferme de rideaux : c eft - là
«uê fg placent les priçces. Le maejurah reffemble à
la courtine des Efpagnols, efpece de tour de lit
qui dérobe les rois 6c princes à la Vue des peu^-
pies, pendant le fervice divin.
MACTIERNE, f. m. & f. ( Hiß. mod.) ancien
nom de dignité, d’ufage en Bretagne. 11 fignifie
proprement fils de prince. L’autorité des princes,
tyrans, comtes ou macliernes, tous noms fynonymes,
étoit grande : il ne fe faifoit rien dans leur diftriét,
qu’ils n’euffent autorifé. Les évêques fe font fait
quelquefois appellcr macliernes, foit des terres de
leur patrimoine, foit des fiefs & feigneuries de
leurs églifes. Ce titre n’étoit pas tellement affeâé
aux hommes, que les femmes n ’en fuffent aufli quelquefois
décorées par les fouverains : alors elles en
faifoient les fondions. Il y avoit peu de macliernes
au douzième fiecle : ils étoient déjà remplacés par
les comtes »vicomtes, barons, vicaires & prévôts.
MACTORIUM, (Géog. anc.) ville ancienne de
Sicile, au-deffus de celle de Gela. Il eft fort douteux
que ce foit la petite ville de Mazarino. (D . J .)
MACUCAQUA, f. f. (Ornith.) grande poulefau-
vage du Brefil. Elle eft groffe, puiffante, fans queue;
fon bec eft fort, noir, & un peu crochu au bout ;
fa tête & fon col font tachetés de noir & de jaune ;
fon jabot eft blanc ; fon dos, fon ventre, & fa poitrine
font cendrés-brun ; fes aîles olivâtres & diaprées
de noir, mais fes longues pennes font toutes
noires ; fes oeufs font plus gros que ceux de la poule
ordinaire ; leur couleur eft d’un bleu-verdâtre. Cet
oifeau vit des fruits qui tombent des arbres ; il court
fojrt vîte ; mais il ne peut voler ni haut ni loin ; il
eft excellent à manger. Marggrave Hifior. brafü.
i D ' J -) S
MACULATURE , f. f. (Imprimerie.) Les Imprimeurs
appellent maculatures les feuilles de papier
grifes ou demi-blanches, & très-épaiffes qui fervent
d’enveloppe aux rames. Ils s’en fervent pour
conferver le papier blanc, qu’ils pofent toujours
fur une de fes feuilles, au fur & à mefure qu’ils le
trempent ou qu’ils l’impriment. Les Imprimeurs,
ainfi que les Libraires entendent aufli par maculatures,
les feuilles qui fe trouvent mal imprimées,
pochées, peu lifibles, & entièrement défeâueufes.
M a c u l a t u r e , (Graveurs en bois.) feuilles de
papier fervant aux Graveurs en bois. Ce font les papiers
de tapifferies & de contr’epreuves à mettre
entre les épreuves & les feuilles blanches ‘ qu’ils
contr’épreuvent entre les rouleaux de la preffe en
taille-douce. Ces maculatures font plus grandes d’un
pouce tout-au tour que les épreuves & que les feuilles
contr’éprouvées : elles fervent à empêcher que
par l’envers l’impreflion ne macule, & ne tache
les unes & les autres en paffant fous la preffe : ce
qui pourroit même fahr & embrouiller le côté de
l’impreflion. Aucun dictionnaire n’a parlé de ces
maculatures à l’ufage des contr’épreuves de la gravure
en bois. A force de fervir, elles deviennent
fort noires dans le carré où elles reçoivent les
épreuves & les feuilles que ces dernieres contr’épreuvent
: on en change, & l’on en fait d’autres
de tems en tems. Voye^ C o N t r ’ é 'p r e u v e s
£ P a s s é e .
M a c u l a t u r e , terme de Papeterie, qui fignifie
une forte de gros papier grifâtre dont on fe fert
pour empaqueter les rames de papier. On le nomme
aufli trace. Veyeç PAPIER.
M A C U L E , terme de l'ce.conomie animale. Ce
font des taches du fang fur le foetus faites par la
force de l’imagination de la mere enceinte, en délirant
quelque chofe, qu’elle croit ne pouvoir obten
ir , ou qu’elle n’ofe demander. On prétend que
Tome’ IX ,
d a n s c e c a s le foe tu s fe tro u v e m a rq u é fu r la p a rtie
d u co rp s q u i r é p o n d à c e lu i d e la m e re o.ù e lle s’e ft
g r a tté e o u fro tté e . Voye£ ci-après un p lu s g ra n d d é ta
il fous Varticle MONSTRE -, Voye^ au fli F<ETUS 6*.
I m a g in a t io n .
MACULER, v. a£h (Imprim.) Feuilles d’impref-
fion maculées ou qui maculent, font des feuilles qui,
ayant été battues par le relieur, en fortant. pour,
ainfi dire de la preffe, & avant d’être bien feches,
font peu lifibles, les lignes paroiflànt fe doubler les
unes dans les autres; ce qui arrive quand l’encre
qui foutiendroit par elle-même le battement confi-
dérable du marteau, ne peut plus le foutenir, parce
que l’humidité du papier l’excite à s’épancher & à
lortir des bornes de l’oeil de la lettre ; effet que
l’on évitera prefque toujours fi le papier & l’encre
ont eu un tems raifonnable pour fécher.
MACYNIA, (Géograp. anc.) ville de l ’EtoIie, félon
Strabon & folon Pline. Macynium eft une montagne
de la même contrée.
MACZARAT ou MACSARAT, (Géog.) nom des
cafés ou habitations des negres dans l’intérieur de
l’Afrique fur le Niger ou Nil occidental. C ’eft une
maifon grande, fpacieufe & forte, à la maniéré du
pays, où les negres fe retirent par fe garantir des
incurfions de leurs ennemis.
MADAGASCAR, (Géogr. ) île immenfe fur les
côtes orientales d’Atrique. Sa longit. félon H arris,
commence à 61^ i ' 1 y . Sa latit. méridionale tient
depuis 1 zd 1 d jufqu’à z 5d io'-, ce qui fait 3 36 lieues
françoifes de longueur. Elle a 120 lieues dans fa
plus grande largeur, & elle eft fituée nord nord-eft
6c fud-fud-oueft. Sa pointe au fud s’élargit vers le
cap de Bonne-Efpérance; mais celle du nord, beaucoup
plus étroite, fe courbe vers la mer des Inçles.
Son circuit peut aller à 800 lieues, en forte qiie-c’eft
la plus grande île des mers que nous connoiflipns.
Elle a été vifitée de tous les peuples de l ’Europe
qui navigent au-delà de la ligne, & particulièrement
des Portugais, des Anglois, des Hollandois, & des
François. Les premiers l’appellerent l’île de Saint-
Laurent, parce qu’ils la découvrirent le jour de la
fête de ce faint en 1491. Les autres nations l’ont
nommée Madagafcar, nom peu différent de celui des
natuels du pays, qui l’appellent Madécaffe.
Les anciens Géographes l ’ont aufli connue ÿ
quoique plus imparfaitement que nous. La Cerné de
Pline eft InMeniuhias dePtoIpmée, qu’il place au
1 i d 30'' de latit. fùd, à l’orient d’été du cap Prajftm.
C ’eft aufli la fituation que nos cartes donnent à la
pointe feptentrionale de Madagafcar. D ’ailleurs, la
defeription que l’auteur du Périple fait de fa Ménu-
thias, convient fort à Madagafcar.
Les François ont eu à Madagafcar plufieurs habitations,
qu’ils ont été obligés d’abandonner. Fla-
court nous a fait l’hiftoire naturelle de cette île qu’il
n’a jamais pû connoître, & Rennefort en a forgé le
roman.
Tout ce que nous en favons, fe réduit à juger
qu’elle fe divife en plufieurs provinces & régions ,
gouvernées par diverfes nations, qui font de différentes
couleurs, de différentes moeurs, & toutes
plongées dans l’idolâtrie ou dans les fuperftitions du
mahométifme.
Cette île n’eft point peuplée à proportion de fon
étendue. Tous les habitans font noirs, à un petit
nombre près, defeendans des Arabes qui s’emparèrent
d’une partie de ce pays au commencement du
quinzième fiecle. Les hommes y éprouvent toutes
les influences du climat ; l’amour de la parefl’e & de
la fenfualité. Les femmes qui s’abandonnent publiquement
, n’en font point deshonorées. Les gens du
peuple vont prefque tout nuds ; les plus riches n’ont
que des caleçons ou des jupons de foie. Ils n’ont
O O o 00