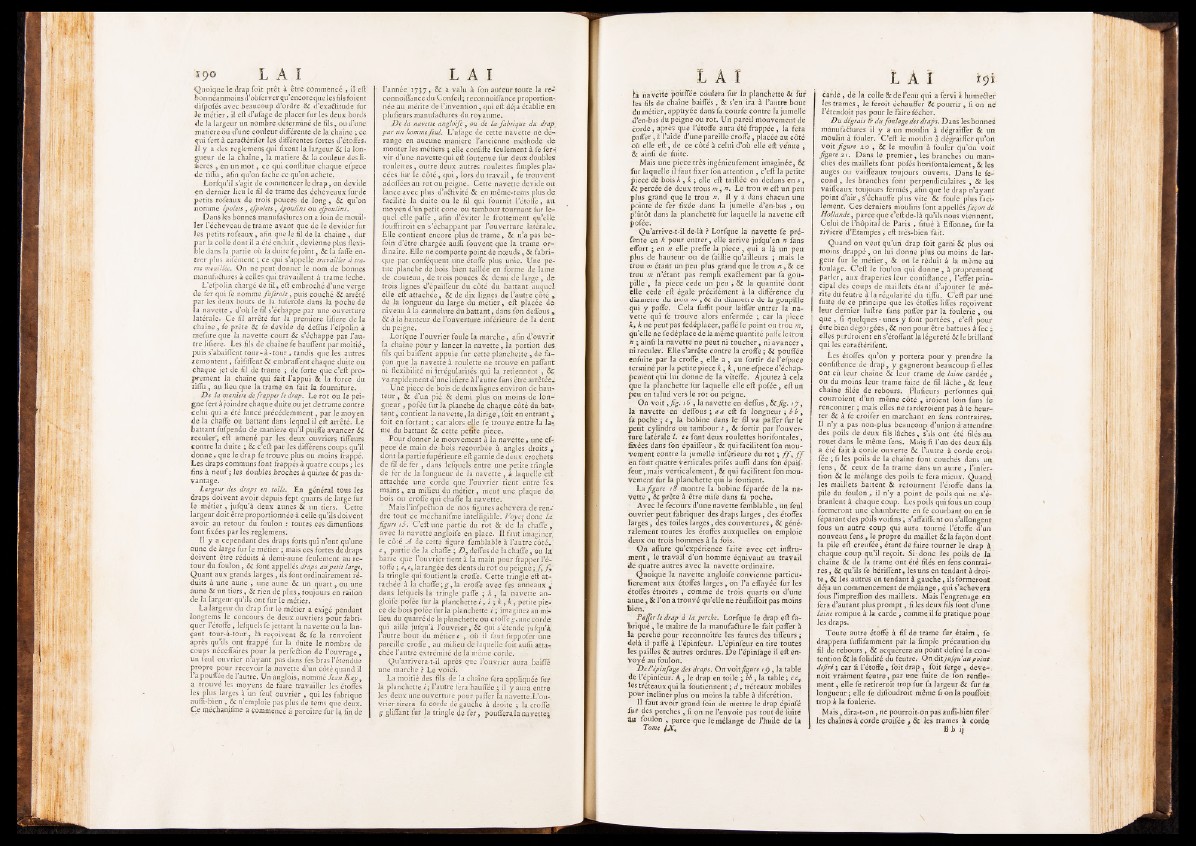
Quoique le drap foit prêt à être commencé , il eft
bon néanmoins d’obferver qu’encore que les fils foient
■ difpofcs avec beaucoup d’ordre & d’exaûitude fur
le métier, il eft d’ufage de placer fur les deux bords
de la largeur un nombre déterminé de fils, ou d’une
matière ou d’une couleur différente de la chaîne ; ce
qui fert à caraâérifer les différentes fortes d’étoffes.
U y a des reglemens qui fixent la largeur & la longueur
de la chaîne, la matière & la couleur des li-
£eres , en un m ot, ce qui conftitue chaque efpece
de tiffu , afin qu’on fâche ce qu’on acheté.
Lorfqu’il s’agit de commencer le drap, on dévidé
en dernier lieu le fil de trame des écheveaux fur de
petits rofeaux de trois pouces de long, & qu’on
nomme épolets , efpolets, époulins ou efpoulins.
Dans les bonnes manufactures on a foin de mouiller
l’écheveau de trame avant que de le devider fur
les petits rofeaux, afin que le fil de la chaîne , dur
par la colle dont il a été enduit, devienne plus flexible
dans la partie où laduitefe joint, & la faffe entrer
plus aifément ; ce qui s’appelle travailler à trame
mouillée. On ne peut donner le nom de bonnes
manufactures à celles qui travaillent à trame feche.
L’efpolin chargé de fil, eft embroché d’une verge
de fer qui fe nomme fuferole, puis couché & arrêté
par les deux bouts de la fuferole dans la poche de
la navette, d’où le fil s’échappe par une ouverture
latérale. Ge fil arrêté fur la première lifiere de la
çhaîne, fe prête & fe dévidé de deffus l’efpolin à
mefure que la navette court & s’échappe pac l’autre
lifiere. Les fils de chaîne fe hauffent par moitié,
puis s’abaiffent tour-à-tour , tandis que les autres
remontent, faillirent & embraffent chaque duite ou
chaque jet de fil de trame ; de forte que c ’eft proprement
la chaîne qui fait l’appui & la force du
tiffu , au lieu que la trame en fait la fourniture.
De la maniéré de frapper le drap. Le rot ou le peigne
fert à joindre chaque duite ou jet de trame contre
celui qui a été lancé précédemment, par le moyen
de la chaffe pu battant dans lequel il eft arrêté. Le
battant fufpendu de maniéré qu’il puiffe avancer &
reculer’', eft amené par les deux ouvriers tiffeurs
contre la duite ; & c’eft par les différens coups qu’il
donne, que le drap fe trouve plus ou moins frappé.
Les draps communs font frappés à quatre coups ; les
fins à neuf ; les doubles broches à quinze & pas davantage.
Largeur des draps en toile. En général tous les
draps doivent avoir depuis fept quarts de large fur
le métier, jufqu’à deux aunes & un tiers. Cette
largeur doit être proportionnée à celle qu’ils doivent
avoir au retour du foulon : toutes ces dimenfions
font fixées par les reglemens^
Il y a cependant des draps forts qui n’ont qu’une
aune de large fur le métier ; mais ces fortes de draps
doivent être réduits à demi-aune feulement au retour
du foulon, & font àppellés draps au petit large.
Quant aux grands larges , ils font ordinairement réduits
à une aune , une aune & un quart, ou une
aune & un tiers, & rien de plus, toujours en raifon
de la largeur qu’ils ont fur le métier.
La largeur du drap fur le métier â exigé pendant
longtems le concours de deux ouvriers pour fabriquer
l’étoffe, lefquels fe jettant la navette ou la lançant
tour-à-tour, lâ reçoivent & fe la renvoient
après qu’ils ont frappé fur la duite le nombre de
coups néceffaires pour la perfefrion de l’ouvragé,
un feul ouvrier n’ayant pas dans fes bras l’étendue
propre pour recevoir la navette d’un côté quand il
l’a pouffée de l’autre. Un anglois, nommé Jean K ay,
a trouvé les moyens de faire travailler les étoffes
les plus larges à un feul ouvrier , qui les fabrique
aufli-bien , & n’emploie pas plus de tems que deux.
Ce méchanifme a çommencé à paroître fur la fin de
l’année 173 7 , & a valu à fon auteur toute la re-
connoiffance du Confeil; reconnoiffance proportion*,
née au mérite de l’invention, qui eft déjà établie en
plufieurs manufactures du royaume.
De la navette angloife, ou de la fabrique du drap{
par un homme feul. L’ufage de cette navette nè dérange
en aucune maniéré l’ancienne méthode de
monter les métiers ; elle confifte feulement à fe fer-:
vir d’une navette qui eft foutenue fur deux doubles
roulettes , outre deux autres roulettes fimples placées
fur le côté, q u i, lors du tra vail, fe trouvent
adoffées au rot ou peigne. Cette navette dévidé on
lance avec plus d’aélivité & en.même-tems plus de
facilité la duite ou le fil qui fournit l’étoffe, au
moyen d’un petit cône ou tambour tournant fur lequel
elle paffe , afin d’éviter le frottement qu’elle
fouffriroit en s ’échappant par l’ouverture latérale*
Elle contient encore plus de trame, & n’a pas be-
foin d’être chargée aufli fouvent que la trame ordinaire.
Elle ne comporte point de noeuds, & fabrique
par conféquent une étoffe plus unie. Une petite
planche de bois bien taillée en forme de lame
de couteau, de trois pouces & demi de large , de
trois lignes d’épaiffeur du côté du battant auquel
elle eft attachée, & de dix lignes de l’autre côté
de la longueur du large du métier, eft placée de
niveau à la cannelure du battant, dans fon deflous y
& à la hauteur de l’ouverture inférieure de la dent
du peigne.
Lorfque l’ouvrier foule la marche, afin d’ouvrir
la chaîne pour y lancer la navette, la portion des.
fils qui baiffent appuie fur cette planchette , de façon
que la navette à roulette ne trouve en paffant
ni flexibilité ni irrégularités qui la retiennent , ôc
va rapidement d’une lifiere à l’autre fans être arrêtées
Une piece de bois de deux lignes environ de hauteur
, & d’un pié & demi plus ou moins de longueur
, pofée fur la planche de chaque côté du bat-,
tant, contient la navette ,1a dirige, foit en entrant
foit en fortant ; car alors d ie fe trouve entre la la-;
me du battant & cette pente piece.
Pour donner le mouvement à la navette, une ef-;
pece de main de bois reepurbée à angles droits ,
dont la partie fupérieure eft garnie de deux crochets
de fil de fer , dans lefquels entre une petite tringle
de fer de la longueur de la navette , à laquelle eft
attachée une corde que l’ouvrier tient entre fes
mains, au milieu du métier, meut une plaque de
bois ou croffe qui chaffe la navette.
Mais Pinfpecfion de nos figures achèvera de rendre
tout ce méchanifme intelligible. Fôye^ donc la.
figure t5 . C ’eft une partie du rot & de la chaffe ,
avec la navette angloife en place. II faut imaginer,
le côté A de cette figure femblable à l’autre côté.'
c , partie de la chaffe ; D , deffus de la chaffe, ou la'
barre que l’ouvrier tient à la main pour frapper l’étoffe
; e, e, la rangée des dents du rot ou peigne ; f i fi,
la tringle qui foutientla croffe. Cette tringle eft attachée
à la chaffe ; g , la croffe avec fes anneaux
dans lefquels la tringle paffe ; h , la navette angloife
pofée fur la planchette i , i \ k , k , petite pièce
de bois pofée fur la planchette i ; imaginez au milieu
du quarrédela planchette ou croffe g,une corde
qui aille jufqu’à l’ouvrier, & qui s’étende jufqu’à
l’autre bout du métier c , où il faut fuppofer une
pareille croffe, au milieu de laquelle foit aufli attachée
l’autrè extrémité de la même corde.
Qu’arrivera-t-il après que l’ouvrier aura baiffé
une marche ? Le voici.
La moitié des fils de la chaîne fera appliquée fur
la planchette i; l’autre fera hauflee ; il y aura entre
les deux une ouverture pour paffer la navette.L’ouvrier
tirera fa corde dé gauche à droite ; la croffe
g gliffant fur la tringle de fe r , pouffera la navette^
L À !
là navette pouffée coulera fuir la planchette & fur
îes fils de chaîne baiffés , & s’en ira à l’autre bout
du métier, appuyée dans fa.courfe contre la jumelle
d’en-bas du peigne ôU rot. Un pareil mouvement de
corde, après que l’étoffe aura été frappée , la fera
jiaffer * à l’aidé d’une pareille croffe, placée au côté
6ù elle eft, dé ce côté à celui d’où ellé eft venue ,
& ainfi de fliite.
Mais une pieCe très ingénieufement imaginée, &
fur laquelle il faut fixer fon attention , c’eft la petite
piecé dé bois k , k ; elle eft taillée en dedans en s ,
& percée de deux trous m, n. Le trou m eft un peu
plus grand que le trou n. 11 y a dans chacun une
pointe dé fer fixée dans la jumelle d’en-bas , ou
plutôt dans la planchette fur laquelle la navette ëft
pofée.
Qu’arrive-t-il de-là ? Lorfque la navette fe préfente
en A: pour entrer, elle arrive jufqu’en n fans
effort ; en n elle preffe la piece , qui a là un peu
plus dë hauteur ou de faillie qu’ailleùrs ; mais le
trou m étarit un peu plus grand que le trou n , & ce
trou rti n’étant pas rempli exaftement par fa goupille
, là piece cede un peu , & la quantité dont
elle cede eft égale précisément à la différence du
diamètre du trou ni , & du diâmetre de la goupille
qui y paffe. Cela fuflit pour laiffer entrér la nà-
Vette qui fe trouve alors enfermée ; car la piece
k, k ne peut pas fedéplacer, paffé le point ou trou m,
qu’elle ne fe déplace de la même quantité paffé le trou
h ; àinfi la navette ne peut ni toucher, ni avancer,
ni reculer. Elle s’arrête contre la croffe ; & pouffée
enfuite par la croffe, elle a , au fortir de l’efpacé
terminé par la petite piece k , k , une efpece d*échàp-
pemént qüi ldi donne de la vîtèffe. Ajoutez à cela
que la planchette fur laquelle elle eft pofée, eft un
peu en talud vers le rot ou peigne.
On voit tfig. 1 6 , la navette en deffus, & fig. ijr,
la navette eh deffous ; a a eft fa longueur ; b b ,
fa poché ; ç , la bobine dans lé fil va paffer fur le
petit cylindre ou tambour t , & fortir par l’ouver-
iure latérale /. ce fqpt deux roulettes horifontales,
fixées dans fon épaiffeur, & qui facilitent fon mouvement
contre la jumelle inférieure du rot ; f f , f f
èn font quàtfe Verticales prifes âufîi dans fon épaif-
feur, mais verticalement, & qui facilitent fon mouvement
fur la planchette qui la foutient.
La figure 18 montre la bobine féparée de la navette
, & prête à être iiiife dans fà poche.
Avec le fecours d’une navette femblable, iin feul
Ouvrier peut fabriquer des draps larges, des étoffes
larges, des toiles larges, des couvertures, & généralement
toutes les étoffes auxquelles on emploie
deux ou trois hommes à la fois.
On affure qu’expérience faite avec cet infiniment
, le travail d’un homme équivaut au travail
de quatre autres avec la navette ordinaire.
Quoique la navette angloife convienne particulièrement
aux étoffes larges, on l’a effayée fur les
étoffes étroites , comme de trois quarts ou d’une
aune, & l’on a trouvé qu’elle ne réufliffoit pas moins
bien.
Paffer le drap à ta perche. Lorfque le drap eft fabriqué
, lé maître de la manufacture le fait paffer à
la perché pour reconnoître les fautes des tiffeurs ;
delà il paffé à l’épinfeur. L’épinféur en tire toutes
les pailles & autres ordures. D e l’épinfage il eft envoyé
au foulon.
DeVépinfage des draps. On voitfigure t f) , la tablé
de l’épinfeur.- A , le drap en toile bb, la table ; c
les tréteaux qui la foutiennertt ; d , tréteaux mobiles
pour incliner plus ou moins la table à diferétion.
Il faut avoir grand foin de mettre le drap épirifé
fuf des perches , fi on ne l’enyoie pas tout dé fuite
du foulon , parce que le mélange de l’huile dé la
Tome IX %
L À ï 19!
càfdé , dé la colle & de feau qui a fervî â hiimeClef
les trames, le feroit échauffer & pourrir, fi on né
l’étendoit pas pour le Faire féchèr.
Du dégràis & du foulage dés draps. Dans les bonnes
manufactures il y a un moulin à dégraiffer & un
moulin à fduler. C ’ëft le moulin à dégraiffer qu’on
"volt figure 20 , & le moulin â fouler qu’on voit
figure a t. Dans le premier, les branches ou manches
des maillets font pbfés hbrifontâlement, & les
augfes ou vaiffeaux toujours oùverts. Dans le fécond
, les branches font perpendiculaires , & les
vaiffeaux toujours fermés, afin que le drap n’ayant
point d’a ir , s’échauffe plus vîte & foulé plus facilement.
Ces derniers moulins font àppellés façon dè
Hollande, parce que c’eft de-là qu’ils nous viennent.
Celui de l’hôpital de Paris , fitué à Effonne, fur là
rivierô d’Etampes > eft trè’s-bién fàit.
Quand on veut qu’un drap foit garni & plus où
moins drappé, on lui donné plus où moins de largeur
fur le métier, & ori lé réduit à la même au
foulage. C ’eft le foulon qui donne, à proprement
parler, àux draperies leur confiftarice, l ’effet principal
des coups de maillets étant d'ajouter lé mérite
dii feutre à la régularité du tiffu. C’eft par uné
fuite de ce principe que les étoffes liffes reçoivent
leur dérnier luftre fans paffer par la foulerié , où
que , fi quelques - unes y font portées , e’elt pour
être bien dégorgées, & non pour être battues à fec %
elles perdroient eh s’étoffant la légèreté & le brillant
qui les cara&érifent.
Les étoffes qu’on y portera pour y prendre la
confiftence de drap, y gagneront beaucoup fi elles
ont eû leur chaîne &c leur trame de laine cardée y
ou du moins leur trame faite de fii lâche , & leur
chaîne filée de rebours. Plufieurs perfonnes qui
courroient dJun même côté , iroient loin fans fe
rencontrer ; mais elles ne tarderoient pas à fe heurter
& à fé croifer en marchant en fens contraires.
Il n’y a pas non-plus beaucoup d’union à attendre
des poils de deux fils lâches, s’ils ont été filés au
rouet dans le même fens. Mais fi l’un des deux fils
a été fait à corde ouverte & l’autre à corde croi-
fée ; fi les poils de la chaîne font couchés dans un
fens , & ceux de la trame dans un autre , l’infer-
tion & le mélange des poils fe fera mieux. Quand
les maillets battent & retournent l’étoffe dans la
pile du foulon , il n’y a point de poils qui ne s’ébranlent
à chaque coup. Les poils qui fous un coup
formeront une ehambrette en fe courbant ou en fe
féparant des pôils voifins, s’affaiffent ou s’allongent
fous un autre coup qui aura tourné l’étoffe d’un
nouveau fens, le propre du maillet & la façon dont
la pile eft creufée, étant de faire tourner le drap à
chaque coup qu’il reçoit; Si donc les poils de la
chaîne & de la trame ont été filés en fens contraires
, & qu’ils fe hériffent, les uns en tendant à droite
, & les autres en tendant à gauche, ils formeront
déjà un commencement de mélange, qui s’àchevera
fous l’impreflion des maillets. Mais l’engrenage en
fera d’autant plus prompt, fi les deux fils font d’une
laine rompue à la ca rde, comme il fe pratique pour
les draps.
Toute autre étoffe à fil de trame fur étaim , fe
drappera fuffifammènt par la fimple précaution du
fil de rebours , & acquérera au point defiré la contention
& la folidité du feutre; On dit jufqu'aupoint
defiré j car fi l’étoffe, foit drap , foit ferge ,- dev.e-.
noit vraiment feutre, par une fuite de fon renflement
, elle fe retireroit trop fur fa largeur & fur fa
longueur ; elle fe diôoudroit même fi on la pouffoit
trop à la foulerie.
Mais, dira-t-on, ne pourroit-onpas aufli-bien filer
les chaînes à corde çroifée > & les trames k corde
B b ij