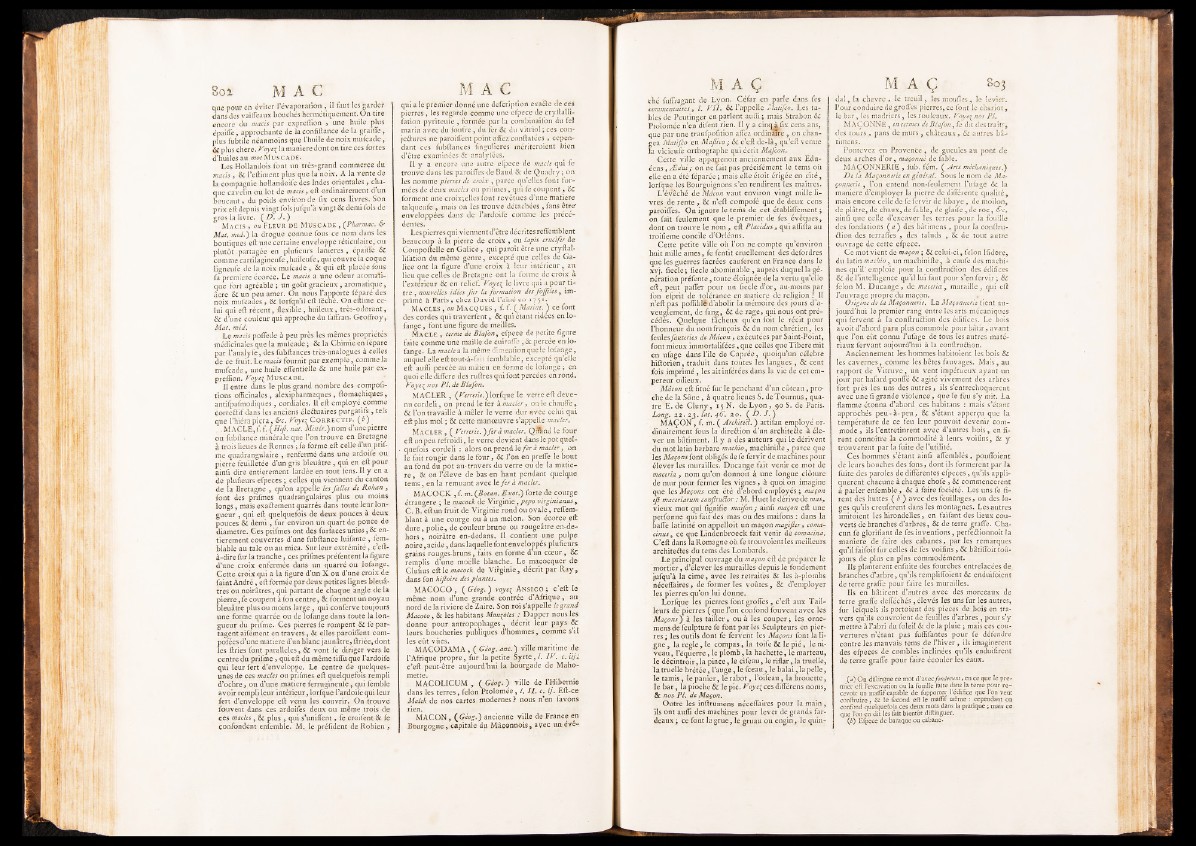
que pouf eh éviter l’évaporation , il faut les garder
dans des vaifléaux bouchés hermétiquement. On tire
encore du macis par expreffion , une huile plus
épailïe, approchante de la confiftance de la graiffe,
plus fubtile néanmoins que l’huile de noix mufcade,
& plus chere. Voye^ la maniéré dont on tire ces fortes
d’huiles au mot Mu sc ad e .
Les Hollandois font un très-grand commerce du
macis, 6c l’eftiment plus que la noix. A la vente de
la compagnie hollandoife des Indes orientales , chaque
cavelin ou lot de macis, eft ordinairement d’un
boucaut, du poids environ de fix cens livres. Son
prix eft depuis vingt fols julqu’a vingt 6c demi fols de
gros la livre. ( D. J . )
Macis -, 0« Fleur de Mu scade , (Pharmac. &
Mat. med.) la drogue connue fous ce nom dans les
boutiques eft une certaine enveloppe réticulaire, ou
plutôt partagée en plufieurs lanières , épaifle 6c
comme cartilagineufe, huileufe, qui couvre la coque
li^neufe de la noix mufcade , & qui eft placée fous
fa première écorce. Le macis a une odeur aromatique
fort agréable ; Un goût gracieux, aromatique,
âcre 6c un peu amer. On nous l’apporte féparé des
noix mufeades , 6c lorfqu’il eft féché. On ettime celui
qui eft récent, flexible, huileux, très-odorant,
& d’une couleur qui approche du faffran. Geoffroy,
Mat. mèd.
Le macis poffede à peu près les mêmes propriétés
médicinales que la mufcade ; & la Chimie en fépare
par l’analyfe, des fubftances très-analogues à celles
de ce fruit. Le macis fournit par exemple, comme la
mufcade, une huile effentielle 6c une huile par ex-
preflion. Voyc{ MUSCADE.
Il entre dans le plus grand nombre des compofi-
tions officinales, alexipharmaques , ftomachiques,
antifpafmodiques , cordiales. Il eft employé comme
correétif dans les anciens éleâuaires purgatifs , tels
que l’hiéra picra, &c. Voye[ C o r r e c t if . (£)_
. MACLE, f. f. (Hijl. nat. Miner.) nom d’une pierre
ou fubftance minérale que l’on trouve en Bretagne
à trois lieues de Rennes ; fa forme eft celle d’un prif-
me quadrangulaire , renfermé dans une ardoife ou
pierre feuilletée d’un gris bleuâtre , qui en eft pour
ainfi dire entièrement lardée en tout fens. Il y en a
de plufieurs efpeces ; celles qui viennent du canton
de la Bretagne , qu’on appelle les f ailes de Rohan ,
font des prifmes quadrangulaires plus ou moins
longs, mais exactement quarrés dans toute leur longueur
, qui eft quelquefois de deux pouces à deux
pouces 6c d emi, fur environ un quart de pouce de
diamètre. Ces prifmes ont des furfaces unies, 6c entièrement
couvertes d’une fubftance luifante , fem-
blable au talc ou au mica. Sur leur extrémité, c’eft-
à-dire fur la tranche , ces prifmes préfentent la figure
d’une croix enfermée dans un quarré ou .lofange.
Cette croix qui a la figure d’un X ou d’une croix de
faint André, eft formée par deux petites lignes bleuâtres
ou noirâtres, qui partant de chaque angle de la
pierre ,fe coupent à fon centre, & forment un noyau
bleuâtre plus ou moins large , qui conferve toujours
une forme quarrée ou de lofange dans toute la longueur
du prifme. Ces pierres fe rompent & fe partagent
aifément en travers, & elles paroiffent com-
pofées d’une matière d’un blanc jaunâtre, ftriée, dont
les ftries font parallèles, 6c vont fe diriger vers le
centre du prifme, qui eft du même tiffu que l’ardoife
qui leur fert d’enveloppe. Le centre de quelques-
unes de ces macles ou prifmes eft quelquefois rempli
d’ochre , ou d’une matière ferrugineule, qui femble
avoir rempli leur intérieur, lorfque l’ardoif'e qui leur
fert d’enveloppe eft venu les couvrir. On trouve
fouvent dans ces ardoifes deux ou même trois de
ces macles , 6c plus , qui s’unifient, fe croifent & fe
confondent enfemble. M. le préfident de Robien,
qui a lé premier donné une defeription exa&e de ces
pierres, les regarde comme une efpece de cryftalli-
i'ation pyriteuie , formée par la combinaifon du fel
marin avec du foutre, du fer & du vitriol ; ces conjectures
ne paroiffent point allez conftatées , cependant
ces fubftances fingulieres mériteroient bien
d’être examinées & analyfées.
Il y a encore une autre efpece de macle qui fe
trouve dans les paroiffes de Baud & de Quadry ; on
les nomme pierres de croix , parce qu’elles font formées
de deux macles ou prifmes, qui fe coupent, 6c
forment une croix pelles font revêtues d’une matière
talqueufe , mais on les trouve détachées , fans être*
enveloppées dans de l’ardoife comme les précédentes.
Les pierres qui viennent d’être décrites reffemblent
beaucoup à la pierre de croix , ou lapis crucifer de
Compoftelle en Galice, qui paroît être une cryftal-
lifation du même genre, excepté que celles de Galice
ont la figure d’une croix à leur intérieur, au
lieu que celles de Bretagne ont la forme de croix a
l’exterieur 6c en relief. V&ye^ le livre qui a pour titre
, nouvelles idées fur la formation des fofjiles, imprimé
à Paris, chez David l’aîné en 1751.
M a c l e s , ou M a c q u e s , f. f . ( Marine. ) ce font
des cordes qui traverfent, & qui étant ridées en lofange
, font une figure de mailles.
Ma c l e , terme de Blafon, efpece de petite figure
faite comme une maille de cuiraffe , & percée en lofange.
La macle a la même dimenfion que le lofange ,
auquel elle eft tout-à-fait femblable, excepté qu’elle-
eft auflî percée au milieu en forme de lofange ; en
quoi elle différé des ruftres qui l’ont percées en rond.
Voye^ nos PI. de Blafon.
MACLER , (Verrerie.) lorfque le verre eft devenu
cordeli, on prend le fer à macler, on le chauffe,
& l’on travaille à mêler le verre dur avec celui qui
eft plus mol ; & cette manoeuvre s’appelle macler.
M A CL ER , ( Verrerie.) fer a macler. Quând le four
eft un peu refroidi, le verre devient dans le pot quelquefois
cordeli 'alors on prend ït fer à macler , on
le fait rougir dans le four, 6c l’on en preffe le bout
au fond du pot au-travers du verre ou de la matièr
e , & on l’éleve de bas en haut pendant quelque
tems, en la remuant avec \t fer à macler.
M ACOCK , f. m. (Botan. Exot.) forte de courge
étrangère ; le macock de Virginie, pepo virginianus ,
C. B. eft un fruit de Virginie rond ou o vale, reffem-
blant à une courge ou à un melon. Son écorce eft
dure, polie, de couleur brune ou rougeâtre en-dehors
, noirâtre en-dedans. Il contient une pulpe
noire, acide, dans laquelle font enveloppés plufieurs,
grains rouges-bruns, faits en forme d’un coe u r, 6c
remplis d’une moelle blanche. Le macocquer de
Clufius eft le macock de Virginie, décrit par Ray ,
dans fon hifoire des plantes.
M A C O C O , (G éog .) voyei A n s i c o ; c ’eft le
même nom d’une grande contrée d’Afrique, au
nord de Iariviere de Zaire. Son roi s’appelle le grand
Macoco, & les habitans Moufles : Dapper nous les
donne pour antropophages, décrit leur pays 6c
leurs boucheries publiques d’hommes, comme s il
les eût vûcs.
M A CODAMA, ( Géog. anc.) ville maritime de
l’Afrique propre, fur la petite Syrte,/. IV . c. iij
c’eft peut-être aujourd’hui la bourgade de Maho-
mette.
MACOLICUM , ( Géog. ) ville de l’Hibernie
dans les terres, félon Ptolomee, l. I I . c. i j . Eft-ce
Malek de nos cartes modernes ? nous n’en favons
rien.
MACON , (Géog.) ancienne ville de France en
Bourgogne, capitale du Mâconnois, avec uaévêr
cW fuffragant de Lyon. Céfar en parle dans fes
commentaires, l. V il . & l’appelle Matifco. Les tables
de Peutinger en parlent aufli ; mais Strabon 6c
Ptolomée n’en difent rien. Il y a cinq à fix cens ans,
que par une tranfpofition affez ordinaire , on changea
Matifco en Maflico ; 6c c’eft de-là, qu’eft venue
la vicieufe orthographe qui.écrit Mafcon.
Cette ville appartenoir anciennement aux Edu-
éens ,Æd ui; on ne fait pas précifément le tems où
elle en a été féparée ; mais elle étoit érigée en cité,
lorfque les Bourguignons s’en rendirent les maîtres.
L’évêché de Mâcon vaut environ vingt mille livres
de rente , 6c n’eft compofé que de deux cens
paroiffes. On ignore le tems de cet établiffement ;
on fait feulement que le premier de fes évêques,
dont on trouve le nom, eft Placidus , qui aflifta au
troifieme concile d’Orléans.
Cette petite ville où l’on ne compte qu’environ
huit mille âmes, fe fentit cruellement des defordres
que les guerres facrées cauferent en France dans le
xvj. fiecle; fiecle abominable , auprès duquel la génération
préfente, toute éloignée de la vertu qu’elle
eft, peut paffer pour un fiecle d’or, au-moins par
fon efprit de tolérance en matière de religion ! Il
n’eft pas pofliblS d’abolir la mémoire des jours d ’aveuglement,
de fang, 6c de rage, qui nous ont précédés.
Quelque fâcheux qu’en foit le récit pour
l’honneur du nom françois 6c du nom chrétien, les
feules fauteries de Mâcon , exécutées par Saint-Point,
font mieux immortalifées, que celles que Tibere mit
en ufage dans l’île de Caprée, quoiqu’un célébré
hiftorien, traduit dans toutes les langues , 6c cent
fois imprimé, les ait inférées dans la vie de cet empereur
odieux.
Mâcon eft fitué fur le penchant d’un coteau, proche
de la Sône, à quatre lieues S. de Tournus, quatre
E. de Clun y , 15 N. de L y on , ,90 S. de Paris.
Long. 22. 23. lat. 46". 20. ( D . J . )
M A CON , f. m. ( ArchiteÙ. ) artilan employé ordinairement
fous la direftion d’un architecte à élever
un bâtiment. Il y a des auteurs qui le dérivent
du mot latin barbare machio, machinifte , parce que
les Maçons font obligés de fe fervir de machines pour
élever les murailles. Ducange fait venir ce mot de
maceria , nom qu’on donnoit à une longue clôture
de mur pour fermer les vignes, à quoi on imagine
que les Maçons ont été d’abord employés ; maçon
ejl maceriarum conftruclor : M. Huet le dérive de mas,
vieux mot qui lignifie maifon ; ainfi maçon eft une
perfonne qui fait des mas ou des maifons : dans la
baffe latinité on appelloit un maçon magifler, coma-
cinus, ce que Lindenbroeck fait venir de comacina.
C ’eft dans laRomagne où fe trouvoient les meilleurs
architectes du tems des Lombards.
Le principal ouvrage du maçon èft de préparer le
mortier, d’élever les murailles depuis le fondement
jufqu’à la cime, avec les retraites & les à-plombs
néceffaires, de former les voûtes, 6c d’employer
les pierres qu’on lui donne.
Lorfque les pierres fontgroffes, c’eft aux Tailleurs
de pierres ( que l’on confond fouvent avec les
Maçons ) à les tailler, ou à les couper ; les orne-
mens de fculpture fe font par les Sculpteurs en pierres
; les outils dont fe fervent les Maçons font la ligne
, la réglé, le compas, la toife & le pié, le niveau
, l’équerre, le plomb, la hachette, le marteau,
le décintroir, la pince, le cifeau, le riflar, la truejle,
la truelle brétée, l’auge, le fceau, le balai, la pelle,
le tamis, le panier, le rabot, l’oifeau, la brouette,
le bar, la pioche 6c le pic. Voyc^ ces différens noms,
& nos. PI. de Maçon.
Outre les inftruméns néceffaires pour la main,
ils ont aufli des machines pour lever de grands fardeaux
; ce font la grue, le gruau ou engin, le quin-
M A Ç 803
da l, la chevre , lé treuil, les moufles, le levier.
Pouf conduire cle groffes pierres, ce font le chariot,
le b ar, les madriers, les rouleaux. Voye^ nos PL
MAÇONNÉ, en termes de Blafon, fe dit des traitr*
des tours , pans de murs , châteaux, 6c autres bâ-
timens.
Pontevez en Provence, de gueules au pont de
deux arches d’o r , maçonné de fable.
MAÇONNERIE , fub. fém. ( Arts méchariiqucs.)
De la Maçonnerie en général. Sous le nom de Maçonnerie
, l’on entend non-feulement l’ufage 6c la
maniéré d’employer la pierre de différente qualité,
mais encore celle de fe fervir de libaye , de moilon,
de plâtre, de chaux, de fable, de glaife , de roc, &c.
ainfi que celle d’excaver les terres pour la fouille
des fondations ( a ) des Bâtimens , pour la conftru-
élion des terraffes , des taluds , 6c de tout autre
ouvrage de cette efpece.
Ce mot vient de maçon ; 6c celui-ci, félon Ifidore,
du latin machio, un machinifte, à caufe des machines
qu’il' emploie pour la conftruôion des édifices
6c de l’intelligence qu’il lui faut pour s’en fervir ; 6c
félon M. Ducange, dé macerice, muraille, qui eft
l’ouvrage propre du maçon.
Origine de la Maçonnerie. La Maçonnerie tient aujourd’hui
le premier rang entre les arts mécaniques
qui fervent à la conftrucfion des édifices. Le bois
a voit d’abord paru plus commode pour bâtir, avant
que l’on eût connu l’ufage de tous les autres matériaux
fervant aujourd’hui à la conftru&ion.
Anciennement les hommes habitoient les bois &
les cavernes, comme les bêtes fauvages. Mais, au
rapport de Vitruve, un vent impétueux ayant un
jour par hafard-pouffé 6c agité vivement des arbres
fort près les uns des autres, ils s’entrechoqueront
avèc une fi grande violence, que le feu s’y mit. La
flamme étonna d’abord ces habitans : mais s’étant
approchés p eu -à -peu, 6c s’étant apperçu que la
température de ce feu leur pouvoit devenir commode
, ils l’entretinrent avec d’autres bois, en firent
connoître la commodité à leurs voifins, & y
trouvèrent par la fuite de l’utilité.
Ces hommes s’étant ainfi affemblés, pouffoient
de leurs bouches des fons, dont ils formèrent par la
fuite des paroles de différentes efpeces, qu’ils appliquèrent
chacune à chaque chofe, 6c commencèrent
à parler enfemble , 6c à faire fociété. Les uns fe firent
des huttes ( b ) avec des feuillages, ou des loges
qu’ils creuferent dans les montagnes. Les autres
imitoient les hirondelles, en faifant des lieux couverts
de branches d’arbres, 6c de terre graffe. Chacun
fe glorifiant de fes inventions, perfe&ionnoit la
maniéré de faire des cabanes, par les remarques
qu’il faifoit fur celles de fes voifins , 6c bâtiffoit toujours
de plus en plus commodément.
Ils plantèrent enfuite des fourches entrelacées de,
branches d’arbre, qu’ils rempliffoient 6c enduifoient
de terre graffe pour faire les murailles.
Ils en bâtirent d’autres avec des morceaux de
terre graffe defféchés , élevés les uns fur les autres,
fur lelquçls ils portoient des pièces de bois en travers
qu’ils couvroient de feuilles d’arbres , pour s’y
mettre à l’abri du foleil & de la pluie ; mais ces couvertures
n’étant pas fuffifantes pour fe défendre
contre les mauvais tems de l’hiver, ils imaginèrent
des efpeces de combles inclinées qu’ils enduifirent
de terre graffe pour faire écouler les eaux.
(a) On diflingue ce mot d’avec fondement, en ce que le premier
eft l’excavation ou la fouille faite dans la terre pour recevoir
un maflif capable de fupporcer l’édifice que l’on veut
conftruire, & le fécond eft le maffif même : cependant on
confond quelquefois ces deux mots dans la pratique ; mais ce
que l’on en dit les fait bientôt diftinguer.
(£) Efpece de baraque ou cabane.