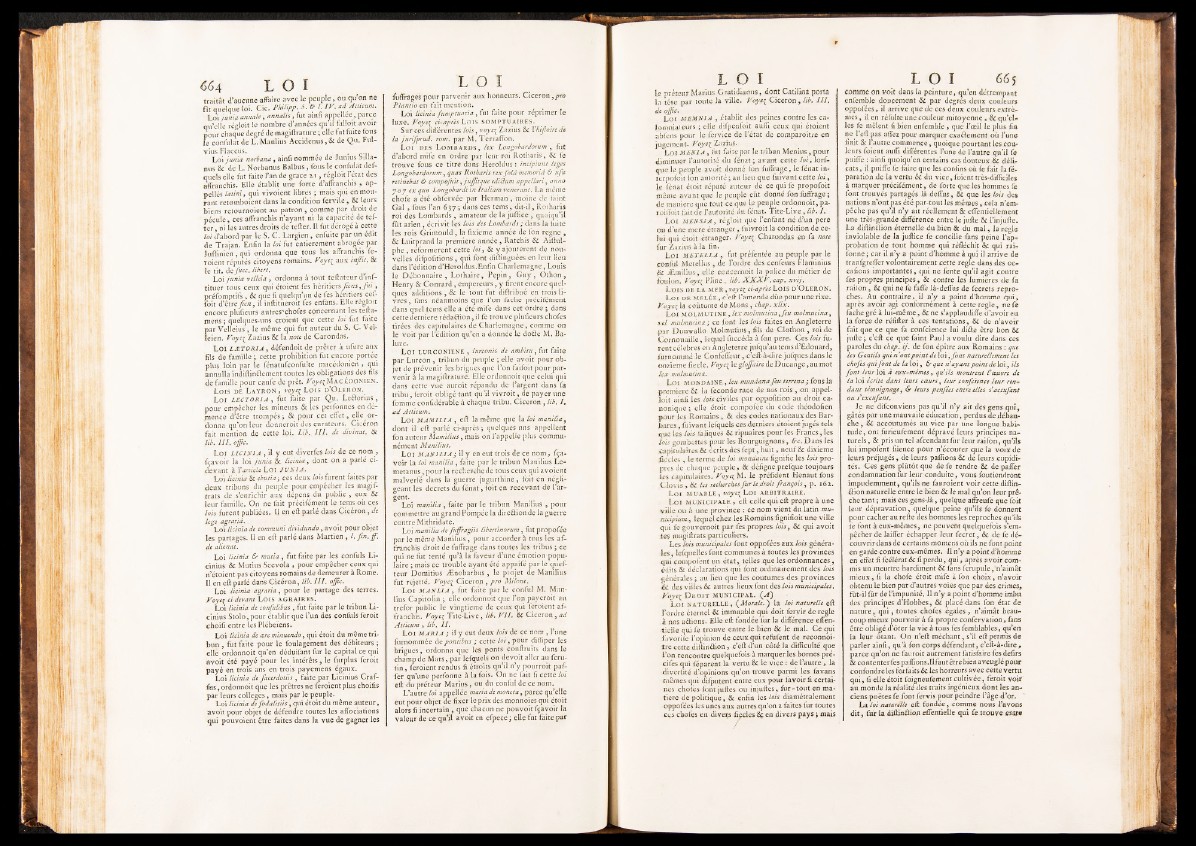
traitât d’aucune affaire avec le peuple, ou qu?on ne
fit quelque loi. Cic. Philipp. i. & g IV- ad Atticum.
Loi j uni a annale , annahs, fut ainfi appellee, parce
qu’elle régloit le nombre d’années qu’il falloit avoir
pour chaque degré de magiftrature ; elle fut faite fous
le confulat de L. Manlius Accidenus, & de Qu. Fül-
vius Flaccus. . . , . ,
Loi junia norbana, ainfi nammee de Junius oiüa-
nus 6c de L. Norbanus Balbus, fous le confulat def-
quels elle fut faite l’an de grâce 2.1, régloit l’état des
affranchis. Elle établit une forte d’affranchis , appelles
latini, qui vivoient libres ; mais qui en mourant
retomboient dans la condition fervile, & leurs
biens retournoient au patron , comme par droit de
pécule, ces affranchis n’ayant ni la capacité dè tef-
te r , ni les autres droits de tefter. Il fut dérogé à cette
loi d’abord par le S. C. Largien, enfuite par un édit
de Traian. Enfin la loi fut entièrement abrogée par
Juftinien, qui ordonna que tous les affranchis fe-
roient réputés citoyens romains. Voye^ aux injlit. &
le tit. de fucc. libert.
Loi junia velleia , ordonna à tout teftateur d inl-
tituer tous ceux qui étoient fes héritiers fieris , f u i ,
préfomptifs , 6c que fi quelqu’un de fes héritiers cef-
foit d’être fien, il inftitueroif fes enfans. Elle régloit
encore plufieurs autres-'çhofes concernant les tefta-
mens ; quelques-uns croient que cette loi fut faite
par V elleius, le même qui fut auteur du S. C. Vel-
leïen. Voye^ Zazius 6c la note de Carondas.
L o i l æ t o r i a , d é fe n d o it d e p r ê te r à u fu r e a u x
fils d e fam ille ; c e t te p ro h ib i t io n fu t e n c o r e p o r té e
p lu s lo in p a r l e fé n a tu fc o n ft i lte m a c é d o n ien , q u i
a n n u lla in d ift in& em e n t to u te s le$ o b lig a t io n s des fils
d e fam ille p o u r c a u fe de p rê t . Voye{ M a c é d o n i e n .
L ois d e L a y r o n , voye^ L o is d’Q i,eron.
L oi l e c t o r i a , fut faite par Qu. Leftorins,
pour empêcher les mineurs & les perfonnes en démence
d’être trompés; & pour cet effet, elle ordonna
qu’on leur donneroit des curateurs. Cicéron
fait mention de cette lpi. Lib. I I I . de divinat. &
lib. I II. offiç.
L o i l i c i n i a , il y eut diverfes lois de ce nom ,
fçavoir la loi junia & Liçinia, dont pn a parle ci-
devant à Y article L o i j u n i a .
Loi licinia & ebutia-, ces deux lois furent faites par
deux tribuns du peuple pour empêcher les magif-
trats de s’enrichir aux dépens du public , eux 6c
leur famille. On ne fait précifément le tems où ces
lois furent publiées. U en eft parlé dans Cicéron, de
lege agrariâ.
Loi licinia de commuai dividundo, avoit pour objet
les partages. 11 en eft parlé dans Martien , l. fin. f .
de aliénât.
Loi licinia & mutia, fut faite par les confuls Li-
cinius 6c Mutius Scevola , pour empêcher ceux qui
n’étoient pas citoyens romains de demeurer à Rome.
Il en eft parlé dans Cicéron, lib. I II. offic.
L o i licinia agraria, p o u r le p a r ta g e d e s te r r e s .
Voye^ ci-devant LO IS AG RAIRES .
Loi licinia de confulibus , fut faite par le tribun Li-
cinius Stolo ,pour établir que l’un des confuls feroit
choifi entre les Plébéiens.
Loi licinia de art minuindo, qui étoit du meme tribun
, fut faite pour le foulagement des débiteurs ;
elle o.rdpnnoit qu’en déduifant fur le capital ce qui
avoit été payé pour les intérêts, le furplus feroit
payé en trois ans en trois payemens égaux.
Loi licinia de facerdotiis , faite par Licinius Craf-
fus, ordonnoit que les prêtres ne feroient plus choifis
par leurs colleges, mais par le peuple.
Loi licinia de fodal'mis, qui étoit du même auteur,
avoit pour objet de défendre toutes les affociations
qui pouvoient être faites dans la vue de gagner les
fuffrages pour parvenir aux honneurs. Cicéron,/)«
Plantio en fait mention.
Loi licinia fumptuaria, fut faite pour réprimer le
luxe. Voyt{ ci-après LOIS SOMPTUAIRES.
Sur c.es différentes lois, voye^ Zazius 6c Yhifoire de
la jurifprud. rom. par M. Terraflon.
L o i des L om b a r d s , lex Longobardorum , fut
d’abord mife en ordre par leur roi Rotharis, 6c fe
trouve fous ce titre dans Heroldus : incipiunt leges
Longobardorum, quas Rotharis rex folà memoriâ & uju
retinebat & compojuit, jufjïtque ediclum appellari, anno
yoy ex quo Longobardi in Italiam vénérant. La même
chofe a été obfervée par Herman , moine de faint
Gai , fous l’an 637; dans ces tems, dit-il, Rotharis
roi des Lombards , amateur de la juftice , quoiqu’il
fût arien, écrivit les lois des Lombards ; dans la fuite
les rois Grimould , la fixieme année de fon régné ,
6c Luitprand la première année, Ratchis ôc Aiftul-
phe , réformèrent cette loi, & y ajoutèrent de nouvelles
difpofitions , qui font diftinguées en leur lieu
dans l’édition d’Heroldus. Enfin Charlemagne, Louis
le Débonnaire , Lothaire, Pépin, G u y , Othon ,
Henry & Conrard, empereurs, y firent encore quelques
additions , 6c le tout fut diftribué en trois livres
, fans néanmoins que l’on fâche précifément
dans quel tems elle a été mife dans cet ordre ; dans
cette derniere rédaftion, il fe trouve plufieurs chofes
tirées des capitulaires de Charlemagne, comme on
le voit par l’édition qu’en a donnée le do&e M. Baluze.
L o i lurconiene , lurconis de ambitu, fut faite
par Lurcon , tribun du peuple ; elle avoit pour objet
de prévenir les brigues que l’on faifoit pour parvenir
à la magiftrature. Elle ordonnoit que celui qui
dans cette vue auroit répandu de l’argent dans fa
tribu, feroit obligé tant qu’il v iv ra it , de payer une
fomme confidérable à chaque tribu. Cicéron , lib. I,
ad Atticum.
L o i m a m i l i a , eft la même que la loi manilia,
dont il eft parlé ci-après; quelques-uns appellent
fon auteur Mamilius, mais on l’appelle plus communément
Manilius.
L o i m a n i l i a j il y en eut trois de ce nom, fçavoir
la loi manilia, faite par le tribun Manilius Le-
metantis, pour la recherche de tous ceux qui avoient
malverfé dans la guerre jugurthine, l'oit en négligeant
les decrets du fénat, loit en recevant de l’ar-
gent.
Loi manilia , faite par le tribun Manilius , pour
commettre au grand Pompée la direûion de la guerre
contre Mithridate.
Loi manilia de fujfragiis libertinorum, fut propofée
par le même Manilius, pour accorder à tous les affranchis
droit de fuffrage dans toutes les tribus ; ce
qui ne fut tenté qu’à la faveur d’une émotion populaire
; mais ce trouble ayant été appaifé par le quef-
teur Domitius Ænobarbus , le projet de Manilius
fut rejette. Voye^ Cicéron , pro Milone.
L o i m a n l i a , fut faite par le conful M. Manlius
Capitolin ; elle ordonnoit que l’on paycroit au
trefor public le vingtième de ceux qui feroient affranchis.
Voye% Tite-Live, lib. V il . & Cicéron, ad
Atticum, lib. II.
L o i m a r i a ; il y eut deux lois de ce nom , l’une
furnommée de pontibus ; cette loi, pour diflîper les
brigues, ordonna que les ponts çonftruits dans le
champ de Mars, par lefquels on devoit aller au feru-
tin, feroient rendus fi étroits qu’il n’y pourroit paf-
fer qu’une perfonne à la fois. On ne fait fi cette loi
eft du préteur Marius, ou du conful de ce nom.
L’autre loi appellée maria de moneta, parce qu’elle
eut pour objet de fixer le prix des monnoies qui étoit
alors fi incertain , que chacun ne pouvoit fçavoir la
valeur de ce qu’il avoit en efpece ; elle fut faite par
le nréteur Marius Gratidianus, dont Catilina porta
la tête par toute la ville. Voyei Cicéron, lib. III.
de ojjic.
L o i MEMN14 , établit des peines contre les ea*
lomniateurs ; elle difpenfoit aufli ceux qui étoient
a biens pour le fcryiçe de l ’état de eomparoître en
jugement. Voye^ Zazius.
L o i m e n ia , fut faite par le tribun Meniws, pour
diminuer l’autorité du fénat; avant cette loi, lorf-
que le peuple av.oit donné fon fuffrage, le fénat in-
terpofoit fon autorité ; au lieu que fuivant .cette lo i,
le fénat étoit réputé auteur de ce qui {e propofoit :
mêoîe avant que le peuple eût donné fon fiiffrage;
de maniéré que tout ce que le peuple ordonnoit, p a - j
roiûbit fait de l’autorité du fénat. Tite-Live, lib. I .
L o i m en s i-a , régloit que l’enfant né d’un pere
ou d’une mere étranger, fuivroit la condition de celui
qui étoit étranger. Voyei Charondas en fa note
fur Zazius à la fin.
L o i m e t e l l a , fut préfentée au peuple par le
conful MeteUus, de l’ordre des cenfeurs Flaminius
Æmilius , elle coneemoit la police du métier de
foulon. Voyc[ Pline, lib. X X X V . cap. xvij.
L ’o i s d e l a m e r , voyez ci-après L o i s d ’O l e r o n .
L o i d e m e l é e » c’eft l’amende due pour une rixe.
Voye{ la coutume de Mons , chap. x lix .
L o i M O LM U T IN E , lex molnmtina,feu molmucina,
vcl mulmuùna ; ce font les lois faites en Angleterre
par Dunwallo Mol mutin s , fils de Clothon, roi de
Cornouaille, lequel fuccéda à fon pere. Ces lois furent
célébrés en Angleterre jnfqu’au tems d’Edouard,
iùrnommé le Confefleur, c’eft à-dire julquesdans le
onzième fiecle. Voye^ le glojfaire de Ducange, au mot
le x molmutina.
L o i mondaine , lex mundana feu terrena; fous la
■ première & la fécondé race de nos ro is , on appel-
Joit ainfi les lois civiles par oppofition au droit canonique
; elle étoit compofée du code théodofien
pour les Romains, & des codes nationaux des Barbares
, fuivan t lefquels ces .derniers étoient jugés tels
que les lois ialiques & ripuaires pour les Francs, les
lois gombettes pour les Bourguignons, &c. Dans les
.capitulaires &i écrits des fept, huit, neuf & dixième
fiçdes , le terme de loi mondaine fignifie les lois propres
de chaque peuple, & défigne prefque toujours
les capitulaires. Voye^ M. le préfident Henaut fous
Clovis , Us recherches fu r le droit français, p. 162.
L o i m u a b l e , voyc{ L o i a r b i t r a i r e .
L o i m u n i c i p a l e , eft celle qui eft propre à une
ville ou à une province : ce nom vient du latin mu-
nïcipïuin, lequel chez les Romains fignifioit une ville
qui fe gouvernoit par fes propres lois, & qui avoit
les magiftrats particuliers.
Les lois municipales font oppofées aux lois générales
, lfifqnelles font communes à toutes les provinces
qui çompofent un état, telles que les ordonnances,
édits & déclarations qui font ordinairement des lois
générales ; au lieu que les coutumes des provinces
& des villes & autres lieux font des lois municipales.
V oy e i D r o i t m u n i c i p a l , { à )
L o i n a t u r e l l e , ( Morale. ) la loi naturelle eft
Tordre éternel & immuable qui doit fervir de réglé
à nos aâions. Elle eft fondée fur la différence effen-
tieile qui fe trouve entre le bien & le mal. Ce qui
fdvorii’e l’opinion de ceux qui refùfent de reconnoî-
tre cette diftinûion, c’eft d’un côté la difficulté que
l’on rencontre quelquefois à marquer les bornes pré-
cifes qui féparent la vertu & le vice : de l’autre , la
diverfité d’opinions qu’on trouve parmi les favans
mêmes qui difputent entre eux pour favoir fi certaines
chofès font juftes ou injuftes , fur-tout en matière
de politique, & enfin les lois diamétralement
oppofées les unes aux autres qu’on a faites fur toutes
cc;s cbofçs en divers ficelés §1. en divers pays ; mais
Comme on voit dans la peinture, qu’en détrempant
enfemble doucement ,& par degrés deux couleurs
oppofées, il arrive que de ces deux couleurs extrêmes
, il en réfulte une couleur mitoyenne, & qu’elles
fe mêlent fi bien enfemble » que l’oeil le plus fin
ne Teftpas affezpour marquer exactement où l’une
finit St l’autre commence, quoique pourtant les cou»
leurs foient aufli différentes l’une de l’autre qu’il fe
puiffe : ainfi quoiqu’en certains cas douteux & délicats,
il puiffe & faire que les confins où fe fait la réparation
de la vertu & du vice, foient très-difficiles
à marquer précifément, de forte que les hommes fe
font trouvés partagés là deffus, & que les lois des
nations n’ont pas été par-tout les mêmes, cela n’empêche
pas qu’il n’y ait réellement & eflentiellement
une très-grande différence entre le jnfte & Tinjufte.
La diftinâion éternelle du bien & du mal, la réglé
inviolable de la juftice fe concilie fans peine l’approbation
de tout homme qui réfléchit & qui rai-
lonne ; car il n’y a point d’homme à qui il arrive de
tranfgreffer volontairement cette regLe dans des oc»
cafions importantes, qui ne fente qu’il agit contre
fes propres principes , & contre les lumières de fa
raiion, & qui ne fe faflè là-deflùs de feerets reproches.
Au contraire, il n’y a point d’homme qui,
après avoir agi conformément à cette réglé, ne fe
fâche gré à lui-même, & ne s’applaudiffe d’avoir eu
la force de réfifter à ces tentations, & de n’avoir
fait que ce que fa confidence lui diâe être bon 6c
jufte ; c’eft ce que faint Paul a voulu dire dans ces
paroles du chap. ij. de fon épître aux Romains : que
les Gentils qui n’ont point de loi ,font naturellement les
chofes qui font de la lo i, & que n'ayant point de loi, ils
font leur loi à eux-mêmes, qu'ils montrent l ’oeuvre de
la loi écrite dans leurs coeurs, Leur confcience leur rendant
témoignage, & leurs penfées entre elles s’açcyfant
ou s’exeufant.
Je ne difeonviens pas qu’il n’y ait des gens qui,
gâtés par une m au vaife éducation, perdus de déhaur
ch e , 6c accoutumés au vice par une longue habitude
, ont furieufemenr dépravé leurs principes naturels
, & pris un tel afcendantfur leur raifon, qu’ils
lui impofent fiience pour n’écouter que la voix de
leurs préjugés, de leurs pallions 6c de leurs cupidités.
Ces gens plutôt que de fe rendre 6c de pafler
condamnation fur leur conduite, vous fout’iendront
impudemment, qu’ils ne fauroient voir cette diûin-
ôion naturelle entre le bien 6c le mal qu’on leur prêche
tant ; mais ces gens-là, quelque affreufe que foit
leur dépravation, quelque peine qu’ils fe donnent
pour cacher au refte des hommes Les reproches qu’ils
fe font à eux-mêmes, ne peuvent quelquefois s’empêcher
de laiffer échapper leur fecret, 6c de fe découvrir
dans de certains momens où ils ne font point
en garde contre eux-mêmes. Il n’y a point d’homme
en effet fi fcélérat 6c fi perdu, qui, après avoir commis
un meurtre hardiment 6c fans fcrupule,'n’aimât
mieux, fi la chofe étoit mife à fon choix, n’avoir
obtenu le bien par d’autres voies que par des crimes,
fût-il fûr de l’impunité. Il n ’y a point d’homme imbu
des principes d ’Hobbes, 6c placé dans fon état de
nature, q u i, toutes chofes égales , n’aimât beaucoup
mieux pourvoir à fa propre conferyation , fans
être obligé d’ôter la vie à tous fes femblables, qu’en
la leur ôtant. On n’eft méchant, s’il eft permis de
parler ainfi, qu’à fon corps défendant, c’eft-à-dire,
parce qn’on ne lauroit autrement fatisfaire fes defirs
& contenter fes pallions.Ilfaut être bien aveuglé pour
confondre les forfaits 6c les horreurs avec cette vertu
qui, fi elle étoit foigneufement cultivée, feroit vo k '
au monde la réalité des traits ingénieux dont les anciens
poètes fe font fervis pour peindre l’âge d ’or.
La loi naturelle eft fondée, comme nous l’avons
dit, fur la diftinûion effentielle qui fe trouve entre