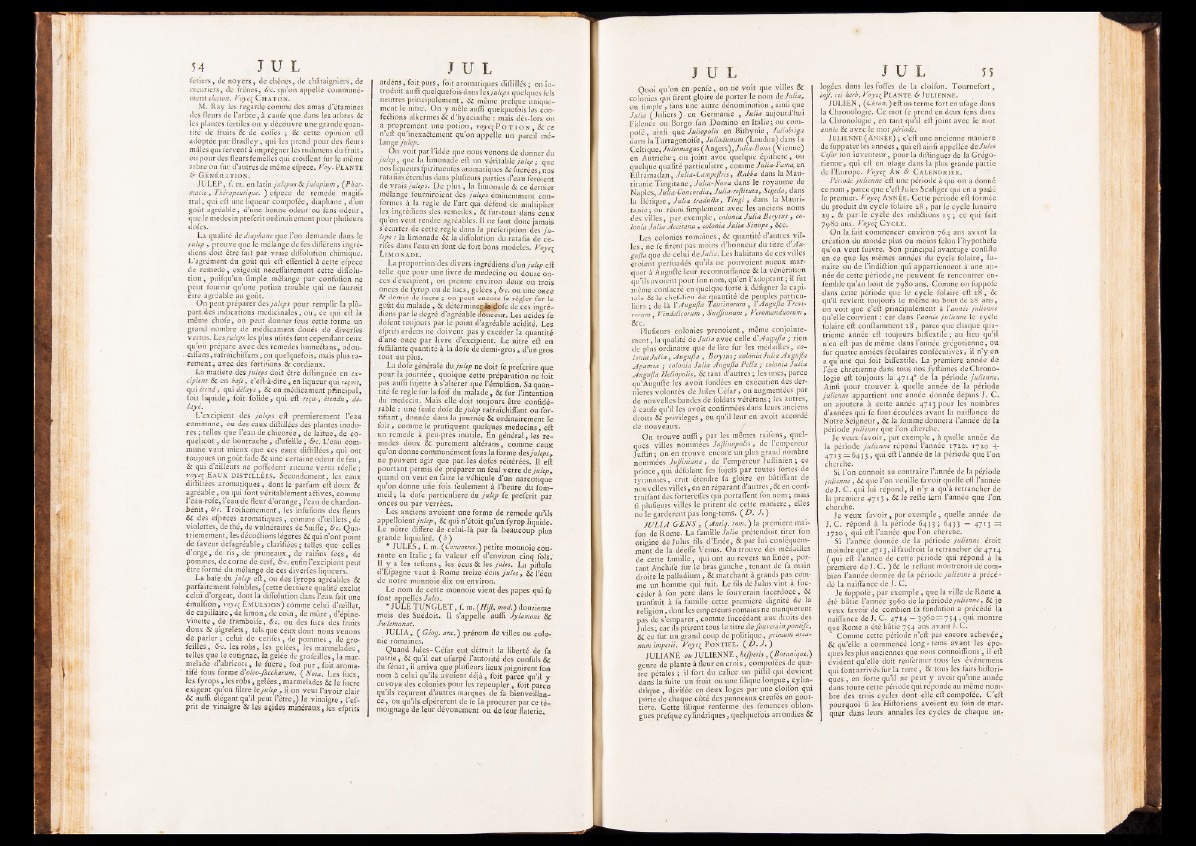
fetiers, de noyers, de chênes, de châtaigniers, de
meuriers, de frênes, &c. qu’on appelle communément
chaton. Foye[ C h a to n .
M. Ray les regarde comme des amas d’étamines
des fleurs de l’arbre, à caufe que dans les arbres 5c
les plantes fertiles on y découvre une grande quantité
de fruits 5c de codes ; 6c cette opinion eft
adoptée par Bradley, qui les prend pour des fleurs
mâles qui fervent à imprégner les rudimens du fruit,
ou pour des fleurs femelles qui croiffent fur le même
arbre ou fur d’autres de même efpece. Voy. Plante
& G én é r a t io n .
JULEP, f. m. en latin julepus 8c julapium, (Pharmacie
, Thérapeutique. ) efpece de remede magif-
tral, qui eft une liqueur compofée, diaphane , d’un
goût agréable, d’une bonne odeur ou fans odeur,
que le médecin prefcrit ordinairement pour plufieurs
dofes.
La qualité de diaphane que l’on demande dans le
julep , prouve que le mélange de fes différens ingré-
diens doit être fait par vraie diffolution chimique.
L’agrément du goût qui eft effentiel à cette efpece
de remede, exigeoit néceffairement cette diffolutio
n , puifqu’un fimple mélange par confufion ne
peut fournir qu’une potion trouble qui ne fauroit
être agréable au goût.
On peut préparer des juleps pour remplir la plû-
part des indications médicinales, o u , ce qui eft la
même chofe, on peut donner fous cette forme un
grand nombre de médicamans doués de diverfes
vertus. Les juleps les plus ufités font cependant ceux
qu’on prépare avec des remedes humefrans, adou-
ciffans, rafraîchiffans, ou quelquefois, mais plus rarement
, avec des fortifians & cordiaux.
La matière des juleps doit être diftinguée en excipient
5c en bafiy c’eft-à-dire, en liqueur qui reçoity
qui étend, qui délaye , 8c en médicament principal,
loit liquide,.foit folide, qui eft reçu-, étendu, délayé.
L’excipient des juleps eft premièrement l’eau
commune, ou des eaux diftillées des plantes inodores
; telles que l’eau de chicorée, de laitue, de coquelicot
, de bourrache, d’ofeille , &c. L’eau commune
vaut mieux que ces eaux diftillées, qui ont
toujours un goût fade ôc une certaine odeur de feu ,
8c qui d’ailleurs ne poffedent aucune vertu réelle ;
voye^ Eau x d is t il lé e s . Secondement, les eaux
diftillées aromatiques , dont le parfum eft doux 5c
agréable, ou qui font véritablement aftives, comme
l’eau-rofe, l’eau de fleur d’orange, l’eau de chardon-
bén it, &c. Troifiemement, les infufions des fleurs
ôc des efpeces aromatiques , comme d’oeillets, de
violettes, de thé, de vulnéraires deSuiffe, &c. Quatrièmement,
les décodions légères 5c qui n’ont point
de faveur defagréable, clarifiées ; telles que celles
d’orge, de ris , de pruneaux, de raifins fecs, de
pommes, de corne de. cerf, &c. enfin l’excipient peut
être formé du mélange de ces diverfes liqueurs.
La bafe du julep eft, ou des fyrops agréables ôc
parfaitement folubles, (cette derniere qualité exclut
celui d?orgeat, dont la diffolution dans l’eau fait une
émulfion, voye[ Ém ulsion) comme celui d’oeillet,
de capillaire, de limon, de coin, de mûre, d’épine-
vinette , de framboife, &c. ou des fucs des fruits
doux Ôc aigrelets, tels que ceux dont nous venons
de parler ; celui de cerifes, de pommes , de gro-
feilles, &c. lesro b s, ,les gelées, les marmelades,
telles que le cotignac, la gelée de grofeilles, la marmelade
d’abricots, le fücre, foit p ü r, foit aroma-
tifé fous forme d’oleo-faccharum. ( Nota. Les fucs
les fyrops, les robs, gelées, marmelades 5c le fucre
exigent cju’on filtre le julep , fi on veut l’avoir clair
& auffi élégant qu’il peut l’être ,) le vinaigre, l’ef-
prit de vinaigre & les agides minéraux, les efprits
ardéns,'foit purs, foit aromatiques diftill'és ; on introduit
auffi quelquefois dans les juleps quelques fels
neutres principalement, 5c même prefque uniquement
le nitre. On y mêle auffi quelquefois les conférions
alkermes ôc d ’hyacinthe : mais dès-lors on
a proprement une potion, voye^P o t i o n , 5c ce
n’eft qu’inexaûement qu’on appelle un pareil mélange
julep.
On voit par l ’idée que nous venons de donner du
julep ? que la limonade eft un véritable julep; que
nos liqueurs fpiritueufes aromatiques 5c fucrées, nos
ratafias étendus dans plufieurs parties d’eau feroient
de vrais juleps. D e plus , la limonade & ce dernier
mélange fourniroient des juleps éminemment conformes
à la regle de l’art qui défend de multiplier
les iiigrédiens des remedes, 5c fur-tout dans ceux
qu’on veut rendre agréables. Il ne faut donc jamais
s’écarter de cette regle dans la prefeription des ju leps
: la limonade 5c la diffolution du ratafia de cerifes
dans l’eau en font de fort bons modèles. Foyer
L imo nad e.
La proportion des divers ingrédiens d’un julep eft
telle que pour une livre de medecine ou douze onces
d’excipient, on prenne environ deux ou trois
onces de fÿrop ou de fucs, gelées, &c. ou une once
5c demie de fucre ; on peut encore fe régler fur le
goût du malade , ôc détermine&jlgMiofe de ces ingrédiens
par le degré d’agréable douceur. Les acides fe
dofent toujours par le point d’agréable acidité. Les
efprits ardens ne doivent pas y excéder la quantité
d’une once par livre d’excipient. Le nitre eft en
fuffifante quantité à la dofe de demi-gros , d’un gros
tout au plus.
La dofe générale du julep ne doit fe preferire que
pour la journée, quoique cette préparation ne foit
pas auffi fujette à s’altérer que l’émulfion. Sa quantité
fe regle fur la foif du malade, ôc fur l’intention
du médecin. Mais elle doit toujours être confidé-
rable : une feule dofe de julep rafraîchiffant ou fortifiant
, donnée dans la journée ôc ordinairement le
foir, comme le pratiquent quelques médecins, eft
un remede à peu-près inutile. En général, les remedes
doux 5c purement altérans, comme ceux
qu’on donne communément fous la forme des juleps,
ne peuvent agir que par. les dofes réitérées. Il eft
pourtant permis de préparer un feul verre de julep,
quand on veut en faire le véhicule d’un narcotique
qu’on donne une fois feulement à l’heure du fom-
meil ; la dofe particulière du julep fe prefcrit par
onces ou par verrées.
Les anciens avoient une forme de remede qu’ils
appelloient julep, ôc qui n’étoit qu’un fyrop liquide.
Le nôtre différé de celui-là par fa beaucoup plus
grande liquidité. ( £ )
* JULES, f. m. (Commerce.) petite monnoie courante
en Italie ; fa valeur eft d’environ cinq fols.'
Il y a les teftons, les écus Ôc les jules. La piftole
d’Efpagne vaut à Rome treize écus ju les , ôc l’écu
de notre monnoie dix ou environ.
Le nom de cette monnoie vient des papes qui fe
font appellés Jules.
* JULE TUNGLET, f. m. (Hiß. mod.j douzième
mois des Suédois. Il s’appelle auffi Jylamont ÔC
Jwlemanat.
JULIA, ( Géog. anc.) prénom de villes ou colo«
nie romaines.
Quand Jules-Céfar eut détruit la liberté de fa
patrie, ôc qu’il eut ufurpé l’autorité des confuls &
du fénat, il arriva que plufieurs lieux joignirent fon
nom à celui qu’ils avoient déjà, foit parce qu’il y
envoya des colonies pour les repeupler, foit parce
qu’ils reçurent d’autres marques de fa bienveillance
, ou qu’ils efpérerent de fe la procurer par ce témoignage
de leur dévouement ou de leur flaterie.
Quoi qu’on en penfe, on ne voit que villes 6c
colonies qui firent gloire de porter le nom 8e Julia,
ou fimple , fans une autre dénomination , ainfi que
Julia (Juliers.) en Germanie , Julia aujourd’hui
Fidence ou Borgo fan Domino en Italie; ou com-
p o fé, ainfi que Juliopolis en Bithynie, Juliobriga
dans la Tarragonoife, Juliodunum (Loudun) dans la
Celtique, Juliomagus (Angers), Julia-Bona (Vienne)
en Autriche ; ou joint avec quelque épithete, ou
quelque qualité particulière, comme Julia-Fama, en
Eftramadan, Julia-Campcjlris, Rabba dans la Mauritanie
Tingitane, Julia-Nova dans le royaume de
Naples, Julia-Concordia, Julia-reflituta, Segeda, dans
la Bétique, Julia traduela, Tingi , dans la Mauritanie;
ou réuni Amplement avec les anciens noms
des villes, par exemple, colonia JuliaBerytus, co-
lonia Julia Accitana , colonia Julia Sinope, ôcc.
Les colonies romaines, 6c quantité d’autres ville
s , ne fe firent pas moins d’honneur du titre d*Au-
gufla que de celui de Julia. Les habitans de ces villes
étoient perfuadés qu’ils ne pouvoient mieux marquer
à Augufte leur reconnoiffance ôc la vénération
qu’ils avoient pour fon nom, qu’en l’adoptant ; il fut
même confacré en quelque forte à défigner la capitale
ôc le chef-lieu de quantité de peuples particuliers
; de là l’Augufla Taurinorum, VAugujla Trevi-
rorum, Vindelicorum , Suejjionum , Veromanduorum ,
ôcc. I .
Plufieurs colonies prenoient, meme conjointement
, la qualité de Julia avec celle d’Augujla ; rien
de plus ordinaire que de lire fur les médailles, co-
Ipnia Julia , Augujla , Berytus ; colonia Julia Augujla
jdpamea ; colonia Julia Augujla Pella ; colonia Julia
Augujla Heliopolis, ôc tant d’autres ; les unes, parce
qu’Augufte lès avoit fondées en exécution des dernières
volontés de Jules Cé far, ou augmentées par
■ de nouvelles bandes de foldats vétérans ; les autres,
à caufe qu’il les avoit confirmées dans leurs anciens
droits ôc privilèges , ou qu’il leur en avoit accordé
de nouveaux.
On trouve auffi, par lés memes raifons, quel-
quès villes nommées Jujlinopolis, de l’empereur
Juftin ; on en trouve encore un plus grand nombre
nommées Jujliniana, de l’empereur Juftinièn ; ce
prince, qui défolant fes fujets par toutes fortes de
tyrannies, crut étendre fa gloire en bâtiffant de
nouvelles v illes, en en réparant d’autres, ôc en conf-
truifant des fortereffes qui portaffent fon nom ; mais
fi plufieurs villes le prirent dé cette maniéré, elles
ne le gardèrent pas long-tems. (D . J . j
JUL IA GENS , (Antiq.rom. ) la première mai-
fon de Rome. La famille Julia prétendoit tirer fon
origine de Julus fils d’Enée, 8c par lui conféquem-
ment de la déeffe Venus. On trouve des médailles
de cette famille, qui ont au revers un Enée, portant
Anchife fur le bras gauche, tenant de fa main
droite le palladium, ôc marchant à grands pas^ comme
un homme qui fuit. Le fils dé Julus vint a fuc-
céder à fon pere dans le fouverain facerdoce, ôc
tranfmit à fa famille cette première dignité de la
religion, dont les empereurs romains ne manquèrent
pas de s’emparer, comme fuccédant aux droits des
Jules; car ils prirent tous le titre de fouverain.pontife,
Ôc ce fut un grand coup de politique, primum arca-
numimperii. Voyei Po ntife. ( D . J. )
JULIANE ou JULIENNE, hefperis, (Botanique.')
genre de plante à fleur en croix, compofées. de quatre
pétales ; il fort du calice un piftil qui devient
dans la fuite un fruit ou une filique longue, cylindrique
, divifée en deux loges par une cloifon qui
porte de chaque côté des panneaux creufés en gouttière.
Cette filique renferme des femences oblon-
gués prefque cylindriques, quelquefois arrondies ÔC
logées dans les foffes de la cloifon. Tournefort,
injl. rei herb. Voye{ Plante & JULIENNE.
JULIEN, ( Chron.) eft un terme fort en ufage dans
la Chronologie. Ce mot fe prend en deux fens dans
la Chronologie, en tant qu’il eft joint avec le mot
année ÔC avec le mot période.
Julienne (A nnée) ; c’eft une ancienne maniéré
de fupputer les années, qui eft ainfi appellée de Jules
Cefar ion inventeur, pour la diftinguer de la Grégorienne
, qui eft en ufage dans la plus grande partie
de l’Europe. Voye{ A n & C alendrier.
Période julienne eft une période à qui on a donné
ce nom, parce que c’eft Jules Scaiiger qui en a parié
le premier. V yyeç A nnée. Cette période eft formée
du produit du cycle folaire 28 , parle cycle lunaire
29 y 8c par le cycle des indi&ions 1 5 ; ce qui fait
7980 ans. Foye{ C y c l e .
On la fait commencer environ 764 ans avant la
création du monde plus ou moins félon l’hypothèfe
qu’on veut fuivre. Son principal avantage confifte
en ce que les mêmes années du cycle folaire, lunaire
ou de l’indiélion qui appartiennent à une année
de cette période,ne peuvent fe rencontrer en-
femble qu’au bout de 7980 ans. Comme on fuppofe
dans cette période que le cycle folaire eft 28, ôc
qu’il revient toujours le même au bout de 28 ans ,
on voit que c’eft principalement à Vannée julienne
qu’elle convient : car dans Vannée julienne le cycle
lolaire eft conftamment 28 , parce que chaque quatrième
année eft toujours biffextile ; au lieu qu’il
n’en eft pas de même dans l’année grégorienne , ou
fur quatre années féculaires confécutives, il n’y en
a qu’une qui foit biffextile. La première année de
l’ére chrétienne dans tous nos fyftèmes de Chronologie
eft toujours la 4714e de la période julienne.
Ainfi pour trouver à quelle année de la période
julienne appartient une année donnée depuis J. G.
on ajoutera à celte année 4713 pour les nombres
d’années qui fe font écoulées avant la naiffance de
Notre Seigneur, ôc la fomme donnera l’année de la
période julienne que l’on cherche.
Je veux favoir, par exemple , à quelle année de
la période julienne répond l’année 1710. 1710 4-
.4713 = 6433 , qui eft l’année de la période que l’on
cherche.
Si l’on connoit au contraire l’année de la période
julienne, ôc que l’on veuille favoir quelle efl l’année
de J. C. qui lui répond, il n’y a qu’à retrancher de
la première 4713» ôc le refte fera l’année que l’on
cherche.
Je veux fa voir , par exemple, quelle année de
J. C. répond à la période 6433 ; 6433 — 4713 =
1720 , qui eft l’année que l’on cherche.
Si l’année donnée de la période julienne étoit
moindre que 4713, il faudroit la retrancher de 4714
( qui eft l’année de cette période qui répond à la
première de J. C . ) ôc le reftant montreroit de combien
l’année donnée de la période julienne a précé dé
la naiffance de J. C.-
Je fuppofe, par exemple, que la ville de Rome a
été bâtie l’année 3960 de la période julienne, ÔC je
veux favoir de combien fa fondation a précédé la
naiffance de J. C. 4714- 3960 = 754 » qui montre
que Rome a été bâtie 754 ans avant J. C.
Comme cette période n’eft pas encore achevée,'
ôc qu’elle a commencé long-tems avant les époques
les plus anciennes que nous connoiffions , il eft
évident qu’elle doit renfermer tous les éyénemens
qui font arrivés fur la terre, Ôc tous les faits hiftori-
ques , en forte qu’il ne peut y avoir qu’une année
dans toute cette période qui réponde au même nombre
des trois cycles dont-elle eft compofée. C’eft
pourquoi fi les Hiftoriens avoient eu foin de marquer
dans leurs annales les cycles de chaque an