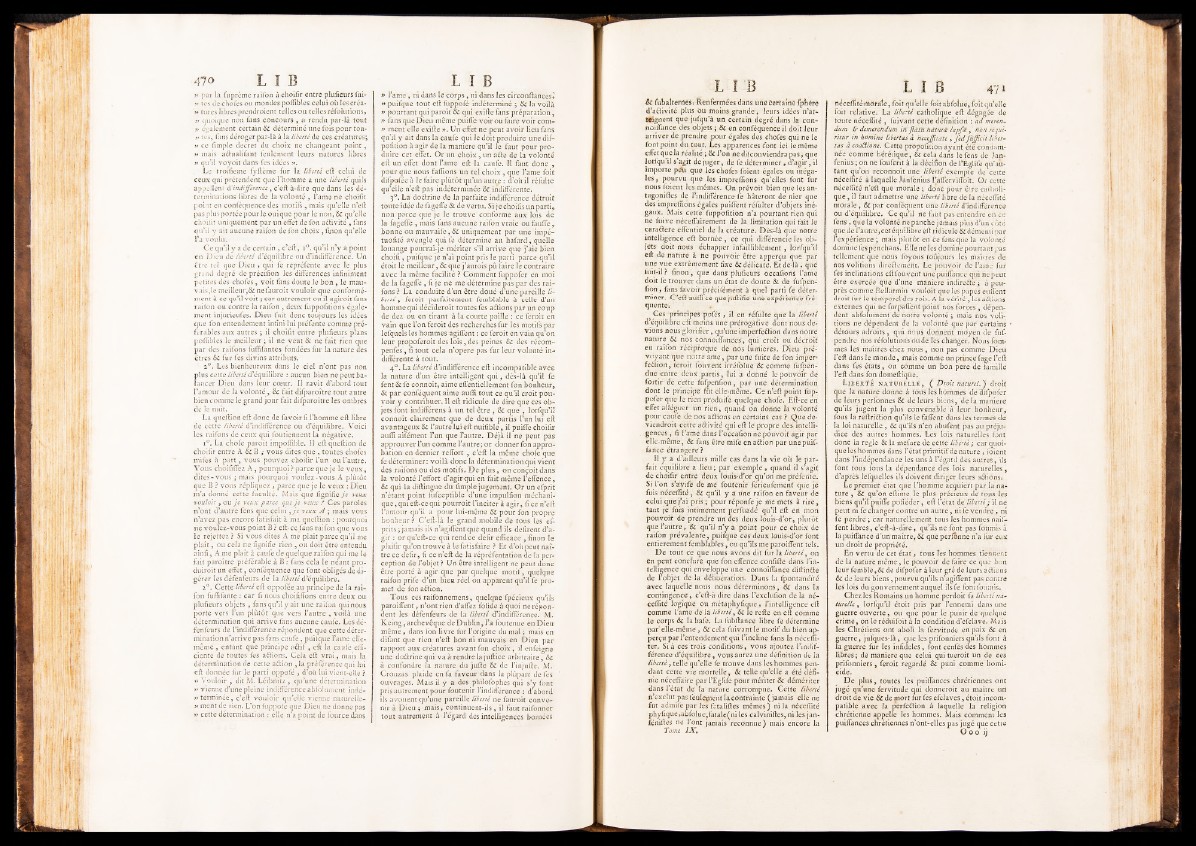
» par la fuprème raifon à choifir entre plufieurs fui-
» tes de chofes ou mondes poffibles celui où les créa-
» turcs libres prendroient telles ou telles réfolutions,
» quoique non fans concours , a rendu par-là tout
» également certain & déterminé une fois pour tou-
» tes, fans déroger par-là à la liberté de ces créatures;
» ce fimple decret du choix ne changeant point,
» mais aéluàlifant feulement leurs natures libres
» qu’il voyoit dans fes idées ».
Le troifieme fyftème fur la liberté eft celui de
ceux qui prétendent que l ’homme a une liberté quils
appellent d’indifférence, c’eft-à-dire que dans les déterminations
libres de la v olonté, l’ame nè choifit
point en conféquence des motifs, mais qu’elle n’eft
pas plus portée pour le oui que pour le non,& qu’elle
choilit uniquement par un effet de fon activité , fans
qu’il y ait aucune raifon de fon choix, linon qu’elle
l’a voulu.
Ce qu’il y a de certain , c’eft, i° . qu’il n’y a point
en Dieu de liberté d’équilibre ou d’indifférence. Un
être tel que D ieu , qui fe repréfente avec le plus
grand degré de précilion les différences infiniment
petites des chofes, voit fans doute le bon , le mauvais,
le meilleur,& nefauroit vouloir que conformément
à ce qu’il voit ; car autrement ou il agiroit fans
railon ou contre la raifon , deux fuppolitions également
injurieufes. Dieu fuit donc toujours les idées
que fon entendement infini lui préfente comme préférables
aux autres ; il choilit entre plufieurs plans
poffibles le meilleur ; il ne veut & ne fait rien que
par des raifons fuffifantes fondées fur la nature des
êtres & fur fes divins attributs.
z°. Les bienheureux dans le ciel n’ont pas non
plus cette liberté d’équilibre : aucun bien ne peut balancer
Dieu dans leur coeur. Il ravit d’abord tout
l ’amour de la volonté , & fait difparoître tout autre
bien comme le grand jour fait difparoître les ombres
de la nuit.
La queftion eft donc de favoir fi l’homme eft libre
de cette liberté d’indifférence ou d’équilibre. Voici
les raifons de ceux qui foutiennent la négative.
i° . La chofe paroît impoffible. Il eft queftion de
choifir entre A & B ; vous dites que , toutes chofes
mifes à pa rt, vous pouvez choifir l’un ou l’autre.
Vous choififfez A , pourquoi? parce que je le veux,
dites-vous ; mais pourquoi voulez-vous A plutôt
que B ? vous répliquez, parce que je le veux : Dieu
m’a donné cette faculté. Mais que fignifie je veux
vouloir, ou je veux parce que je veux ? Ces paroles
n’ont d’autre fens que celui ,/e veux A ; mais vous
n’avez pas encore fatisfait à ma queftion : pourquoi
ne voulez-vous point B ? eft-ce fans raifon que vous
le rejettez ? Si vous dites A me plaît parce qu’il me
plaît, ou cela ne fignifie rien , ou doit être entendu
ainfi, A me plaît à caufe de quelque raifon qui me le
fait paroître préférable à B : fans cela le néant pro-
duiroit un effet, conféquence que font obligés de digérer
les défendeurs de la liberté d-’équilibre.
i ° . Cette liberté eft oppofée au principe de la raifon
fuffifante : car fi nous choififfons entre deux ou
plufieurs objets , fans qu’il y ait une raifon qui nous
porte vers l’un plutôt que vers l’autre , voilà une
détermination qui arrive fans aucune caufe. Les défendeurs
de l’indifférence répondent que cette détermination
n’arrive pas fans caufe, puifque l’ame elle-
même , entant que principe a&if , eft la caufe efficiente
de toutes fes aftions. Cela eft v rai, mais la
détermination de cette a&ion , la préférence qui lui
eft donnée fur le parti oppofé , d’où lui vient-elle ?
« Vouloir , dit M. Léïbnitz , qu’une détermination
» vienne d’une pleine indifférence abfolument indé-
» terminée, c’eft vouloir qu’elle vienne naturelle-
» ment de rien. L’on fuppofe que Dieu ne donne pas
» cette détermination : elle n’a point de fource clans
» l’ame, ni dans le corps, ni dans les circonftances»
» puifque tout eft fuppofé indéterminé ; & la voilà
» pourtant qui paroît & qui exifte fans préparation,
» fans que Dieu même puiffe voir ou faire voir com-
» ment elle exifte ». Un effet ne peut avoir lieu fans
qu’il y ait dans la caufe qui le doit produire une dif-
pofition à agir de la maniéré qu’il le faut pour produire
cet effet. Or un choix , un afte de la volonté
eft un effet dont l’ame eft la caufe. Il faut donc ,
pour que nous faffions un tel choix, que l’ame foit
difpofée à le faire plutôt qu’un autre : d’où il réfulte
qu’elle n’eft pas indéterminée & indifférente.
3°. Là doctrine de la parfaite indifférence détruit
toute idée de fageffe & de vertu. Si je choifis un parti,
non parce que je le trouve conforme aux lois de
la fageffe , mais fans aucune raifon vraie ou fauffe ,
bonne ou mauvaife, & uniquement par une impé-
tuofité aveugle qui fe détermine au hafard, quelle
louange pourrai-je mériter s’il arrive que j’aie bien
choifi , puifque je n’ai point pris le parti parce qu’il
étoit le meilleur, & que j’aurois pû faire le contraire
avec la même facilité ? Comment fuppofer en moi
de la fageffe , fi je ne me détermine pas par des raifons
? La conduite d’un être doué d’üne pareille liberté
y feroit parfaitement femblable à celle d’un
homme qui décideroit toutes fes aftions par un coup
de dez ou en tirant à la courte paille : ce feroit en
vain que l’on feroit des recherches fur les motifs par
lefquels les hommes agiffent : ce feroit en vain qu’on
leur propoferoit des lois, des peines & des récom-
penfes, fi tout cela n’opere pas fur leur volonté indifférente
à tout.
4°. La liberté d’indifférence eft incompatible avec
la nature d’un être intelligent qui, dès-là qu’il fe
fent & fe connoît, aime efl'entiellement fon bonheur,
& par conféquent aime auffi tout ce qu’il croit pouvoir
y contribuer. Il eft ridicule de dire que ces objets
font indifférens à un tel être , & que , lorfqu’ii
connoît clairement que de deux partis l’un lui eft
avantageux & l’autre lui eft nuifible, il puiffe choifir
auffi aifément l’un que l’autre. Déjà il ne peut pas
approuver l’un comme l’autre; or donner fon approbation
en dernier reffort , c’eft la même chofe que
fe déterminer: voilà donc la détermination qui vient
des raifons ou des motifs. De plus, on conçoit dans
la volonté l’effort d’agir qui en fait même l’effence ,
& qui la diftingue du fimple jugement. Or un efprit
n’étant point fufceptible d’une impulfion méchani-
que,quieft-cequi pourroit l’inciter à agir, fi ce n’eft
l’amour qu’il a pour lui-même & pour fon propre
bonheur ? C’eft-là le grand mobile de tous les ef-
prits; jamais ils n’agiffent que quand ils défirent d’agir
: or qu’eft-ce qui rendee defir efficace , finon le
plaifir qu’on trouve à le fatisfaire ? Et d’où peut naître
ce defir, fi ce n’eft de la répréfentation de la perception
de l’objet? Un être intelligent ne peut donc
être porté à agir que par quelque motif, quelque
raifon prife d’un bien réel ou apparent qu’il fe promet
de fon a&ion.
Tous ces raifonnemens, quelque fpécieux qu’ils
paroiffent, n’ont rien d’affez folide à quoi ne répondent
les défenfeurs de la liberté d’indifférence. M.
Keing, archevêque de Dublin, l’a foutenue en Dieu
même, dans fon livre fur l’origine du mal ; mais en
difant que rien n’eft bon ni mauvais en Dieu par
rapport aux créatures avant fon choix, il enfeigne
une doclrine qui va à rendre la juftice arbitraire, &
à confondre la nature du jufte & de l’injufte. M.
Crouzas plaide en fa faveur dans la plupart de fes
ouvrages. Mais il y a des philofophes qui s’y font
pris autrement pour foutenir l’indifférence : d’abord
ils avouent qu’une pareille liberté ne fauroit convenir
à Dieu ; mais, continuent-ils, il fautraifonner
tout autrement à l’égard des intelligences bornées
& fubalterilééi Renfermées dafls unécettaînê fphéte
d’aôivité plus Ou moins grande * leurs idées h’at-
teignent que jufqu’à un certain degré dans la con-
noiffance des objets ; & en conféquence il doit leur
arriver de prendre pour égales des chofes qui ne le
font point du tout. Les apparences -font ici le même
effet que la réalité ; & l ’on ne dilconviendra pas, que
loriqu il s’agit de juger * de fe déterminer > d’agir, il
importe pdU que les chofes foient égales ou inégales*
pourvu que les, impreffions qu’elles font fur
nous foient les: mêmes. On prévoit bien que lesan-
tagoniftes de l’indifférence fe hâteront de nier que
des impreffions égales puiffent réfulter d ’objets inégaux.
Mais cette fuppofition n’a pourtant rien qui
ne fuive néceffairement de là limitation qui fait le
caraftefe effentiel de la créature. Dès-là que notre
intelligence eft bornée , ce qui différencie les objets
doit nous échapper infailliblement , loriqü’il
eft de nature à ne pouvoir être âpperçu qué par
tine vue extrêmement fixe &délicàte. Et dé-là, que
luit-il? finon, que dans plùfienfs occafiortS l’ame
doit fe trouver, dans un état de doute & de füfpën^
lion, fans fiivOir précifément à quel parti fe déterminer.
C ’eft auffi Cè que juftifie Une expérience fréquente;
:
Ces prirtcipçs'pofés, il en réfulte que la liberté
d équilibre eft moins une prérogative dont nous devions
nous glorifier, qu’une imperfection dans nôtre
nature ôé nôs connoiffancès, qui croît ou déerbît
en raifon récipfoque de nôs lumières. Dieu prévoyant
que notre ame, par une fuite de fon imper*
feèiion,-feroit fouvent ïrféfôlue 6c comme fufpen-
due entre, dètix.partis, lui à donné le pouvoir de
fortir dé cette ftïfpeflfion, par Une détermination
dont le principe ntt elle-même. Ce n’eft point ftip-
pofer que le rien prodnifé quelque chofe. Eft-ceen
effet alléguer un rien, quand dn donne la volonté
pour caufe de nos a étions en certains cas ? Que de-
viendrôtt cette a&ivité qui eft lé propre désJ- intelligences
, fi f ’affié dans fôccafion ne pOuvoif agir par
elle-mênte, & fans être mife enàéïion par unèpüif-
fance étrangère?
II y a d’ailleurs mille' cas dans la vie Où le parfait
équilibre a lieu ; pâr exemple, quand il s’agit
de chôïfir entré deux lOUis-d’or qu’on me préfente.
Si l’on s’âyife de me foutenir férieufémênt que je
fuis néeeffité, & qu’il y à une' raifon en faveur de
celui que j’ai prié; pour réponfe je me mets à rire,
tant je fuis intimement peïfuâdé qu’il eft en mon
pouvoir de prendre un des deux louis-d’or, plutôt
que l’autre, & qu’il n’y a point pour ce choix de
raifon prévalente, puilque ceSdeux lduis-d’ôr font
entièrement femblabJes, ou qu’ils me paroiffent tels.
De tout ce que nous avons dit fur la liberté, on
en peut conclure que fon effence confifte dans l'intelligence
qui enveloppe une cônnoiffanCe diftinfte
de l’objet de la délibération. Dans ta fponta'néïré
avec laquelle nous nous déterminons, &c dans la
contingence, c’eft-à-dire dans rexclufion dè la né-
ceffité' logique on métâphyfique, l’intelligence eft
comme l’ame de" la liberté, & le refte en eft comme
le corps & la bafe. La fubftance libre fe détermine
par* elle-même, &C cela fuivant lé motif du bien ap-
perçu par l’enrendement qui l’incline fans la néceffi-
ter. Si à ces trois conditions, vous ajoutez l’indifférence
d’équilibre , voiïsaurez une définition de la
liberté, telle qu’elle' fe trouve dans les hommes pendant
cette vië mortelle, & telle qu’elle a été définie
néceffaire par l’Eglilè pour mériter & démériter
dans l’état de l'a nature corrompue. Cette liberté
n’exclut pas l'eûleptent fa contrainte (jamais elle ne
fut adrnifè par les fataliftes mêmes ) ni la néeeffité
phyfique,abfolue,fatale(ni les calviniftes, ni les jan-
fértiftes ne l’ont jamais reconnue) mais encore la
Tome IX «
neceffite rhdrale, foit qu’eiie lbitabfoîiie, ibit quelle
foit relative. La liberté catholique eft dégagée de
toute néeeffité , fuivant Cët'te définition : ad. meren-
dum & dtmerehdum ifi flàtu hàiurce lapfcè , non rcqui-
ritur iti homitii liber tas à hecejfitatc , fed jufficit liber-
tas a coaclione. Cette propofttiOn ayant été condamnée
comme hérétique , & cela dans le fëns de Jan-
fenius ; on ne fouferit à la déeiiiôn de l’Églifè qu’aît-
tant qu’on reconnoît une liberté exempté de cette
néeeffité à laquelle janfenius l’afferviffoit. Or cette
néeeffité n’eft que morale ; donc pour être catholique
, il faut admettre une liberté libre de la néeeffité
morale, & par conféquent une liberté d’indifférence
ou d’équilibre. Ce qu’il ne faüt pas entendre en ce
fens , que la volonté ne pànche jamais plus d’un côté
que de l’autre, cet équilibre èft ridicule & démenti par
l’expérience ; mais plutôt ert êë fëns que la volonté
domine fes pencha ns. Elle né les domine pourtant pas
tellement que nous foyons toujours .les maîtres dé
nos voûtions directement. Le pouvoir de l’aine fur
fes inclinations eft fou vent une puiffance qui ne peut
être exercée que d’iine manière ihdireflfe ; à peu-
près comme Bellârmin voulôit que les papes enflent
droit l'uf le tèmpôréldes rois. A la vérité , lës àCtions
externes qui ne furpâffént point nos forces , dépendent
abfolument de nôtrè volonté; mais nos yoli*
tions ne dépendent de fa volonté que par certains
détours adroits, qui nous donnent mdyen de fuf-
pertdre nos réfolutions ou de Tes changer. Nous fom-
més les maîtres chez nous, lion pas comme Dieu
l’eft dans le monde, mais comme un prince fage Peft
dans fes états , ou comme un bon pere de famille
l’eft dans fon domeftiqùe.
L i b e r t é n a t u r e l l e , ( Droit naturel. ) droit
que la nature donne à fous les hommes de difpofer
de leurs perfônnes & dé le'urs biens, de la maniéré
qu’ils jugent la plus convenable à leur bonheur,
fous la reftriCtion qu’ils le faffent dans les termes de
la loi nâturélle , & qu’ils n’en abufent pas au préjudice
des autres hommes. Leà lois naturelles font
donc la réglé & la mefure de cette Liberté ; car quoique
les hommes dans l’état primitif de nature, foient
dans l’indépendance les uns à l'égard des autres, ils
font fous fous la dépendance des lois naturelles *
d’après lefquelles ils doivent diriger leurs a.Cliôns.
Le premier état que l’homme acquiert par la na*
turê , & qu’on eftime le plus précieux de" tons les
biens qu’il puiffe poffeder, eft l’état de liberté; W ne
peut ni fe changer contre un autre, ni fe vendre, ni
le perdre' ; car naturellement tous les hommes naif-
fent libres, c’eft-à-dire , qu’ils ne font pas fournis à
la puiffance d un‘maître,& quéperfônne n’a fiir eux
un droit de propriété.
En vertu de cet é ta t, tous les hommes tiennent
de la nature même, le pouvoir de faire ce que bon
leur femble,& de difpofer à leur gré de leurs avions
& de leurs biens, pourvu qu’ils n’agiffent pas contre
les lois du gouvernement auquel ilsfe fontfoumis'.
Chez les Romains un homme perdoit fa liberté naturelle
, lôrfqu’il étoit pris par l’ennemi dans une
guerre ouverte , ou que pour le punir de quelque
crime, on leréduifoit â fa conditiond’èfclave. Mais
les Chrétiens ont aboli la fervitude en paix & en
guerre * jufques-là * que les prifonniers qu’ils font à
la guerre fur les infidèles, font cenfés des hommes
libres; de maniéré que celui qui tueroit un de ees
prifonniers, feroit regardé & puni comme homicide.
D e plus, toutes les puiffances chrétiennes ont
jugé qu’une fervitude qui donneroit au maître urt
droit de vie & de mort fur fes efclaves, étoit incompatible
avec la perfeéfion à laquelle la religion
chrétienne appelle les hommes. Mais comment les
puiffances chrétiennes n’ont-elles pas jugé que cette