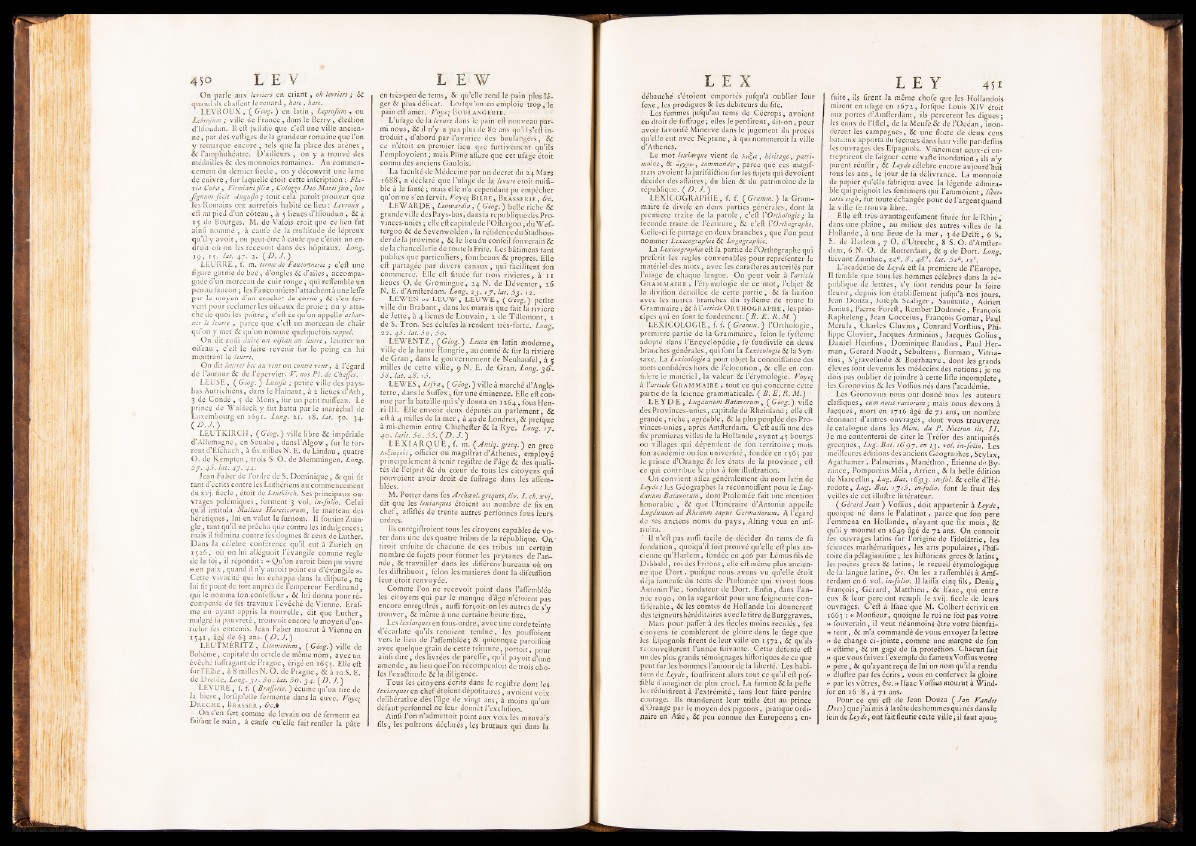
On parle aux lévriers en criant , oh lévriers ; &
■ quand Us chaflent le renard, hare, hare.
LEVROUX, ( Géog.') en latin, Leprofum, ou
Lebrofum ; ville de France , dans le Berry, élection
d’IiToudun. Il eft juftifié que c’ell une ville ancienne
, par deS vertiges de la grandeur romaine que l’on
y remarque encore, tels que la place des arènes ,
&c I’amphithéatre. D ’ailleurs , on y a trouvé des
médailles & des monnoies romaines. Au commencement
du dernier iiecle , on y découvrit une lame
de cuivre, fur laquelle étoit cette infeription : Fla-
via Cuba , Firmianifilia , Colo^yo Deo Marti fuo , hoc
Jignum fteit dugujlo ; tout cela paroît prouver que
les Romains ont autrefois habité ce lieu : Levroux ,
eft au pied d’un coteau , à 5 lieues d’Iffoudun , & à
15 de Bourges. M. de Valois croit que ce lieu fut
ainfi nomme , à caufe de la multitude de lépreux
qu’il y avoit, ou peut-être à caufe que c’étoit un endroit
où on les recevoit dans des hôpitaux. Long.
19 , 15. lat. 47. 2.c;| D .J .')
LEURRE, 1. m. terme de Fauconnerie ; c’eft une
figure garnie de b ec, d’ongles & d’ailes, accompagnée
d’un morceau de cuir rouge, qui reflemble un
peu au faucon ; les Fauconniers l’attachent à une leffe
par le moyen d’un croche“ de corne , & s’en fervent
pour reclamer les oileaux de proie ; on y attache
de quoi les paître, c’eft ce qu’on appelle acharner
le leurre , parce que c’eft un morceau de chair
qu’on y met & qu’on nomme quelquefois rappel.
On dit auffi duire un oifeau au leurre, leurrer un
oifeau , c’èft le faire revenir fur le poing en lui
montrant le leurre.
On dit leurrer bec au vent ou contre vent, à l’égard
de l’autour & de l’épervier. V. nos PI. de ChaJJes.
LEUSE, ( Géog. ) Lutofa ; petite ville des pays-
bas Autrichiens, dans le Hainaut, à 2 lieues d’Ath,
3 de Condé , 5 de Mons, fur un petit ruifleau. Le
prince de "Waldeck y fut battu par le maréchal de
Luxembourg en 1691. Long. 21. 18. lat. 50. 34. r a H H H ; LEUTKIRCH, ( Geog. ) ville libre & impériale
d’Allemagne, en Souabe, dans l’Algo-w, fur le torrent
d’E fchach, à fix milles N. E. de Lindau, quatre
O. de Kempten, trois S O. de Memmingen. Long.
3.7. 45. lat. 47. 44.
Jean Faber de l’ordre de S. Dominique, & qui fit
tant d’écrits contre les Luthériens au commencement
du xvj. fiecle, étoit de Leutkirch. Ses principaux ouvrages
polémiques, forment 3 vol. in-folio. Celui
qu’il intitula Maliens Hcereticorum , le marteau des
hérétiques, lui en valut le furnom. Il foutint Zuin-
g le , tant qu’il ne prêcha que contre les indulgences ;
mais il fulmina contre fes dogmes & ceux de Luther.
Dans la célébré conférence qu’il eut à Zurich en
3526, où on lui alléguoit l’évangile comme réglé
de la fo i, il répondit : « Qu’on auroit bien pu vivre
» en paix, quand il n’y auroit point eu d’évangile ».
Cette vivacité qui lui échappa dans la difpute, ne
lui fit point de tort auprès de l’empereur Ferdinand,
qui le nomma fon confeffeur, & lui donna pour ré-
compenfe de fes travaux l’évêché de Vienne. Eraf-
me en ayant appris la nouvelle, dit que Luther,
malgré fa pauvreté, trouvoit encore le moyen d’enrichir
fes ennemis. Jean Faber mourut à Vienne en
1541, âgé de 63 ans. ( D . J. )
LEUTMÉRITZ, Litomerium, ( Géog.') ville de
Bohème, capitale du cercle de même nom, avec un
évêché fuffragant de Prague, érigé en 165 5. Elle eft
fur l’Elbe, à 8 milles N. O . de Prague, & à 1 o S. E.
de Drelde. Long. 31. 5 o. lat. 5o. 34. (Z>. J .)
LEVURE, f. f. ( Brafferie. ) écume q u’on tire de
la biere, lorfqu’elle fermente dans la cuve. Voyez
Dreche, Brasser, &c.*
On s’en fert comme de levain ou de ferment en
fai faut le nain, à caufe qu’elle fait renfler la pâte
en très-peu de tetps, & qu’elle rend le pain plus léger
& plus délicat. Lorfqu’on en emploie trop, le
pain eft amer. Voyeç B o u l a n g e r i e .
L ’ufage de la levure danSle pain eft nouveau parmi
nous, & il n’y a pas plus de 80 ans qu’il s?eft introduit
, d’abord par l’avariée des boulangers, &
ce n’étoit en premier lieu que furtivement qu’ils
l’employôient ; mais Pline aflure que cet ufâge étoit
connu des anciens Gaulois';- ,
La faculté de Médecine par un decret du 24 Mars
1688, a déclaré que l’ufage de la levure étoit nuifi-
ble à la fanté ; mais elle n’a cependant pu empêcher
qu’on ne s’en fervît. Voye^ B i e r e , B r a s s e r i e , &c.
LÉWARDE, Leowardia, ( Géog. ) belle riche &
grande ville des Pays-bas, dans la république des Pro-
vinces-unies ; elle eft capitale de l’Oftergoo, du \Vef-
tergoo & de Sevenwolden, la réfidenceduStadhou-
der de la province, & le lieu du confeil fouve.rain &
de la chancellerie de toutelaFrife. Les bâtimens tant
publics que particuliers, font beaux & propres. Elle
eft partagée par divers canaux, qui facilitent fon
commerce. Elle eft lituée fur trois rivières, à 11
lieues O. de Gromingue, 24 N. de Dé venter, 26
N. E. d’Amfterdam. Long. 23. iy . lat. 5 i . 12.
LEWEN ou LEUW , LEUWE, ( Géog. ) petite
ville du Brabant, dans les marais que fait la riviere
de Jette, à 4 lieues de Louvain, 2 de Tillemont, 1
de S. Tron. Ses éclufesla rendent très-forte. Long.
22. 46. lat.So. 5o.
LEWENTZ, ( Géog.) Leuca en latin moderne,
ville de la haute Hongrie, au comté & fur la riviere
de Gran, dans le gouvernement de Neuhaufel, à 5
milles de cette ville , 9 N. E. de Gran. Long. 3 6 .
58. lat. 48. i5. ’
L E V E S , Lefva, ( Géog. ) ville à marché d’Angleterre,
dans le Suffex, fur une éminence. Elle eft connue
par la bataille qui s’y donna en 1264, fous Henri
III. Elle envoie deux députés au parlement, &
eft à 4 milles de la mer, à 40 de Londres, & prefque
à mi-chemin entre Chichefter & la Rye. Long. 17,
40. laiit. 5 o. 55. ( D . J. )
L E X IA R Q U E , f. m. ( Antiq. grecq. ) en grec
At&apzoç, officier ou magiftrat d’Athenes, employé
principalement à tenir regiftre de l’âge & des qualités
de l’efprit & du coeur de tous les citoyens qui
pouvoient avoir droit de fuffrage dans les affem-
blées.
M. Potter dans fes Archoeol. greques, liv. I. ch. x vj.
dit que les lexiarques étoient au nombre de fix en
chef, affiliés de trente autres perfonnes fous leurs
ordres.
Ils enregiftroient tous les citoyens capables de voter
dans une des quatre tribus de la république. On
tiroir enfuite de chacune de ces tribus un certain
nombre de fujets pour former les prytanes de l’année
, & travailler dans les différens bureaux où on
les diftribuoit, félon les matières dont la difeuffion
leur étoit renvoyée.
Comme l’on ne recevoit point dans l’aflemblée
les citoyens qui par le manque d’âge n’étoient pas
encore enregiftrés, auffi forçoit-on les autres de s’y
trouver, & même à une certaine heure fixe.
Les lexiarques en fous-ordre, avec une corde teinte
d’écarlate qu’ils tenoient tendue, les poufloient
vers le lieu de l’aflëmblée; & quiconque paroifloit
avec quelque grain de cette teinture, portoit, pour
ainli dire, des livrées de parefle, qu’il payoit d’une
amende, au lieu que l’on récompenfoit de trois oboles
l’exaftitude & la diligence.
Tous les citoyens écrits dans le regiftre dont les
lexiarques en chef étoient dépofitaires, avoient voix
délibérative dès l’âge de vingt ans, à moins qu’un
défaut perfonnel ne leur donnât l ’exclufion.
Ainli l’on n’admettoit point aux voix les mauvais
fils, les poltrons déclarés, les brutaux qui dans la
débauché s’étoient emportés jufqu’à oublier leur
fexe, les prodigues & les débiteurs du fife.
Les femmes jufqu’au tems de Cécrops, avoient
eu droit de fuffrage; elles le perdirent, dit-on, pour
avoir favorifé Minerve dans le jugement du procès
qu’elle eut avec Neptune, à qui nommeroit la ville
d’Athenes.
Le mot lexiarque vient de , héritage, patrimoine
, & dpxuvf commander, parce que ces magif-
trats avoient la jurifdiélion fur les fujets qui dévoient
décider des affaires, du bien & du patrimoine delà
république. (D . J. )
LEXICOGRAPHIE, f. f. ( Gramm. ) la Grammaire
fe divife en deux p'arties générales, dont la
première traite de la parole, c’eft VOrthoLogie; la
leconde traite de l’écriture, 6c c ’eft l’Orthographe.
Celle-ci fe partage en deux branches, que l’on peut
nommer Lexicographie & Logo graphie,
La Lexicographie eft la partie de l’Orthographe qui
preferit les réglés convenables pour repréfenter le
matériel des mots, avec les caraâeres autorifés par
l’ufage de chaque langue; On peut voir à l'article
G r am m a ir e> l’étymologie de ce mot, l’objet &
la divifion détaillée de cette partie, & fa liaifon
avec les autres branches du fyftème de toute la
Grammaire ; & à Varticle O r th o g r a ph e , les principes
qui en font le fondement. ( B. E. R. M. )
LEXICOLOGIE, f. f. ( Gramm. ) l’Orthologie,
première partie de la Grammaire, félon le fyftème
adopté dans l’Encyclopédie, fe foudivife en deux
branches générales, qui font la Lexicologie & la Syntaxe.
La Lexicologie a pour objet la connoiflance des
mots confédérés hors de l’élocution , & elle en con-
fidere le matériel, la valeur & l’étymologie. Voye^
à l’article Gr ammaire , tout ce qui concerne cette
partie de la fcience grammaticale. ( B. E. R. M.~)
L E Y D E , Lugdunum Batavorum, ( Géog. ) ville
des Provinces-unies , capitale du Rheinland ; elle eft
grande, riche, agréable, & la plus peuplée des Provinces
unies, après Amfterdam. C ’eft auffi une des
fix premières villes de la Hollande, ayant 45 bourgs
• ou villages qui dépendent de fon territoire; mais
.fon académie.ouion univerfité, fondée en 1565 par
le prince d’Orange Sc les états de la province, eft
ce qui contribue le plus à fôn illuftration.
On convient affez généralement du nom latin de
Leyde : les Géographes la reconnoiffent pour le Lugdunum
Batavorum, dont Ptolomée fait une mention
honorable , & que l’Itinéraire d’Antonin appelle
■ Lugdunum ad Rhenum càpur Germanorum. A l’égard
de Tes anciens noms du pays, Alting vous en inf-
truira.
’ Il n’eft pas auffi facile de décider du tems de fa
fondation, quoiqu’il foit prouvé qu’elle eft plus ancienne
qu’Harlem, fondée en 406 par Lémus fils de
Dibbald, roi des Friions ; elle eft même plus ancienne
que D o r t, puifque nous avons vu qu’elle étoit
déjà fameufe du tems de Ptolomée qui vivoit fous
Antonin Pie, fondateur de Dort. Enfin. dans l’année
1090, on la regardoit pour une feigneurie con-
fidérable, & les comtes de Hollande lui donnèrent
des feigneurs héréditaires avec le titre de Burggraves.
Mais pour paffer à des fiecles moins reculés, fes
citoyens fe comblèrent de gloire dans le fiege que
les Efpagnols firent de leur ville en 1572, & qu’ils
renouvellerent l’année fuivante. Cette défenfe eft
un des plus grands témoignages, hiftoriques de ce que
peut fur les hommes l’amour de la liberté. Les habi-
tans de Leyde, fouffrirent alors tout ce qu’il eft pof-
fible d’imaginer de plus cruel. La famine & la pefte
les réduifirent à l’extrémité, fans leur faire perdre
courage. Ils mandèrent leur trifte état au prince
d’Orange par le moyen des pigeons , pratique ordinaire
en Àfie, & peu connue des Européens ; enfuite,
ils firent la même chofe que les Hollandois
mirent en ufage en 1672, lorfque Louis XIV étoit
aux portes d’Amfterdam , ils percerent les digues;
les eaux de l’ifle l, de la Meufe & de l ’Océan, inondèrent
les campagnes, & une flotte de deux cens
bateaux apporta du fecours dans leur ville par-deflùs
les ouvrages des Efpagnols. Vainement ceux-ci entreprirent
de faigner cette vafte inondation, ils n’y
purent reuffir, & Leyde célébré encore aujourd’hui
tous les ans, le jour de fa délivrance. La monnoie
de papier qu’elle fabriqua avec la légende admirable
qui peignoit les fentimens qui l’animoient, liber-
tatis ergb, fut toute échangée pour de l’argent quand
la ville fe.trouva libre.
Elle eft très-avantageufement fituée fur le Rhin
dans une plaine, au milieu des autres villes de la
Hollande, à une lieue de la mer, 3 de D e lft , 6 S.
E. de Harlem, 7 O. d’Utrecht, 8 S. O. d’Amfterdam,
6 N. O. de Rotterdam, & 9 de Dort. Long.
fuivant Zurnbac, 22d. 8'. 48'- . lat. ix 1.
L’académie de Leyde eft la première de l’Europe.
Il femble que tous les hommes célébrés dans la république
de lettres, s’y font rendus pour la faire
fleurir, depuis fon établiflement jufqu’à nos jours.
Jean Douza, Jofeph Scaliger, Saumaife, Adrien
Junius, Pierre Foreft, Rember Dodonée , François
Rapheleng, Jean Cocceius, François Gomar, Patil
Merula, Charles Cluvius, Conrard Vorftius, Philippe
Cluvier, Jacques Arminius, Jacques Golius,
Daniel Heinfius, Dominique Baudius, Paul Herman,
Gérard Noodt, Sebultens, Burman, Vitria-
rius, S’gravefande & Boerhaave, dont les grands
éleves font devenus les médecins des nations ; je ne
dois pas oublier de joindre à cette lifte incomplète,
les Gronovius & les Voffius nés dans l’académie.
Les Gronovius nous ont donné tous les auteurs
claffiques; cum notis variorum ; mais nous devons à
Jacques, mort en 1716 âgé de 71 ans, un nombre
étonnant d’autres ouvrages, dont vous trouverez
le catalogue dans les Mém. du P. Niceron tit. I I .
Je mécontenterai de citer le Tréfor des antiquités
grecques, Lug. Bat. 16.97. en 13. vol. in-folio. Les
meilleures éditions des anciens Géograuhes, S cylax,
Agathamer , Palmerius, Manéthon, Etienne de Byzance,
PomponiusMéla, Arrien, & la belle édition
de Marcellin, Lug. Bat. /(Tcjj. in-fol. & celle d’Hérodote,
Lug. Bat. iy/5 . in folio, font le fruit des
veilles de cet illuftre littérateur.
( Gérard Jean ) Voffius, doit appartenir à Leyde,
quoique né dans le Palatinat, parce que fon pere
l’emmena en Hollande, n’ayant que fix mois, Sc
qu’il y mourut en 1649 ^8® 7 1 ans* On connoît
les ouvrages latins fur l’origine de l’idolâtrie, les
fciences mathématiques, les arts populaires, l’hif-
toire du pélagianifme ; les hiftoriens grecs & latins,
les poètes grecs & latins, le recueil étymologique
de la langue latine, &c. On les a raflemblés à Amfterdam
en 6 vol. in-folio. Il laifla cinq fils, Denis ,
François, Gérard, Matthieu, & Ifaac, qui entre
eux & leur pere ont rempli le xvij. fiecle de leurs
ouvrages. C ’eft à Ifaac que M. Colbert écrivit en
1663 : « Monfieur, quoique le roi ne foit pas votre
» fouverain, il veut néanmoins être votre bienfai-
» teur, & m’a commandé de vous envoyer la lettre
» de change ci-jointe, comme une marque de fon
» eftinie, & un gage de fa proteélion. Chacun fait
» que vo.usfuivez l’exemple du fameux Voffius votre
» pere, & qu’ayant reçu de lui un nom qu’il a rendu
» illuftre par fes écrits , vous en confervez la gloire
» par les vôtres, &c. » Ifaac Voffius mourut à NVind-
for en i6:'8 , à 71 ans.
Pour ce qui eft de Jean Douza ( Jan Vander
Does) quej’aimis à la tête des hommes quinés dans le
fein de Leyde, ont fait fleurir cette ville ; il faut ajou