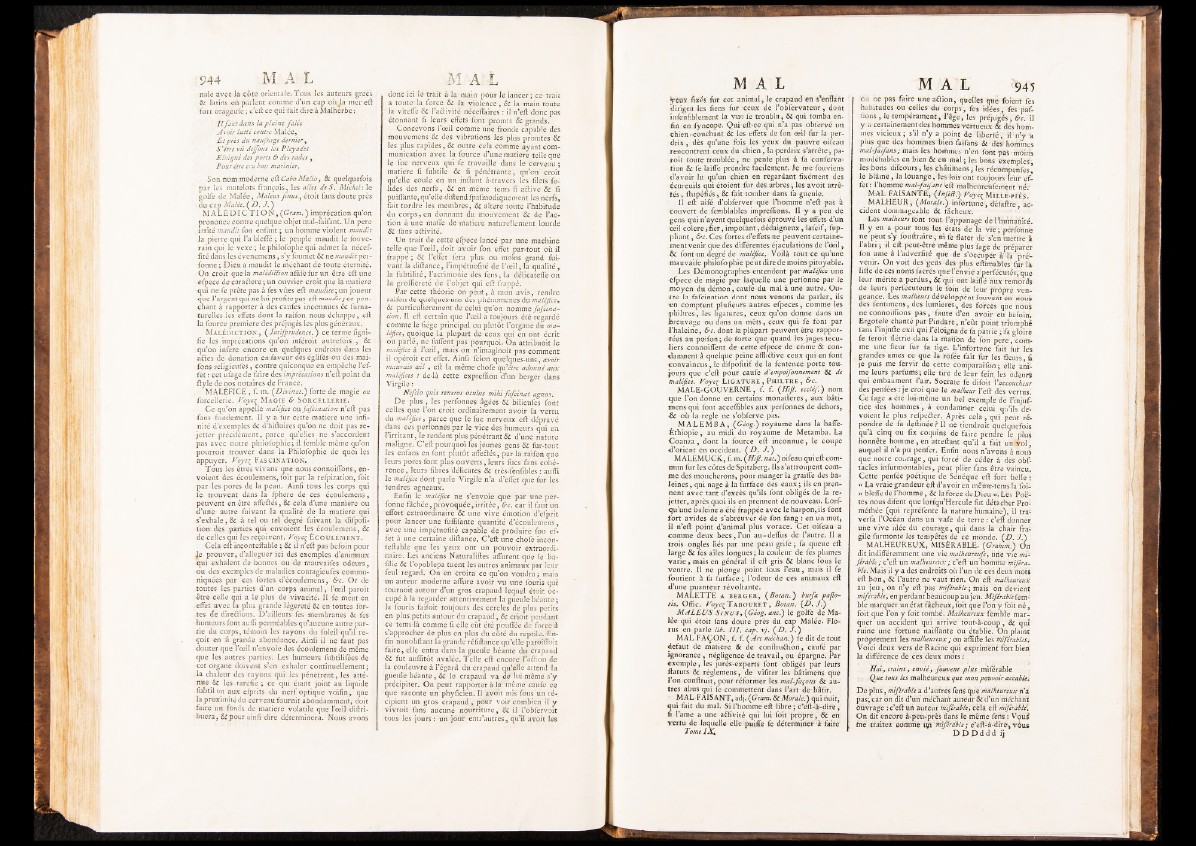
nale avçe la côte orientale. Tous les auteurs grecs
& latins .en parlent comme d’un cap oii^la mer eft
fort orageufe ; c’eft ce qui fait dire à Malherbe :
I l faut dans la plaine falée
Avoir lutté contre Malée,
E t prés du naufrage dernier,
1 S'être vu deffous les Pleyades
Eloigné des ports & des rades ,
Pour être cru bon marinier.
Son nom moderne eft Cabo Malio , & quelquefois
par les matelots françois., les ailes de S. Michel', le
golfe de Malée, Maleus finus, étoit fans doute près
du cap Malée. ( D . J. )
M A L É D I C T I O N , {Gram.) imprécation qu’on
prononce contre quelque objet mal-faifant. Un pere
. irrité maudit fon enfant ; un homme violent maudit
la pierre qui l’a bleflé ; le peuple maudit le fouve-
rain qui le vexe ; le philofophe qui admet la nécef-
lité dans les évenemens, s’y foumet & ne maudit per-
fonne ; Dieu a maudit le méchant de toute éternité.
On croit que la malédiction aflife fur un être eft une
efpece de caraftere ; un ouvrier croit que la matière
qui ne fe prête pas à fes vues eft maudite-, un joueur
que l’argent qui ne lui profite pas eft maudit; ce penchant
à rapporter à des caufes inconnues & fiirna-
turelles les effets dont la raifon nous échappe, eft
la. fource première des préjugés les plus généraux.
Maléd ic tio n , ( Jurifprudence. ) ce terme figni-
fie les imprécations qu’on inféroit autrefois , &
qu’on inféré encore en quelques endroits dans les
aftes de donation en faveur des églifes ou des mai-
fons religieufes, contre quiconque en empêche l ’effet
: cet ufage de faire des imprécations n’eft point du
ftyle de nos notaires de France.
MALÉFICE, f. m. (Divinat.) forte de magie ou
forcellerie. Voyt^.Mag ie & So r c e l ler ie .
Ce qu’on appelle maléfice ou fafeination n’eft pas
fans fondement. Il y a fur cette matière une infinité
d’exemples & d’hiftoires qu’on ne doit pas re-
jetter préerfément, parce qu’elies ne s’accordent
pas avec notre philofophie; il femble même qu’on
pourroit trouver dans la Philofophie de quoi les
appuyer. Voyeç Fascinat ion s
Tous les êtres vivans que nous connoiffons, envoient
des écoulemens, foit par la refpiration, foit
par les pores de la peau. Ainfi tous les corps qui
le trouvent dans la fphere de ces écoulemens,
peuvent en être affeftés, & cela d’une maniéré ou
d’une autre fuivant la qualité de la matière qui
s’exhale, & à tel ou tel degré fuivant la difpofi-
tion des parties qui envoient les écoulemens, &
de celles qui les reçoivent. Voye^ É co u l em en t .
Cela eft inconteftable ; & il n’eft pas befoin pour
Je prouver, d’alleguer ici des exemples d’animaux
.qui exhalent de bonnes ou de mauvaifes odeurs,
ou des exemples de maladies contagieufés communiquées
par ces fortes d’écoulemens, &c. Or de
toutes les parties d’un corps animal, l’oeil paroît
être celle qui a le plus de vivacité. Il fe meut en
-effet avec la plus grande légèreté & en toutes fortes
de directions. D ’ailleurs fes membranes & fes
humeurs font aufli perméables qu’aucune autre partie
du corps, témoin les rayons du foleil qu’il reçoit
en fi grande abondance. Ainfi il ne faut pas
douter que l’oeil n’envoie des écoulemens de même
que les autres parties. Les humeurs fubtilifées de
cet organe doivent s’en exhaler continuellement ; ■'j
la chaleur des rayons qui les pénètrent, les atténue
& les raréfié ; ce qui étant joint au liquide
fubtiiou aux efprits du nerf optique voifin, que
la proximité du cerveau fournit abondamment, doit
faire un fonds de matière volatile que l’oeil diftri-
buera, & pour ainfi dire déterminera. Nous avons
, donc ici le trait à la main pour le lancer ; ce trait
a toute’ la force & la violence, & la main toute
la vîteffe & l’a&ivité néceffaires : il n’eft donc pas
étonnant fi leurs effets font promis & grands.
Concevons l’oeil comme une fronde capable des
mouvemens & des vibrations les plus promtes &
les plus rapides, & outre cela comme ayant communication
avec la fource d’une matière telle que
le fuc nerveux qui fe travaille dans le cerveau ;
matière fi fubtile & fi pénétrante, qu’on croit
qu’elle coule en un inftant à-travers les filets fo-
lides des nerfs, & en même tems fi aéfive & fi
puiffante, qu’elle diftendfpafmodiquement les nerfs,
fait tordre les membres, & altéré toute l’habitude
du corps y en donnant du mouvement & de l’action
à une maffe de matière naturellement lourde
& fans attivité.
Un trait de cette efpece lancé par une machine
telle que l’oe il, doit avoir fon effet par-tout où il
frappe ; & l’effet fera plus ou moins grand fuivant
la diftance, l’impétuofité de l ’oe il, la qualité,
la fubtilité, l’acrimonie des fens, la délicateffe ou
la groiîiereté de l’objet qui eft frappé.
Par cette théorie on peut, à mon av is , rendre
raifon de quelques-uns des phénomènes du maléfice,
& particulièrement de celui qu’on nomme fafeination.
Il eft certain que l’oeil a toujours été regardé
comme le fiége principal ou plutôt l’organe du ma-
léficcy quoique la plupart de ceux qui en ont écrit
ou parlé, ne fuffent pas pourquoi. On attribuoit le
maléfice à l’oe il, mais on n’imaginoit pas comment
il opéroit cet effet. Ainfi félon quelques-uns, avoir
mauvais ce.il , eft la même chofe qu'être adonné aux
maléfices : de-là cette expreflion d’un berger dans
Virgile :
N ef cio quis teneros oculus mihi fafeinat àgnôs.
D e plus , les perfonnes âgées & bilieufes font
celles que l’on croit ordinairement avoir la vertu
du maléfice, parce que le fuc nerveux eft dépravé
dans ces perfonnes par le vice des humeurs qui en
l’irritant, le rendent plus pénétrant & d’une nature
maligne. C ’eft pourquoi les jeunes gens & fur-tout
les enfans en font plutôt affeûés, par la raifon que
leurs pores font plus ouverts, leurs fucs fans cohérence,
leurs fibres ’délicates & trèsTenfibles : aufli
le maléfice dont parle Virgile n’a d’effet que fur les
tendres agneaux.
Enfin le maléfice ne s’envoie que par une per-
fonne fâchée, provoquée, irritée, &c. car il faut un
effort extraordinaire & une vive émotion d’efprit
pour lancer une fuffifante quantité d’écoulemens,
avec une impétuofité capable de produire fon effet
à une certaine diftance. C ’eft une chofe inconteftable
que les yeux ont un pouvoir extraordinaire.
Les anciens Naturaliftes affurent que le bà-
filic & l’opoblepa tuent les autres animaux par leur
feul regard. On en croira ce qu’on voudra; mais
un auteur moderne affure avoir vu une fouris qui
tournoit autour d’un gros crapaud lequel étoit occupé
à la regarder attentivement la gueule béante ;
la fouris faifoit toujours des cercles de plus petits
en plus petits autour du crapaud, & crioit pendant
ce tems-là comme fi elle eût été pouflee de force à
s’approcher de plus en plus du côté du reptile. Enfin
nonobftant la grande réfiftance qu’elle paroiffoit
faire, elle entra dans la gueule béante du crapaud
& fut auftitôt avalée. Telle eft encore l’aftion de
la couleuvre à l’égard du crapaud qu’elle attend la
gueule béante, & le crapaud va de lui-même s’y
précipiter. On peut rapporter à la même caufe ce
que raconte un phyficien. Il avoit mis fous un ré-:
cipient un gros crapaud, pour voir combien il y
vivroit fans aucune nourriture, & il l’obfervoit
tous les jours : un jour entr’autres, qu’il avoit les
yèux fixés! fur cet animal, le crapaud en s’ehflafit
dirigea les fiéns fur ’ceux de Tobfeïvatenr, dont
infenfiblement la vue fe troubla, & qui tomba enfin
en fyncope. Qui eft-ce qui n’a pas oblervé un
. chien- couchant & les effets de fon oeil fur la perdrix
, dès qu’une fois les yeux dit pauvre ©ifeau
rencontrent ceux du chien, la perdrix s’arrête-, pa-
roît toute troublée ; ne penfe plus à fa Conferva-
■ tion & fe laiffe prendre facilement. Je me foiivïerts
d’avoir lu qu’un chien en regardant fixement des
écureuils qui étoient fur des arbres ; les avoit arrêtés
, ftupéfiés* & fait tomber dans fa gueule.
Il eft aifé d’obferver que l’homme n’eft pas à
Couvert de.femblables impreflions. Il y a peu de
gens qui n’ayent quelquefois éprouvé les effets d’un
oeil colere>ner, imposant, dédaigneux * lafeif, fup-
pliant, &c. Ces fortes-d’effets ne peuvent eertaine-
ment venir que des differentes éjaculations de -l’deil,
& font <un degré de maléfice. Voilà tout ce qu’une
mauvaife philofophie peut dire de moins pitoyable.
Les Démonographes entendent par maléfice une
efpece de magie par laquelle une perfonne par le
moyen du démon,caufe du mal à une autre. Outre
la fafeination dont nous venons de parler, ils
en comptent plufieurs autres efpeces, comme les
philtres* les ligatures, ceux qu’on donne dans un
breuvage ou dans un mets* ceux qui fe font par
Thaleine, &c. dont la plupart peuvent être rapportées
au poifon; de forte que quand les juges iécu-
-liers connoiffent de cette efpece de crime & condamnent
à quelque peine affliétive ceux qui en font
convaincus, le difpofitif de la fentence porte toujours
que e’eft pour caufe d'émpoifonnement & de
maléfice. Voye{ Lig a tu r e , Phil tr e , &c.
MALE-GOUVERNE , f. f. {Hifi. eccléf.') nom
que l’on donne en certains monafteres, aux bâti-
xnens qui font acceflibles aux perfonnes de dehors*
où la réglé ne s’obferve pas.
M A L EM B A , QGéogé) royaume dans la baffe-
Éthiopie , au midi du royaume de Metamba. La
C o an za , dont la fource eft inconnue, le coupe
■ d’orient en occident. ( D . J. )
MALEMUCK, f. m. {Hifi. nat.)oi(ean qui eft commun
fur les côtes deSpitzberg. Ils s’attroupent comme
des moucherons, pour manger la graiffe des baleines
, qui nage à la îùrface des eaux ; ils en prennent
avec tant d’excès qu’ils font obligés de la re-
jetter, après quoi ils en prennent de nouveau. Lorf-
qu’une baleine a été frappée avec le harpon, ils font
fort avides de s’abreuver de fon fang : en un mot;
il n’eft point d’animal plus vorace. Get oifeau a
comme deux becs, l’un au - deffus de l’autre. Il a
trois ongles liés par une peau grife ; fa queue eft
large & fes ailes longues ; la couleur de fes plumes
v a r ie , mais en général il eft gris & blanc fous le
ventre. Il ne plonge point fous l’eau, mais il fe
foutient à fa Iùrface ; l ’odeur de ces animaux eft
d’une puanteur révoltante.
MALETTE A b e r g er , ( Botan. ) burfa partons.
Offic. Voye^T a b o u r e t , Botan. ( 2? ./ .)
M ALEUS Sin u s y (Géog. anc.) le golfe de Malée
qui étoit fans doute près du cap Malée* Flo-
rus en parle lib. III. cap. vj. (D . J .)
MAL F A ÇO N , f. f. { Art méchan.) le dit de tout
defaut de matière & de conftru&ion, càufé par
ignorance , négligence de travail, ou épargne. Par
exemple, les jurés-experts font obligés par leurs
ftatuts & régleméns, de vifiter les bâtimens que
l’on conftruit, pour réformer les mal-façons & aîl-
tres abus qui fe commettent dans l’art dè-bâïir.
MAL FAISANT, adji {Gram. & Morale.') qui riùit*
qui fait du mal. Si l’homme eft libre ; c ’éft-â-dire ;
fi l’ame a une a&ivité qui lui foit'propre; & en
vertu de laquelle elle puiffe fe déterminer ‘à faire
Tome IX*
OH ne pas faire une a â io n , queflës 'qhë forent fis
habitudes ou celles du corps, fes idées, fes paf-
fions , le •tempérament, l’âge; les préjugés; &c. il
y a certainement des hommes Vertueux & des hommes
vicieux; s’il n’y a point de 'liberté',' i l !nV a
plus que des hommes bie» faifans & : dès hommes
- mal-faifans.; mais les hommes n’en font pàS ' moi ris
modéfiables en bien & en mal ; les bons exemples'
les bons difcoùrs* ieS châti’ftiens, les récômpenifes \
le blâme, la louange, les lois ont toujours leur e f fet
: l’homme maTfafaht left malheureüfemènt héÿ
MAL FAISANTE* (/«/eff.) Voye^ M i lLé-p Iés.
MALHEUR, (Afo/vz/ê.) infortune‘* defaftre, accident
dommageable &c fâcheux!
Lès malheurs font tout- l’àppanage de Lbififiafiité.
Il y en a pour tous les ëtâts de la vié vpérfohnb
ne pèut s’y fouftraire, ni fe flater de s’en ■ mettre à
1 abri ; il eft peut-etré meme plusfage de préparer
l'on ame à i ’adverfité que de s’ôccupér &W prévenir.
On voit des 'geris des plus eftimables; fiir là-
lifte de ces noms lactés qtie l’ènvie a!perféclités,'que
leur mérite a perdus, & qui ont laiffé 'aUx rehiprds
de leurs perleeuteurs le foin de leur propre Vengeance.
-Les malheurs dé veloppent fouveiit eh nout
des fentimens, des lumières-, des forcés que nous
ne connoiflions pas, faute d’en avoir e'u bèfoin.
Ergotele chante par Pindaré, n’eût point triomphé
fans rinjufte exil qui l’éloigna de fa patrie ; fa gïbirè
le leroit fletrie dans la maîfon de fon pere, "comme
une fleur fur fa tige. L’infortuné fait fui lefc
grandes âmes ce que la rofé'e fait fur les fleurs, û
je puis me fervir de cètte compàraifon ; elle anf-
me leurs parfums; elle tire de leur fein les odeurs
qui embaument l’air. Socrate fe difoit V'accoucheur
des penfées : je croi que le malheur l’eft dès vertus’.
Ce fage a été lui-même un bel exemple de Vrhjuf'
tice des hommes -, à condamner celui qu’ils dévoient
le plus refpeéler. Après c e la , qui peut ré-
pondre de fa deft-inée ? Il ne tiendroit quelquefois
qu’à cinq ou fix coquins de faire pendre le plus
honnête homme, en atteftant qu’il a fait un%ol '
auquel il n’a pu penfer. Enfin nous n’avohs à houl
que notre courage, qui forcé de céder à des obf-
taclès infurmontables, peut plier fans être vaincu.
Cette penfée poétique de Sénéque eft fort belle i
*< La vraie grandeur eft d’avoir en même-tèms la foii
» bleffe de l’homme, & la force de Dieu ». Lés Poètes
nous difent que lotfqu’Hereule fut détacher Pro-
méthée (qui repréfenre la nature htimàihe), il tra-
verfa l’Océan dans un vafe de tefre : c’eft donner
une v ive idée du courage, qui dans là chair frai
gile furmonte lés tempêtes de ce monde. {D . ƒ.)
MALHEUREUX, MISÉRABLE. {Gram}) On
dit.indifféremment une vïe malhmreufe, iitie v ie mi-
feràble ; c’eft un malheureux ; c’eft un ho'mhre mifera-
bie. Mais il y a des endroifS où l’un de cës deux motÉ
ëft bon, & l’autre ne vaùt rien. On eft. malheureux:
au jeu , on n*y eft pas hnférable ; mais on devient
miféràbley en perdant bèaücoupau jeu. Mifèrdble femble
marquer un état fâcheux, foit que l’bn y foit n é ,
foit qué l’bn y foit tombé. Malheureux femble mar-:
quer un accident qui arrive tOur-à-coup, & qui
ruine une fortune naiffahte ou établie. On plaint
proprement les màlluunùx; on afiïfte les ttfiférableSi
Voici deux vers de Racinfe qüi expriméht fort bien
la différence de ces deux mots :
Haiy craint, envié, fomvent plus miférable
. Que tous les malheureux que mon pouvoir accabUi
De plus, miférable a d ’antres feris que malheureux n’â
pas; car on dit d’uh méfchaht aütéttr & d’iin méchant
Ouvrage : C’eft uii aiitéuf htifêroblty tèlâ eft miféràblef
On dit encore à-péù-pfès dans le même fens : Vquÿ
6ié ttaitei eorimie i^l ‘frdférdbl'e ; c’eft-à-dirê^* vous
D D D d d d i j