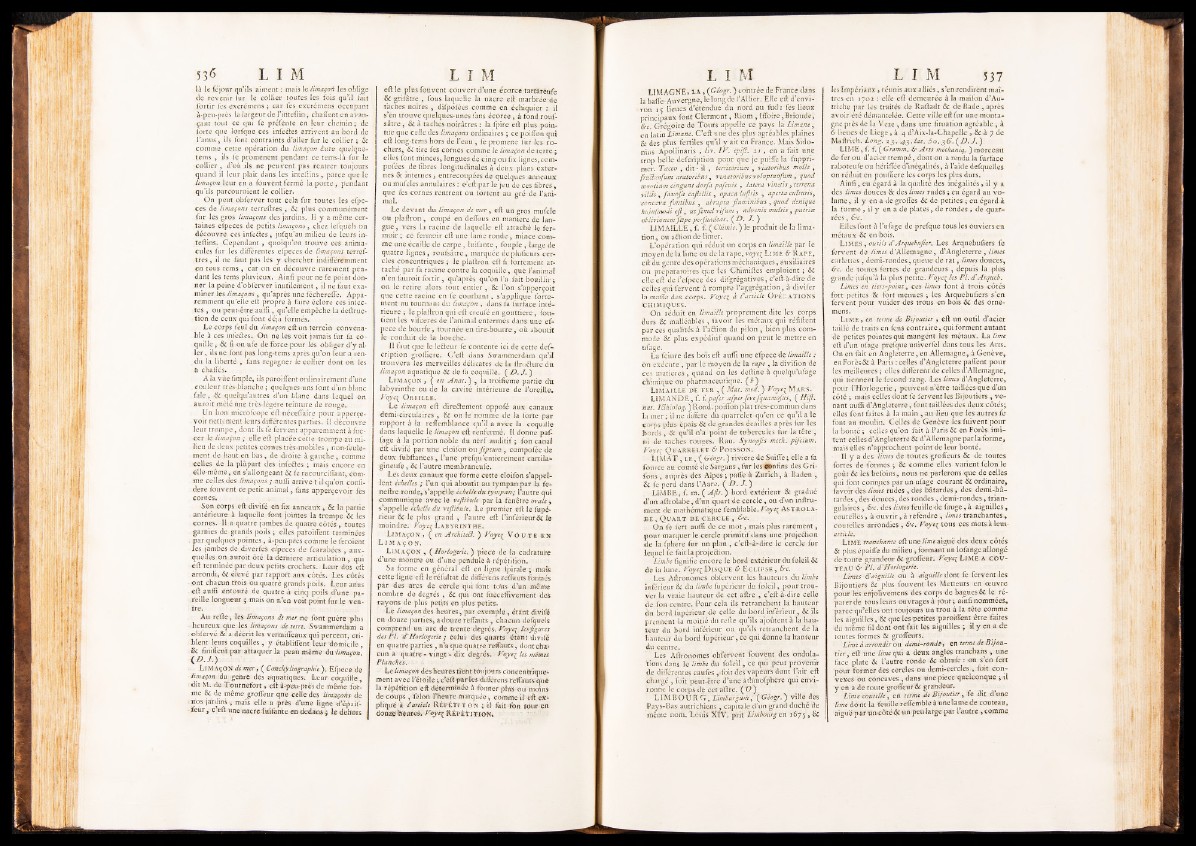
53* L IM L IM
là le féjour qu’ ils aiment : mais le limaçoii les oblige
de revenir fur lé collier toutes les fois qu’il fait
fortir fes êxcrémens ; car fes excrétnens occupant
à-peu-près la largeur de l’irlteftin, chaffent en avançant
tout ce qui fe préfsnte en leur ehetnin ; de
forte que lorfque ces infeôes arrivent au bord de
l ’anus , ils font contraints d’aller fur le collier ; &
comme cette opération du limaçon dure quelqué-
tems , ils le promènent pendant ce tems-là fur le
collier , d’où ils ne peuvent pas rentrer toujours
quand il leur plaît dans les inteftins, parce que le
limaçon leur en a fouvènt fermé la porte , pendant
qu’ils parcouroient le collier.
On peut obferver tout cela fur toutes les efpe-
ces de limaçons terreftres , ôc plus communément
fur les gros Limaçons des jardins. Il y a même certaines
elpeces de petits limaçons, chez lefquèls bn
découvre ces infeéles , jufqu’au milieu de leurs inteftins.
.Cependant , quoiqu’on trouve ces anima-
cules fur les différentes efpeces de limaçons terréf-
t fe s , il ne faut pas les y chercher indifféremment
en tous tems , car on en découvre rarement pendant
les tems pluvieux. Ainli pour ne fe point donner
la peine d’obférver inutileinent, il ne faut examiner
fes limaçons , qu’après une fécherefte.» Apparemment
qu’elle elt propre à faire éclore ces iniec-
tes , ou peiit-être au f i l , qu’elle empêche la deftruc-
tion de ceux qui font déjà formés.
Le corps feiil du limaçon eft un terrein convenable
à ces inleéleSi On ne les voit jamais fur fa co quille
j ôc fi on ufe de force pour lés obliger d’y alle
r , ils ne font pas long-tems après qü’on leur a rendu
la liberté , fans regagner le collier dont on les
a chaffés.. t .
A la vue fimple, ils paroiffent ordinairement d’une
couleur très-blanche ; quelques-uns font d’un blanc
fa le, ôc quelqu’autres d’un blanc dans lequel on
. auroit mêlé ùne très-légère teinture de rouge.
Un bon microfcope éft néceffaire pour apperçe-
voir nettement leurs différentes parties. Il découvre
leur trompe, dont ils fe fervent apparemment à fuc-
cer le limaçon ; elle éft placée cette trompe au milieu
de deux petites cornes très-mobiles , non-feulement
de haut en bas , de droite à gauche, comme
celles de la plupart des infeâes ; mais encore en
elle-même, en s’allohgeant Ôc fe racourciffant, comme
celles des limaçons ; auffi arrive t ii qu’on cOnfi-
dere fouvent ce petit animal, fans apperçevoir fes
cornes1.
Son corps eft divifé en fix anneaux, ôc la partie
antérieure à laquelle font jointes la trompe ÔC les
cornes. Il a quatre jambes de. quatre côtés, toutes
garnies de grands poils ; elles pafoiffent terminées
par quelques pointes, à-peu-près comme le feroient
les jambes de.diverfes efpeces de fearabées , auxquelles
on.auroit ôté la derhiere articulation, qui
eft terminée par deux petits crochets. Leur d'os eft
arrondi, ôc élevé par rapport aux côtés» Les côtes
.ont chacun trois bu quatrè grands poils. Leur anus !
eft auffi entouré de quatre à cinq poils d’une pa- |
Teille longueur ; mais on n’en voit point fur le ven- ;
ire.
Au refte-, les limaçons dé mer ne font guère plus
heureux que.les limaçons de terre. Swammerdam a
obferve & a décrit les vermiffeaux qui perefent, criblent
leurs coquilles , y établiffem leur 'domicile ,
6c fi ni fient par attaquer la peau même du 'limaçon.
{D. A):.’,:;.-,;,.
L im a ç o n , de mer, ( Ccmchyliographie Efpécé de
limaçon du gehre des aquatiques; Leur coquille, :
dit M-. de Tournefort, eft à-peu,-près de même for- !
me ôc de même groffeur que celle des ïimàç&ks- de I
lïos jardins , mais elle a -près d’une ligne d’ëpaif- I
feur, tfeft une nacre luifànte en dedans ; le dèhors
eft le plus foUvent couvert d’une écarcé tarfâréufe
ôc grilâtre , fous laquelle la nacre eft marbrée de
tâches noires , difpolèes comme en échiquier : il
s’én trouve quelques-unes lans écorce, à fondrouf-
sâtre, & à taches noirâtres : la fpire eft plus pointue
que celle des limaçons ordinaires ; ce poiffon qui
eft long-tems hors de l’eau , fe promene fur les rochers,
6c tire fes cornes comme le limaçon de terre;
elles font minces, longues de cinq ou fix lignes^,composées
de fibres longitudinales à deux plans externes
& internes > entrecoupées de quelques anneaux
ou mufeles annulaires i ô’eft par le jeu de ces fibres,
que fes cornés rentrent ou fortent au gré de l’animal.
Le devant du limaçon de mer, eft un gros mufcle
ou plaftron , coüpé en deflous en maniéré de langue,
vers la racine de laquelle eft attaché le fermoir
; cê fermoir eft une lame ronde , mince comme
une écaille de carpe , luifànte, fouple , large de
quatre lignes, roufsârre , marquée deplufieurs cercles
concentriques ; le plaftron eft li fortement attaché
par fa racine contre la coquille, que l’animal
n’en fauroit fortir , qu’après qu’on l’a fait bouillir ;
on le retire alors tout entier, ôc l’on s’apperçoit
que cette racine en fe courbant, s ’applique fortement
au tournant du limaçon , dans fa furface intérieure
; le plaftron qui eft creufé en gouttière, fou-
tient les viïceres de l’animal enfermés dans une ef-
pece de bourfe, tournée en tire-bourre, où aboutit
le conduit de la bouche»
Il faut que le leéfeur fe contente ici de cette description
grofliere. C ’eft dans Swa ramer dam qu’il
trouvera les merveilles délicates de la ftruélure du
limaçon aquatique ôc de fa coquille. ( D. J. )
Limaçon , ( en Anat») , la troifieme partie du
labyrinthe ou de la cavité intérieure de l’oreille,
Voyt^ O r e il l e .
Le limaçon eft dire élément oppofé aux canaux
demi-circulaires , & on le nomme de la forte par
rapport à la reffemblance qu’il a avec la coquille
dans laquelle le limaçàn eft renfermé. Il donne paf-
(age à la portion noble du nerf auditif ; fon canal
éft divifé par une cloifon Ou feptum , compofée de
deux fubftances, l’une prefqu’entièrement cartila-
gineufe, ôc l’autre membraneufe.
Lés deux canaux que forme cette cloifon s’appellent
échelles ; l’ürt qui aboutit au tympan par la fe-
neftre ronde, s’appelle échettedu iymp-an; l’autre qui
communique avec le vefibule par la fenêtre ovale ç
s’appelle échelle du vefibult. Le premier eft le flipé*-
rieur ôc le plus grand , l’autre eft l’inférieur & le
moindre. Voÿe{ LABYRINTHE.
Limaçon , ( en Archiied. ) Voye^ V ô u t e e n
L im a ç o n »
Limaçon , ( Horlogerie, ) pièce de fe cadrature
d’une mohtre Ou d’une pendule à répétition.
Sa forme en général eft en ligne fpirafe ; ma«
cette ligne eft leréfultat dé différéns reffaut$ formés
par des arcs de cercle qui font tous d’un mémo
nombre de degrés , & qui ont fiiCcèffivemèrtt des
rayons de plus petits en plus petits.
Lê limaçon Aies heures^ par exemple, étant divifé
en douze parties^ a douze reflauts, chacun dèfqiïels
comprend un arc de t-rêntedegrés. Voye^. les figures
des PL d'Horlogerie ; celui des quarts étant divifé
en quatre parties , n’a qnè'quatre rehauts, dont cha1
cun à quatre - vingt i- dix degrés. Voyt^ tes mêmes
Planches. •
Lè limuçoh des heures tient toujours concentriquement
avec l’étoile ; c^éftparies différons reffauts què
la répétition !eft déterminée à fonder plus ou moins
de cou ps , Talon rhéure marquée -, comme il eft expliqué
à l'article RÉ'pétr t oIn ; il fait fon four en
douze''toèures'. Poye^ Ré-pé
L I M
LIMAGNE, l a , (Géogr. ) contrée de France dans
la b a ffe -Auvergne, le long de l’Ailier. Elle eft d’envL
ron i 5 lieues d’étendue du nord au fud : fes lieux
principaux font Clermont, Riom , Ifibire, Brioude,
&c. Grégoire de Tours appelle ce pays la Limane,
en latin Limane. C ’eft une des plus agréables plaines
& des plus fertiles qu’il y ait en France. Mais Sidonius
Apollinaris , Hy. ÎP . epifl. 2 1 , en a fait une
trop belle defeription pour que je puiffe la fùppri-
jner. Taceo , dit - il , territOriiim , viatoribus molli ,
frucluofum aratoribus, venatoribus volapttiofum , quod
montium cingunt dorfa pafeuis , latera vinetis, tirrenà
Villis , faxoja cafiellis , opaca luflris , aperta cultutis,
concava fontibus , abrupta fiuminibus , quod dtnique
hujujiuodi efl, utfimel v if um, advenis muitis, patries
oblivionem fcepe perfiadeas. (D . J. )
LIMAILLE, f. f. '( Chimie.) le produit de la lima-
tion, ou aftion de limer.
L’opération qui réduit un corps en limaillt par le
moyen de la lime ou de la râpe, voye^ Lime & R âpe,
eft du genre des opérations méchaniques, auxiliaires
Ou préparatoires que les Chimiftes emploient ; &
elle eft de i’efpece des difgrégatives, c’eft-à-dire de
celles qui fervent à rompre l’aggrégation, à divifer
la maffe des, corps. Voye^ à l'article Opérations
CHlMlQtJES.
On réduit en limaille proprement dite les corps
durs & malléables , lavoir les métaux qui réfiftent
par ces qualités à TaÔion du pilon , bien plus commode
ôc plus expéditif quand on peut le mettre en
üfage.
La fciure des bois eft auflï une efpece de limaille :
cm exécute , p a rle moyen de la râpe , la divifion de
ces matières, quand on les deftine à quelqu’ufage
chimique ou pharmaceutique. ( b )
Limaille oe fer',\M a t. mtd.') /^qye^MARS.
LIMANDE, f. f. pafir afp erJîveJquamofus, ( fîift.
hat. Icihioiôg.) Rond, poiffon plat très-commun dans
la mer ; il ne différé du qivarrelet qu’en ce qu’il a le
corps plus épais & dé grandes écailles après fur les
bords , & qu’il n’a point de tubercules fur la tête ,
ni de taches ronges. Rau. Synopfis meth. pif'cium.
Voyei Q üaRRELET & POISSON.
LIMAT , LE, '( Géogr. ) rivière de Sui'ffe ; elle a fa
four ce au comté de Sarg an s , fur les flonhns des Gri-
fons , auprès des Alpes ; paffe -à Zurich, à Baden ,
& fe perd dans l’Aare. { D . J. )
LIMBE , f. m. ( Afir. ) -bord extérieur & gradué
d’un aftrolabe, d’un quart de cercle , ou d’un inftrù-
ment de mathématique fembiable. Voye^ Astrola-
jje , Q uart be cercle , 6x.
On fo fert auffi de ce mot, mais plus rarement,
pour marquer le cercle primitif clans une proje&ion
de la fpbere for un plan , c ’eft-à*-dife le cercle for
lequel fe fait la projedion.
Limbe fignifie encore le bord extérieur dufoleil &
de la lune» Voye^ DiSQUE'& Eclipse , &c.
Les Aftronomes obfervent les -hauteurs ,dù limbe
inférieur & du limbe fupérieur du fol c i l, pour trouver
la vraie hauteur de cet aftre , c’eft-à-dire celle
de fon centre. Pour cela ils retranchent la hauteur
du bord fupérieur dé celle du bord inférieur, & ils
prennent la moitié du refte qu’ils ajoutent à la hauteur
du bord inférieur ou qu’ils retranchent de là
hauteur dù bord 'fupérieur, cê qui donne la hanteur
du centre.
Les Aftronomes obféfvent Toùvént des ondulations
dans lè limbe du fbleil, ce qui peut provenir
de différentes caufes ,»foir d'èSYàpeûrs dont f ’air eft
chargé , foit peut-être d’une àfhrnôfphère qui environne
le corps cle cet aftre. J( 0 j
L TM B O U R G , Limbürgitrfi, (G'éogr. ) ville dés
Pays-Bas autrichiens , capitaje d’un grand duché de
même nom. Lcius X'IV, prit Limboürg en 1675, ôc
L I M 5 37
les Impériaux, réunis aux alliés, s’en rendirent maîtres
en 1702 : elle eft demeurée à la maifon d’Autriche
par les traités de Raftadt ôc de Bade , après
avoir été démantelée. Cette ville eft fur une montagne
près de la Veze , dans une fituation agréable, à
6 lieues de Liege » à 4 d’Aix-la-Chapelle, ôc à 7 de
Mafirich. Long. 23 . -43. lat. 5 o. 3 6 . (D . J. )
LIME, i. f. ( Gramm. & Arts méchaniq. ) morceau
de fer ou d’acier trempé, dont on a rendu fe furface
raboteufe ou hcrifice d’inégalités, à l’aide defquelles
on réduit en poulfiere les corps les plus durs.
Ainfi, eu égard à la qualité des inégalités, il y a
dés limes douces Ôt des limes rudes ; eu égard au volume
, il y en a de greffes ôc de petites ; eu égard à
la forme , il y en a de plates, de rondes * de quar-
rées, &c.
Elles font à l’ufage de prefque tous les ouviers en
métaux ôc en bois.
Limes , outils d'Arquebujier. Les Arquebufiers fe
fervent de limes d’Allemagne, d’Angleterre , /z/w«
earlettes , demi-rondes, queue de r a t , limes douces,
&c. de toutes fortes de grandeurs , depuis la plus
grande jufqu’à la plus petite. Voye{ les PL d'Arqueb.
Limes en tiers-point, ces limes font à trois cotés
fort petites & fort menues ; les Arquebufiers s ’en
fervent pour vuider des trous en bois ôc des orne-
mens.
Lime , en terme de Bijoutier , eft un outil d’acier
taillé de traits en fens contraire, qui forment autant
de petites pointes qui mangent les métaux. La lime
eft d’un ufage prefque univerfel dans tous les Arts.
On en fait en Angleterre, en Allemagne, à Genève,
en Forés ÔC à Pariscelles d’Angleterre paffent pour
les meilleures ; elles different de celles d’Allemagne,
qui tiennent le fécond rang. Les limes d’Angleterre,
pour l'Horlogerie, peuvent n’être taillées que d’un
côté ; mais celles dont fe fervent les Bijoutiers , venant
auffi d’Angleterre, font taillées des deux côtés;
elles font faites à la main , au lieu que les autres fe
font au moulin. Celles de Genève les fuivent pour
la bonté ; celles qu’on fait à Paris ôc en Forés imitent
celles d’Angleterre Ôc d’Allemagne par la forme,
mais elles n’approchent -point de leur bonté.
Il y a des limes dé toutes groflèurs ôc de toutes
fortes de formes ; ôc comme elles varient félon le
goût ôc les befoins, nous ne parlerons que de celles
qui font connues par un ufage courant ôc ordinaire,
fa voir des limes rudes , des bâtardes, des demi-bâtardes
, des douces, des rondes -, demi-rondes, triangulaires
, &c. des limes feuille dé fauge, à aiguilles,
couteHês-, à ouvrir, à refendre , limes tranchantes.,
co u telles arrondies , &c. Voye^ tous ces niots.à leui-
article.
LrME tranchante eft une AWaiguë des deux côtés
& plus.épaifle du milieu, formant un lofangeallongé
de tonte grandeur ôc groffeur. Voye^ Lime a ebu-
teaü & PL d"fforlogerie.
Limés tfaiguilk. ou -à aiguille dont fe fervent les
Bijoutiers ôc plus fouvent Tes Metteurs en oeuvne
pour les enjolivemens des corps de bagues & le ré-
parer-de tous leurs ouvrages à jour; ainfi nommées,
parce qu’ elles ont toujours un trou à la tête comme
% s aiguilles, ôc que lespetités paroiffent être faites
du mime fil dont ont fait les aiguilles.; il y en a de
toutes formes & groflewrs. ' '
Limé h arrondir ou demi-rond#, en urme.de Btjou~
Jtier, eft une lime qui a deux angles rranchans ■ , une
face plate Ôc l’autre ronde & ôbmtfe : on s?én fert
pour former des cercles ou demi-cercles , fort ,oon-
vexes ou concaves , clans une piece quelconque ; i l
y en a dé toute groffeur Ôc gr andeur. ^
'■ Lime xoùtèlh, en terme de Bijoutier, fe -dit d une
-lime do nt-la feuille reffemble à nne'lame de couteau,
aiguë par üncôté ôc un-peufetge par l’autre , comme