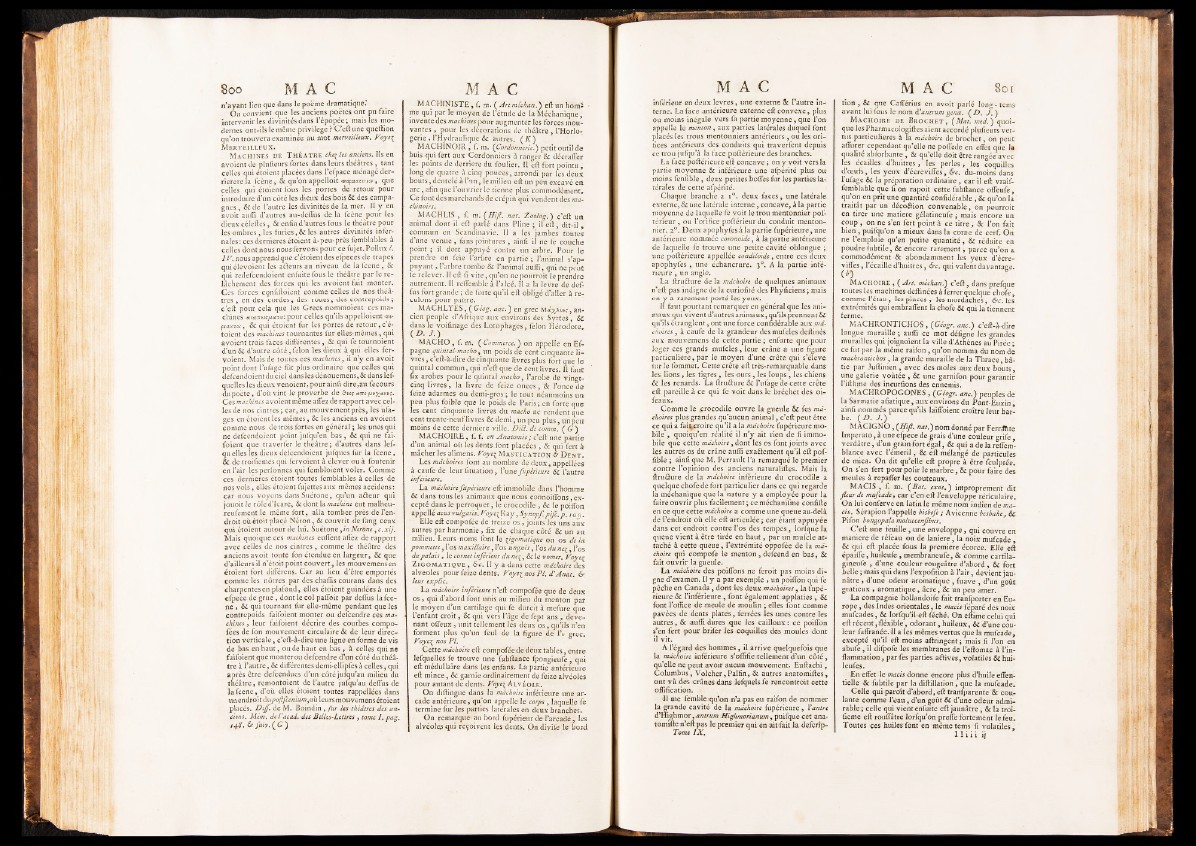
n’ayaht liea que dans le poëme dramatique.’
On convient que les anciens poëtes ont pu faire
intervenir les divinités dans l’épopée ; mais les modernes
ont-ils le même privilège ? C ’eft une queftion
qu’on trouvera examinée au mot merveilleux. Voyei
M e r v e il l e u x .
M a c h in e s d e T h é â t r e che^les anciens. Ils en
avoient de plusieurs fortes dans leurs théâtres , tant
celles qui étoient placées dans l’efpace ménagé der-
rierere la fcène, & qu’on appelloit ^ctfetTKiviov, que
celles qui étoient fous les portes de retour pour
introduire d’un côté les dieux des bois & des campagnes
, & de l’autre les divinités de la mer. Il y en
a voit au fli d’autres au-deflùs de la fcène pour les
dieux céleftcs, & enfin d’autres fous le théâtre pour
les ombres, les furies, & les autres divinités infernales:
ces dernieres étoient à-peu-près femblables à
celles dont nous nous fervons pour ce fujet. Pollux /.
IV . nous apprend que c’étoient des efpeces de trapes
qui élevoient les a&eurs au niveau de la feene , &
qui redefeendoient enfuite fous le théâtre par le relâchement
des forces qui les avoient fait monter.
Ces forces confiftoient comme celles de nos théâtres
, en des cordes, des roues, des contrepoids;
c ’eft pour cela que les Grecs nommoient ces machines
avamiiTfAcLTec: pour celles qu’ils appelaient trt-
pict-AToi, & qui étoient fur les portes de retour, c’étoient
des machines tournantes fur elles-mêmes, qui
avoient trois faces différentes, & qui fe tournoient
d’un & d’autre cô té, félon les dieux à qui elles fer-
voient. Mais de toutes ces machines, il n’y en avoit
point dont l’ufage fut plus ordinaire que celles qui
defeendoient du ciel dans les dénouemens, & dans lef-
quelles les dieux venoient, pour ainfi dire,au fecours
du poëte, d’où vint le proverbe de «tto /u.nxctv»ç.
Ces machines avoient même allez de rapport avec celles
de nos cintres ; car, au mouvement près, les ufa-
ges en étoient les mêmes, & les anciens en avoient
comme nous de trois fortes en général ; les unes qui
ne defeendoient point jufqu’en bas, & qui ne fai-
foient que traverfer le théâtre; d’autres dans lef-
quelles les dieux defeendoient jufques fur la feene,
& de troifiemes qui fervoient à élever ou à foutenir
en l’air les perfonnes qui fembloient voler. Comme
ces dernieres étoient toutes femblables à celles de
nos vo ls , elles étoient fujettesaux mêmes accidens:
car nous voyons dans Suétone, qu’un aôeur qui
iouoit le rôle d’Icare, & dont la machine eut malheu-
reufement le même fort, alla tomber près de l’endroit
oii étoit placé Néron, & couvrit de fang ceux
qui étoient autour de lui. Suétone fmNerünt, c.xij.
Mais quoique ces machines euffent affez de rapport
avec celles de nos cintres, comme le théâtre des
anciens avoit toute fon étendue en largeur, & que
d’ailleurs il n’étoit point couvert, les mouvemensen
étoient fort différens. Car au lieu d’être emportés
comme les nôtres par des chafiis courans dans des
charpentes en plafond, elles étoient guindées à une
efpece de grue, dont le col paffoit par deffus la feen
e , & qui tournant fur elle-même pendant que les
contrepoids faifoient monter ou defeendre ces machines
, leur faifoient décrire des courbes compo-:
fées de fon mouvement circulaire & de leur direction
verticale, c’eft-à-dire une ligne en forme de vis
de bas en haut, ou de haut en bas , à celles qui ne
faifoient que monter ou defeendre d’un côté du théâtre
à l’autre, & différentes demi-ellipfes à celles, qui
après être defeendues d’un côtéjufqu’au milieu du
théâtre, remontoient de l’autre jufqu’au deffus de
la feene, d’où elles étoient toutes rappellées dans
lin endroit dupo/lfceniumtoxi leurs mouvemens étoient
placés. Dijf. de M. Boindin ,/«r les théâtres des anciens.
Mèm. deVacad. des Belles-Lettres 3 tome I , pag.
14$. 6* fuiv. ( G )
MACHINISTE, f. m. { A n mickan.) eff un hom- -
me qui par le moyen de l’étude de la Méchanique,
invente des machines pour augmenter les forces mouvantes
, pour les décorations de théâtre, l’Horlogerie
, l’Hydraulique & autres. ( K )
MACHINOIR, f. m. (Cordonnerie.) petit outil de
buis qui fert aux Cordonniers à ranger & décraffer
les points de derrière du fou lier. Il eff fort pointu ,
long de quatre à cinq pouces, arrondi par les deux
bouts, dentele a l’un, le milieu eft un peu excavé en
a rc, afin que l’ouvrier le tienne plus commodément.
Ce font des marchands de crépin qui vendent des ma-,
chinoirs.
MACHLIS , f. m. ( Hifl. nat. Zoolog. ) c’eft un
animal dont, il eft parlé dans Pline ; il eft, d it-il,
commun en Scandinavie. Il a les jambes toutes
d’une venue , fans jointures , ainfi il ne fe couche
point ; il dort appuyé contre un arbre. Pour le
prendre on feie l’arbre en partie ; l’animal s’appuyant
, l’arbre tombe & l’animal auffi, qui ne peut
fe relever. Il eft fi v ite , qu’on ne pourroit le prendre
autrement. Il reffemble à l’alcé. Il a la levre de deffus
fort grande ; de forte qu’il eft obligé d’aller à reculons
pour paître.
MACHLYES, (Géog. anc. ) en grec ancien
peuple d’Afrique aux environs des Syrtes, &
dans le voifinage des Lotophages, félon Hérodote.
(Z>. /.)■
MACHO, f. m. ( Commerce. ) on appelle en Ef-
pagne quintal-macho , un poids de cent cinquante livres
, c’eft-à-dire de cinquante livres plus fort que le
quiptal commun, qui n’eft que de cent livres. Il faut
fix arobes pour le quintal macho, l’arobe de vingt-
cinq livres, la livre de feize oncés, & l’once de
feize adarmes ou demi-gros ; le tout néanmoins un
peu plus foible que le poids de Paris ; en forte que
les cent cinquante livres du macho ne rendent que
cent trente-neuf livres & demi, un peu plus, un peu
moins de cette derniere ville. DiS. de comm. ( G )
MACHOIRE, f. f. en Anatomiej c’eft une partie
d’un animal où les dents font placées , & qui fert à
mâcher les alimens. Voye^ M a s t i c a t io n & D e n t .
Les mâchoires font au nombre de deux, appellées
à caufe de leur fuuation, l’une fupérieure & l’autre
inférieure.
La mâchoire fupérieure eft immobile dans l’homme
& dans tous les animaux que nous connoiffons, excepté
dans le perroquet, le crocodile , & le poiffon
appellé aats vulgaris. Voye^ R a y , Synopf pifc.p. iocf.
Elle eft compofée de treize o s , joints les uns aux
autres par harmonie, fix de chaque côté & un au
milieu. Leurs noms ifont le figomatique ou os de la
pommette, l’os maxillaire , l’os unguis, l’os du ner, l’os
du palais , le cornet inférieur du ne^, & le vorner. Voyc%_
Z ig o m a t iq u e , &c. Il y a dans cette mâchoire des
alvéolés pour feize dents. Voye^nos PI. d'Anat. 6*
leur explic.
La mâchoire inférieure n’eft compofée que de deux
os , qui d’abord font unis au milieu du menton par
le moyen d’un cartilage qui fe durcit à mefure que
l’enfant croît, & qui vers l ’âge de fept ans , devenant
offeux, unit tellement les deux o s , qu’ils n’en
forment plus qu’un feul de la figure de l’o grec.
Voye£ nos PI.
Cette mâchoire eft compofée de deux tables, entre
lefquelles fe trouve une fubftance fpongieufe, qui
eft médullaire dans les enfans. La partie antérieure
eft mince, & garnie ordinairement de feize alvéoles
pour autant de dents. Voye{ A l v é o l e .
On diftingue dans la mâchoire inférieure une arcade
antérieure, qu’on appelle 1 z corps , laquelle fe
termine fur les parties latérales en deux branches.
On remarque au bord fupérieur de l’arcade, les
alvéoles qui reçoivent les dents. On divife le bord
inférieur en deux levres, une externe & l’autre interne.
La face antérieure externe eft convexe, plus
ou moins inégale vers fa partie moyenne, que l’on
appelle le menton, aux parties, latérales duquel font
placés les trous mentonniers antérieurs, ou les orifices
antérieurs des conduits qui traverfent depuis
ce trou jufqu’à la face poftérieure des branches.
La face poftérieure eft concave ; on y voit vers la
partie moyenne & inférieure une afpérité plus, ou
moins fenfible, deux petites boffes fur les parties latérales
de cette afpérité.
Chaque branche a x°. deux face s, une latérale
externe, & une latérale interne, concave, à la partie
moyenne de laquelle fe voit le trou mentonnier pof-
térieur, ou l’orifice poftérieurdu conduit mentonnier.
2°. Deux apophyfesà la partie fupérieure, une
antérieure nommée coronoïde, à la partie antérieure
de laquelle fe trouve une petite cavité oblongue ;
une poftérieure appellée condiloide , entre ces deux
apophyfes , une échancrure. 30. A la partie inférieure
, un angle.
La ftrii&ure de la mâchoire, de quelques animaux
n’eft pas indigne de la curiofité des Phyficiens ; mais
on y a rarement porté les yeux.
IÏ faut pourtant remarquer en général que les animaux
qui vivent d’autres animaux, qu’ils prennent &
qu’ils étranglent, ont une force confidérable aux mâchoires
, à caufe de la grandeur des mufcles deftinés
aux mouvemens de cette partie ; enforte que pour
loger ces grands mufcles, leur crâne a une figure
particulière, par le moyen d’une crête qui s’élève
fur le fommet. Cette crête eft très-remarquable dans
les lions, les tigres, les ours, les loups, les chiens
& les renards. La ftru&ure & Pufage de cette crête
eft pareille à ce qui fe voit dans le bréçhet des oi-
feaux.
Comme le crocodile ouvre la gueule & fes mâchoires
plus grandes qu’aucun animal, c’eft peut être
ce qui a fai^eroire qu’il a la mâchoire fupérieure mobile
, quoiqu’en réalité il n’y ait rien de fi immobile
que cette mâchoire, dont les os font joints avec
les autres os du crâne auffi exaftement qu’il eft pof-
fible ; ainfi que M. Perrault l ’a remarqué le premier
contre l’opinion des anciens naturaliftes. Mais la
ftruûure de la mâchoire inférieure du crocodile a
quelque chofe de fort particulier dans ce qui regarde
la méchanique que la nature y a employée pour la
faire ouvrir plus facilement ; ce méchanifme confifte
en ce que cette mâchoire a comme une queue au-delà
de l’endroit où elle eft articulée ; car étant appuyée
dans cet endroit contre l’os des tempes , lorfque la
queue vient à être tirée en haut, par un mufcle attaché
à cette queue, l’ extrémité oppofée de la mâchoire
qui compofe le menton, defeend en bas, &
fait ouvrir la gueule.
La mâchoire des poiffons ne feroit pas moins digne
d’examen. Il y a par exemple , un poiffon qui fie
pêche en Canada, dont les deux mâchoires, la fupé-
rieure & l’inférieure -, font également applaties , &
font l’office >de meule de moulin ; elles font comme
pavées de dents plates, ferrées les unes contre les
autres, & auffi dures que les cailloux : ce poiffon
s’en fert pour brifer les 'Coquilles des moules dont
il vit.
A l’égard ides hommes, il arrive quelquefois que
la mâchoire inférieure s’offifie tellement d’un cô té,
qu’elle ne-peut a voir aucun mou vement. Euftadhi,
Columbus, Volcher ,Palfin, & autres anatomiftes,
ont vu des crânes dans iefquels fe rencontroit oette
offification.
11 me fiemble -qu’on n’a pas eu raifon de nommer
la grande cavité de la mâchoire fupérieure, Y-antre
d’Highmor yantrum Mighmonanum, puifque cet ana-
tomifte n’eft pas le premier qui en ait fait la deferîp-
Tome IX .
tion , & que Cafférius en avoit parlé long - tems1
avant lui fous le nom d’antrum gêna. ( D . J. )
M â c h o ir e d e B r o c h e t , (Mat. med. ) quoique
les Pharmacologiftes aient accordé' plufieurs vertus
particulières à la mâchoire de brochet, on peut
affurer cependant qu’elle ne poffede en effet que la
qualité abforbante , & qu’elle doit être rangée avec
les écailles d’huitres, les perles, les coquilles
d’oeufs, les yeux d’écreviffes, &c. du-moins dans
l’ufage & la préparation ordinaire , car il eft vraif-
femblable que fi on rapoit cette fubftance offeufe,
qu’on en prît une quantité confidérable , & qu’on la
traitât par un décoôion, convenable, on pourroit
en tirer une matière gélatineufe ; mais encore un
coup , on ne s’en fert point à ce titre, & l’on fait
bien , puifqu’on a mieux dans la corne de cerf. On
ne l’emploie qu’en petite quantité, & réduite en
poudre liibtile, & encore rarement, parce qu’on a
commodément & abondamment les yeux d’écreviffes
, l’écaille d’huitres, &c. qui valent davantage.
w
M â c h o ir e , (Art. mechan.) e’e f t, dans prefque
toutes les machines deftinées à ferrer quelque chofe,
comme l’étau, les pinces, les mordaches, &c. les
extrémités qui embraffent la chofe & qui la tiennent
ferme.
MACHRONTICHOS, (Géogr. anc.) c’eft-à-dire
longue muraille ; auffi ce mot défigne les grandes
murailles qui joignoient la ville d’Athènes au Pirée ;
ce fut par la même raifon, qu’on nomma du nom de
machrontichos , la grande muraille de la Thrace, bâtie
par Juftinien , avec des moles aux deux bouts,
une galerie voûtée , & une garnifpn pour garantir
Pifthme des ineurfions des ennemis.
MACHROPOGONES , (Géogr. anc.) peuples de
la Sarmatie afiatique, aux environs du Pont-Euxin
ainfi nommés parce qu’ils laiffoient croître leur barbe.
(D . J .)
MACIGNO, (Hifl. nat.) nom donné par Ferr&ite
Imperato, à une efpece de grais d’une couleur g rife,
verdâtre, d’un grain fort égal, & qui a de la reffem-
blance avec l’émeril, & eft mélangé de particules
de mica. On dit qu’elle eft propre à être fculptée.
On s’e.n fert pour polir le marbre, & pour faire des
meules à repaffer les couteaux.
MACIS , f. m. (Bot. exot.) improprement dit
fleur de mufeade, car c’en eft l’enyeloppé réticulaire.
On lui conferve en latin le même nom indien de macis.
Sérapion l’appelle bishefe ; Avicenne besbahe} &
Pifon bongopala moluccenflbus.
C ’eft »ne feuille, une enveloppe, qui couvre en
maniéré de réfeau ou de laniere, la noix mufcaçle ,
& qui eft placée fous la première écorce. Elle eft
épaiffe, huileufe , membraneufe, & comme cartila-
gineu'fe , d’une couleur rougeâtre d’abord , & fort
belle ; mais qui dans l’expofition à l’air, devient jaunâtre
, <l’une odeur aromatique , fuave , d’un goût
gratieux , aromatique, â c re ,,& un peu amer.
La compagnie hollandoife fait tranfporter en Europe,,
des Indes orientales, le macis féparé des noix
mufeades, & Iorfqu’il-eft féché. On eftime celui qui
eft récent, fléxible, odorant, huileux, & d’une couleur
faffranée. II a les mêmes vertus que la mufeade,
excepté qu’il eft moins aftringent ; mais fi l’on en
abufe, il difpofe les membranes de l’eftomac à l’inflammation,
par fes parties a vives, volatiles & hui-
leufes.
En effet le macis donne encore plus d’huile effen-
tielle & fubtile par la diftillation, que la mufeade.
Celle qui paroît d’abord, eft tranlparente & coulante
comme l’eau , d’un goût & d’une odeur admirable;
celle qui vient enfuite eft jaunâtre, & la troi-
fieme eft rouffâtre lorfqu’on prefle fortement le feu.
Toutes ces huilesfont en même tems fi volatiles,
1 1 i i i ij