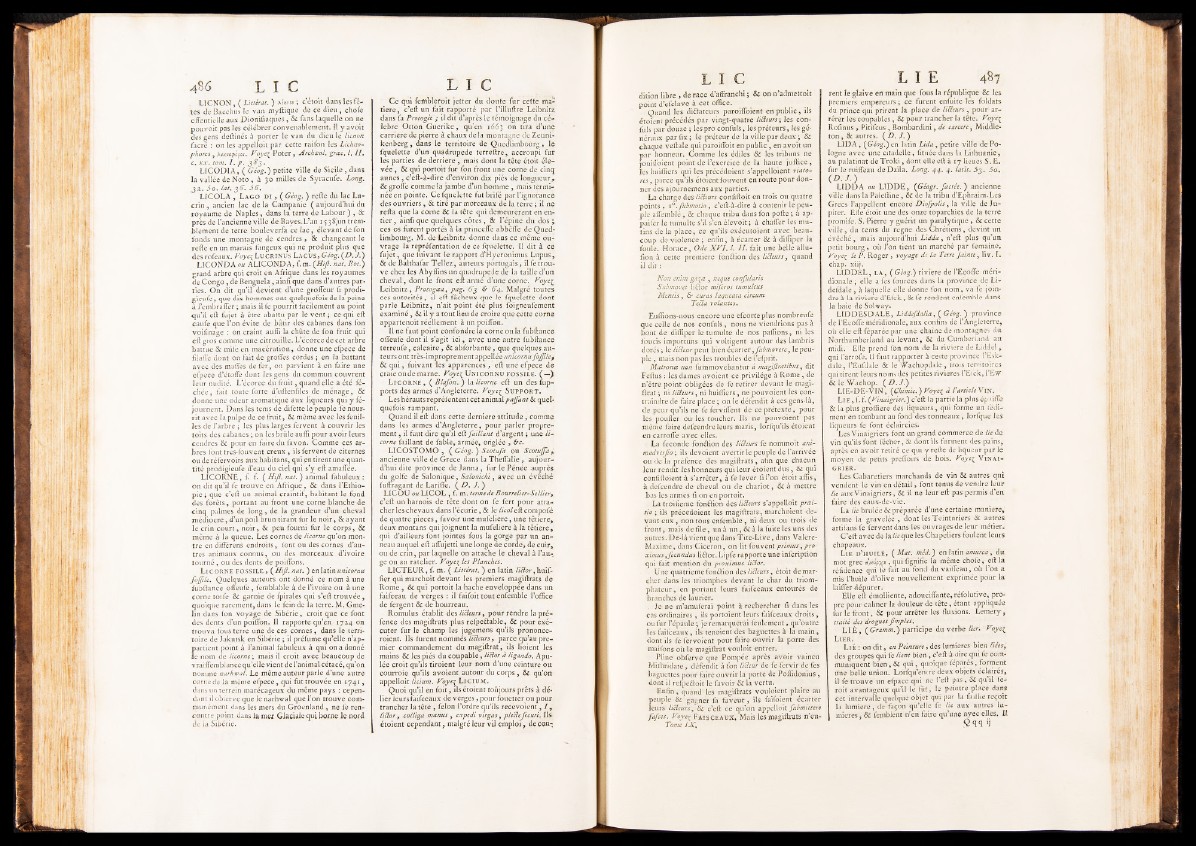
LICNON , ( Littérat. ) *Uw ; c’étoit dans les fêles
de Bacchus le van myftique de ce dieu, chofe
eflentielle aux Dionifiaques, 6c fans laquelle on ne
pouvoit pas les célébrer convenablement. Il y avoit
des gens deftinés à porter le van du dieu le licnon
/acré : on les appelloit par cette railon les Lichno-
jihores , xuvoipôpoi. Foye^ Poter, Archceol. grtec, l. I I .
c. x x . tom. I . p. 383 •
LICODIA, ( Géog.) petite ville de Sicile , dans
la vallée de Noto, à 30 milles de Syracufe. Long.
j a . 60. lut. jG . 66.
LICOLA , L ag o di , ( Géog. ) refte du lac Lu-
crin , ancien lac de la Campanie ( aujourd’hui du
royaume de Naples, dans la terre de Labour) , &
près de l’ancienne ville de Bayes.L’an 15 3 8’uii tremblement
de terre bouleverfa ce la c , élevant de fon
fonds une montagne de cendres , & changeant le
refte en un marais fangeux qui ne produit plus que
des rofeaux. ^oyc^LuCRiNUS Lacu s, Geog. (JD. J.')
LICONDA ou ALICONDA, f. m. (Hifi. nat. Bot!)
grand arbre qui croît en Afrique dans les royaumes
de Congo, de Benguela, ainfi que dans d’autres parties.
On dit qu’il devient d’une groffeur fi prodi-
gieufe, que dix hommes ont quelquefois de la peine
à l’embraffer ; mais il fe pourrit facilement au point
qu’il eft fujet à être abattu par le vent ; ce qui eft
caufe que l’on évite de bâtir des cabanes dans fon
voifinage : on craint aufîi la chute de fon fruit qui
eft gros comme une citrouille. L ’écorce de cet arbre
battue & mile en macération, donne une efpece de
filafle dont on fait de groffes cordes ; en la battant
avec des malfes de fer, on parvient à en faire une
efpece d’étoffe dont les gens du commun couvrent
leur nudité. L’écorce du fruit, quand elle a été fé-
chée, fait toute forte d’uftenfiles de ménage, &
donne une odeur aromatique aux liqueurs qui y fé-
journent. Dans les tems de difette le peuple fe nourrit
avec la pulpe de ce fruit, 5c même avec les feuilles
de l’arbre ; les plus larges fervent à couvrir les
toîts des cabanes ; on les brûle auffi pour avoir leurs
cendres 6c pour en faire du fa von. Comme ces arbres
font tres-fouvent creux , ils fervent de citernes
ou de réfervoirs auxhabitans, quien tirent une quantité
prodigieufe d’eau du ciel qui s’y eft amaffée.
LICORNE, f. f. ( Hifi. nat. ) animal fabuleux :
on dit qu’il fe trouve en Afrique, & dans l’Ethiopie
; que c’eft un animal craintif, habitant le fond
des forêts, portant au front une corne blanche de
cinq palmes de long, de la grandeur d’un cheval
médiocre, d’un poil brun tirant fur le noir, & ayant
le crin court, noir, & peu fourni fur le corps, 6c
même à la queue. Les cornes de licorne qu’on montre
en différent endroits, font ou des cornes d’autres
animaux connus, ou des morceaux d’ivoire
tourné, ou des dents de poiffons.
L icorne fo s s il e , (Hifi. nat. ) en latin unicornu
fojjile. Quelques auteurs ont donné ce nom à une
fubftance offeufe, femblable à de l’ivoire ou à une
corne torfe 6c garnie de fpirales qui s’eft trouvée,
quoique rarement, dans le fein de la terre. M. Gme-
lin dans fon voyage de Sibérie, croit que ce font
des dents d’un poiffon. Il rapporte qu’en 1714 on
trouva fous terre une de ces cornes, dans le territoire
de Jakutsk en Sibérie ; il préfume qu’elle n’appartient
point à l’animal fabuleux à qui on a donné
le nom de licorne ; mais il croit avec beaucoup de
vraiffembiance qu’elle vient de l’animal cétacé, qu’on
nomme narhwal. Le même auteur parle d’une autre
corne de la même efpece, qui fut trouvée en 174 1 ,
dans un terrein marécageux du même pays : cependant
il obl'erve que le narhwal que l’on trouve communément
dans les mers du Groenland, ne fe rencontre
point dans la mer Glaciale qui borne le nord
de la Sibérie.
C e qui fembleroit jetter du doute fur cette matière,
c’eft un fait rapporté par l’illuftre Leibnitz
dans fa Protogét ; il dit d’après le témoignage du célébré
Otton Guerike, qu’en 1663 on rira d’une
carrière de pierre à chaux delà montagne deZeuni-
kenberg, dans le territoire de Quedlimboùrg, le
fquelette d’un quadrupède terreftre, accroupi fur
les parties de derrière , mais dont la tête étoit élevée
, &c qui portoit fur fon front une corne de cinq
aunes, c’eft-à-dire d’environ dix piés de longueur,
& grofie comme la jambe d’un homme , mais terminée
en pointe. Ce fquelette futbrifé par l’ignorance
des ouvriers, & tiré par morceaux de la terre ; il ne
refta que la corne & la tête qui demeurèrent eh entier
, ainfi que quelques côtes , & l’épine du dos ;
ces os furent portés à la princeffe abbêffe de Qued-
limbourg. M. de Leibnitz -donne dans ce même ouvrage
la repréfentation de ce fquelette. Il dit à ce
fujet, que fuivant le rapport d’Hyeronimus Lupus,
& de Balthafar T elle z, auteurs portugais, il fe trouve
chez les Abyffins un quadrupède de la taille d’un
cheval, dont le front eft armé d’une corne, Foye^
Leibnitz, Protogaa, pag. Gj & 64. Malgré toutes
ces autorités, il eft fâcheux que le fquelette dont
parle Leibnitz, n’ ait point été plus foigneufement
examiné, & il y a tout lieu de croire que cette corne
appartenoit réellement à un poiffon.
Il ne faut point confondre la corne ou la fubftance
offeufe dont il s’agit ic i , avec une autre fubftance
terreufe, calcaire, & abforbante, que quelques auteurs
ont très-improprement appellée unicornu fojjile f
& q ui, fuivant ‘les apparences , eft une efpece de
craie oude marne. Foye^ Unicornu fossile. ( —)
Licorne, ( Blàfon. ) la licorne eft un des fup-
ports des armes d’Angleterre. Voye^ Support.
Les hérauts repréfentent cét animalpajfant & quelquefois
rampant.
Quand il eft dans cette derniere attitude, comme
dans les armes d’Angleterre, pour parler proprement
, il faut dire qu’il eft faillant d’argent ; une licorne
faillant de fable, armée, onglée , &c.
LICOSTOMO , ( Géog. ) Scotufa ou Scotuffa,'
ancienne ville de Grece dans la Theffalie , aujourd’hui
dite province de Janna, fur le Pénée auprès
du golfe de Salonique, Salonichi, avec un évêché
fuffragant de Lariffe. ( D . J . )
LICOU ou LICOL , f. m. termede Bourrelier-Sellier
c’ eft un harnois de tête dont on fe fert pour attacher
les chevaux dans l’écurie, & le licol eft compofé
de quatre pièces, favoir une mufeliere, une têtiere,
deux montans qui joignent la mufeliere à la têtiere,
qui d’ailleurs font jointes fous là gorge par un anneau
auquel eft affujetti une longe de corde, de cuir,
ou de crin, par laquelle on attache le cheval à l’auge
ou au râtelier. Foye{ les Planches.
LICTEUR, f. m. ( Littérat. ) en latin liclor, huîf-
fier qui marchoit devant les premiers magiftrats de
Rome , 6c qui portoit la hache enveloppée dans un
faifeeau de verges : il faifoit tout enfemble l’office
de fergent 6c de bourreau.
Romulus établit des licteurs, pour rendre la pré-
fence des magiftrats plus refpe&able, & pour exécuter
fur le champ les jugemens qu’ils prononce-
roient. Ils lurent nommés licteurs, parce qu’au premier
commandement du magiftrat, ils lioient les
mains 6c les piés du coupable, liclor à ligando. Apulée
croit qu’ils tiroient leur nom d’une ceinture ou
courroie qu’ils avoient autour du corps, & qu’on
appelloit licium. Voyt£ LlClUM.
Quoi qu’il en foit, ils étoient toujours prêts à délier
leurs faifeeaux de verges, pour fouetter ou pour
trancher la têté , félon l’ordre qu’ils recevoiént, / ,
liclor, colliga manus , expedi virgas, plectefecuri. Ils
étoient cependant, malgré leur v il emploi, de condition
libre , de race d’affranchi; & on n’admettoit
point d’efclave a cet office.
Quand les diâateurs paroiffoient en public, ils
étoient précédés par vingt-quatre licteurs ; les confias
par douze ; lespro confuls, les préteurs, les généraux
par fix ; le préteur de la ville par deux ; 6c
chaque veftale qui paroiffoit en public, en avoit un
par honneur. Comme les édiles 6c les tribuns ne
jouiffoient point de l’exercice de la haute juftice,
les huiffiers qui les précédoient s’appelloient viato-
res, parce qu’ils étoient fouvent en route pour donner
des ajournemens aux parties.
La charge des licteurs confiftoit en trois ou quatre
points, 1 Jub m o d o , c’eft-à-dire à contenir le peuple
affemblé, & chaque tribu dans fon pofte ; à ap-
paifer le tumulte s’il s’en élevoit ; à chaffer les mutins
delà place, ce qu’ils exécutoient avec beaucoup
de violence ; enfin, à écarter 6c à diffiper la
foule. Horace, Ode X F I . L. II. fait une belle allu-
fion à cette première fonftion des licteurs, quand
il dit :
Non enim gaçoe , neque confularis
Submovet liélor miferos tumultus
Mentis, & curas laqueata çircum
Tecta volumes.
Euffions-nous encore une efcorteplus nombreufe
que celle de nos confuls, nous ne viendrions pas à
bout de diffiper le tumulte de nos pallions, ni les
l'oucis importuns qui voltigent autour des lambris
dorés ; le licteur peut bien écarter, fubmovere, le peuple
, mais non pas les troubles de l’efprit.
. Matrone non fummovebantur à magiflratibus, dit
Feftus : les dames avoient ce privilège à Rome, de
n’être point obligées de fe retirer devant le magiftrat
; ni licteurs, ni huiffiers, ne pouvoient les contraindre
de faire place ; on le défendit à ces gens-là,
de peur qu’ils ne fe ferviffent de ce prétexte, pour
les pouffer ou les toucher. Ils ne pouvoient pas
même faire defeendre leurs maris, lorfqu’ils étoient
en carroffe avec elles.
La-fécondé fonction des licteurs fe nommoit a'ni-
madverfio ; ils dévoient avertir le peuple de l’arrivee
ou de la préfence des magiftrats, afin que chacun
leur rendît les honneurs qui leur étoient dus, 6c qui
confiftoient à s’arrêter, à fe lever fiTon étoit affis,
à defeendre de cheval ou de chariot, & à mettre
bas les armes fi on en portoit.
La troifieme fonftion des licteurs s’appelloit prtzi-
ùo ; ils précedoient les magiftrats, marchoient devant
eu x , non tous enfemble , ni deux ou trois de
front, mais de file, un à un, & à la fuite les uns des
autres; Dc-là vient que dans T ite-Live, dans Valere-
Maxime, dans Cicéron, on lit fouvent primus,pro-
ximus ,/ecundus liélor. Lipfe rapporte une infeription
qui fait mention du proximus liclor.
Une quatrième fonction des Licteurs, étoit démarcher
dans les triomphes devant le char du triomphateur,
en portant leurs faifeeaux entourés de
branches de laurier.
. Je ne m’amuferai point à rechercher fi dans les
cas ordinaires , ils portoient leurs faifeeaux droits,
ou fur l’épâule ; je remarquerai feulement, qu’outre
les faifeeaux, ils tenoient des baguettes à la main,
dont ils fe fervoient pour faire ouvrir la porte des
maifons oii le magiftrat vouloit entrer.
Pline obferve que Pompée après avoir vaincu
Mithridate, défendit à fon licteur de fe fervir de fes
baguettes pour faire ouvrir la porte de Poffidonius ,
dont il refpe&oit le favoir 6c la vertu.
Enfin, quand les magiftrats vouloient plaire au
peuple 6c gagner fa faveur, ils faifoient écarter
leurs licteurs6c c’eft ce qu’on appelloit fubmittere
fafees. Foye{ Faisceaux. Mais les magiftrats n’eu-
Tome IX .
rent le glaive en main que fous la république 6c les
premiers empereurs ; ce furent enfuite les foldats
du prince qui prirent la place de licteurs , pour ar-
rêrer les coupables, & pour trancher la tête. Foye£
Rofinus , Pitifcus , Bombardini, de carcere, Middle-
ton , & autres. (D . J .)
L ID A , (Géog.) en latin Lida, petite ville de Pologne
avec une citadelle, fituée dans la Lithuanie,
au palatinat de T ro k i, dont elle eft à 17 lieues S. E.
fur le ruiffeau deDzila. Long. 44. 4. latit. S3. 60. mjgm WÊÊÊ LIDDA ou LID D E , (Géogr. facree.) ancienne
ville dans la Paleftine, & de la tribu d’Ephraim.Les
Grecs l’appellent encore Diofpolis, la ville de Jupiter.
Elle étoit une des onze toparchies de la terre
promife. S. Pierre y guérit un paralytique , & cette
v ille , du tems du régné des Chrétiens, devint un
évêché, mais aujourd’hui Lidda, n’eft plus qu’un
petit bourg, où l’on tient un marché par femaine.
Foye^ le P . Roger , voyage de la Terre jointe, liv. I.
chap. xiij.
L lD D E L, l a , ( Géog.) riviere de l’Ecoffe méridionale
; elle a fes fources dans la province de Li-
defdale, à laquelle elle donne fon nom, va fe joindre
à la riviere d’Efck, & fe rendent enfemble dans
la baie de Solway.
LIDDESDALE, Liddefdalia, (G éog .) province
de l’Ecoffe méridionale, aux confins de l’Angleterre,
où elle eft féparée par unè chaîne de montagnes du
Northumberland au levant, & du Cumberiand au
midi. Elle prend fon nom de la riviere de Liddel,
qui l’arrofe. Il faut rapporter à ceite province l’Esk-
dale, PEufdale & le Wachopdale, trois territoires
qui tirent leurs noms des petites rivières l’Efck, l’Ew
6c le Wachop. ( D . J.)
LIE-DE-VIN, (Chimie.) Foye^ à Varticle V in .
L ie , f. f. (Finaigrier.) c ’eft la partie la plus ép ûffe
& la plus groffiere des liqueurs, qui forme un iëdi-
ment en tombant au fond des tonneaux, lorfque les
liqueurs fe font éclaircies.
Les Vinaigriers font un grand commerce de lie de
vin qu’ils font fécher, & dont ils forment des pains,
après en avoir retiré ce qui y refte de liqueur par le
moyen de petits preffoirs de bois. Foye^ Vinaigrier.
Les Cabaretiers marchands de vin & autres qui
vendent le vin en détail, font tenus de vendre leur
lie aux Vinaigriers, & il ne leur eft pas permis d’en
faire des eaux-de-vie.
La Lie brûlée & préparée d’une certaine manière,'
forme la gravelée , dont les Teinturiers & autres
artifansfe fervent dans les ouvrages de leur métier.
C ’ert avec de la lie que lès Chapeliers foulent leurs
chapeaux.
Lie d’huile, (Mat. méd.) en latin amurca, du
mot arec ct/Mù^n, qui figmfie la meme choie, eft la
réfidence qui fe fait au fond du vaiffeau, où l’on a
mis l’huile d’olive nouvellement exprimée polir la
laiffer dépurer.
Elle eft émolliente, adouciffante, réfolutive, propre
pour calmer la douleur de tête, étant appliquée
fur le front, Sc pour arrêter les fluxions. Lemery ,
traité des drogues fimples.
L IÉ , (Gramm.) participe du verbe lier. Foyeç
Lier.
L ié : on dit, en Peinture, des lumières bien liéesy
des groupes qui fe lient bien, c?eft à-dire qui fe communiquent
bien, & qui, quoique fépàrés, forment
Une belle union. Lorfqu’entre deux objets éclairés,
il fe trouve un efpace qui ne l’eft pas, ôi qu il fe-
roit avantageux qu’il le fût, le peintre place dans
cet intervalle quelque objet qui par la faillie reçoit
la lumière, de façon qu’elle fe lie aux autres lumières,
& fembient nfen faire qu’une ayec elles. Il