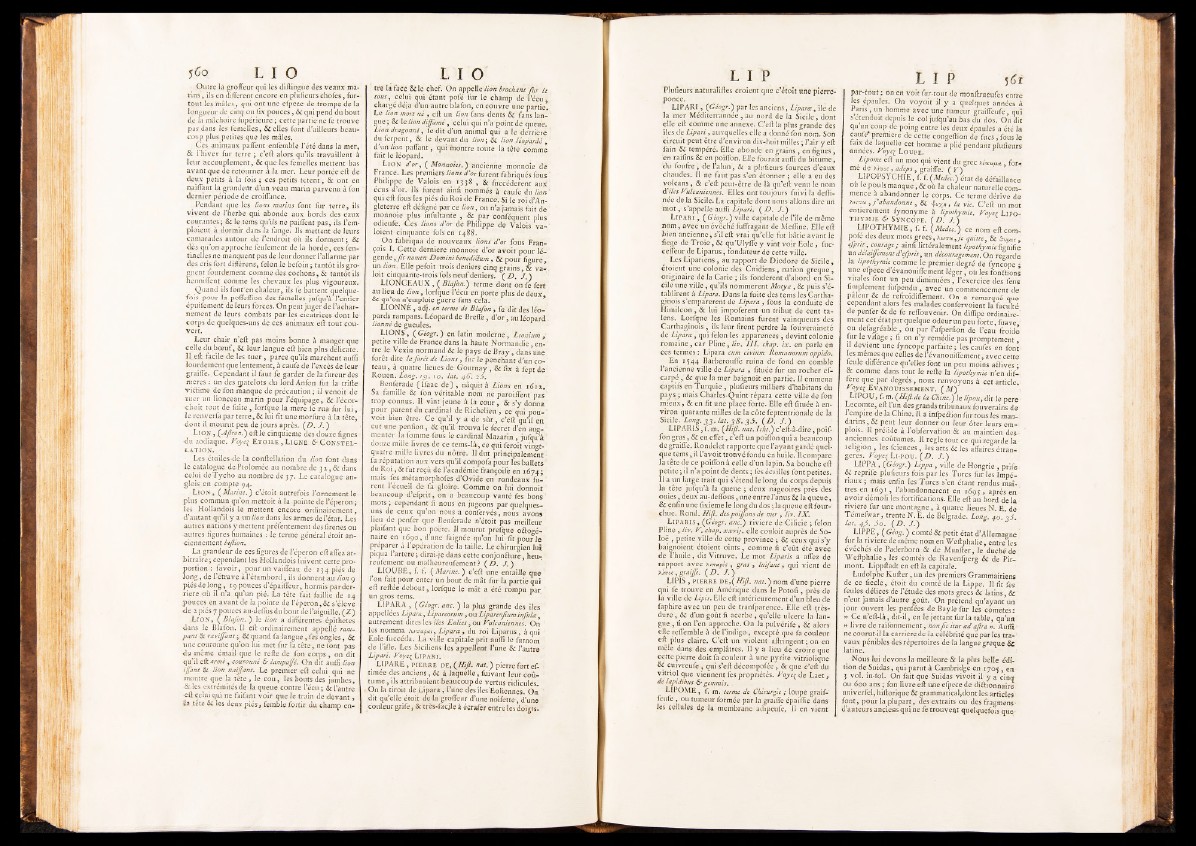
Outre la groffeur qui les diftiiigùé des .veaux marins
, ils en different encore en plufieurs choies, fur-
tout les mâles , qui ont une efpece de trompe de la
longueur de cinq ou (ix pouces, & qui pend du bout
d.e la mâchoire fupérieure ; cette partie ne fe trouve
pas dans les femelles, & elles font d’ailleurs beaucoup
plus petites que les mâles.
Ces animaux palfent enlemble l’été dans la mer,
& l'hiver fur terre ; c’eft alors qu’ils travaillent à
leur accouplement, & que les femelles mettent bas
avant que de retourner à la mer. Leur portée eft de
deux petits à la fois ; ces petits tetent, & ont en
naiflant la grandeur d’un veau marin parvenu à fon
dernier période de croiflance.
Pendant que. les lions marins font fur terre, ils
vivent de l’herbe qui abonde aux bords des eaux
courantes; & le tems qu’ils ne paiflenr pas, ils l’emploient
à dormir dans la fange. Ils mettent de leurs
camarades autour de l’endroit oit ils dorment ; &
dès qu’on approche feulement de la horde, ces fen-
tinelles ne manquent pas de leur donner l’allarme par
des cris fort différens, félon le befoin ; tantôt ils grognent
lourdement comme des cochons, & tantôt ils
■ henniflent comme les chevaux les plus vigoureux.
Quand ils fonfen chaleur, ils fe battent quelquefois
pour la polfeflîon des femelles jufqu’à l’entier
épuifement de leurs forces. On peut juger de l’aëhar-
nement de leurs combats par les cicatrices dont le
corps de quelques-uns de ces animaux eft tout couvert.
Leur chair n’eft pas moins, bonne à manger que
celle du.boeuf, & leur.langue eft bien pins délicate.
Il, eft facile de les tu e r , parce qu’ils marchent aufli
lourdement que lentement, à caufe de l’excès de leur
graiffe. Cependant il faut fe garder de la fureur des
meres : un des ipatelots du lord Anfon fut la trifte
vi&ime de fon manque de précaution ; il venoit de
tuer un lionceau marin pour l’équipage, & l’écor-
choit tout de fuite , lorfque la mere fe rua fur lu i, •
le renverfa par terre, & lui fit une morfure à la tête,
dont il mourut peu de jours après. (Z?. J. )
Lion ,[Afiron.) eft le cinquième des douze lignes
du zodiaque. Voye{ Eto ile,L igne ^ C onstellation,
.
Les étoiles de la conftellation du lion font dans
le catalogue de Ptolomée au nombre de 32, & dans
celui deTycho au nombre de 37. Le catalogue an-
glois en compte 04.
Lion., (Marine, ) c’étoit autrefois l’ornement le
plus commun qu’on mettôit à la pointe de l’éperon ; ,
les Hollandois le mettent encore ordinairement,
d’autant qu’il y a un lion dans les armes de l’état. Les
autres nations y mettent préfentement des firenes ou
-autres figures humaines : le terme général étoit anciennement
btfiion.
La grandeur de ces figures de l ’éperon eft alfez arbitraire;
cependant les Hollandois fuivent cette proportion
: favoir, pour un vaiffeau de 134 piés de
long, de l’étrave à l’étambord, ils donnent au lion 9
piés de long, 19 pouces d’épaiffeur, hormis par derrière
où il n’a qu’un pié. La tête fait faillie de 14
pouces en avant de la pointe de l’éperon,& s ’élève
d e 2 piés 7 pouces au-deflùs du bout de l’aiguille. (Z )
Lion, ( Blafon. ) le lion a différentes épithetes •
dans le Blafon. Il eft ordinairement appellé nim-
pant & ravijfant ; & quand fa langue ,fes ongles, &
une couronne qu’on lui met fur la tête, ne l'ont pas
du même émail que le refte de fon corps, on dit
qu’il eft armé, couronné & lampaffé. On dit aufli lion •
ijfam & lion naifiant. Le premier eft celui qui ne
montré que la tête , le cou, les bouts des jambes,
de les extrémités de la queue contre l’écu ; & l’autre
eft celui qui ne faifant voir que le train de devant, :
te îete ôc les deux piés, femble fortir du champ entre
la face & le chef. On appelle lion brochant fur le
tout, celui qui étant pofé fur le champ de l’écu-
chargé déjà d’un autre blafon, en couvre une partie.
Le lion mort né , eft un lion ians dents & fans langue
; oc le lion diffamé, celui qui n’a point de queue.
Lion dragonné, fe dit d’un animal qui a le derrière ’
duferpent, & le devant du lion\ & lion léopardé ,
d un lion paflant, qui ïnontre toute la tête comme
fait le léopard.
Lion d'or, ( Monnoies.) ancienne monnoie de
France. Les premiers lions d'or furent fabriqués fous
Philippe de Valois en 1338 , & fnecéderent aux
ecus d’or. Ils furent ainfi nommés à caufe du lion1
qui eft fous les piés du Roi de France. Si le roi d’Angleterre
eft défigné par ce lion, on n’a jamais fait de
monnoie plus infultante , & par conféquent plus
odieufe. Ces lions d'or de Philippe de Valois va- '
loieiit cinquante fols en 1488.
On fabriqua de nouveaux: lions d'or fous François
I. Cette derniere monnoie d’or avoit pour lég
en d e ,^ nomen Dominibtnediclum, & pour figure,
un lion. Elle pefoit trois deniers cinq grains, & va- -
loit cinquante-trois fols neuf deniers. ( D. J .)
LIONCEAUX, ( BLàfon.') terme dont on fe fert
au lieu de lion, lorfque l’écu en porte plus de deux,
& qu’on n’emploie guere fans cela.
LIONNE, adj . en terme de Blafon , fe dit des léo-
pards rampans. Léopard de Briffe, d’Or, aüïéopaïd.
lionnè de gueules.
LIONS, ( Géogr. ) en latin moderne , Leonium;
petite ville de France dans la haute Normandie, entre
le Vexin normand & le pays d eB ra y , dans une
foret dite la forêt de Lions, fur le penchant d’un co-
teau, à quatre lieues de Gournay, & fix à fept de
Rouen. Long. 1^:10. lat. 46“.
Benferade (lfaac de) , nâquit à Lions en 1612.
Sa famille & fon véritable nom ne paroiffent pas
trop connus. Il vint jeune à la cou r, & s’y donna
pour parent du cardinal de Richelieu , ce qui pôu-
voit bien être. Ce qu’il y a de sur, c’eft qu’il en
eut une penfion, & qu’il trouva le fecret d’en augmenter
la fomme fous le cardinal Mazarin , jufqu’à
douze mille livres de ce tems-là, ce qui feroit vingt-
quatre mille livres du nôtre. Il dut principalement;
fa réputation aux vers qu’il compofa pour les ballets '
du Roi, & fut reçu de l’académie françoife en 1674;
mais fes métamorphofes d’Ovide en rondeaux furent
l’écueil de fa gloire. Comme on lui donnoit
beaucoup d’efprit, on a beaucoup vanté fes bons'
mots ; cependant fi nous en jugeons par quelques-
uns de ceux qu’on nous a confervés, nous avons
lieu de penfer que Benferade n’étoit pas meilleur
plaifant que bon poëre. Il mourut prefque octogénaire
en 1690, d’une faignée qu’on lui fit pour le
préparer à l’opération de la taille. Le chirurgien lui
piqua l’artere; dirai-je dans cette conjoncture, heu-
reufement ou malheureufement ? (D . J .)
LIOUBE, f. f. (Marine.) e’eft une entaille que
l’on fait pour enter un bout de mât fur la partie qui
eft reftee debout, lorlque le mât a été rompu par
un gros tems.
LIPARA , (Géogr. anc.) la plus grande des îles
appellées Lipara, Lipareorum, ou Liparenjium infulce y
autrement dues les îles Eolies, ou Vulcaniennes. On '
les nomma a l'ôsa.pai, Lipara, du roi Liparus, à qui
Eole fuccéda. La ville capitale prit aufli le furnom
de l’ifle. Les Siciliens les appellent l’une & l’autre
Lipari. Voye^ L lP A R I .
LIPARE, pierre de, (H ifi. nat. ) pierre fort ef-
timée des anciens, & à laquelle, fuivant leur coû-
tume, ils attribuoient beaucoup de vertus ridicules.
Onia tiroit de Lipara, l’Une des îles Eoliennes. On '
dit qu’elle étoit de la groffeur d’une noifette, d’une
couleur grife, & très-facile à écrafer entre les doigts.
Plufieurs naturaliftes Croient que c’étoit une piérre-
ponce.
LIPARI, (Géogr.) par les anciens, Lipara, île de
la mer Méditerrannée, au nord de la Sicile, dont
elle eft comme une annexe. C’eft la plus grande des
îles de Lipari, auxquelles elle a donné fon nom. Son
circuit peut être d’environ dix-huit milles ; l’air y eft
fam & tempère. Elle abonde en grains , en figues ,
en raifins & en poiflon. Elle fournit aufli du bitume,
du foufre, de l’alun, & a plufieurs fources d’eaux
chaudes; Il ne faut pas s’en étonner ; elle a eu des
. volcans, & ç’eft peut-être de là qu’eft venu le nom
V'ilcaniennes. Elles ont toujours fuivi la defti-
nee de la Sicile. La capitale dont nous allons dire un
mot, s ’appelle aufli Lipari. (D . J .)
Lipari , (Géogr.) ville capitale de l’île de même
nom, avec un évêché fuffragant de Meflîne. Elle eft
bien ancienne , s’il eft vrai qu’elle fut bâtie avant le
fiege de T ro ie , & qu’UIyfle y vint voir Eole , fuc-
cefleùr de Liparus, fondateur de cette ville.
Les Lipariens , au rapport de Diodore de Sicile,
étoient une colonie des Cnidiens, nation greque,
originaire de la Carie ; ils fondèrent d’abord en Sicile
une v ille, qu’ils nommèrent Motya , & puis s’établirent
à Lipara. Dans la fuite des tems les Carthaginois
s’emparèrent de Lipara, fous la conduite de
Himrlcon, & lui impoferent un tribut de cent ta-
lens. Lorfque les Romains furent vainqueurs des
Carthaginois , ils leur firent perdre la fouveraineté
de Lipara , qui félon les apparences , devint colonie
romaine, car Pline, liv. I II. chap. ix. en parle en
ces termes : Lipara cum civium Romanorum oppido.
En 1544 Barberoufîe ruina de fond en comble
l’ancienne ville de Lipara , fituée fur un rocher ef-
carpé, & que la mer baignoit en partie. II emmena
captifs en Turquie , plufieurs milliers d’habitans du
pays ; mais Chàrles-Quint répara cette ville de fon
mieux, & en fit une place forte. Elle eft fituée à environ
quarante milles de la côte feptentrionale de la
Sicile. Long. 3 3 . lat. 38 . (D . J .)
LIPARIS, i. mt (Hift- nat. Ickt.) c ’eft-à-dire, poif-
fon gras, & en effet, c’eft un poiflon qui a beaucoup
de graille. Rondelet rapporte que l’ayant gardé quelque
tems, il l’avpit trouvé fondu en huile. Il compare
la tête de ce poiflon à celle d’un lapin. Sa bouche eft
petite ; il n’a point de dents ; fes écailles font petites.
Il a un large trait qui s’étend le long du corps depuis
la tête jufqu’à la queue ; deux nageoires près des
ouies, deux au-deflbus, une entre l’anus & la queue,
& enfin une fixieme le long du dos ; la queue eft fourchue.
Rond. Lbift- despoijjons de mer , liv. IX .
Liparis , (Géogr. anc.) riviere de Cilicie ; félon
Pline , liv. V. chap. xxvij. elle couloit auprès de So-
loë , petite ville de cette province ; & ceux qui s’y
baignoient étoient oints, comme fi c’eût été avec
de l’huile, dit Vitruve. Le mot Liparis a allez de
rapport avec xi7mpoç , gras, luifant, qui vient de
t iw , graiffe. (D . J .)
LIPIS , p ie r r e d e ,(HiJi, nat.) nom d’une pierre
qui fe trouve en Amérique dans le Potofi, près de
là ville de Lipis. Elle eft intérieurement d’un bleu de
faphire avec un peu de tranfparence. Elle eft très-
dure , & d’un goût fi acerbe, qu’elle ulçere la langue
, fi on l’en approche. On la pulvériie, & alors
elle reflemble à de l’indigo, excepté que fa couleur
eft plus claire. C ’eft un violent aftringent ; on en
mêle dans des emplâtres. Il y a lieu de croire que
cette pierre doit fa couleur à une pyrite vitriolique
oc cuivreufe , qui s’eft décompofée , & que c’eft du
vl5noJ que viennent fes propriétés. Voye£ de Laet,
de lapidibus & gernmis.
LIPOME, f. m. terme de Chirurgie ; loupe graif-
feufe, ou tumeur formée par la graiffe épaiffie dans
les cellules dp la membrane adipeufet II en vient
paf-tôut ; On ert voit fur-tout de monftrueufes entre
les épaules. On voyoit il y a quelques années à
Paris , un homme avec une tumeur graifleufe, qui
s’étendoit depuis le col jufqu’au bas du dos. Ort dit
qu un coup de poing entre les deux épaules a été la
caufe*première de cette congeftion de fuc$,fous le
faix de laquelle cet homme a plié pendant plufieurs
•années. Voye£ Loupe.
Lipome eft un mot qui vient du grec \iisuua. forme
de yêïTtoç , adeps, graiffe.' ( T )
LIPOPSYCHIE, f. f. (Medec.) état de défaillance
où le pouls manque, & où la chaleur naturelle commence
«l abandonner le corps. Ce terme dérive de
Xuvru , j abandonne, & > 1°- vie. C ’eft un mot
entièrement fynonyme à lipothymie. Voyer Lipothymie
& Syncope. (D . J .)
LIPOTHYMIE, f. f. ( Medec. ) ce nom eft com-
pofe des deux mots grecs, Xtnru ,je quitte, & d-upoc,
cfprit, courage; airtfi littéralement lipothymiefignifie
un délaijfetncnt d’ifprit, tin découragement. On regardé
lipothymie comme le premier, degré de fyncope ;
une efpêee d’évanouiffement léger, où les fonaions
' ’“tal^s Tour un peu diminuées l'exercice des Cens
Amplement fufpendu, avec un commencement de
pâleur & de refroidiffement. On a remarqué que
cependant alors les malades confervoient la faculté
de penfer & de fe reffouvenir. On diflipe ordinaire-'
ment cet état par quelque odeur un peu forte, fuave ‘
ou defagréable, ou par i’afperfion de l’eau froide
fur le vifage ; fi on n’y remédie pas promptement,
il devient une fyncope parfaite ; les caufes en font-
les memes que celles de l’evanouiffement, avec cette
feule différence qu’elles font un peu moins aélives ;
& comme dans tout le refte la lipothymie n’en différé
que par degres, nous renvoyons à cet article.
Voyei Evanouissement. (M )
LIPOU, f. m. (Hifl.de la Chine.) le lipou, dit le pere
Lecomte, eft 1 un des grands tribunaux fouverains de 1 empire de la Chine. 11 a infpeaion fur tous les mandarins
, & peut leur donner ou leur ôter leurs emplois.
Il préfide à l’obfervation & au maintien des-
anciennes coûtumes. Il réglé tout ce qui regarde la
1 eligion , les fciences, les arts & les affaires étrangères.
Voye[ Li-pou. (D . J .)
LIPPA, (Geogr.) Lippa, ville de Hongrie , prife
& reprife plufieurs fois par les Turcs fur les Impériaux
; mais enfin les Turcs s’en étant rendus maîtres
en 1691 , l’abandonnèrent en 1695 , après en
avoir démoli les fortifications. Elle eft au bord delà
riviere fur une montagne, à quatre lieues N. E. de
Témefwar, trente N. E. de Belgrade. Long. 40
lat. 46. So. (D . J .) * J *
LIPPE, ( Géog. ) comté & petit état d’Allemagne
fur la riviere de même nom en V eftphalie, entre les
évêchés de Paderbçrn & de Munfter, le duché de
Weftphalie, les comtés de Ravenfperg & de Pir-
mont. Lippftadt en eft la capitale.
Ludolphe Kufter, un des premiers Grammairiens
de ce fiecle, étôit du comté de la Lippe. Il fit fes
feules délices de l’étude des mots grecs & latins, &
n’eut jamais d’autre goût. On prétend qu’ayant un
jour ouvert les penfees de Bayle fur les cometes:
» Ce n’eft-là, dit-il, en le jettant fur la table, qu’un
» livre de raifonnement, nonfie itur ad afira ». Aufli
ne courut-il la carrière de la célébrité que par les travaux
pénibles des répertoires de la langue greque &
latine.
Nous lui devons la meilleure & la plus belle édition
de Suidas, qui parut à Cambridge en .iy o ç , en
3 vol. in-fol. On fait que Suidas vivoit il y a cinq
ou 6.00 ans ; fon livre eft une efpece de diôionnaire:
univerfel, hiftorique & grammatical,dont les articles
font, pour la plupart, des extraits ou des fragmens •
d’auteurs anciens qui ne fe trouvent quelquefois que