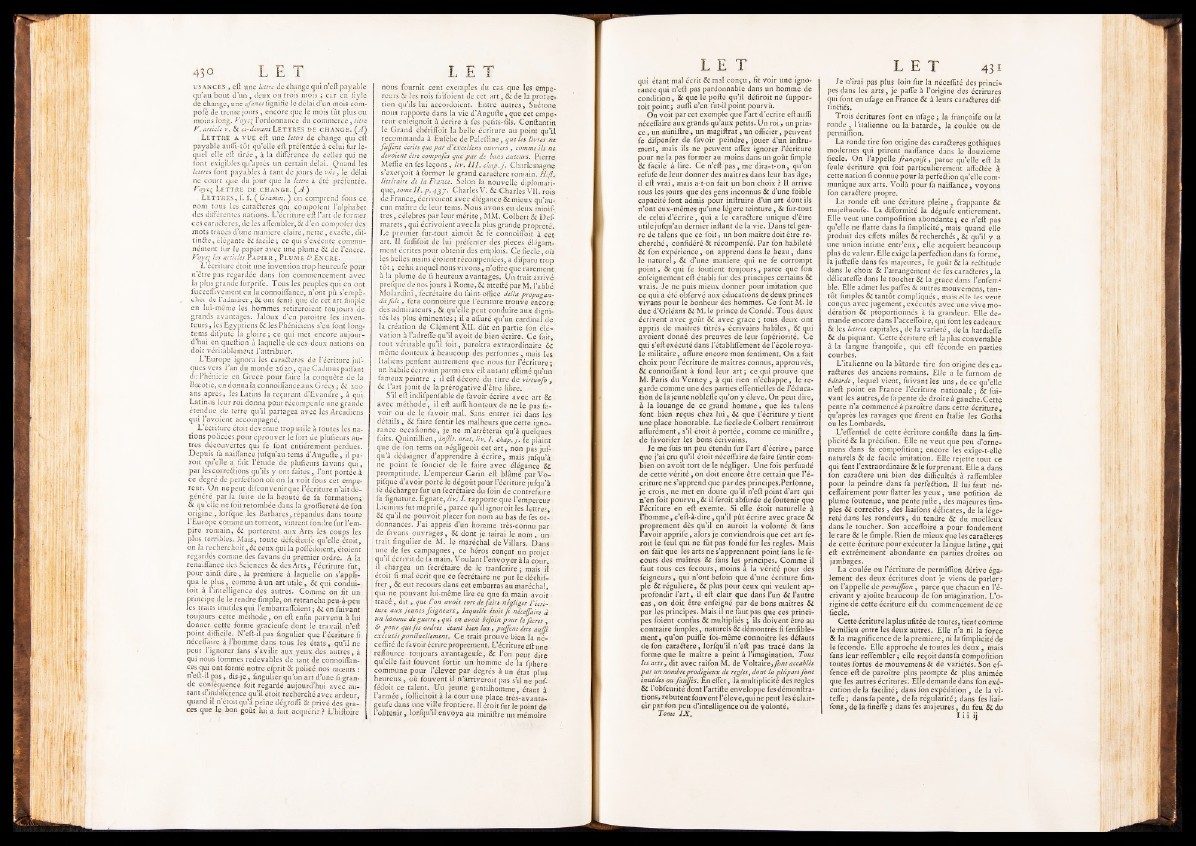
U SANCES , eft une lettre de change qui n’eft payable
qu’au bout d’un , deux ou trois mois ; car en iryle
de change, une uj'ance fignifie le délai d’un mois com-
pofé de trente jours, encore que le mois fût plus ou
moins long. Voye{ l’ordonnance du commerce, titre
V, article v. & ci-devant L E T T R E S DE CH AN GE. (A")
Lettre a vue eft une lettre de change qui eft
payable auffi-tôt qu’elle eft prélentée à celui fur lequel
elle eft tirée, à la différence de celles qui ne
lont exigibles qu’après un certain délai. Quand les
lettres font payables à tant de jours de vue, le délai
ne court que du jour que la lettre a été préfentée.
Voye^ Lettre de change. ( ^ )
Lettres, 1. f..( Gramm. ),.on comprend fous ce
nom tous les caratteres qni compoient l’alphabet
des différentes nations. L’écriture eft l’art de former
ces cara&eres, de les affembler, & d’en compofer des
mots tracés d’une maniéré claire, nette, exafre, dif-
tin&e, élégante & facile ; ce qui s’exécute communément
fur le papier avec une plume 8c de l’encre.
Voye{ les articles P A P IE R , P LUME & EN CRE.
L’écriture étoit une invention trop heureufe pour
n’etrepas regardée dans fon commencement avec
la plus grande furprife. Tous les peuples qui en ont
fuccefîivement eu la connoiffance, n’ont pu s'empêcher
de l’admirer, 8c ont fenti jque de cet art fimple
en lui-même les hommes retireroient toujours de
grands avantages. Jaloux d’en paroitre les inventeurs
, les Egyptiens 8c les Phéniciens s’en font long-
tems difputé la gloire ; ce qui met encore aujourd’hui
en queftion à laquelle de ces deux nations on.
doit véritablement l’attribuer.
L’Europe ignora les caraéleres de l ’écriture juf-
ques vers l ’an du monde 2620, que Cadinuspaffant
de Phénicie en Grece pour faire la conquête de la
Bceotiç, .en donna la connoiffance aux Grecs; 8c 200-
ans après, les Latins la reçurent d’Evancfre, à qui
Latinus leur roi donna pour récompenfe une grande
étendue de terre qu’il partagea avec lesArcadiens ;
qui I’avoient accompagné.
_ L’écriture étoit devenue trop utile à toutes les nations
policées,pour éprouver le fort de plufieurs autres
découvertes qui fe font entièrement perdues.
Depuis fa naiffance jufqu’au tems d’Augufte, il pa-
roit qu’elle a fait l’étude de plufieurs fa vans qui,
par les correâions qu’ils y ont faites, l’ont portée à
ce degré de perfeÛion où on la voit fous cet empereur.
On ne peut difeon venir que l ’écriture n’ait dégénéré
parla fuite delà beauté de fa formation;'
& qu’elle ne foit retombée dans la grofliereté de fon
origine , lorfque.les Barbares, répandus dans toute
l’Europe comme un torrent, vinrent fondre fur l’empire
romain, 8c portèrent aux Arts les coups les
plus terribles. Mais, toute défe&eufe qu’elle étoit,
on la recherchoit, & ceux qui la poffédoient, étoient
regardés comme des favans du premier ordre. A la
renaiffance "des Sciences & des Arts , l’écriture fut,
pour ainfi dire, la première à laquelle on s’appliqua
le plus, comme à un art utile , & qui çondui-
loit à l’intelligence des autres. Comme on fit un
principe de le rendre fimple, on retrancha peu-à-peu
les traits inutiles qui Pembarraffoient ; & en fuivant
toujours cette méthode, on eft enfin parvenu à lui
donner, cette forme gracieufe dont le travail n’eft
point difficile. N’eft-il pas fingulier que l’écriture fi.
néceffaire à l’homme dans tous les états, qu’il ne
peut l’ignorerians s’avilir aux .yeux, des a.utres, à
qui nous fommes redevables de tant de connoiffan-
ces qui ont formé notre efprit & policé nos moeurs :
n’eft-il pas, dis-;je, fingulier qu’un art d’une fi grande
conféque.nce foit regardé aujourd’hui avec autant
d’indifférence qu’il étoit recherché avec ardeur,
quand il n’étoit qu’a peine dégroffi & privé des grâces
que le bon goût lui a fait acquérir? L’hiftoire
nous fournit cent exemples du cas que les empe*
reurs & les rois faifoient de cct art, 8c de la protec»
tion qu’ils,lui accordoient. Entre autres, Suétone
nous rapporte dans la vie d’Augufte, que cet empereur
enfeignoit à écrire à fes petits-fils. Conftantin
le Grand chériffoit la belle écriture au point qu’il
recommanda à Ëufebe de Paleftine, que les livres ne
fujfcnt écrits que par d'excellent ouvriers , comme ils ne
dévoient être compofés que par de bons auteurs. Pierre
Meffie en fes leçons, liv. I I I . chap.j. Charlemagne
s’exerçoit à former le grand cara&ere romain. Hijl
littéraire de la France. Selon la nouvelle diplomatique,
tome II. p. 43y . Charles V. 8c Charles VII. rois?
de France, écrivoient avec élégance & mieux qu’aucun
maître de leur tems. Nous avons eu deux minif-
tres, célébrés par leur mérite, MM. Colbert 8c Défi
marets, qui écrivoient avec la plus grande propreté*
Le premier fur-tout aimoit 8c fe connoiffoit à cet
art. Il fuffifoit de lui préfenter des pièces élégamment
écrites pour obtenir des emplois. Ce fiecle, où
les belles mains étoient récompenfées, a difparu trop
i tôt ; celui auquel nous vivons, n’offre que rarement
à la plume de fi heureux avantages. Un trait arrivé
prefque de nos jours à Rome, 8c attefté par M. l’abbé.
Molardini, fecrétaire du faint-office délia propagan-
dafide , fera connoître que l’écriture trouve encore
des admirateurs, & qu’elle peut conduire aux dignités
les plus éminentes ; il a affuré qu’un cardinal de
la création de Clément XII. dût en partie fon élévation
à l’adreffe qu’il avoit de bien écrire. Ce fait,
tout véritable qu’il foit, paroitra extraordinaire 8c
même douteux à beaucoup des perfonnes, mais les
Italiens penfent autrement que nous fur l’écriture *
un habile écrivain parmi eux eft autant eftimé qu’un
fameux peintre ; il eft décoré, du titre de virtuofo ,
l & l’art jouit de la prérogative d’être libre.
' S’il eft indifpenfable de favoir écrire avec art &
avec méthode, il eft auffi honteux de ne le pas favoir
ou de le favoir mal. Sans entrer ici dans les
• détails , & faire fentirles malheurs que cette igno-
, rance occafionne, je ne m’arrêterai qu’à quelques:
; faits. Quintillien, jrijlit. orat. liv. I. chap.j. fe plaint
que de fon tems on négligeoit cet art, non pas jufi
qu’à dédaigner d’apprendre à écrire, mais jufqu’à
ne point le foucier de le faire avec élégance 8c
promptitude. L’empereur Carin eft blâmé parVo-
pifque d’avoir porte le dégoût pour récriture jufqu’à
fe décharger fur un fecrétaire du foin de contrefaire
' fa fignature. Egnate, liv! I. rapporte que l’empereur
Licinius fut méprifé, parce qu’il ignoroit les lettres,
8c qu’il ne pouvoit placer fon nom au bas de fes ordonnances.
J’ai appris d’un homme très-connu par
de favans ouvrages, 8c dont je tairai le nom, un
trait fingulier de M. le maréchal de Villars. Dans
une de lès campagnes, ce héros conçut un projet
qu’il écrivit de la main. Voulant l’envoyer à la cour,
il chargea un fecrétaire de le tranferire ; mais il
; étoit fi mal écrit que ce fecrétaire ne put le déchif-
; fre r, 8c eut recours dans cet embarras au maréchal,
I qui ne pouvant lui-même lire ce que fa main avoit •
' trace , d i t , que l'on avoit tort de faire négliger l'écriture
aux jeunes feigneurs , laquelle étoit J i néceffaire à
un homme de guerre , qui en avoit b e foin pour le fecret,
&■ pour que fes ordres étant bien lus, puffent être auffi
exécutés ponctuellement. Ce trait prouve bien la né-
ceffité de fayoir écrire proprement. L’écriture eft une
reffource toujours avantageufe, 8c l’on peut dire
qu’elle fait fouvent fortir un homme de la fphére
commune pour l’élever par degrés à un état plus
heureux, où fouvent il n’arriveroit pas s’il ne pof-
fédoit ce talent, Uu jeune gentilhomme, étant à
l’armée, follicitoit à la cour une place très-avanta-
geufe dans une ville froptiere. Il étoit fur le point de
l’obtenir, lorfqu’il envoya au miniftre un mémoire
qui étant mal écrit & mal conçu, fit voir une ignorance
qui n’eft pas pardonnable dans un homme de
condition, & que le pofte qu’il défiroit ne fuppor-
toit point ; auffi n’en fut-il point pourvu.
On voit par cet exemple que l’art d’écrire eft auffi
néceffaire aux grands qu’aux petits. Un roi, un princ
e , un miniftre, un magiftrat, un officier, peuvent
fe difpenfer de favoir peindre, jouer d’un inftru-
ment, mais ils ne peuvent affez ignorer l’écriture
pour ne la pas former au moins dans un goût fimple
8c facile à lire. Ce n’eft pas, me dira-t-on, qu’on
refufe de leur donner des maîtres dans leur bas âge,
il eft v ra i, mais a-t-on fait un bon choix ? 11 arrive
tous les jours que des gens inconnus 8c d’une foible
capacité font admis pour inftruire d’un art dont ils
n’ont eux-mêmes qu’une légère teinture, & fur-tout
de celui d’écrire, qui a le carattere unique d’être
utile jufqu’au dernier inftant de la vie. Dans tel genre
de talens que ce foit, un bon maître doit être recherché
, confidéré & récompenfé. Par fon habileté
8c fon expérience, on apprend dans le beau, dans
le naturel, 8c d’une maniéré qui ne fe corrompt
point, & qui fe foutient toujours, parce que fon
enfeignement eft établi fur des principes certains &
vrais. Je ne puis mieux donner pour imitation que
ce qui a été obfervé aux éducations de deux princes
vivans pour le bonheur des hommes. Ce font M. le
duc d’Orléans 8c M. le prince de Condé. Tous deux
écrivent avec goût 8c avec grâce ; tous deux ont
appris de maîtres titrés, écrivains habiles, & qui
avoient donné des preuves de leur fupériorité. Ce
qui s’eft exécuté dans l’établiffement de l’école royale
militaire, affure encore mon fentiment. On a fait
choix pour l’écriture de maîtres connus, approuvés,
8c connoiffant à fond leur art ; ce qui prouve que
M. Paris du V ern e y , à qui rien n’échappe, le regarde
comme une des parties effentielles de l’éducation
de la jeune nobleffe qu’on y éleve. On peut dire,
à la louange de ce grand homme, que les talens
font bien reçus chez lu i, 8c que l’écriture y tient
une place honorable. Le fiecle de Colbert renaîtroit
affurément, s’il étoit à portée, comme ce miniftre,
de favorifer les bons écrivains.
Je me fuis un peu étendu fur l’art d’écrire, parce
que j’ai cru qu’il étoit néceffaire de faire fentir combien
on avoit tort de le négliger. Une fois perfuadé
de cette v é r ité , on doit encore être certain que l’écriture
ne s’apprend que par des principes.Perfonne,
je crois, ne met en doute qu’il n’eft point d’art qui
n’en foit pourvu, & il feroit abfurde de foutenir que
l’écriture en eft exemte. Si elle étoit naturelle à
l ’homme, c’eft-à dire, qu’il pût écrire avec grâce &
proprement dès qu’il en auroit la volonté & fans
l ’avoir apprife, alors je conviendrois que cet art feroit
le feul qui ne fût pas fondé fur les réglés. Mais
on fait que les arts ne s’apprennent point fans le fe-
cours des maîtres & fans les principes. Comme il
faut tous ces fecours, moins à la vérité pour des
feigneurs, qui n’ont befoin que d’une écriture fimple
& régulière, 8c plus pour ceux qui veulent approfondir
l’art, il eft clair que dans l’un 8c l’autre
c a s , on doit être enfeigné par de bons maîtres &
par les principes. Mais il ne faut pas que ces principes
foient confus & multipliés ; ils doivent être au
contraire fimples, naturels & démontrés fi fenfible-
ment, qu’on puiffe foi-même connoitre les défauts
de fon ca raâ ere, lorfqu’il n’eft pas tracé dans la
forme que le maître a peint à l’imagination. Tous
les arts, dit avec raifon M. de Voltaire, font accablés
par un nombre prodigieux de réglés, dont la plupart font
inutiles ou faujfes. En effet, la multiplicité des réglés
& l’obfcurité dont l’artifte enveloppe fes démonftra-
tions, rebutent fouvent l’éleve,quine peut les éclaircir
par fon peu d’intelligence ou de volonté.
Tome IX ,
Je n’irai pas plus loin fur la néceffité des princi*
pes dans les arts, je paffe à l’origine des écrirures
qui font en ufage en France 8c à leurs carafteres difi
tinftifs.
Trois écritures font en ufage ; la françoife ou ïâ
ronde , l ’italienne ou la bâtarde, la coulée ou de
permiffion.
La ronde tire fon origine des carafteres gothiques
modernes qui prirent naiffance dans le douzième
fiecle. On l’appelle françoife, parce qu’elle eft la
feule écriture qui foit particulièrement affeftée à
cette nation fi connue pour la perfe&ion qu’elle com*
munique aux arts. Voilà pour fa naiffance, voyons
fon cara&ere propre.
La ronde eft une écriture pleine, frappante 8c
majeftueufe. La difformité la déguife entièrement.
Elle veut une compofition abondante ; ee n’eft pas
qu’elle ne flatte dans la fimplicité, mais quand elle
produit des effets mâles & recherchés, & qu’il y a
une union intime entr’eux, elle acquiert beaucoup
plus de valeur. Elle exige la perfeéHondans fa forme,
la jufteffe dans fes majeures, le goût & la re&itude
dans le choix & l’arrangement de fes carafteres, la
délicateffe dans le toucher & la grâce dans l’enfem*
ble. Elle admet les paffes & autres mouvemens, tantôt
fimples 8c tantôt compliqués, mais elle les veut
conçus avec jugement, exécutés avec une vive modération
8c ptoportionnés à fa grandeur. Elle demande
encore dans l ’acceffoire, qui font les cadeaux
& les lettres capitales, de la variété, de la hardieffe
8c du piquant. Cette écriture eft la plus convenable
à la langue françoife, qui eft féconde en parties
courbes.
L’italienne ou la bâtarde tire fon origine des ca-
ra&eres des anciens romains. Elle a le furnom de
bâtarde, lequel vient, fuivant les uns, de ce qu’elle
n’eft point en France récriture nationale ; & fuivant
les autres, de fa pente de droite à gauche.Cette
pente n’a commencé à paroître dans cètte écriture,
qu’après les ravages que firent en Italie les Goths
ou les Lombards.
L’effentiel de cette écriture confifte dans la fimplicité
8c la précifion. Elle ne veut que peu d’orne-
mens dans fa compofition ; encore les exige-t-ellè
naturels & de facile imitation. Elle rejette tout cc
qui fent l’extraordinaire & le furprenant. Elle a dans
ion cara&ere uni bien des difficultés à raffembler
pour la peindre dans fa perfeâion. Il lui faut né-
ceffairement pour flatter les y e u x , une pofition de
plume foutenue, une pente jufte, des majeures fimples
& correâes, des liaifons délicates, de la légèreté
dans les rondeurs, du tendre 8c du moelleux
dans le toucher. Son acceffoire a pour fondement
le rare & le fimple. Rien de mieux que les caraûeres
de cette écriture pour exécuter la langue latine, qui
eft extrêmement abondante en parties droites où
jambages.
La coulée ou l ’écriture de permiffion dérive également
des deux écritures dont je viens de parler t
on l’appelle de permiffion, parce que chacun en l’écrivant
y ajoute beaucoup de fon imagination. L’origine
de cette écriture eft du commencement de ce
fiecle.
Cette écriture la plus ufitée de toutes, tient comme
le milieu entre les deux autres. Elle n’a ni la force
& la magnificence de la première, ni la fimplicité de
le fécondé. Elle approche de toutes les deux, mais
fans leur reffembler ; elle reçoit dans fa compofition
toutes fortes de mouvemens & de variétés. Son ef»
fence eft de paroître pins prompte 8c plus animée
que les autres écritures. Elle demande dans fon exécution
de là facilité; dans fon expédition , de la vî-
teffe; dans fa pente, de la régularité ; dans fes liaifons,
de la fineffe ; dans fes majeures , du feu & du
I i i ij