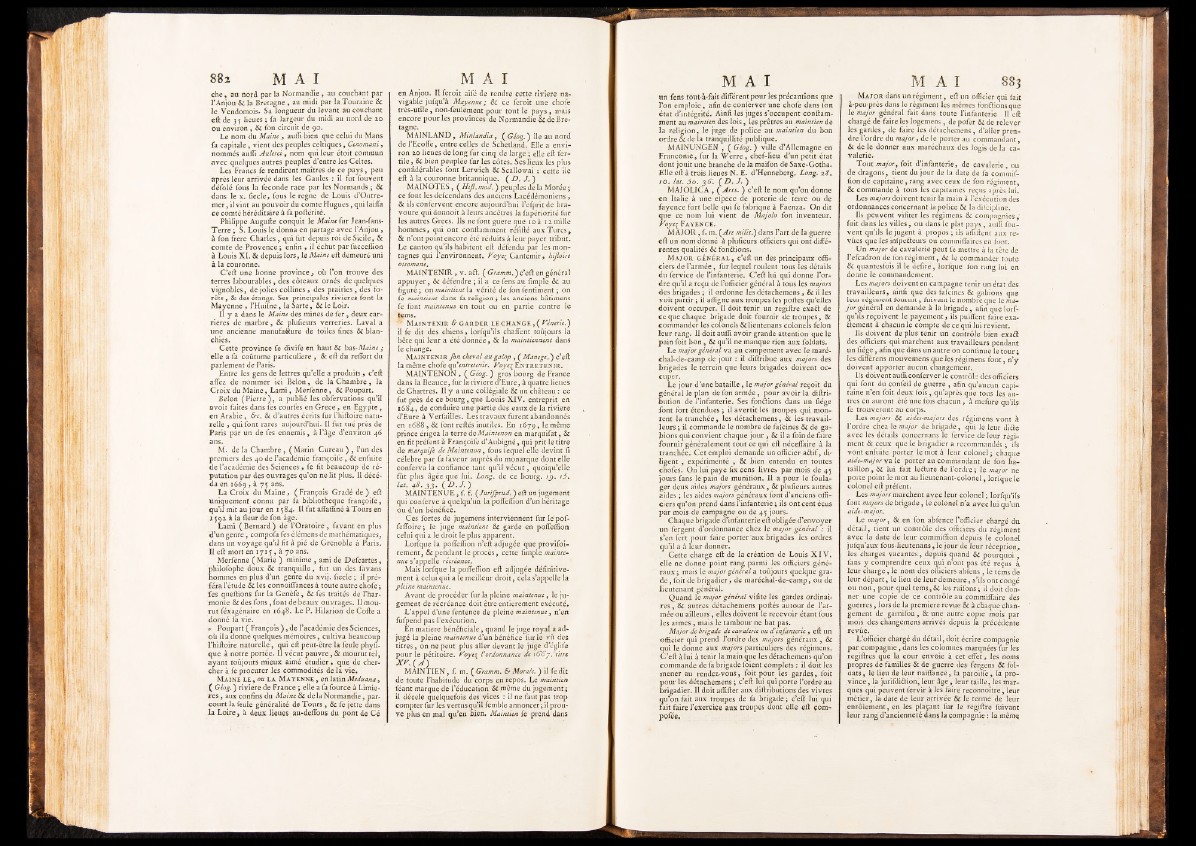
che, au nord par la Normandie, au couchant par
l’Anjou & la Bretagne , au midi par la Touraine &
le Vendomois. Sa longueur du levant au couchant
eft de 35 lieues ; fa largeur du midi au nord de 20
ou environ , & fon circuit de 90.
Le nom du Maint , aufli bien que celui du Mans
fa capitale, vient des peuples celtiques, Ctnomani,
nommés aufli Aultrci, nom qui leur étoit commun
avec quelques autres peuples d’entre les Celtes.
Les Francs fe rendirent maîtres de ce pays, peu
après leur arrivée dans les Gaules : il fut fouvent
défolé fous la fécondé race par les Normands ; &
dans le x. fiecle, fous le régné de Louis d’Outre-
mer, il vint au pouvoir du comte Hugues, qui laifla
ce comté héréditaire à fa poftérité.
Philippe Augufte conquit le Maint fur Jean-fans-
Terre ; S. Louis le donna en partage avec l’Anjou,
à fon frere Charles, qui fut depuis roi de Sicile, &
comte de Provence ; enfin , il échut par fucceflion
à Louis X I. & depuis lors, le Maint eft demeuré uni
à la couronne.
C ’eft une bonne province, où l’on trouve des
terres labourables, des coteaux ornés de quelques
vignobles, de jolies collines, des prairies, des forêts
, & des étangs. Ses principales rivières font la
Mayenne, l’Huifne, la Sarte, & le Loir.
Il y a dans le Maine des mines de fe r , deux carrières
de marbre, & plufieurs verreries. Laval a
une ancienne manufafture de toiles fines & blanchies.
Cette province fe divife en haut & bas-Maine ;
elle a fa coutume particulière , & eft du reflbrt du
parlement de Paris.
Entre les gens de lettres qu’elle a produits , c’eft
allez de nommer ici Beion, de la Chambre, la
Croix du Maine, Lami, Merfenne, & Poupart.
Beion (Pie r re ) , a publié lesobfervations qu’il
avoit faites dans les courfes en Grece, en Egypte,
en Arabie, &c. & d’autres écrits fur l’hiftoire naturelle
, qui font rares aujourd’hui. Il fut tué près de
Paris par un de fes ennemis, à l ’âge d’environ 46
ans.M
. de la Chambre, ( Marin Cureau ) , l’un des
premiers des 40 de l’académie françoife, & enfuite
de l’académie des Sciences , fe fit beaucoup de réputation
par des ouvrages qu’on ne lit plus. Il décéda
en 1669 ? à 75 ans.
La Croix du Maine , ( François Gradé de ) eft
uniquement connu par fa bibliothèque françoife,
qu’il mit au jour en 1584. Il fut affaffiné à Tours en
z 592 à la Heur de fon âge.
Lami (Bernard) de l’Oratoire, favant en plus
d’un genre, compofa fes éiémens de mathématiques,
dans un voyage qu’il fit à pié de Grenoble à Paris.
Il eft mort en 1715 , à 70 ans.
Merfenne ( Marie ) minime , ami de Defcartes,
philofophe doux & tranquille, fut un des favans
hommes en plus d’un genre du xvij. fiecle ; il préféra
l’étude & les connoiffances à toute autre chofe ;
fes queftions fur la Genèfe, & fes traités de l’harmonie
& des fons, font de beaux ouvrages. Il mourut
féxagénaire en 1648. Le P. Hilarion de Cofte a
donné fa vie.
w Poupart ( François ) , de l’académie des Sciences,
où il a donné quelques mémoires, cultiva beaucoup
l’hiftoire naturelle, qui eft peut-être la feule phyfi-
que à notre portée. Il vécut pauvre, & mourut tel,
ayant toûjours mieux aimé étudier, que de chercher
à fe procurer les commodités de la vie.
Maine le , ou l a Mayenne , en latin Mtduana,
( Géog. ) riviere de France ; elle a fa fource à Limie-
r e s , aux confins du Maint & delà Normandie, parcourt
la feule généralité de Tours, & fe jette dans
la Loire, à deux lieues au-deflbus du pont de Ce
en Anjou. Il feroit aifé de rendre cette riviere navigable
jufqu’à Mayenne ; & ce feroit une chofe
très-utile, non-feulement pour tout le pa ys , mais
encore pour les provinces de Normandie ôc de Bretagne.
MAINLAND, Minlandia, ( Géog. ) île au nord
de l’Ecoffe, entre celles de Schetland. Elle a environ
20 lieues de long fur cinq de large ; elle eft fertile
, fk bien peuplée fur les côtes. Ses lieux les plus
confidérables font Lerwich & Scallowai : cette île
eft à la couronne britannique. ( D . J. )
MAINOTES, ( Hiß, mod. ) peuples de la Morée ;
ce font les defeendans des anciens Lacédémoniens ,
& ils confervent encore aujourd’hui l’efprit de bravoure
qui donnoit à leurs ancêtres la fupériorité fur
les autres Grecs. Ils ne font guere que 10 à 12 mille
hommes, qui ont conftamment refifté aux Turcs,
& n’ont point encore été réduits à leur payer tribut.
Le canton qu’ils habitent eft défendu par les montagnes
qui l’environnent. Voye^ Cantemir, liißoirt
ottomane.
MAINTENIR , v . aft. ( Gramm. ) c’eft en général
appuyer, & défendre ; il a ce fens au fimple Sc au
figuré ; on maintient la vérité de fon fentiment ; on
fe maintient dans fa religion ; les anciens bâtimens
fe font maintenus en tout ou en partie contre le
fçms.
*'* Ma intenir & garder le ch an ge , ( Vénerie.')
il fe dit des chiens, lorfqu’ils chaffent toûjours la
bête qui leur a été donnée, & la maintiennent dans
le change.
Maintenir fon cheval au galop, ( Manege. ) c’eft
la même chofe qu’entretenir. Voye^ Entretenir.
MAINTENON , ( Géog. ) gros bourg de France
dans la Beauce, fur la riviere'd’Eure, à quatre lieues
de Chartres. Il y a une collégiale & un château : ce
fut près de ce bourg, que Louis XIV. entreprit en
1684, de conduire une partie des eaux de la riviere
d’Eure à Verfailles. Les travaux furent abandonnés
en 1688, & font reftés inutiles. En 1679, le même
prince érigea la terre de Maintenon en marquifat, &
en fitpréfent à Françoife d’Aubigné, qui prit le titre
de marquife de Maintenon, fous iequel elle devint fi
célébré par fa faveur auprès du monarque dont elle
conferva la confiance tant qu’il, v écu t, quoiqu’elle
fût plus âgée que lui. Long, de ce Bourg. /cju lâ.
lat. 48. 3 3 . ( D . J. )
MAINTENUE, f. f. ( Jurifprud. ) eft un jugement
qui conferve à quelqu’un la pofleflion d’un héritage
ou d’un bénéfice.
Ces fortes de jugemens interviennent fur le’pof-
feftoire; le juge maintient & garde en pofleflion
celui qui a le droit le plus apparent.
Lorlque la pofleflion n’eft adjugée que provifoi-
rement, & pendant le procès, cette fimple mainte-
nue s ’appelle récréance.
Mais lorfque la pofleflion eft adjugée définitivement
à celui qui a le meilleur droit, cela s’appelle la
pleine maintenue.
Avant de procéder fur la pleine maintenue, le jugement
de récréance doit être entièrement exécuté.
L’appel d’une fentence de pleine maintenue , n’en
fufpend pas l’exécution.
En matière b én é ficia i, quand le juge royal a adjugé
la pleine maintenue d’un bénéfice fur le vû des
titres, on ne peut plus aller devant le juge d eglif'e
pour le pétitoire. Voye{ Vordonnance de 166y .'‘titre
MmÊ MAINTIEN, f. m. ( Gramm. & Morale. ) il fe dit
de toute l’habitude du corps en repos. Le maintien
féant marque de l’éducation & même du jugement;
il décele quelquefois des vices : il ne faut pas trop
compter fur les vertus qu’il femble annoncer ; il prouve
plus en niai qu’en bien. Maintien fe prend dans
un fens tout-à-fait différent pour les précautions que
l’on emploie, afin de conferver une chofe dans ion
état d’intégrité. Ainfi les juges s’occupent conftamment
au maintien des lois, les prêtres au maintien de
la religion, le juge de police au maintien du bon
ordre & de la tranquillité publique.
MAINUNGEN , ( Géog. ) ville d’Allemagne en
Franconie, fur la W er re, chef-lieu d’un petit état
dont jouit une branche de la maifon de Saxe-Gotha.
Elle eft à trois lieues N. E. d’Henneberg. Long. 28.
10. lat. 3o. 36’. ( D . J. )
MAJOLICA , ( Arts. ) c’eft le nom qu’on donne
en Italie à une efpece de poterie de terre ou de
fayence fort belle qui fe fabrique à Faenza. On dit
que ce nom lui vient de Majolo fon inventeur.
Voye^ Fa yen c e .
MÀJOR, f. m. (Art milité) dans l’art de la guerre
eft un nom donné à plufieurs officiers qui ont différentes
qualités & fondions.
Major g é n é r a l , c’eft un des principaux officiers
de l’armée, fur lequel roulent tous les détails
du fervice de l’infanterie. C ’eft lui qui donne l’or-:
dre qu’il a reçu de l’officier général à tous les majors
des brigades ; il- ordonne les détachemens , & il les
voit partir ; il affigne aux troupes les poftes qu’elles
doivent occuper. Il doit tenir un regiftre exad de
ce que chaque brigade doit fournir de troupes, &
commander les colonels ôdieutenans colonels félon
leur rang. Il doit aufli avoir grande attention que le
pain foit bon, & qu’il ne manque rien aux foldats.
Le major général va au campement avec le maré-
chal-de-camp de jour : il diftribue aux majors des
brigades le terrein que leurs brigades doivent occuper.
Le jour d’une bataille, le major général reçoit du
général le plan de fon armée, pour avoir la diftri-
bution de l’infanterie. Ses fondions dans un fiége
font fort étendues ; il avertit les troupes qui montent
la tranchée, les détachemens, & les travailleurs
; il commande le nombre de fafeines & de gabions
qui convient chaque jou r , & il a foin de faire
fournir généralement tout ce qui eft néceflaire à la
tranchée. Cet emploi demande un officier a â i f , diligent
, expérimenté , & bien entendu en toutes
chofes. On lui paye fix cens livres par mois de 45
jours fans le pain de munition. Il a pour le foula-
ger deux aides majors généraux, & plufieurs autres
aides ; les aides majors généraux font d’anciens officiers
qu’on prend dans l’infanterie ; ils ont cent écus
par mois de campagne ou de 45 jours.
Chaque brigade d’infanterie eft obligée d’envoyer
un fergent d’ordonnance chez le major général : il
s’en fert pour faire porter "aux brigades les ordres
qu’il a à leur donner.
. Cette charge eft de la création de Louis X IV .
elle ne donne point rang parmi les officiers généraux
; mais le major général a toûjours quelque grade
, foit de brigadier, de maréchal-de-camp, ou de
lieutenant général.
Quand le major général vifite les gardes ordinaire
s , & autres détachemens poftés autour de l’armée
ou ailleurs, elles doivent le recevoir étant fous
les armes , mais le tambour ne bat pas.
Major de brigade de cavalerie ou d'infanterie , eft un
officier qui prend l’ordre des majors généraux, &
qui le donne aux majors particuliers des régimens.
C ’eft à lui à tenir la main que les détachemens qu’on
commande de fa brigade foient complets : il doit les
mener au rendez-vous, foit pour les gardes, foit
pour les détachemens ; c’eft lui qui porte l’ordre au
brigadier. Il doit affifter aux diftributions des vivres
qu’on fait aux troupes de fa brigade ; c’eft lui qui
fait faire l’exercice aux troupes dont elle eft çom-
pofée.
Major dans un régiment, eft un officier qui fait
à-peu-près dans le régiment les mêmes fondions que
le major général fait dans toute l’infanterie II eft
chargé de faire les logemens, de pofer & de relever
les gardes, de faire les détachemens, d’aller prendre
l’ordre du major, de le porter au commandant,
& de le donner aux maréchaux des logis de la cavalerie.
Tout major, foit d’infanterie, de cavalerie, ou
de dragons, tient du jour de la date de fa commif-
fion de capitaine, rang avec ceux de fon régiment,
& commande à tous les capitaines reçus après lui.
Les majors doivent tenir la main à l’exécution des
ordonnances concernant la police &c la difeipline.
Ils peuvent vifiter les régimens & compagnies
foit dans les v illes, ou dans le plat pa ys, aufli fou-
vent qu’ils le jugent à propos ; ils affiftent aux revîtes
que les infpeéieurs ou commiffaires en font.
Un major de cavalerie peut fe mettre à la tête de
l’efeadron de fon régiment, & le commander toute
& quantesfois. il le déliré, lorlque fon rang lui en
donne le commandement.
Les majors doivent en campagne tenir un état des
travailleurs, ainfi que des fafeines & gabions que
leur régiment fournit, fuivant le nombre que le ma-
jor général en demande à la brigade, afin que lorf-
qu’ils reçoivent le payement, ils puiflent faire exactement
à chacun le compte de ce qui lui revient.
Ils doivent de plus tenir un contrôle bien exaèfc
des officiers qui marchent aux travailleurs pendant
un fiége, afin que dans un autre on continue le tour ;
les différens mouvemens que les régimens font, n’y
doivent apporter aucun changement.
Ils doivent aufli conferver le contrôle des officiers
qui font du confeil de guerre , afin qu’aucun capitaine
n’en foit- deux fois, qu’après que tous les autres
en auront été une fois chacun, à mefure qu’ils
fe trouveront au corps.
Les majors & aides-majors des régimens vont à
l’ordre chez le major de brigadé, qui le leur diète
avec les détails conçernans le fervice de leur régiment
& ceux que le brigadier a recommandés ; ils
vont enfuite porter le mot à leur colonel ; chaque
aide-major va le porter au commandant de fon ba-
tailLon, & lui fait leèture de l’ordre ; le major ne
porte point le mot au lieutenant-colonel, lorlque le
colonel eft prélent.
Les majors marchent avec leur colonel ; lorfqu’ils
font majors de brigade, le colonel n’a avec lui qu’un
aide- major.
Le major, & en fon abfence l’officier chargé du
détail, tient un contrôlé des officiers du régiment
avec la date de leur commiffion depuis le colonel
jufqu’aux fous-lieutenans, le jour de leur réception,
les charges vacantes , depuis quand & pourquoi ,
fans y comprendre ceux qui n’ont pas été reçus à
leur charge, le nom des officiers a biens , le tems de
leur départ, le lieu de leur demeure, s’ils ont congé
ou non, pour quel tems, & les raifons ; il doit donner
une copie de ce contrôle au commiflaire des
guerres, lors de la première revue & à chaque changement
de garnifon, & une autre copie mois par
mois des changemens arrivés depuis la précédente
revûe.
L’officier chargé du détail, doit écrire compagnie
par compagnie, dans les colomnes marquées fur les
regiftres que la cour envoie à cet effet,.les noms
propres de familles & de guerre des fergens & foldats,
le lieu de leur naiflance, la paroilfe, la province
, la jurifdiâiori, leur âge, leur taille, les marques
qui peuvent fervir à les faire reconnoître, leur
métier, la date de leur arrivée & le terme de leur
enrôlement, en les plaçant fur le regiftre fuivant
leur rang d’ancienneté dans la compagnie : la même