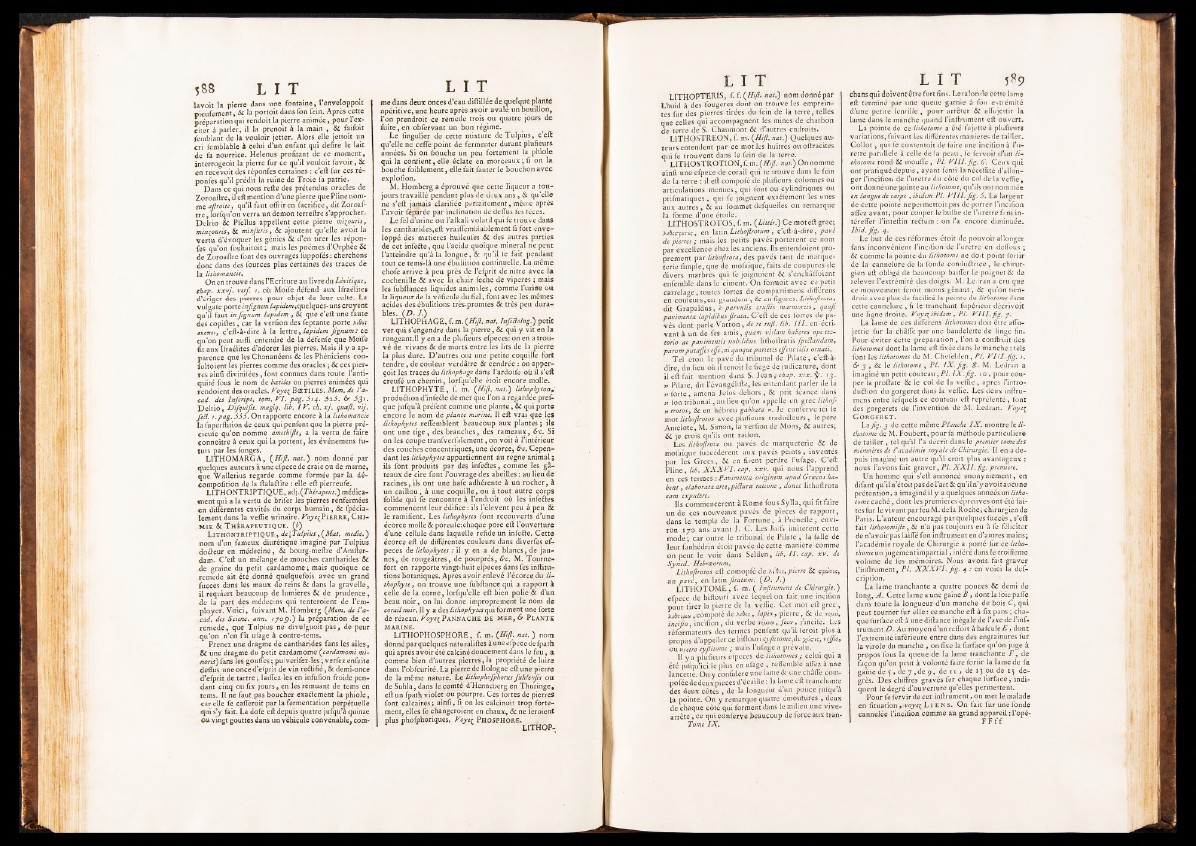
lavoit la pierre dans une fontaine, l’ enveloppoït
pieufement, & la portoit dans fon fein. Après cette
préparation qui rendoit la pierre animée, pour l’ex-
ciier à parler, il la prenoit à la main , 6c faifoit
j'emblant de la vouloir jetter. Alors elle jettoit un
cri l'emblable à celui d’un enfant qui defire le lait
de fa nourrice. Helenus profitant de ce moment,
interrogeoit la pierre fur ce qu’il vouloit favoir, &
en recevoit des réponfes certaines : c’eft fur ces ré-
ponfes qu’il prédit la ruine de Troie fa patrie.
Dans ce qui nous relie des prétendus oracles de
Zoroaftre, il eft mention d’une pierre que Pline nomme
aftroite, qu’il faut offrir en facrifice, dit Zoroaftre
, lorfqu’on verra un démon terreftre s’approcher.
Delrio & Pfellus appellent cette pierre miçouris,
minzpuris, & minfuris, 6c ajoutent qu’elle avoit la
vertu d’évoquer les génies 6c d’en tirer les réponfes
qu’on fouhaitoit ; mais les poëmes d’Orphee 6c
de Zoroaftre font des ouvrages fuppofés : cherchons
donc dans des fources plus certaines des traces de
la lithomancie.
On en trouve dans l’Ecriture au livre du Lévitique,
,ekap. xxvj. verf. i. oit Moïfe défend aux Ifraélites
d’ériger des pierres pour objet de leur culte. La
vulgate porte infignem quelques-uns croyent
qu’il faut in Jignum lapidem , 6c que c’eft une faute
des copiftes, car la verfion des feptante porte A<floç
wnovt c’eft-à-dire à la lettre, lapidem Jignum : ce
qu’on peut aufli entendre de la défenfe que Moïfe
fit aux Ifraélites d’adorer les pierres. Mais il y a apparence
que les Chananéens 6c les Phéniciens con-
fultoient les pierres comme des oracles ; & ces pier-
Tes ainfi divinifées, font connues dans toute l’antiquité
fous le nom de boetiUs ou pierres animées qui
rendoient des oracles. Voyt{ B oe t i l e s . Mem. de Va-
Cad. des Infcript. tom. VI. pag. J14. 5 x5 . 6* 5j i .
Delrio, Difquifit. magiq. lib. IV . ch. x j. qutefi. vij.
fecl. t.pag. 555. On rapporte encore à la lithomancic
la fuperftition de ceux qui penfent que la pierre pré-
cieufe qu’on nomme amethifie, a la vertu de faire
connoître à ceux qui la portent, les événemens futurs
par les fonges.
LITHOMARGA, (Hifi. hat.) nom donné par
quelques auteurs à une efpece de craie ou de marne,
que Wallerius regarde comme formée par la dé-
compofition de la ftalaélite : elle eft pierreufe.
LtTHONTRIPTIQUE, adj.(Tkérapcuc.) médicament
qui a la vertu de brifer les pierres renfermées
en différentes cavités du corps humain, 6c fpécia-
lement dans la veflie urinaire. J'qyqTiERRE, C him
ie & T hér apeutique. (b)
L ithon tript iq ue , de | Tulpius, (Mat. medic. )
nom d’un fameux diurétique imaginé par Tulpius
doéleur en médecine, 6c bourg-meftre d’Amfter-
dam. C ’eft un mélange de mouches cantharides &
de graine du petit cardamome ; mais quoique ce
remede ait été donné quelquefois avec un grand
fuccès dans les maux de reins 6c dans la gravelle,
il requiert beaucoup de lumières 6c de prudence,
de la part des médecins qui tenteroient de l’employer.
V oici, fuivant M. Homberg (Mem. de l'a-
-cad. des Scienc. ann. i jo g .) la préparation de ce
remede., que Tulpius ne divulguoit pas, de peur
qu’on n’en fît ufage à contre-tems.
Prenez une dragme de cantharides fans les aîles,
&ome dragme du petit cardamome (cardamomi mi-
tioris) fans les gouffes ; pulverifez-les ; verfez enfuite
deffus -.une once d’efprit de vin reélifié, & demi-once
d’efprk de tartre ; Iaiffez-les en infufion froide pendant
cinq ou fix jours, en les remuant de tems en
tems. Il ne faut pas boucher exactement la phiole,
•car elle fe cafferoit par la fermentation perpétuelle
•qui s’y fait. La dofe eft depuis quatre jufqu’à quinze
ou vingt gouttes dans un véhicule convenable, comme
dans deux onces d’eau diftiliée de quelque planté
apéritive, une heure après avoir avale un bouillon,
l’on prendroit ce remede trois ou quatre jours de
fuite, en obfervant un bon régime.
Le fingulier de cette mixture de Tulpius, c’eft
qu’elle ne celle point de fermenter durant plufieurs
années. Si on bouche un peu fortement la phiole
qui la contient, elle éclate en morceaux ; fi on la
bouche foiblement, elle fait fauter le bouchon avec
explofion.
M. Homberg a éprouvé que cette liqueur a toujours
travaillé pendant plus de deux ans, & qu’elle
ne s’eft jamais clarifiée parfaitement, même après
l’avoir fé{!§rée par inclination de deffus fes fèces.
Le fel d’urine ou l’alkali volatil qui fe trouve dans
les cantharides,eft vraiffemblablement fi fort enveloppé
des matières huileufes 6c des autres parties
de cet infeéte, que l’acide quoique minerai ne peut
l ’atteindre qu’à la longue, & qu’il le fait pendant
tout ce tems-là une ébullition continuelle. La même
chofe arrive à peu près de l’efprit de nitre avec la
cochenille 6c avec la chair feche de viperes ; mais
les fubftances liquides animales, comme l’iirirte ou
la liqueur de la véficule du fiel, font avec les mêmes
acides des ébulitions très-promtes & très-peu dura-,
blés. (D . J.)
LITHOPHAGE, f.m. (Hiß. nat. Infeclolog.) petit
ver qui s’engendre dans la pierre, 6c qui y vit en la
rongeant.il y en a de plufieurs efpeces: on en a trouvé
de vivans & de morts entre les lits de la pierre
la plus dure. D ’autres ont une petite coquille fort
tendre, de couleur verdâtre & cendrée : on apper-
çoit les traces du Lithophage dans l'ardoife où il s’eft
creufé un chemin, lorfqu’elle étoit encore molle.
LITHOPHYTE, f. m. (Hiß. nat.') lithophyton*
production d’infeCte de mer que l’on a regardée prêt-
que jufqu’à préfent comme une plante, 6c qui porte
encore le nom de plante marine. Il eft vrai que les
lithophytes reffemblent beaucoup aux plantes ; ils
ont une tige, des branches, des rameaux, &c. Si
on les coupe tranfverfalement, on voit à l’intérieur
des couches concentriques, une écorce, &c. Cependant
les lithophytes appartiennent au regne animal ;
ils font produits par des infeétes, comme les gâteaux
de cire font l’ouvrage des abeilles : au lieu de
racines, ils ont une bafe adhérente à un rocher, à
un caillou, à une coquille, ou à tout autre corps
folide qui fe rencontre à l’endroit où les infeétes
commencent leur édifice : ils l’élevent peu à peu &
le ramifient. Les lithophytes font recouverts d’une
écorce molle & poreuferchaque pore eft l’ouverture
d’une cellule dans laquelle refide un infeéte. Cette
écorce eft de différentes couleurs dans diverfes efpeces
de lithophytes : il y en a de blancs, de jaunes,
de rougeâtres, de pourprés, &c. M. Tourne-
fort en rapporte vingt-huit efpeces dans fes inftitu-
tions botaniques. Après avoir enlevé l’écorce du //-
thophyte, on trouve une fubftancequi a rapport à
celle de la corne, lorfqu’elle eft bien polie & d’un
beau noir, on lui donne improprement le nom de
corail noir. Il y a des lithophytes qui forment une forte
de rézeau. Voye^ P a n n a c h e d e m e r , & P l a n t e
m a r i n e .
LITHOPHOSPHORE, f. m. (Hiß. nat. ) nom
donné par quelques naturaliftes à une efpece de fpath
qui après avoir été calciné doucement dans le feu, a
comme bien d’autres pierres, la propriété de luire
dans l’obfcurité. La pierre de Bologne eft une pierre
de la même nature. Le luhophofphorus fuhlenfis ou
de Suhla, dans le comté d’Henneberg en Thuringe,
eft un fpath violet ou pourpre. Ces fortes de pierres
font calcaires ; ainfi, fi on les calcinoit trop fortement,
elles fe changeroient en chaux, 6c ne feroient
plus phofphoriques. Voyez Phosphore.
LITHOPUTHOPTËRIS,
{ .f. (Hiß. nat.) nom donné par
Lhuid à des fougères dont on trouve les empreintes
fur des pierres tirées du fein de la terre, telles
que celles qui accompagnent les mines de charbon
de terre de S. Chaumont 6c d’autres endroits.
LITHOSTREON, f. m. (Hiß. nat.) Quelques auteurs
entendent par ce mot les huîtres ouoftracites
qui fe trouvent dans le fein de-la terre.
LITHOSTROTION, f. m. (Hiß. nat.) On nomme
ainfi une efpece de corail qui te trouve dans le fein
de la terre : il eft compofé de plufieurs colonnes ou
articulations menues, qui font ou cylindriques ou
prifmatiques, qui fe joignent exactement les unes
aux autres, & au fommet defqueiles on remarque
-la forme d’une étoile.
LITHOSTROTOS, f.m. (Littér.) C e moteft grec;
À/floç-poToc, en latin Lithoflrotum, c’eft-à-dire, pavé
de pierres; mais-les petits pavés portèrent ce nom
par excellence chez les anciens. Ils entendoient proprement
par lithoßrota, des pavés tant de marqueterie
fimple, que de mofaïque, faits de coupures de
divers marbrés, qui fe joignoient 6c s’enchâffoient
enfemble dans le ciment. On formoit avec ce petit
carrelage, toutes fortes de compartimens difterens
en couleurs,en grandeur, & en figures. Lithoßrota,
dit Grapaldus, è parvulis crufiis marmoreis, quafi
pavimenta lapidibusßrata. C eft de ces fortes de pavés
dont parle Varron, de re ruß. lib. I II. en écrivant
à un de fes amis, quam villam höheres ope tec-
torio ac pavimentis nobtlibus lithoftratis fptclandam,
parumputaßes ejfe,ni quoqueparûtes ejfitnt illis ornati.
Tel étoit le pavé du tribunal de Pilate, c’eft-à-
dire, du lieu où il tenoit le fiege dé judicature, dont
il eft fait mention dans S. Jean $chap. xix. ÿ . f y .
» Pilate, dit l’évangélifte, les entendant parler de la
» forte, amena Jefus dehors , 6c prit féance dans
fon tribunal, au.lieu qu’on appelle en grec lithof-
» trotos, 6c en hébreu gabbata ». Je conferve ici le
mot lithofirotos avec plufieurs traduâeurs, le pere
Amelote, M. Simon, la verfion de Mons, 6c autres;
6c je crois qu’ils ont raifon.
Les lithoßrota ou pavés de marqueterie 6c de
mofaïque luccéderent aux pavés peints, inventés
par les Grecs, 6c en firent perdre l’ufage. C ’eft
Pline, lib. X X X V I . cap. xxv. qui nous l’apprend
en ces termes.: Pavimenta originem apud Grtecos ha-
bent, elaborata artetpiclur<e ratione , donec lithoftrota
eam expulere.
Ils commencèrent à Rome fous Sylla, qui fit faire
un de çes nouveaux pavés de pièces de rapport,
dans le temple de la Fortune, à Prénefte, environ
170 ans avant J. C. Les Juifs imitèrent cette
mode; car outre le tribunal de Pilate , la falle de
leur fanhédrin étoit pavee de cette maniéré comme
on peut le voir dans Seiden, lïb. I I . cap. xv. de
Syned. Hebroeorum.
Lithofirotos eft comopfé de */ôoç, pierre 6c ç-pdroc,
Un pavé, en latin ßratum. (D . J.)
LITHOTOME, f. m. (^Infiniment de Chirurgie.)
efpece de biftouri avec lequel on fait une incifiori
pour tirer la pierre de la veflie. Cet mot eft grec ,
SviÔTo/*«, compolé de X<8oç, lapis, pierre & de ™/«i,
incifio, incifion, du verbe ri'p®, /£c» ,\j’incife. Les
réformateurs des termes penfent qu’il ièroit plus à
-propos d’appel 1er ce Wxüoun cyfiitome^a vefiîe,
ou urttro cyfiitome ; mais l’ufage a prévalu. ^ .
Il y a plufieurs .efpeces de lithotomes ; celui qui a
été jufqu’ici le plus en ufage , reflemble affez à une
lancette. On y confidere une lame & une châfl'e com-
pofée de deux pièces d’écaille : la lame eft tranchante
des deux côtés , de la longueur.d’un pouce jufqu’à
la pointe. On y remarque quatre emoutures , deux
de chaque côté qui forment dans le milieu une vive-
arrête, ce qui conferye beaucoup de force aux tràn-
Tome IX ,
chansqui doivent être fort fins. Le talon de cette lame
eft terminé par une queue garnie à fon extrémité
d’une petite lentille, pour arrêter 6c affujettir la
lame dans le manche quand J’inftrument eft ouvert.
La pointe de ce lithotome a été fujette à plufieurs
variations, fuivant les différentes maniérés de tailler.
C o llo t , qui fe conrentoit de faire une incifion à l’u-
retre parallèle à celle de la peau, fe fervoit d’un //-
thotome rond & moufle , PL VIII. fig. G. Ceux qui
ont pratiqué depuis, ayant lenti la néceflité d’allonger
Fincifion de l’uretre du côté du col dé la veflie,
ont donné une ppinte au lithotome, qu ils ont nommée
en langue de carpe , ibidem PL VIII. fig. 5. La largeur
de cette pointe nepermettoit pas de porter l’incifion
affez avant, pour couper le bulbe de l’uretre fans in-
"téreffer l’inteftin reôum : on l’a encore diminuée.
Ibid. f ig . 4.
Le but de ces réformes étoit de pouvoir allonger
fans inconvénient l’incifion de l’uretre en deffous ;
6c comme la pointe du lithotome ne doit point lôrtir
de la cannelure de la fonde conduôrice , le chirurgien
eft obligé de beaucoup baiffer le poignet & de
relever l’extrémité des doigts. M. LeJran a cru que
ce mouvement feroit moins gênant, 6c qu’on tien-
droit avec plus de facilité la pointe du lithotome dans
cette cannelure , fi le tranchant fupérieur décrivoit
une ligne droite. Voye^ibidem , Pl. VIII.fig. y.
La lame de ces différens .lithotomes doit être affù-
jettie fur la châffe par une bandelette de linge fin.
Pour éviter cette préparation , l’on a conftruit des
lithotomes dont la lame eft fixée dans le manche : tels
font les lithotomes de M. Chelelden, Pl. VIH.fig. 1,
& j , 6c le lithotome , P L IX . fig. 8. M. Ledran a
imaginé un petit couteau, PL IX. fig. 10, pour couper
la proftate 6c le col de la veflie , après l’intro-
duftion du gorgeret dans la veffie. Les deux inftru-
mens entre lefquels ce couteau eft reprélenté, font
des gorgerets de l’invention de M. Ledran. Voyeç
G o r g e r e t .
La fig. 3 de cette meme Planche IX . montre le //-
thotome de M. Foubert, pour fa méthode particulier«
de tailler , tel qu’il l’a décrit dans le premier tome des
mémoires de l'académie royale de Chirurgie. Il en a depuis
imaginé un autre qu’il croit plus avantageux:
nous l’avons fait graver, Pl. X X I I . fig. première.
Un homme qui s’eft annoncé anonymement,: en
difant qu’il n’étoit pas de l’art & qu’il n’y a^voit aucune
prétention, a imaginé il y a quelques années un lithotome
caché, dont les premières épreuves ont été faites
fur le vivant par feu M. delà Roche, chirurgien de
Paris. L’auteur encouragé par quelques fuccès, s’eft
fait lithotomifie, & n’a pas toujours eu à fe féliciter
de n’avoir pas Iaiffé fon inftrument en d’autres mains;
l’académie royale de Chirurgie a porté fur ce litho-
thome un jugement impartial, inféré dans le troifieme
volume de fes mémoires. Nous avons, fait graver
l’inftrument, Pl. X X X V I . fig. 4 : en voici la def-
cription.
La lame tranchante a quatre pouces 6c demi de
long, A . Cette lame aune gaîne B , dont la foie paffe
dans toute la longueur d’un manche de bois C, qui
peut tourner fur elle : ce manche eft à fix pans ; chaque
furface eft à une diftance inégale de l’axe de l’inftrument
Z?. Au moyen d’un reffort àbafcule-f, dont
l’extrémité inférieure entre dans des engrainures fur
la virole du manche , on fixe la furface qu’on juge à
propos fous la queue de la lame tranchante F 9 de
façon qu’on peut à volonté faire fortir la lame de fa
gaîne de 5 , de 7 , de 9 , de 11 , de 13 ou de 15 degrés.
Des chiffres gravés fur chaque furface, indiquent
le degré d’ouverture qu’elles permettent.
Pour fe fervir de cet inftrument, on met lé malade
en fituation , voye[ L i e n s . On fait fur une fonde
cannelée l’incifion comme au grand appareil : l’opé-
F F f f